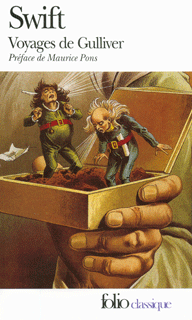>
Critique de JulienDjeuks
Dans un premier niveau de lecture, les Voyages de Gulliver apparaissent comme une fable rabelaisienne, où la caricature vire à la farce, où la grossièreté se mêle à un aspect critique, politique, philosophique. Les voyages extraordinaires de Gulliver rappellent par leur facture les aventures de Sindbad le marin, intégrées aux Mille et Une Nuits d'Antoine Galland (publiées au début du siècle), mais le merveilleux et l'aventure ne sont qu'un prétexte pour une prise de recul et une réflexion sur la condition humaine.
Dans la lignée des Lettres persanes de Montesquieu, Swift utilise le décentrement du regard pour offrir une critique de plus en plus mordante de la civilisation humaine. Il commence par faire observer une micro-société – comme à l'échelle des fourmis – pour émettre une critique des institutions, comme les religions et l'autoritarisme des monarques qui entraînent des guerres stupides pour des causes sans importances ou d'ordre privé. Dans un second temps, Swift montre comme la beauté du corps humain est elle aussi relative, question de formation de l'oeil, corps beaucoup moins admirable une fois passé à la loupe. le troisième grand voyage de Gulliver permet à Swift de s'attaquer aux dérives intellectuelles et scientifiques, à leur manque de considération pour la vie concrète – perdus dans leurs pensées dans une invention farfelue, sans capacité d'écoute, sans un regard pour la situation concrète des pauvres, cocufiés par leurs femmes… Swift s'attaquant au passage au fantasme de l'immortalité et aux grands hommes de l'histoire, objectifs et fondements d'un scientisme et d'un positivisme (encore d'actualité avec le transhumanisme d'un Bill Gates), se rapproche en fait moins des conservateurs que de l'historiographie moderne (qui regarde moins les grands hommes que les structures), et que des critiques de la technologie du XXe siècle comme Günther Anders ou Ivan Illich.
En offrant une comparaison entre diverses sociétés plus ou moins élaborées, Swift donne clairement sa préférence pour les moins élaborées d'un point de vue civilisationnel – celle plus animale des Houyhnhnms chevalins, celle des géants, toutes deux plus agricoles, plus lentes –, mais pas forcément les moins fines quant à la sagesse et à la faculté de cette société à collaborer. On peut ainsi lire comme un regard écologique avant l'heure, une envie de retour à la terre, à la vie simple, à la vie en communauté…
N'empêche qu'il domine à la fin de l'oeuvre un certain pessimisme sur la nature humaine, un dégoût, les vices des Yahoos, ces êtres humains sauvages, semblent être inscrits dans la nature humaine : regard sur l'autre, jalousie, égoïsme, brutalité… le mythe du bon sauvage est écarté au passage, l'être humain n'est pas bon de nature, une certaine civilisation et l'utilisation de la raison permettent à l'Homme un certain assouplissement de sa nature mauvaise. Mais loin d'aller vers un perfectionnement continu, l'Homme retombe régulièrement dans ses travers. L'Homme est-il un danger pour la nature et pour la planète ? Une espèce nuisible et irrécupérable ? Ou bien y a-t-il encore des possibilités pour aller vers la sagesse ? Quand on regarde les sociétés appréciées par Swift, ce sont des sociétés où dominent la sagesse, l'entraide, l'ordre collectif, la vie en harmonie avec la nature, la lenteur, le dialogue… La science, les technologies, l'intelligence, ne sont en fait que des illusions qui maintiennent le cap vicieux de l'Homme.
Lien : https://leluronum.art.blog/2..
Dans la lignée des Lettres persanes de Montesquieu, Swift utilise le décentrement du regard pour offrir une critique de plus en plus mordante de la civilisation humaine. Il commence par faire observer une micro-société – comme à l'échelle des fourmis – pour émettre une critique des institutions, comme les religions et l'autoritarisme des monarques qui entraînent des guerres stupides pour des causes sans importances ou d'ordre privé. Dans un second temps, Swift montre comme la beauté du corps humain est elle aussi relative, question de formation de l'oeil, corps beaucoup moins admirable une fois passé à la loupe. le troisième grand voyage de Gulliver permet à Swift de s'attaquer aux dérives intellectuelles et scientifiques, à leur manque de considération pour la vie concrète – perdus dans leurs pensées dans une invention farfelue, sans capacité d'écoute, sans un regard pour la situation concrète des pauvres, cocufiés par leurs femmes… Swift s'attaquant au passage au fantasme de l'immortalité et aux grands hommes de l'histoire, objectifs et fondements d'un scientisme et d'un positivisme (encore d'actualité avec le transhumanisme d'un Bill Gates), se rapproche en fait moins des conservateurs que de l'historiographie moderne (qui regarde moins les grands hommes que les structures), et que des critiques de la technologie du XXe siècle comme Günther Anders ou Ivan Illich.
En offrant une comparaison entre diverses sociétés plus ou moins élaborées, Swift donne clairement sa préférence pour les moins élaborées d'un point de vue civilisationnel – celle plus animale des Houyhnhnms chevalins, celle des géants, toutes deux plus agricoles, plus lentes –, mais pas forcément les moins fines quant à la sagesse et à la faculté de cette société à collaborer. On peut ainsi lire comme un regard écologique avant l'heure, une envie de retour à la terre, à la vie simple, à la vie en communauté…
N'empêche qu'il domine à la fin de l'oeuvre un certain pessimisme sur la nature humaine, un dégoût, les vices des Yahoos, ces êtres humains sauvages, semblent être inscrits dans la nature humaine : regard sur l'autre, jalousie, égoïsme, brutalité… le mythe du bon sauvage est écarté au passage, l'être humain n'est pas bon de nature, une certaine civilisation et l'utilisation de la raison permettent à l'Homme un certain assouplissement de sa nature mauvaise. Mais loin d'aller vers un perfectionnement continu, l'Homme retombe régulièrement dans ses travers. L'Homme est-il un danger pour la nature et pour la planète ? Une espèce nuisible et irrécupérable ? Ou bien y a-t-il encore des possibilités pour aller vers la sagesse ? Quand on regarde les sociétés appréciées par Swift, ce sont des sociétés où dominent la sagesse, l'entraide, l'ordre collectif, la vie en harmonie avec la nature, la lenteur, le dialogue… La science, les technologies, l'intelligence, ne sont en fait que des illusions qui maintiennent le cap vicieux de l'Homme.
Lien : https://leluronum.art.blog/2..