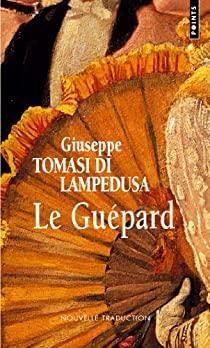>
Critique de Erik35
À LA TOUTE FIN, L'ÉTERNITÉ.
Nous sommes en Juillet 1957. Un homme presque totalement inconnu du public vient de rendre l'âme, il n'avait que 60 ans. Dans son testament rédigé fin mai de la même année - l'homme se savait atteint d'un cancer du poumon - voici, entre autre, ce que ces proches découvrent :
«Je désire que tout ce qui est possible soit fait pour que le "Guépard" soit publié (le texte valable est celui qui a été recueilli dans un seul manuscrit) ; cela ne signifie pas évidemment qu'il doit être publié aux frais de mes héritiers ; je considérerai cela comme une grande humiliation. [...]»
L'ultime voeu de cet homme un peu étrange, relativement reclus, fin lettré passionné de littérature anglaise et française (langues qu'il connaissait à la perfection), donnant à quelques jeunes étudiants, sur les dernières années de sa vie, des genres de leçons particulières consacrées à ses auteurs favoris (Shakespeare, Byron, Flaubert et, surtout, Stendhal), n'ayant jusque-là que quelques rares textes publiés, pour l'essentiel des critiques, cet ultime voeu, le Prince Giuseppe Tomasi di Lampedusa ne le verra donc pas de son vivant à quelques trois malheureux mois prêt. Pas plus qu'il n'aura connu la gloire incommensurable, tant populaire que critique, que ce texte écrit tardivement mais dans une certaine urgence obtiendra tant en Italie qu'à l'international, succès dont il faut admettre qu'il fut encore plus éclatant après le succès du film de Luchino Visconti, Palme d'Or à Cannes en 1963, demeurant d'ailleurs sans aucun doute la réalisation la plus fameuse du cinéaste italien. (Pour la petite histoire, jamais un roman italien n'avait obtenu un tel succès dans son propre pays depuis cent ans. Il faudra attendre le Nom de la rose d'Umberto Eco, en 1980, pour atteindre de tels scores d'édition !).
Mais que peut bien cacher un tel roman pour obtenir un tel déluge de superlatifs, un tel succès, une telle reconnaissance tant par les lecteurs que par la critique académique - ce qui est, reconnaissons-le, un phénomène des plus rares - ?
Tout d'abord, une histoire servie par un homme en tout point fascinant : Don Fabrizio Salina, éminent prince d'une Sicile connaissant les grands bouleversements politiques et sociaux de son époque - les années 1860 - et surtout, de la future nation italienne avec les tourments révolutionnaires du "risorgimento" (mot que l'on peut traduire par "renaissance" ou "résurrection"), voulue de longue date par le Comte de Cavour, sous l'égide du futur roi Victor-Emmanuel II aidé de son bras armé (surtout en ce qui concerne le Royaume de Sicile), le célèbre Garibaldi. Ainsi, cet homme déjà entré dans ce qu'il est coutume de nommer "la force de l'âge" a-t-il déjà une longue expérience des êtres, et une immémoriale histoire derrière lui (sa famille serait née des ébats d'un empereur romain !). Personnage à la stature imposante «Non qu'il fût gros : il n'était qu'immense et très fort ;[...]», «le teint rosé, les poils couleur de miel», se décrivant lui-même comme un détonnant mélange d'origine germanique, autoritaire, hautain et cédant aux délices de l'intellectualisme, par sa mère, de «sensualité et de laisser-aller» par son père sicilien, «le Prince Fabrizio vivait dans un mécontentement perpétuel, malgré son regard jupitérien courroucé, et il contemplait la ruine de sa classe et de son patrimoine sans rien faire pour y porter remède ni en avoir la moindre envie». Voila comment nous est présenté, dès les premières pages, cet homme dont nous allons suivre, avec délectation, avec une incroyable attention, les pensées les plus intimes, les engouements et les détestations, les longs et puissants moments de contemplation - le Prince n'est-il pas un astronome reconnu de ses pairs, ses talents de scientifique lui ayant même valu, jadis, la remise d'une médaille d'honneur par le grand savant et homme d'état français François Arago -. Car il est ainsi, Don Fabrizio : les pieds et l'ironie bien sur cette terre mais les pensées proches des étoiles.
Dès la première scène - la fin de la récitation du rosaire - de la première partie, qui a lieu en mai 1860, di Lampedusa nous emporte, avec une maestria invraisemblable, dans ce petit royaume en perpétuel déclin, en état de déréliction presque imperceptible mais pourtant si présente tout au long de l'ouvrage. Ainsi en est-il, dans les quelques pages qui suivent la présentation de cet hôte colossal, de la description, fascinante, du jardin de la propriété, pas totalement à l'abandon, pas non plus absolument impeccable, et où la nature semble cependant reprendre peu à peu ses droits. Apparaît d'ailleurs dès l'incipit une sorte de méta personnage, un chien, un immense et jeune dogue répondant au nom de Bendicò qui apparaîtra bientôt comme le seul élément simplement gai et heureux de cette histoire épique, qui ponctuera régulièrement certaines des scènes les plus importantes de l'ouvrage, jusqu'à son ultime conclusion, mais n'allons pas trop vite.
Très vite les personnages principaux du roman vont nous être présentés, la plupart du temps sous le regard mordant, cynique et désabusé de Don Fabrizio, de temps à autres par le biais d'un narrateur extérieur omniscient - ne serait-ce que pour permettre l'existence de moments dans lesquels le Prince n'apparaît pas en personne. Souvent pour donner un autre angle à ce que l'histoire intériorisée par le principal personnage nous fait découvrir, parfois pour prolonger le temps de l'histoire avec des temps plus contemporains, souvent pour appuyer encore un peu plus sur le décadentisme irréversible de ce qui est décrit -. Il y a, bien entendu, les proches immédiats : Stella, l'épouse très pieuse, glaciale, trompée (qui n'a, soyons sincère, qu'un rôle très secondaire). Les enfants, à commencer par Concetta, l'une des trois filles, jeune demoiselle soumise à son père, naïve, facilement revêche mais sans méchanceté ni calcul, l'exacte antithèse de l'autre jeune femme du roman. Il y a les fils, à commencé par l'aîné, Paolo, pour lequel son père n'a qu'une sympathie très mesurée, le trouvant mou, lourd, sans grandeur ni vision, n'aimant guère que la compagnie des chevaux (dont, ironie sublime, il mourra) lui-même étant pour ainsi dire l'antithèse de l'autre personnage essentiel, quoi que légèrement décalé narrativement parlant, du Guépard, le jeune Prince Tancrède, son neveu désargenté mais ambitieux, fin, drôle de cette ironie qui plait tant à cet oncle terrible ; pour le dire en un seul mot : aristocratique, comme lui l'est, sans doute l'un des derniers de son clan, de sa race, de son temps. Avec ce petit quelque chose que le prince vieillissant n'a pas, n'a plus : une ambition politique absolument dévorante, dont on comprendra vers la fin qu'elle fut plus forte que son ménage avec sa sublissime épouse...
Car l'époque est aux grands bouleversement, dans cette péninsule cis-alpine en mal de rassemblement. Déjà, l'ancien Royaume de Sardaigne a-t-il adopté une constitution de type libérale en 1848. Mais c'est le débarquement des "Mille" sous les ordres de Giuseppe Garibaldi, les fameuses "Chemises rouges", qui accélérera, dans cette Sicile royale, le mouvement révolutionnaire déjà à l'oeuvre sur le continent. L'intelligence de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, concernant ces moments connus et reconnus de tout italien qui se respecte, c'est de n'avoir évoqué, abordé ces faits historiques d'importance que par le biais de digressions, parfois d'évocations anodines au cours d'une conversation, à d'autre instants par l'arrivée brutale et tout aussi brutalement résumé des conséquences immédiates de ces troubles ; ainsi de ce jeune soldat royaliste trouvé mort dans le jardin de la propriété princière. Parce que le Guépard n'est pas un roman historique - mais bien plutôt se penche sur les conséquences de faits historiques, sur L Histoire en général, et leurs répercussions sur des histoires particulières - il évite ainsi les travers factuels de ce type d'oeuvre, l'ouvrant à un universel auquel un texte contant les péripéties et autres batailles des uns ou des autres lors cette période n'aurait probablement pas pu prétendre. Car si Lampedusa use, avec une finesse étonnante, toujours étincelante, de ces moments cruciaux de l'Histoire moderne de l'Italie, c'est d'abord, et même avant tout, pour nous faire toucher d'aussi près que possible les états d'âme languides mais cyniques d'un grand sceptique, mêlant une certaine apathie à l'impossibilité de jamais vraiment pouvoir exprimer la moindre vraie colère - tandis que le personnage est incroyablement colérique ! -, la moindre réaction vive face à ce monde qui s'écroule sous ses yeux (ce qu'il voit, sait, comprend), mais aussi, d'une certaine manière, en son propre for intérieur, nous faisant approcher d'une manière rarement atteinte en littérature les soubresauts, les supplices de l'angoisse lorsqu'elle tend à l'existentiel. La sixième partie de l'ouvrage, modestement intitulée "La fin du prince" en est un exemple sublime, palpitant, d'une émotion inouïe autant que surprenante rarement lue par ailleurs.
Toute l'intelligence, le raffinement, l'intuition de di Lampedusa de ce monde en décapilotade apparaît à travers ce personnage ainsi que par le biais de binôme, parfois en bonne intelligence comme celui formé par Don Fabrizio et Tancredi, s'excerçant plus souvent par le biais de rapports presque strictement antithétiques comme c'est le cas entre le Prince et le futur beau-père de Tancrède, Calogero Sedàra, le prototype de l'homme nouveau dans cette atmosphère de fin du monde, de fin d'UN monde qui peine à l'admettre malgré les évidences, Sedàra, un homme roué, malin, intelligent même, mais qui confond beauté et valeur pécuniaire de cette beauté, un être que l'on ne peut même pas qualifier de vil, tant son destin et ses entreprises semblent clairs comme de cette eau pourtant si rare en Sicile - à moins qu'elle ne se mette subitement à tomber sans discontinuer sous forme d'orage cataclysmique -, un parfait homme d'affaire, fils d'un paysan illettré et repoussant, tout dévoué au culte de Mammon, aujourd'hui on parlerait sans aucun doute d'un parvenu ; seulement cet homme-là est le père heureux d'une merveille, sa fille - qui réalise un autre binôme, toujours dans l'antithèse exacte, avec Concetta, Angelica au prénom prédestiné - même si angélique elle est loin de l'être tout à fait - et plutôt que de tenter de la décrire, avec maladresse, laissons l'auteur nous présenter sa première apparition dans le salon du château princier de Donnafugata :
«L'instant dura cinq minutes ; puis la porte s'ouvrit et Angelica entra. La première impression fut de surprise éblouie. Les Salina restèrent le souffle coupé ; Tancredi senti même battre les veines de ses tempes. Devant l'impétuosité de sa beauté les hommes furent incapables d'en remarquer, en les analysant, les défauts qui n'étaient pas rares ; et nombreuses étaient les personnes qui ne seraient jamais capables de cette élaboration critique. Elle était grande et bien faite, sur la base de critères généreux ; sa carnation devait posséder la saveur de la crème fraîche à laquelle elle ressemblait, sa bouche enfantine celle des fraises. Sous la masse des cheveux couleur de nuit enroulés en d'exquises ondulations, il y avait l'aube de ses yeux verts, immobiles comme ceux des statues et, comme eux, un peu cruels. Elle avançait lentement, en faisant tournoyer sa large jupe blanche et portait sur sa personne la sérénité, l'invincibilité de la femme sûre de sa beauté. Ce n'est que bien des mois plus tard que l'on sut qu'au moment de son entrée triomphale elle avait été sur le point de s'évanouir d'anxiété.»
Le lecteur remarquera sans doute, au passage, que Lampedusa ne dit finalement pas tant ce qu'est cette beauté : la carnation de la peau et des lèvres, sa chevelure, ses yeux un peu plus ; une démarche. Il n'omet pas même une certaine réalité : qu'elle n'est pas une pure perfection. Mais, quand bien même nous n'assistons pas directement à cette scène d'où le temps semble s'être d'ailleurs un instant retiré, les impressions, les regards des autres - soyons francs : des hommes pour l'essentiels - , par lesquels nous admirons Angelica nous donnent plus à imaginer qu'aucune description complète de ce physique n'aurait jamais pu le faire. Si le lecteur s'est laissé subjuguer, au détour de ces quelques lignes extraites du roman, par cette évanescente beauté apparue dans la torpeur d'un salon mondain, exprimé par ce style qui prend son temps, tout en évoquant beaucoup, qu'il imagine seulement l'effet que peuvent avoir quelques trois cent pages de ce niveau, de cette sidération permanente, de, osons l'affirmer, ce chef d'oeuvre absolu d'une densité rare, d'une tension permanente dans son apparente ataraxie, un roman où les réflexions les plus fondamentales sur le pouvoir, sur la beauté, sur la politique, sur le temps qui passe, sur les rapports entre hommes et femmes, sur les buts mêmes d'une existence, sur la mort, peuvent surgir d'une simple et champêtre scène de chasse, de quelques instants de songerie dans le creux d'un canapé, d'une discussion à bâtons rompus avec un émissaire de la jeune Monarchie Constitutionnelle, etc.
Les grands textes contant la fin d'une époque, la fin d'un monde, de tout un monde, ne sont pas si rares. Quelques-uns atteignent au génie - nous pensons plus précisément à ce roman incontournable de la "Mittel Europa" naissante, "La Marche de Radetzky" du grand écrivain autrichien (mort en 1939 à Paris, presque oublié) Joseph Roth. Nous ne pouvons omettre "A la Recherche du temps perdu" de notre illustre Marcel Proust dont certaines thématiques ne sont évidemment pas sans rappeler celles présentes dans le Guépard, même s'il faut reconnaître que cette correspondance sera encore plus approfondie dans ce chef d'oeuvre du cinéma mondial que Visconti fit quelques années plus tard du roman -. Celui de Lampedusa est incontestablement de ces immenses textes-là, à moins de s'arrêter à cette trompeuse apparence d'un livre axé sur la seule décadence d'un monde - l'aristocratie dans la Sicile du Roi François II- déjà en perdition depuis des années, en Italie comme presque partout ailleurs dans l'Europe de la seconde moitié du XIXème siècle. C'est aussi un livre qui s'amuse - avec mordant et une certaine lucidité rogue - de l'émergence du monde nouveau bientôt seul à l'oeuvre. Pour mieux répéter le passé, ainsi que le prévoit et le prédit le jeune Tancrède, dans une formulation demeurée célèbre, et qui donne l'une des clés possibles - certainement pas la seule - à ce roman allégorique : « Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change». N'est-ce pas ce que les supposées alternances politiques nous promettent régulièrement ? Ce à quoi elles aboutissent invariablement...?
On aurait pu s'arrêter sur quelques autres personnages, tel ce prêtre, le fidèle Père Pirrone, dont le nom est celui d'un curé ayant réellement existé et qui fut le chapelain de l'arrière grand-père dont l'auteur s'est assez largement inspiré - même s'il estimait qu'il l'avait rendu plus intelligent que ne l'avait jamais été le véridique aïeul ! -, ou encore ce compagnon de chasse - presque devenu un ami, malgré la différence de classe et de condition -, organiste de l'église du village, homme secret un peu bourru mais dont le sens de l'honneur, sans faille tout autant que vain, semble appartenir à un monde encore plus ancien que celui de Don Fabrizio. Il y a aussi ce chien un peu fou qui, dans les dernières pages du roman, va représenter une espèce de parabole aux ultimes dérisoires instants de ce monde définitivement mort.
Tout est là, dans ce récit au mille stratagèmes narratifs - comment expliquer sinon que l'on croit, par exemple, d'autant plus à l'assurance du mariage éclatant des deux amants, Tancredi et Angelica, qu'à aucun moment l'auteur ne nous y fera assister ? Que les rumeurs de la révolution suffisent amplement à nous en donner toute l'importance, quand bien même il eût été aisé d'en faire quelque description bien sentie - et l'art de Lampédusa eut certainement su décrire un tel type de "vérité" -, mieux, que c'est parce que nous n'assistons à aucune de ces péripéties militaires, autrement que par le biais de conversations, de détails postérieurs à leur effectivité, des souvenirs, que nous sommes subjugués par la force de leurs conséquences ? Est-il vraiment indispensable d'ajouter que l'oeuvre tient, pour une part, de Stendhal (principalement de la Chartreuse de Parme) dont l'auteur était un excellent connaisseur, pour une autre part du roman "vériste" Les Princes de Francalanza de de Roberto pour la description de la ruine de l'aristocratie sicilienne ? C'est indubitablement exact, et ne saurait pourtant expliquer qu'une fraction du génie tant inspiré de cette oeuvre si profonde, si personnelle, où l'on devine aisément que, derrière ce Prince de la fin du XIXème siècle, c'est incidemment le Prince écrivain lui-même qui peut se lire en creux dans le portrait de cet homme Ô ! combien solitaire (malgré son entourage) et désabusé.
Mais toutes les explications consacrées à un texte qui n'en finit pas d'être pressé, déconstruit, analysé par ses innombrables exégètes ne peuvent parfaitement rendre compte de la magie - de la pure magie - du style de Lampedusa (et le lecteur français lambda ne dispose pourtant "que" de la magistrale traduction de Jean-Paul Maganaro dont le travail, probablement héroïque, homérique même, est à porter au zénith de la traduction littéraire), un style intensément baroque, imperceptiblement allusif, pratiquant un art de la métaphore à des niveaux rarement atteints, sachant manier un verbe que l'on pourrait qualifier d'aristocratique si le terme n'était aussi galvaudé voire honni, jouant sans cesse de l'allusion et de l'hyperbole, travaillant les mots comme un véritable orfèvre de la langue, n'hésitant pas à essouffler le lecteur de ses phrases parfois interminables (et d'un lyrisme souvent étrange, arythmique), pour mieux le laisser exsangue sur une réflexion emportant tout sur son passage, un instantané de pure grâce, un moment captivant où espace et temps semblent demeurer suspendus dans l'imagination en fusion de qui les reçoit. Une langue belle, belle et inquiétante comme on peut le ressentir de l'observation de l'oiseau de proie en suspension au dessus de sa future proie. Un roman monde, un roman intemporel mais d'une temporalité romanesque construite - et déconstruite à la fois - avec la sapience d'un grand architecte, un roman fusion, qui nous en dit autant de ce que nous sommes que de ce que peut être le monde alentour, par-delà les différences temporelles, sociales et géographiques... Un roman hommage, enfin, à cette terre revêche, jaunie par le soleil, asséchée par le souvenir des embruns, dure sans nulle doute, sauvage certainement, difficilement compréhe
Nous sommes en Juillet 1957. Un homme presque totalement inconnu du public vient de rendre l'âme, il n'avait que 60 ans. Dans son testament rédigé fin mai de la même année - l'homme se savait atteint d'un cancer du poumon - voici, entre autre, ce que ces proches découvrent :
«Je désire que tout ce qui est possible soit fait pour que le "Guépard" soit publié (le texte valable est celui qui a été recueilli dans un seul manuscrit) ; cela ne signifie pas évidemment qu'il doit être publié aux frais de mes héritiers ; je considérerai cela comme une grande humiliation. [...]»
L'ultime voeu de cet homme un peu étrange, relativement reclus, fin lettré passionné de littérature anglaise et française (langues qu'il connaissait à la perfection), donnant à quelques jeunes étudiants, sur les dernières années de sa vie, des genres de leçons particulières consacrées à ses auteurs favoris (Shakespeare, Byron, Flaubert et, surtout, Stendhal), n'ayant jusque-là que quelques rares textes publiés, pour l'essentiel des critiques, cet ultime voeu, le Prince Giuseppe Tomasi di Lampedusa ne le verra donc pas de son vivant à quelques trois malheureux mois prêt. Pas plus qu'il n'aura connu la gloire incommensurable, tant populaire que critique, que ce texte écrit tardivement mais dans une certaine urgence obtiendra tant en Italie qu'à l'international, succès dont il faut admettre qu'il fut encore plus éclatant après le succès du film de Luchino Visconti, Palme d'Or à Cannes en 1963, demeurant d'ailleurs sans aucun doute la réalisation la plus fameuse du cinéaste italien. (Pour la petite histoire, jamais un roman italien n'avait obtenu un tel succès dans son propre pays depuis cent ans. Il faudra attendre le Nom de la rose d'Umberto Eco, en 1980, pour atteindre de tels scores d'édition !).
Mais que peut bien cacher un tel roman pour obtenir un tel déluge de superlatifs, un tel succès, une telle reconnaissance tant par les lecteurs que par la critique académique - ce qui est, reconnaissons-le, un phénomène des plus rares - ?
Tout d'abord, une histoire servie par un homme en tout point fascinant : Don Fabrizio Salina, éminent prince d'une Sicile connaissant les grands bouleversements politiques et sociaux de son époque - les années 1860 - et surtout, de la future nation italienne avec les tourments révolutionnaires du "risorgimento" (mot que l'on peut traduire par "renaissance" ou "résurrection"), voulue de longue date par le Comte de Cavour, sous l'égide du futur roi Victor-Emmanuel II aidé de son bras armé (surtout en ce qui concerne le Royaume de Sicile), le célèbre Garibaldi. Ainsi, cet homme déjà entré dans ce qu'il est coutume de nommer "la force de l'âge" a-t-il déjà une longue expérience des êtres, et une immémoriale histoire derrière lui (sa famille serait née des ébats d'un empereur romain !). Personnage à la stature imposante «Non qu'il fût gros : il n'était qu'immense et très fort ;[...]», «le teint rosé, les poils couleur de miel», se décrivant lui-même comme un détonnant mélange d'origine germanique, autoritaire, hautain et cédant aux délices de l'intellectualisme, par sa mère, de «sensualité et de laisser-aller» par son père sicilien, «le Prince Fabrizio vivait dans un mécontentement perpétuel, malgré son regard jupitérien courroucé, et il contemplait la ruine de sa classe et de son patrimoine sans rien faire pour y porter remède ni en avoir la moindre envie». Voila comment nous est présenté, dès les premières pages, cet homme dont nous allons suivre, avec délectation, avec une incroyable attention, les pensées les plus intimes, les engouements et les détestations, les longs et puissants moments de contemplation - le Prince n'est-il pas un astronome reconnu de ses pairs, ses talents de scientifique lui ayant même valu, jadis, la remise d'une médaille d'honneur par le grand savant et homme d'état français François Arago -. Car il est ainsi, Don Fabrizio : les pieds et l'ironie bien sur cette terre mais les pensées proches des étoiles.
Dès la première scène - la fin de la récitation du rosaire - de la première partie, qui a lieu en mai 1860, di Lampedusa nous emporte, avec une maestria invraisemblable, dans ce petit royaume en perpétuel déclin, en état de déréliction presque imperceptible mais pourtant si présente tout au long de l'ouvrage. Ainsi en est-il, dans les quelques pages qui suivent la présentation de cet hôte colossal, de la description, fascinante, du jardin de la propriété, pas totalement à l'abandon, pas non plus absolument impeccable, et où la nature semble cependant reprendre peu à peu ses droits. Apparaît d'ailleurs dès l'incipit une sorte de méta personnage, un chien, un immense et jeune dogue répondant au nom de Bendicò qui apparaîtra bientôt comme le seul élément simplement gai et heureux de cette histoire épique, qui ponctuera régulièrement certaines des scènes les plus importantes de l'ouvrage, jusqu'à son ultime conclusion, mais n'allons pas trop vite.
Très vite les personnages principaux du roman vont nous être présentés, la plupart du temps sous le regard mordant, cynique et désabusé de Don Fabrizio, de temps à autres par le biais d'un narrateur extérieur omniscient - ne serait-ce que pour permettre l'existence de moments dans lesquels le Prince n'apparaît pas en personne. Souvent pour donner un autre angle à ce que l'histoire intériorisée par le principal personnage nous fait découvrir, parfois pour prolonger le temps de l'histoire avec des temps plus contemporains, souvent pour appuyer encore un peu plus sur le décadentisme irréversible de ce qui est décrit -. Il y a, bien entendu, les proches immédiats : Stella, l'épouse très pieuse, glaciale, trompée (qui n'a, soyons sincère, qu'un rôle très secondaire). Les enfants, à commencer par Concetta, l'une des trois filles, jeune demoiselle soumise à son père, naïve, facilement revêche mais sans méchanceté ni calcul, l'exacte antithèse de l'autre jeune femme du roman. Il y a les fils, à commencé par l'aîné, Paolo, pour lequel son père n'a qu'une sympathie très mesurée, le trouvant mou, lourd, sans grandeur ni vision, n'aimant guère que la compagnie des chevaux (dont, ironie sublime, il mourra) lui-même étant pour ainsi dire l'antithèse de l'autre personnage essentiel, quoi que légèrement décalé narrativement parlant, du Guépard, le jeune Prince Tancrède, son neveu désargenté mais ambitieux, fin, drôle de cette ironie qui plait tant à cet oncle terrible ; pour le dire en un seul mot : aristocratique, comme lui l'est, sans doute l'un des derniers de son clan, de sa race, de son temps. Avec ce petit quelque chose que le prince vieillissant n'a pas, n'a plus : une ambition politique absolument dévorante, dont on comprendra vers la fin qu'elle fut plus forte que son ménage avec sa sublissime épouse...
Car l'époque est aux grands bouleversement, dans cette péninsule cis-alpine en mal de rassemblement. Déjà, l'ancien Royaume de Sardaigne a-t-il adopté une constitution de type libérale en 1848. Mais c'est le débarquement des "Mille" sous les ordres de Giuseppe Garibaldi, les fameuses "Chemises rouges", qui accélérera, dans cette Sicile royale, le mouvement révolutionnaire déjà à l'oeuvre sur le continent. L'intelligence de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, concernant ces moments connus et reconnus de tout italien qui se respecte, c'est de n'avoir évoqué, abordé ces faits historiques d'importance que par le biais de digressions, parfois d'évocations anodines au cours d'une conversation, à d'autre instants par l'arrivée brutale et tout aussi brutalement résumé des conséquences immédiates de ces troubles ; ainsi de ce jeune soldat royaliste trouvé mort dans le jardin de la propriété princière. Parce que le Guépard n'est pas un roman historique - mais bien plutôt se penche sur les conséquences de faits historiques, sur L Histoire en général, et leurs répercussions sur des histoires particulières - il évite ainsi les travers factuels de ce type d'oeuvre, l'ouvrant à un universel auquel un texte contant les péripéties et autres batailles des uns ou des autres lors cette période n'aurait probablement pas pu prétendre. Car si Lampedusa use, avec une finesse étonnante, toujours étincelante, de ces moments cruciaux de l'Histoire moderne de l'Italie, c'est d'abord, et même avant tout, pour nous faire toucher d'aussi près que possible les états d'âme languides mais cyniques d'un grand sceptique, mêlant une certaine apathie à l'impossibilité de jamais vraiment pouvoir exprimer la moindre vraie colère - tandis que le personnage est incroyablement colérique ! -, la moindre réaction vive face à ce monde qui s'écroule sous ses yeux (ce qu'il voit, sait, comprend), mais aussi, d'une certaine manière, en son propre for intérieur, nous faisant approcher d'une manière rarement atteinte en littérature les soubresauts, les supplices de l'angoisse lorsqu'elle tend à l'existentiel. La sixième partie de l'ouvrage, modestement intitulée "La fin du prince" en est un exemple sublime, palpitant, d'une émotion inouïe autant que surprenante rarement lue par ailleurs.
Toute l'intelligence, le raffinement, l'intuition de di Lampedusa de ce monde en décapilotade apparaît à travers ce personnage ainsi que par le biais de binôme, parfois en bonne intelligence comme celui formé par Don Fabrizio et Tancredi, s'excerçant plus souvent par le biais de rapports presque strictement antithétiques comme c'est le cas entre le Prince et le futur beau-père de Tancrède, Calogero Sedàra, le prototype de l'homme nouveau dans cette atmosphère de fin du monde, de fin d'UN monde qui peine à l'admettre malgré les évidences, Sedàra, un homme roué, malin, intelligent même, mais qui confond beauté et valeur pécuniaire de cette beauté, un être que l'on ne peut même pas qualifier de vil, tant son destin et ses entreprises semblent clairs comme de cette eau pourtant si rare en Sicile - à moins qu'elle ne se mette subitement à tomber sans discontinuer sous forme d'orage cataclysmique -, un parfait homme d'affaire, fils d'un paysan illettré et repoussant, tout dévoué au culte de Mammon, aujourd'hui on parlerait sans aucun doute d'un parvenu ; seulement cet homme-là est le père heureux d'une merveille, sa fille - qui réalise un autre binôme, toujours dans l'antithèse exacte, avec Concetta, Angelica au prénom prédestiné - même si angélique elle est loin de l'être tout à fait - et plutôt que de tenter de la décrire, avec maladresse, laissons l'auteur nous présenter sa première apparition dans le salon du château princier de Donnafugata :
«L'instant dura cinq minutes ; puis la porte s'ouvrit et Angelica entra. La première impression fut de surprise éblouie. Les Salina restèrent le souffle coupé ; Tancredi senti même battre les veines de ses tempes. Devant l'impétuosité de sa beauté les hommes furent incapables d'en remarquer, en les analysant, les défauts qui n'étaient pas rares ; et nombreuses étaient les personnes qui ne seraient jamais capables de cette élaboration critique. Elle était grande et bien faite, sur la base de critères généreux ; sa carnation devait posséder la saveur de la crème fraîche à laquelle elle ressemblait, sa bouche enfantine celle des fraises. Sous la masse des cheveux couleur de nuit enroulés en d'exquises ondulations, il y avait l'aube de ses yeux verts, immobiles comme ceux des statues et, comme eux, un peu cruels. Elle avançait lentement, en faisant tournoyer sa large jupe blanche et portait sur sa personne la sérénité, l'invincibilité de la femme sûre de sa beauté. Ce n'est que bien des mois plus tard que l'on sut qu'au moment de son entrée triomphale elle avait été sur le point de s'évanouir d'anxiété.»
Le lecteur remarquera sans doute, au passage, que Lampedusa ne dit finalement pas tant ce qu'est cette beauté : la carnation de la peau et des lèvres, sa chevelure, ses yeux un peu plus ; une démarche. Il n'omet pas même une certaine réalité : qu'elle n'est pas une pure perfection. Mais, quand bien même nous n'assistons pas directement à cette scène d'où le temps semble s'être d'ailleurs un instant retiré, les impressions, les regards des autres - soyons francs : des hommes pour l'essentiels - , par lesquels nous admirons Angelica nous donnent plus à imaginer qu'aucune description complète de ce physique n'aurait jamais pu le faire. Si le lecteur s'est laissé subjuguer, au détour de ces quelques lignes extraites du roman, par cette évanescente beauté apparue dans la torpeur d'un salon mondain, exprimé par ce style qui prend son temps, tout en évoquant beaucoup, qu'il imagine seulement l'effet que peuvent avoir quelques trois cent pages de ce niveau, de cette sidération permanente, de, osons l'affirmer, ce chef d'oeuvre absolu d'une densité rare, d'une tension permanente dans son apparente ataraxie, un roman où les réflexions les plus fondamentales sur le pouvoir, sur la beauté, sur la politique, sur le temps qui passe, sur les rapports entre hommes et femmes, sur les buts mêmes d'une existence, sur la mort, peuvent surgir d'une simple et champêtre scène de chasse, de quelques instants de songerie dans le creux d'un canapé, d'une discussion à bâtons rompus avec un émissaire de la jeune Monarchie Constitutionnelle, etc.
Les grands textes contant la fin d'une époque, la fin d'un monde, de tout un monde, ne sont pas si rares. Quelques-uns atteignent au génie - nous pensons plus précisément à ce roman incontournable de la "Mittel Europa" naissante, "La Marche de Radetzky" du grand écrivain autrichien (mort en 1939 à Paris, presque oublié) Joseph Roth. Nous ne pouvons omettre "A la Recherche du temps perdu" de notre illustre Marcel Proust dont certaines thématiques ne sont évidemment pas sans rappeler celles présentes dans le Guépard, même s'il faut reconnaître que cette correspondance sera encore plus approfondie dans ce chef d'oeuvre du cinéma mondial que Visconti fit quelques années plus tard du roman -. Celui de Lampedusa est incontestablement de ces immenses textes-là, à moins de s'arrêter à cette trompeuse apparence d'un livre axé sur la seule décadence d'un monde - l'aristocratie dans la Sicile du Roi François II- déjà en perdition depuis des années, en Italie comme presque partout ailleurs dans l'Europe de la seconde moitié du XIXème siècle. C'est aussi un livre qui s'amuse - avec mordant et une certaine lucidité rogue - de l'émergence du monde nouveau bientôt seul à l'oeuvre. Pour mieux répéter le passé, ainsi que le prévoit et le prédit le jeune Tancrède, dans une formulation demeurée célèbre, et qui donne l'une des clés possibles - certainement pas la seule - à ce roman allégorique : « Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change». N'est-ce pas ce que les supposées alternances politiques nous promettent régulièrement ? Ce à quoi elles aboutissent invariablement...?
On aurait pu s'arrêter sur quelques autres personnages, tel ce prêtre, le fidèle Père Pirrone, dont le nom est celui d'un curé ayant réellement existé et qui fut le chapelain de l'arrière grand-père dont l'auteur s'est assez largement inspiré - même s'il estimait qu'il l'avait rendu plus intelligent que ne l'avait jamais été le véridique aïeul ! -, ou encore ce compagnon de chasse - presque devenu un ami, malgré la différence de classe et de condition -, organiste de l'église du village, homme secret un peu bourru mais dont le sens de l'honneur, sans faille tout autant que vain, semble appartenir à un monde encore plus ancien que celui de Don Fabrizio. Il y a aussi ce chien un peu fou qui, dans les dernières pages du roman, va représenter une espèce de parabole aux ultimes dérisoires instants de ce monde définitivement mort.
Tout est là, dans ce récit au mille stratagèmes narratifs - comment expliquer sinon que l'on croit, par exemple, d'autant plus à l'assurance du mariage éclatant des deux amants, Tancredi et Angelica, qu'à aucun moment l'auteur ne nous y fera assister ? Que les rumeurs de la révolution suffisent amplement à nous en donner toute l'importance, quand bien même il eût été aisé d'en faire quelque description bien sentie - et l'art de Lampédusa eut certainement su décrire un tel type de "vérité" -, mieux, que c'est parce que nous n'assistons à aucune de ces péripéties militaires, autrement que par le biais de conversations, de détails postérieurs à leur effectivité, des souvenirs, que nous sommes subjugués par la force de leurs conséquences ? Est-il vraiment indispensable d'ajouter que l'oeuvre tient, pour une part, de Stendhal (principalement de la Chartreuse de Parme) dont l'auteur était un excellent connaisseur, pour une autre part du roman "vériste" Les Princes de Francalanza de de Roberto pour la description de la ruine de l'aristocratie sicilienne ? C'est indubitablement exact, et ne saurait pourtant expliquer qu'une fraction du génie tant inspiré de cette oeuvre si profonde, si personnelle, où l'on devine aisément que, derrière ce Prince de la fin du XIXème siècle, c'est incidemment le Prince écrivain lui-même qui peut se lire en creux dans le portrait de cet homme Ô ! combien solitaire (malgré son entourage) et désabusé.
Mais toutes les explications consacrées à un texte qui n'en finit pas d'être pressé, déconstruit, analysé par ses innombrables exégètes ne peuvent parfaitement rendre compte de la magie - de la pure magie - du style de Lampedusa (et le lecteur français lambda ne dispose pourtant "que" de la magistrale traduction de Jean-Paul Maganaro dont le travail, probablement héroïque, homérique même, est à porter au zénith de la traduction littéraire), un style intensément baroque, imperceptiblement allusif, pratiquant un art de la métaphore à des niveaux rarement atteints, sachant manier un verbe que l'on pourrait qualifier d'aristocratique si le terme n'était aussi galvaudé voire honni, jouant sans cesse de l'allusion et de l'hyperbole, travaillant les mots comme un véritable orfèvre de la langue, n'hésitant pas à essouffler le lecteur de ses phrases parfois interminables (et d'un lyrisme souvent étrange, arythmique), pour mieux le laisser exsangue sur une réflexion emportant tout sur son passage, un instantané de pure grâce, un moment captivant où espace et temps semblent demeurer suspendus dans l'imagination en fusion de qui les reçoit. Une langue belle, belle et inquiétante comme on peut le ressentir de l'observation de l'oiseau de proie en suspension au dessus de sa future proie. Un roman monde, un roman intemporel mais d'une temporalité romanesque construite - et déconstruite à la fois - avec la sapience d'un grand architecte, un roman fusion, qui nous en dit autant de ce que nous sommes que de ce que peut être le monde alentour, par-delà les différences temporelles, sociales et géographiques... Un roman hommage, enfin, à cette terre revêche, jaunie par le soleil, asséchée par le souvenir des embruns, dure sans nulle doute, sauvage certainement, difficilement compréhe