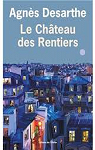Citation de hcdahlem
(Les premières pages du livre)
Le château
Mes grands-parents maternels, Boris et Tsila Jampolski, avaient 65 ans lorsqu’ils ont acheté, sur plan, un appartement de deux pièces avec balcon au huitième étage d’une tour, dans le XIIIe arrondissement de Paris. J’ai écrit leur adresse – 194 rue du Château des Rentiers 75013 Paris – sur des enveloppes et des cartes postales pendant près de trente ans.
Château.
Rentiers.
Pas une fois je ne me suis interrogée sur le sens, le poids que possédaient peut-être ces mots pour deux juifs immigrés en France au début des années 1930 – mon grand-père de remplacement, ancien communiste ayant connu les camps de prisonniers, ma grand-mère de sang, devenue veuve après la déportation et l’assassinat de son premier mari par les nazis –, issus l’un comme l’autre d’un milieu populaire et n’ayant jamais perdu leur accent.
Un château, ose-t-on seulement en rêver lorsque l’on a vécu l’exil et les privations ?
Rentier, n’est-ce pas le statut que l’on réprouve, tout en l’enviant, quand on a porté autrefois le petit foulard rouge des pionniers ?
Le hasard des noms de rue et un marché immobilier à la baisse ont fait de mes grands-parents les habitants d’un château qui n’était pas peuplé que de rentiers, un château en béton plaqué pierre de taille, avec des portes d’ascenseur orange, des dalles en pierre de Bourgogne industrielle, d’immenses miroirs dans lesquels je me suis vue grandir, d’interminables couloirs revêtus de moquette, des portes en bois contrecollé et de larges balcons pourvus de balustrades en fer, d’où l’on pouvait voir et entendre les élèves du CES rue Yeo-Thomas, le collège où il ne fallait pas aller si on voulait faire des études plus tard, le collège où il y avait des blousons noirs (disait-on), des voyous – n’était-ce pas l’un d’eux qui avait volé la montre à cristaux liquides que mon frère avait reçue à l’occasion de sa bar-mitsva parmi une armée de stylos à plume et un bataillon de radios-réveils ?
La rue du Château des Rentiers était une de celles que j’empruntais pour me rendre à la piscine en primaire et, plus tard, pour aller au collège et au lycée. Je lisais, sans y prendre garde et plusieurs fois par jour, les mots inscrits sur la plaque métallique bleue dans son cadre vert. Et ces mots ne signifiaient rien pour moi. Ou alors : cheveux mouillés, bonnet oublié, paquet de chips acheté au distributeur à la sortie du vestiaire, contrôle de physique insuffisamment révisé, rendez-vous à 13 h 30 sur les marches du lycée avant l’orchestre, et, bien sûr, papi et mamie Jampolski, mes grands-parents, qui m’avaient transmis le goût de la langue russe, de la pâte brisée, des noix, des foies de volaille hachés, des graines de pavot et d’une littérature peuplée de personnages aux noms changeants (Alexandre était aussi Sacha, Dimitri Mitia, Nastasia Nastia, Elena Yolka) et interminables, car couplés à leurs patronymes en ov ou en ovna, en ski ou en skaïa ; une onomastique si riche qu’elle fonctionna pour moi comme une initiation à la musique, à la complexité des identités, à la généalogie.
Cette rue, si on mettait de côté son nom, n’avait rien pour évoquer les vieilles et nobles pierres d’un château, pas plus que les revenus, générés non par le travail mais par l’argent lui-même, dont jouissent les rentiers. Le quartier avait été presque intégralement rasé au début des années 1970 et les vieilles bâtisses de travers, dignes d’un décor d’Alexandre Trauner, avaient laissé la place à des immeubles modernes, disparates, jaillis sans harmonie de l’asphalte.
Moi qui ne connaissais de Paris que cette portion située à l’est et au sud-est de la place d’Italie, je me demandais comment les touristes pouvaient considérer cette ville comme la plus belle du monde. Vraiment ? me disais-je en levant les yeux vers les façades hideuses aux fenêtres toujours trop petites et apparemment impossibles à ouvrir, les crépis bon marché et vite écaillés, les matériaux si synthétiques et les proportions si inélégantes que l’on aurait pu s’interroger sur le genre de faute qui méritait pareille punition. Pourquoi habiter là ? me disais-je à l’âge où l’on considère qu’une maison est un carré surmonté d’un triangle.
Quant aux rentiers, où étaient-ils ? Qui étaient-ils ? Les parents de mes camarades de classe étaient, pour la plupart, employés de bureau, artisans, secrétaires, postiers, infirmières.
Pourquoi y revenir aujourd’hui, alors que cet immeuble et cette rue ont déjà été la toile de fond d’un, voire de deux de mes livres ? Pourquoi retourner en pensée dans ces avenues sans charme que je n’ai jamais pris plaisir à arpenter ? Peut-être est-ce plus une histoire de temps que de géographie.
Dans moins de dix ans, j’aurai l’âge qu’avaient mes grands-parents quand ils sont devenus propriétaires du petit appartement de la rue du Château des Rentiers.
À portée de pensée
Récemment, ma grand-mère Tsila est venue me rendre visite en rêve.
Elle vient aussi me voir en pensée.
Elle ne fait que passer. Elle ne me parle pas. Ne semble pas avoir de message particulier à me délivrer. Elle se contente d’être là, et je songe que ce n’est pas elle qui tente de se rapprocher de moi, mais plutôt moi qui, sans m’en apercevoir, sans le vouloir, rien qu’en vieillissant, me rapproche d’elle. Je retourne au moment de notre première rencontre. Moi, bébé aux grands yeux bleus, elle, femme de petite taille, au squelette menu, aux traits fatigués par la maladie, aux yeux d’un bleu moins gris que les miens.
Kak krassivaïa ! (Comme elle est belle !) A-t-elle parlé en russe ou en français, penchée sur moi dans mon berceau ou au creux des bras de ma mère ? A-t-elle prononcé la formule yiddish propre à détourner le mauvais œil, Kein ayin hora ? Il est plus probable qu’elle n’ait rien dit, qu’elle ait simplement pensé : vivantes, toutes les deux, sa fille et la fille de sa fille. Soulagement, surprise, sidération. Je ne crois pas avoir été accueillie dans la joie. C’est sans doute ce qui a fait de moi un bébé, une enfant et une femme joyeux. Il me semble que personne avant moi n’avait eu l’idée ou le loisir d’occuper ce terrain.
J’écris « bébé » et je revois les lieux de mon enfance. L’appartement dans lequel mes parents se sont installés juste avant ma naissance, trop grand, trop vide, qui résonne un peu, les meubles en faux bois couleur acajou, mes couvertures, celle au crochet d’un joli blanc crème, et dont les bords étaient garnis d’un galon de satin brillant, ma courtepointe surpiquée en tissu synthétique bleu très clair, et mon poupoune (ainsi appelais-je mon doudou) qui fut alternativement un débris d’édredon en nylon jaune pâle et une ancienne capuche molletonnée d’un blanc douteux, ayant vraisemblablement appartenu à mon grand frère et qui procurait, lorsque l’on en pressait l’étoffe entre deux doigts pour la faire glisser sur elle-même, une sensation enivrante, un bien-être fou.
En écrivant, je me souviens de tout. Je fais semblant de me souvenir de tout. Peut-être est-ce la même chose. Exactement la même chose.
Je continue : le couloir très très long, le visage de ma mère, sa bouche enfantine, les cernes sous ses yeux vert clair en amande, la grosse tête de mon frère, les cils noirs de mon père, les robes de chambre en nylon matelassées à grand col, les mains aux ongles larges et impeccables de mon père, la porte d’entrée à double battant, les épaules rondes de ma mère, les savates en faux cuir, les savates en tissu, une chaise à armature métallique. Tout est là, à portée de pensée. C’était il y a longtemps. C’était il y a très peu de temps. Ainsi – j’en tiens la preuve – mon avenir, ma vieillesse sont, eux aussi, à portée de pensée. Si ma grand-mère me rend visite, c’est pour me le confirmer. Le temps de vivre deux ou trois choses et je me retournerai vers l’instant où j’écris aujourd’hui, en me disant : c’était hier. Et je n’aurai pas vu le temps passer. Si je ne prends pas un peu d’avance, je me retrouverai au seuil de la mort sans avoir rien prévu, sans avoir rien choisi.
Un projet d’avenir
À 8 ans, je rêvais à la jeune fille que je serais à 17. Elle aurait des cheveux raides et blonds, elle serait mince et musclée, au volant d’une voiture décapotable et ses longs cheveux blonds (c’est si agréable de l’écrire deux fois, de l’imaginer deux fois) voleraient à l’horizontale dans son dos, soulevés par la vitesse et le vent. Ce portrait évoque par bien des aspects, je dois le reconnaître, la publicité pour Barbie-voiture qu’on voyait alors à la télévision. Je ne crois pas que j’établissais le lien entre les deux à l’époque. Quand, neuf ans plus tard, j’ai atteint l’âge rimbaldien, j’avais les cheveux bouclés, châtains et courts, j’étais joufflue, plus souple que musclée, et je ne conduisais aucun véhicule, pas même un vélo.
Je n’ai pas pensé pour autant que j’avais trahi mon rêve, que j’avais mal évalué mes chances de devenir blonde, mince, et de passer mon permis avant l’âge légal. J’ai été portée par cette vision que j’avais eue enfant jusqu’à la veille de mon dix-septième anniversaire, entraînée chaque matin par l’envie de conquérir ce futur radieux. Au moment du bilan, le constat ne s’est teinté d’aucune amertume.
À 17 ans et un jour, j’ai modelé un nouvel idéal en m’inspirant cette fois d’une amie que je trouvais plus jolie, plus intelligente et plus mûre que moi. Je m’achetais les mêmes vêtements qu’elle. Toutefois, comme nos morphologies différaient, ce qui la sublimait – faisant d’elle tantôt une princesse bulgare, tantôt une ballerine de Degas – faisait de moi une brave fille de ferme. Le constat de ce nouvel échec aurait pu mettre fin à ma manie de l’idéalisation. Mais non. J’aimais et j’aime toujours admirer. C’est mon moyen de transport fétiche. Je veux être ce que je ne suis pas. Je veux être là où je ne suis pas. Peu importe que j’y parvienne ou non, car le plaisir est garanti par le trajet.
À 19 ans, je me suis tournée vers la chanteuse du groupe de pop-rock anglais, Eurythmics. Anni
Le château
Mes grands-parents maternels, Boris et Tsila Jampolski, avaient 65 ans lorsqu’ils ont acheté, sur plan, un appartement de deux pièces avec balcon au huitième étage d’une tour, dans le XIIIe arrondissement de Paris. J’ai écrit leur adresse – 194 rue du Château des Rentiers 75013 Paris – sur des enveloppes et des cartes postales pendant près de trente ans.
Château.
Rentiers.
Pas une fois je ne me suis interrogée sur le sens, le poids que possédaient peut-être ces mots pour deux juifs immigrés en France au début des années 1930 – mon grand-père de remplacement, ancien communiste ayant connu les camps de prisonniers, ma grand-mère de sang, devenue veuve après la déportation et l’assassinat de son premier mari par les nazis –, issus l’un comme l’autre d’un milieu populaire et n’ayant jamais perdu leur accent.
Un château, ose-t-on seulement en rêver lorsque l’on a vécu l’exil et les privations ?
Rentier, n’est-ce pas le statut que l’on réprouve, tout en l’enviant, quand on a porté autrefois le petit foulard rouge des pionniers ?
Le hasard des noms de rue et un marché immobilier à la baisse ont fait de mes grands-parents les habitants d’un château qui n’était pas peuplé que de rentiers, un château en béton plaqué pierre de taille, avec des portes d’ascenseur orange, des dalles en pierre de Bourgogne industrielle, d’immenses miroirs dans lesquels je me suis vue grandir, d’interminables couloirs revêtus de moquette, des portes en bois contrecollé et de larges balcons pourvus de balustrades en fer, d’où l’on pouvait voir et entendre les élèves du CES rue Yeo-Thomas, le collège où il ne fallait pas aller si on voulait faire des études plus tard, le collège où il y avait des blousons noirs (disait-on), des voyous – n’était-ce pas l’un d’eux qui avait volé la montre à cristaux liquides que mon frère avait reçue à l’occasion de sa bar-mitsva parmi une armée de stylos à plume et un bataillon de radios-réveils ?
La rue du Château des Rentiers était une de celles que j’empruntais pour me rendre à la piscine en primaire et, plus tard, pour aller au collège et au lycée. Je lisais, sans y prendre garde et plusieurs fois par jour, les mots inscrits sur la plaque métallique bleue dans son cadre vert. Et ces mots ne signifiaient rien pour moi. Ou alors : cheveux mouillés, bonnet oublié, paquet de chips acheté au distributeur à la sortie du vestiaire, contrôle de physique insuffisamment révisé, rendez-vous à 13 h 30 sur les marches du lycée avant l’orchestre, et, bien sûr, papi et mamie Jampolski, mes grands-parents, qui m’avaient transmis le goût de la langue russe, de la pâte brisée, des noix, des foies de volaille hachés, des graines de pavot et d’une littérature peuplée de personnages aux noms changeants (Alexandre était aussi Sacha, Dimitri Mitia, Nastasia Nastia, Elena Yolka) et interminables, car couplés à leurs patronymes en ov ou en ovna, en ski ou en skaïa ; une onomastique si riche qu’elle fonctionna pour moi comme une initiation à la musique, à la complexité des identités, à la généalogie.
Cette rue, si on mettait de côté son nom, n’avait rien pour évoquer les vieilles et nobles pierres d’un château, pas plus que les revenus, générés non par le travail mais par l’argent lui-même, dont jouissent les rentiers. Le quartier avait été presque intégralement rasé au début des années 1970 et les vieilles bâtisses de travers, dignes d’un décor d’Alexandre Trauner, avaient laissé la place à des immeubles modernes, disparates, jaillis sans harmonie de l’asphalte.
Moi qui ne connaissais de Paris que cette portion située à l’est et au sud-est de la place d’Italie, je me demandais comment les touristes pouvaient considérer cette ville comme la plus belle du monde. Vraiment ? me disais-je en levant les yeux vers les façades hideuses aux fenêtres toujours trop petites et apparemment impossibles à ouvrir, les crépis bon marché et vite écaillés, les matériaux si synthétiques et les proportions si inélégantes que l’on aurait pu s’interroger sur le genre de faute qui méritait pareille punition. Pourquoi habiter là ? me disais-je à l’âge où l’on considère qu’une maison est un carré surmonté d’un triangle.
Quant aux rentiers, où étaient-ils ? Qui étaient-ils ? Les parents de mes camarades de classe étaient, pour la plupart, employés de bureau, artisans, secrétaires, postiers, infirmières.
Pourquoi y revenir aujourd’hui, alors que cet immeuble et cette rue ont déjà été la toile de fond d’un, voire de deux de mes livres ? Pourquoi retourner en pensée dans ces avenues sans charme que je n’ai jamais pris plaisir à arpenter ? Peut-être est-ce plus une histoire de temps que de géographie.
Dans moins de dix ans, j’aurai l’âge qu’avaient mes grands-parents quand ils sont devenus propriétaires du petit appartement de la rue du Château des Rentiers.
À portée de pensée
Récemment, ma grand-mère Tsila est venue me rendre visite en rêve.
Elle vient aussi me voir en pensée.
Elle ne fait que passer. Elle ne me parle pas. Ne semble pas avoir de message particulier à me délivrer. Elle se contente d’être là, et je songe que ce n’est pas elle qui tente de se rapprocher de moi, mais plutôt moi qui, sans m’en apercevoir, sans le vouloir, rien qu’en vieillissant, me rapproche d’elle. Je retourne au moment de notre première rencontre. Moi, bébé aux grands yeux bleus, elle, femme de petite taille, au squelette menu, aux traits fatigués par la maladie, aux yeux d’un bleu moins gris que les miens.
Kak krassivaïa ! (Comme elle est belle !) A-t-elle parlé en russe ou en français, penchée sur moi dans mon berceau ou au creux des bras de ma mère ? A-t-elle prononcé la formule yiddish propre à détourner le mauvais œil, Kein ayin hora ? Il est plus probable qu’elle n’ait rien dit, qu’elle ait simplement pensé : vivantes, toutes les deux, sa fille et la fille de sa fille. Soulagement, surprise, sidération. Je ne crois pas avoir été accueillie dans la joie. C’est sans doute ce qui a fait de moi un bébé, une enfant et une femme joyeux. Il me semble que personne avant moi n’avait eu l’idée ou le loisir d’occuper ce terrain.
J’écris « bébé » et je revois les lieux de mon enfance. L’appartement dans lequel mes parents se sont installés juste avant ma naissance, trop grand, trop vide, qui résonne un peu, les meubles en faux bois couleur acajou, mes couvertures, celle au crochet d’un joli blanc crème, et dont les bords étaient garnis d’un galon de satin brillant, ma courtepointe surpiquée en tissu synthétique bleu très clair, et mon poupoune (ainsi appelais-je mon doudou) qui fut alternativement un débris d’édredon en nylon jaune pâle et une ancienne capuche molletonnée d’un blanc douteux, ayant vraisemblablement appartenu à mon grand frère et qui procurait, lorsque l’on en pressait l’étoffe entre deux doigts pour la faire glisser sur elle-même, une sensation enivrante, un bien-être fou.
En écrivant, je me souviens de tout. Je fais semblant de me souvenir de tout. Peut-être est-ce la même chose. Exactement la même chose.
Je continue : le couloir très très long, le visage de ma mère, sa bouche enfantine, les cernes sous ses yeux vert clair en amande, la grosse tête de mon frère, les cils noirs de mon père, les robes de chambre en nylon matelassées à grand col, les mains aux ongles larges et impeccables de mon père, la porte d’entrée à double battant, les épaules rondes de ma mère, les savates en faux cuir, les savates en tissu, une chaise à armature métallique. Tout est là, à portée de pensée. C’était il y a longtemps. C’était il y a très peu de temps. Ainsi – j’en tiens la preuve – mon avenir, ma vieillesse sont, eux aussi, à portée de pensée. Si ma grand-mère me rend visite, c’est pour me le confirmer. Le temps de vivre deux ou trois choses et je me retournerai vers l’instant où j’écris aujourd’hui, en me disant : c’était hier. Et je n’aurai pas vu le temps passer. Si je ne prends pas un peu d’avance, je me retrouverai au seuil de la mort sans avoir rien prévu, sans avoir rien choisi.
Un projet d’avenir
À 8 ans, je rêvais à la jeune fille que je serais à 17. Elle aurait des cheveux raides et blonds, elle serait mince et musclée, au volant d’une voiture décapotable et ses longs cheveux blonds (c’est si agréable de l’écrire deux fois, de l’imaginer deux fois) voleraient à l’horizontale dans son dos, soulevés par la vitesse et le vent. Ce portrait évoque par bien des aspects, je dois le reconnaître, la publicité pour Barbie-voiture qu’on voyait alors à la télévision. Je ne crois pas que j’établissais le lien entre les deux à l’époque. Quand, neuf ans plus tard, j’ai atteint l’âge rimbaldien, j’avais les cheveux bouclés, châtains et courts, j’étais joufflue, plus souple que musclée, et je ne conduisais aucun véhicule, pas même un vélo.
Je n’ai pas pensé pour autant que j’avais trahi mon rêve, que j’avais mal évalué mes chances de devenir blonde, mince, et de passer mon permis avant l’âge légal. J’ai été portée par cette vision que j’avais eue enfant jusqu’à la veille de mon dix-septième anniversaire, entraînée chaque matin par l’envie de conquérir ce futur radieux. Au moment du bilan, le constat ne s’est teinté d’aucune amertume.
À 17 ans et un jour, j’ai modelé un nouvel idéal en m’inspirant cette fois d’une amie que je trouvais plus jolie, plus intelligente et plus mûre que moi. Je m’achetais les mêmes vêtements qu’elle. Toutefois, comme nos morphologies différaient, ce qui la sublimait – faisant d’elle tantôt une princesse bulgare, tantôt une ballerine de Degas – faisait de moi une brave fille de ferme. Le constat de ce nouvel échec aurait pu mettre fin à ma manie de l’idéalisation. Mais non. J’aimais et j’aime toujours admirer. C’est mon moyen de transport fétiche. Je veux être ce que je ne suis pas. Je veux être là où je ne suis pas. Peu importe que j’y parvienne ou non, car le plaisir est garanti par le trajet.
À 19 ans, je me suis tournée vers la chanteuse du groupe de pop-rock anglais, Eurythmics. Anni