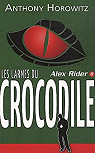Citation de Cielvariable
Ravi Chandra allait devenir un homme riche.
Cette seule pensée lui donnait le vertige. Dans les prochaines heures, il gagnerait plus d’argent qu’au cours des vingt dernières années. Une somme fabuleuse, payée en espèces et en main propre. Une nouvelle vie s’ouvrait devant lui. Bientôt il pourrait offrir à sa femme tout ce qu’elle désirait : des vêtements, une voiture, une alliance de diamant pour remplacer le mince anneau d’or qu’elle portait depuis leur mariage. Il emmènerait leurs deux jeunes fils à Disneyland, en Floride. Il irait à Londres voir jouer l’équipe de cricket indienne sur le célèbre terrain de Lord’s, rêve qu’il avait toujours caressé mais jamais cru possible.
Jusqu’à aujourd’hui.
Il se tenait assis, les épaules voûtées, contre la vitre du bus qui le conduisait au travail, comme chaque jour. Il faisait une chaleur torride. Les ventilateurs étaient en panne, une fois de plus, et bien entendu la compagnie ne se pressait pas pour les remplacer. Et on était au mois de juin, période de l’année connue en Inde du Sud sous le nom d’agni nakshatram. Autrement dit : étoile de feu. Le soleil était impitoyable. On avait du mal à respirer. La chaleur moite vous poissait la peau, de l’aube jusqu’à la nuit. La ville empestait.
Dès qu’il aurait l’argent, Ravi déménagerait. Il abandonnerait le deux pièces exigu qu’il occupait avec sa famille à Perambur, le quartier le plus peuplé de la ville, pour s’installer dans un endroit plus tranquille, plus aéré, plus spacieux. Il aurait un réfrigérateur rempli de bières et un grand écran à plasma. Franchement, ce n’était pas trop demander.
Le bus ralentit. Ravi avait effectué le trajet si souvent qu’il pouvait suivre son parcours les yeux fermés. Ils avaient laissé la ville derrière eux. Dans le lointain se dressaient des collines pentues, tapissées d’une végétation dense d’un vert profond. Mais l’endroit où le bus était arrivé évoquait plutôt un terrain vague, avec quelques palmiers émergeant des gravats, cerné par une forêt de pylônes électriques. La centrale se trouvait juste en face. Dans quelques instants, ils feraient halte à la première grille de sécurité.
Ravi était ingénieur. Son badge d’identité, avec sa photo et son nom complet – Ravindra Manpreet Chandra –, le décrivait comme opérateur d’unité. Il travaillait à la centrale nucléaire de Jowada, à cinq kilomètres au nord de Chennai, quatrième ville de l’Inde, autrefois connue sous le nom de Madras.
Il leva les yeux vers les immenses blocs multicolores, solidement protégés par des kilomètres de clôtures métalliques. Ravi pensait parfois que le fil de fer, sous toutes ses formes, était ce qui définissait le mieux Jowada. Fils barbelés, ronces, herses, fils téléphoniques. Sans compter les milliers de kilomètres de câbles qui acheminaient dans toute l’Inde l’électricité produite par la centrale. Il était étrange de songer que lorsqu’une personne allumait sa télévision à Pondichéry ou sa lampe de chevet à Nellore, le courant venait de Jowada.
Le bus s’arrêta au poste de sécurité, gardé par des sentinelles armées et des caméras de surveillance. Depuis les attaques du 11-Septembre à New York et Washington, toutes les centrales nucléaires du monde entier étaient classées comme cibles terroristes potentielles. À Jowada, on avait ajouté des barrières et augmenté les forces de sécurité. Pendant longtemps, ce surcroît de précautions avait été pénible à vivre : des vigiles étaient prêts à vous sauter dessus au moindre éternuement. Mais ils étaient peu à peu devenus paresseux. Le vieux Suresh, par exemple, qui montait la garde au poste de contrôle extérieur. Il connaissait tous les passagers du bus. Il les voyait à la même heure chaque jour : arrivée à sept heures et sortie à dix-sept heures trente. Parfois, il les rencontrait en ville, quand ils flânaient devant les boutiques de Ranganathan Street. Il connaissait leurs femmes et leurs fiancées. Il ne lui serait pas venu à l’idée de leur demander une pièce d’identité ni de vérifier ce qu’ils apportaient à la centrale. Il fit signe au bus de passer.
Deux minutes plus tard, Ravi en descendit. C’était un petit homme maigre à la peau grêlée, avec une moustache mal perchée au-dessus de la lèvre supérieure. Il était déjà vêtu d’une combinaison de protection et de chaussures à bout renforcé, et portait une boîte à outils. Celle-ci faisait partie de lui, comme un bras ou une jambe.
Le bus s’était immobilisé à côté d’un mur en brique percé d’une porte qui, comme toutes les portes à Jowada, était en acier massif, conçue pour arrêter la fumée, le feu, voire une frappe directe de missile. Un autre vigile et des caméras de télévision en circuit fermé surveillaient la descente des passagers. Une fois la porte franchie, un corridor blanchi à la chaux conduisait aux vestiaires, l’un des rares endroits du complexe sans air conditionné. Ravi ouvrit son placard (dont l’intérieur de la porte s’ornait d’une affiche de Shilpa Shetty, une star de Bollywood), et en sortit un casque de sécurité, des lunettes de protection, des protège-tympans et un blouson fluo. Il prit également un trousseau de clés. Comme dans la plupart des centrales nucléaires, il y avait très peu de cartes magnétiques ou de serrures électroniques sur les portes de Jowada. Cela faisait partie des mesures de sûreté : les clés manuelles fonctionnaient en cas de panne de courant.
Toujours muni de sa boîte à outils, Ravi s’engagea dans un autre corridor. Lors de son arrivée ici, il avait été étonné par l’extrême propreté des lieux – surtout en comparaison de la rue où il habitait, creusée de nids-de-poule remplis d’eau stagnante, jonchée de détritus et des déjections des bœufs qui tiraient des charrettes en bois entre les voitures et les autorickshaws1. Il tourna à un angle et arriva au dernier poste de contrôle, l’ultime barrage avant de pénétrer véritablement dans la centrale.
Pour la première fois, Ravi se sentait nerveux. Il savait ce qu’il transportait. Et ce qu’il s’apprêtait à faire. Que se passerait-il s’il était arrêté ? Il finirait sans doute sa vie en prison. On racontait les pires histoires sur la prison centrale de Chennai, où les détenus étaient confinés dans de minuscules cellules souterraines et recevaient une nourriture tellement répugnante que certains préféraient mourir de faim. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. La moindre hésitation, le moindre geste suspect étaient le plus sûr moyen de se faire prendre.
Cette seule pensée lui donnait le vertige. Dans les prochaines heures, il gagnerait plus d’argent qu’au cours des vingt dernières années. Une somme fabuleuse, payée en espèces et en main propre. Une nouvelle vie s’ouvrait devant lui. Bientôt il pourrait offrir à sa femme tout ce qu’elle désirait : des vêtements, une voiture, une alliance de diamant pour remplacer le mince anneau d’or qu’elle portait depuis leur mariage. Il emmènerait leurs deux jeunes fils à Disneyland, en Floride. Il irait à Londres voir jouer l’équipe de cricket indienne sur le célèbre terrain de Lord’s, rêve qu’il avait toujours caressé mais jamais cru possible.
Jusqu’à aujourd’hui.
Il se tenait assis, les épaules voûtées, contre la vitre du bus qui le conduisait au travail, comme chaque jour. Il faisait une chaleur torride. Les ventilateurs étaient en panne, une fois de plus, et bien entendu la compagnie ne se pressait pas pour les remplacer. Et on était au mois de juin, période de l’année connue en Inde du Sud sous le nom d’agni nakshatram. Autrement dit : étoile de feu. Le soleil était impitoyable. On avait du mal à respirer. La chaleur moite vous poissait la peau, de l’aube jusqu’à la nuit. La ville empestait.
Dès qu’il aurait l’argent, Ravi déménagerait. Il abandonnerait le deux pièces exigu qu’il occupait avec sa famille à Perambur, le quartier le plus peuplé de la ville, pour s’installer dans un endroit plus tranquille, plus aéré, plus spacieux. Il aurait un réfrigérateur rempli de bières et un grand écran à plasma. Franchement, ce n’était pas trop demander.
Le bus ralentit. Ravi avait effectué le trajet si souvent qu’il pouvait suivre son parcours les yeux fermés. Ils avaient laissé la ville derrière eux. Dans le lointain se dressaient des collines pentues, tapissées d’une végétation dense d’un vert profond. Mais l’endroit où le bus était arrivé évoquait plutôt un terrain vague, avec quelques palmiers émergeant des gravats, cerné par une forêt de pylônes électriques. La centrale se trouvait juste en face. Dans quelques instants, ils feraient halte à la première grille de sécurité.
Ravi était ingénieur. Son badge d’identité, avec sa photo et son nom complet – Ravindra Manpreet Chandra –, le décrivait comme opérateur d’unité. Il travaillait à la centrale nucléaire de Jowada, à cinq kilomètres au nord de Chennai, quatrième ville de l’Inde, autrefois connue sous le nom de Madras.
Il leva les yeux vers les immenses blocs multicolores, solidement protégés par des kilomètres de clôtures métalliques. Ravi pensait parfois que le fil de fer, sous toutes ses formes, était ce qui définissait le mieux Jowada. Fils barbelés, ronces, herses, fils téléphoniques. Sans compter les milliers de kilomètres de câbles qui acheminaient dans toute l’Inde l’électricité produite par la centrale. Il était étrange de songer que lorsqu’une personne allumait sa télévision à Pondichéry ou sa lampe de chevet à Nellore, le courant venait de Jowada.
Le bus s’arrêta au poste de sécurité, gardé par des sentinelles armées et des caméras de surveillance. Depuis les attaques du 11-Septembre à New York et Washington, toutes les centrales nucléaires du monde entier étaient classées comme cibles terroristes potentielles. À Jowada, on avait ajouté des barrières et augmenté les forces de sécurité. Pendant longtemps, ce surcroît de précautions avait été pénible à vivre : des vigiles étaient prêts à vous sauter dessus au moindre éternuement. Mais ils étaient peu à peu devenus paresseux. Le vieux Suresh, par exemple, qui montait la garde au poste de contrôle extérieur. Il connaissait tous les passagers du bus. Il les voyait à la même heure chaque jour : arrivée à sept heures et sortie à dix-sept heures trente. Parfois, il les rencontrait en ville, quand ils flânaient devant les boutiques de Ranganathan Street. Il connaissait leurs femmes et leurs fiancées. Il ne lui serait pas venu à l’idée de leur demander une pièce d’identité ni de vérifier ce qu’ils apportaient à la centrale. Il fit signe au bus de passer.
Deux minutes plus tard, Ravi en descendit. C’était un petit homme maigre à la peau grêlée, avec une moustache mal perchée au-dessus de la lèvre supérieure. Il était déjà vêtu d’une combinaison de protection et de chaussures à bout renforcé, et portait une boîte à outils. Celle-ci faisait partie de lui, comme un bras ou une jambe.
Le bus s’était immobilisé à côté d’un mur en brique percé d’une porte qui, comme toutes les portes à Jowada, était en acier massif, conçue pour arrêter la fumée, le feu, voire une frappe directe de missile. Un autre vigile et des caméras de télévision en circuit fermé surveillaient la descente des passagers. Une fois la porte franchie, un corridor blanchi à la chaux conduisait aux vestiaires, l’un des rares endroits du complexe sans air conditionné. Ravi ouvrit son placard (dont l’intérieur de la porte s’ornait d’une affiche de Shilpa Shetty, une star de Bollywood), et en sortit un casque de sécurité, des lunettes de protection, des protège-tympans et un blouson fluo. Il prit également un trousseau de clés. Comme dans la plupart des centrales nucléaires, il y avait très peu de cartes magnétiques ou de serrures électroniques sur les portes de Jowada. Cela faisait partie des mesures de sûreté : les clés manuelles fonctionnaient en cas de panne de courant.
Toujours muni de sa boîte à outils, Ravi s’engagea dans un autre corridor. Lors de son arrivée ici, il avait été étonné par l’extrême propreté des lieux – surtout en comparaison de la rue où il habitait, creusée de nids-de-poule remplis d’eau stagnante, jonchée de détritus et des déjections des bœufs qui tiraient des charrettes en bois entre les voitures et les autorickshaws1. Il tourna à un angle et arriva au dernier poste de contrôle, l’ultime barrage avant de pénétrer véritablement dans la centrale.
Pour la première fois, Ravi se sentait nerveux. Il savait ce qu’il transportait. Et ce qu’il s’apprêtait à faire. Que se passerait-il s’il était arrêté ? Il finirait sans doute sa vie en prison. On racontait les pires histoires sur la prison centrale de Chennai, où les détenus étaient confinés dans de minuscules cellules souterraines et recevaient une nourriture tellement répugnante que certains préféraient mourir de faim. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. La moindre hésitation, le moindre geste suspect étaient le plus sûr moyen de se faire prendre.