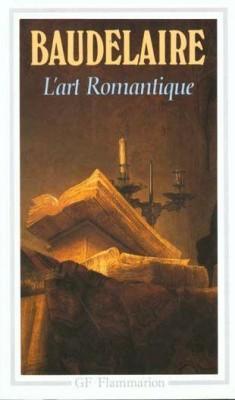Citation de Partemps
RICHARD WAGNER
ET
TANNHÄUSER
À PARIS
I
Remontons, s’il vous plaît, à treize mois en arrière, au commencement de la question, et qu’il me soit permis, dans cette appréciation, de parler souvent en mon nom personnel. Ce Je, accusé justement d’impertinence dans beaucoup de cas, implique cependant une grande modestie ; il enferme l’écrivain dans les limites les plus strictes de la sincérité. En réduisant sa tâche, il la rend plus facile. Enfin, il n’est pas nécessaire d’être un probabiliste bien consommé pour acquérir la certitude que cette sincérité trouvera des amis parmi les lecteurs impartiaux ; il y a évidemment quelques chances pour que le critique ingénu, en ne racontant que ses propres impressions, raconte aussi celles de quelques partisans inconnus.
Donc, il y a treize mois, ce fut une grande rumeur dans Paris. Un compositeur allemand, qui avait vécu longtemps chez nous, à notre insu, pauvre, inconnu, par de misérables besognes, mais que, depuis quinze ans déjà, le public allemand célébrait comme un homme de génie, revenait dans la ville, jadis témoin de ses jeunes misères, soumettre ses œuvres à notre jugement. Paris avait jusque-là peu entendu parler de Wagner ; on savait vaguement qu’au-delà du Rhin s’agitait la question d’une réforme dans le drame lyrique, et que Liszt avait adopté avec ardeur les opinions du réformateur. M. Fétis avait lancé contre lui une espèce de réquisitoire, et les personnes curieuses de feuilleter les numéros de la Revue et Gazette musicale de Paris pourront vérifier une fois de plus que les écrivains qui se vantent de professer les opinions les plus sages, les plus classiques, ne se piquent guère de sagesse ni de mesure, ni même de vulgaire politesse, dans la critique des opinions qui leur sont contraires. Les articles de M. Fétis ne sont guère qu’une diatribe affligeante ; mais l’exaspération du vieux dilettantiste servait seulement à prouver l’importance des œuvres qu’il vouait à l’anathème et au ridicule. D’ailleurs, depuis treize mois, pendant lesquels la curiosité publique ne s’est pas ralentie, Richard Wagner a essuyé bien d’autres injures. Il y a quelques années, au retour d’un voyage en Allemagne, Théophile Gautier, très ému par une représentation de Tannhäuser, avait cependant, dans le Moniteur, traduit ses impressions avec cette certitude plastique qui donne un charme irrésistible à tous ses écrits. Mais ces documents divers, tombant à de lointains intervalles, avaient glissé sur l’esprit de la foule.
Aussitôt que les affiches annoncèrent que Richard Wagner ferait entendre dans la salle des Italiens des fragments de ses compositions, un fait amusant se produisit, que nous avons déjà vu, et qui prouve le besoin instinctif, précipité, des Français, de prendre sur toute chose leur parti avant d’avoir délibéré ou examiné. Les uns annoncèrent des merveilles, et les autres se mirent à dénigrer à outrance des œuvres qu’ils n’avaient pas encore entendues. Encore aujourd’hui dure cette situation bouffonne, et l’on peut dire que jamais sujet inconnu ne fut tant discuté. Bref, les concerts de Wagner s’annonçaient comme une véritable bataille de doctrines, comme une de ces solennelles crises de l’art, une de ces mêlées où critiques, artistes et public ont coutume de jeter confusément toutes leurs passions ; crises heureuses qui dénotent la santé et la richesse dans la vie intellectuelle d’une nation, et que nous avions, pour ainsi dire, désapprises depuis les grands jours de Victor Hugo. J’emprunte les lignes suivantes au feuilleton de M. Berlioz (9 février 1860). « Le foyer du Théâtre-Italien était curieux à observer le soir du premier concert. C’étaient des fureurs, des cris, des discussions qui semblaient toujours sur le point de dégénérer en voies de fait. » Sans la présence du souverain, le même scandale aurait pu se produire, il y a quelques jours, à l’Opéra, surtout avec un public plus vrai. Je me souviens d’avoir vu, à la fin d’une des répétitions générales, un des critiques parisiens accrédités, planté prétentieusement devant le bureau du contrôle, faisant face à la foule au point d’en gêner l’issue, et s’exerçant à rire comme un maniaque, comme un de ces infortunés qui, dans les maisons de santé, sont appelés des agités. Ce pauvre homme, croyant son visage connu de toute la foule, avait l’air de dire : « Voyez comme je ris, moi, le célèbre S… ! » Ainsi ayez soin de conformer votre jugement au mien. » Dans le feuilleton auquel je faisais tout à l’heure allusion, M. Berlioz, qui montra cependant beaucoup moins de chaleur qu’on aurait pu en attendre de sa part, ajoutait : « Ce qui se débite alors de non-sens, d’absurdités et même de mensonges est vraiment prodigieux, et prouve avec évidence que, chez nous au moins, lorsqu’il s’agit d’apprécier une musique différente de celle qui court les rues, la passion, le parti pris prennent seuls la parole et empêchent le bon sens et le bon goût de parler. »
Wagner avait été audacieux : le programme de son concert ne comprenait ni solos d’instruments, ni chansons, ni aucune des exhibitions si chères à un public amoureux des virtuoses et de leurs tours de force. Rien que des morceaux d’ensemble, chœurs ou symphonies. La lutte fut violente, il est vrai ; mais le public, étant abandonné à lui-même, prit feu à quelques-uns de ces irrésistibles morceaux dont la pensée était pour lui plus nettement exprimée, et la musique de Wagner triompha par sa propre force. L’ouverture de Tannhäuser, la marche pompeuse du deuxième acte, l’ouverture de Lohengrin particulièrement, la musique de noces et l’épithalame furent magnifiquement acclamés. Beaucoup de choses restaient obscures sans doute, mais les esprits impartiaux se disaient : « Puisque ces compositions sont faites pour la scène, il faut attendre ; les choses non suffisamment définies seront expliquées par la plastique. » En attendant, il restait avéré que, comme symphoniste, comme artiste traduisant par les mille combinaisons du son les tumultes de l’âme humaine, Richard Wagner était à la hauteur de ce qu’il y a de plus élevé, aussi grand, certes, que les plus grands.
J’ai souvent entendu dire que la musique ne pouvait pas se vanter de traduire quoi que ce soit avec certitude, comme fait la parole ou la peinture. Cela est vrai dans une certaine proportion, mais n’est pas tout à fait vrai. Elle traduit à sa manière, et par les moyens qui lui sont propres. Dans la musique, comme dans la peinture et même dans la parole écrite, qui est cependant le plus positif des arts, il y a toujours une lacune complétée par l’imagination de l’auditeur.
Ce sont sans doute ces considérations qui ont poussé Wagner à considérer l’art dramatique, c’est-à-dire la réunion, la coïncidence de plusieurs arts, comme l’art par excellence, le plus synthétique et le plus parfait. Or, si nous écartons un instant le secours de la plastique, du décor, de l’incorporation des types rêvés dans des comédiens vivants, et même de la parole chantée, il reste encore incontestable que plus la musique est éloquente, plus la suggestion est rapide et juste, et plus il y a de chances pour que les hommes sensibles conçoivent des idées en rapport avec celles qui inspiraient l’artiste. Je prends tout de suite un exemple, la fameuse ouverture de Lohengrin, dont M. Berlioz a écrit un magnifique éloge en style technique ; mais je veux me contenter ici d’en vérifier la valeur par les suggestions qu’elle procure.
Je lis dans le programme distribué à cette époque au Théâtre-Italien : « Dès les premières mesures, l’âme du pieux solitaire qui attend le vase sacré plonge dans les espaces infinis. Il voit se former peu à peu une apparition étrange qui prend un corps, une figure. Cette apparition se précise davantage, et la troupe miraculeuse des anges, portant au milieu d’eux la coupe sacrée, passe devant lui. Le saint cortège approche ; le cœur de l’élu de Dieu s’exalte peu à peu ; il s’élargit, il se dilate ; d’ineffables aspirations s’éveillent en lui ; il cède à une béatitude croissante, en se trouvant toujours rapproché de la lumineuse apparition, et quand enfin le Saint-Graal lui-même apparaît au milieu du cortège sacré, il s’abîme dans une adoration extatique, comme si le monde entier eût soudainement disparu.
Cependant le Saint-Graal répand ses bénédictions sur le saint en prière et le consacre son chevalier. Puis les flammes brûlantes adoucissent progressivement leur éclat ; dans sa sainte allégresse, la troupe des anges, souriant à la terre qu’elle abandonne, regagne les célestes hauteurs. Elle a laissé le Saint-Graal à la garde des hommes purs, dans le cœur desquels la divine liqueur s’est répandue, et l’auguste troupe s’évanouit dans les profondeurs de l’espace, de la même manière qu’elle en était sortie. »
Le lecteur comprendra tout à l’heure pourquoi je souligne ces passages. Je prends maintenant le livre de Liszt, et je l’ouvre à la page où l’imagination de l’illustre pianiste (qui est un artiste et un philosophe) traduit à sa manière le même morceau :
« Cette introduction renferme et révèle l’élément mystique, toujours présent et toujours caché dans la pièce… Pour nous apprendre l’inénarrable puissance de ce secret, Wagner nous montre d’abord la beauté ineffable du sanctuaire, habité par un Dieu qui venge les opprimés et ne demande qu’amour et foi à ses fidèles. Il nous initie au Saint-Graal ; il fait miroiter à nos yeux le temple de bois incorruptible, aux murs odorants, aux portes d’or, aux solives d’asbeste, aux colonnes d’opale, aux parois de cymophane, dont les splendides portiques ne sont approchés que de ceux qui ont le cœur élevé et les mains pures. Il ne nous le fait point apercevoir dans son imposante et réelle structure, mais, comme ménageant nos faibles sens, il nous le montre d’abord reflété dans quelque onde azurée ou reproduit par quelque nuage irisé.
ET
TANNHÄUSER
À PARIS
I
Remontons, s’il vous plaît, à treize mois en arrière, au commencement de la question, et qu’il me soit permis, dans cette appréciation, de parler souvent en mon nom personnel. Ce Je, accusé justement d’impertinence dans beaucoup de cas, implique cependant une grande modestie ; il enferme l’écrivain dans les limites les plus strictes de la sincérité. En réduisant sa tâche, il la rend plus facile. Enfin, il n’est pas nécessaire d’être un probabiliste bien consommé pour acquérir la certitude que cette sincérité trouvera des amis parmi les lecteurs impartiaux ; il y a évidemment quelques chances pour que le critique ingénu, en ne racontant que ses propres impressions, raconte aussi celles de quelques partisans inconnus.
Donc, il y a treize mois, ce fut une grande rumeur dans Paris. Un compositeur allemand, qui avait vécu longtemps chez nous, à notre insu, pauvre, inconnu, par de misérables besognes, mais que, depuis quinze ans déjà, le public allemand célébrait comme un homme de génie, revenait dans la ville, jadis témoin de ses jeunes misères, soumettre ses œuvres à notre jugement. Paris avait jusque-là peu entendu parler de Wagner ; on savait vaguement qu’au-delà du Rhin s’agitait la question d’une réforme dans le drame lyrique, et que Liszt avait adopté avec ardeur les opinions du réformateur. M. Fétis avait lancé contre lui une espèce de réquisitoire, et les personnes curieuses de feuilleter les numéros de la Revue et Gazette musicale de Paris pourront vérifier une fois de plus que les écrivains qui se vantent de professer les opinions les plus sages, les plus classiques, ne se piquent guère de sagesse ni de mesure, ni même de vulgaire politesse, dans la critique des opinions qui leur sont contraires. Les articles de M. Fétis ne sont guère qu’une diatribe affligeante ; mais l’exaspération du vieux dilettantiste servait seulement à prouver l’importance des œuvres qu’il vouait à l’anathème et au ridicule. D’ailleurs, depuis treize mois, pendant lesquels la curiosité publique ne s’est pas ralentie, Richard Wagner a essuyé bien d’autres injures. Il y a quelques années, au retour d’un voyage en Allemagne, Théophile Gautier, très ému par une représentation de Tannhäuser, avait cependant, dans le Moniteur, traduit ses impressions avec cette certitude plastique qui donne un charme irrésistible à tous ses écrits. Mais ces documents divers, tombant à de lointains intervalles, avaient glissé sur l’esprit de la foule.
Aussitôt que les affiches annoncèrent que Richard Wagner ferait entendre dans la salle des Italiens des fragments de ses compositions, un fait amusant se produisit, que nous avons déjà vu, et qui prouve le besoin instinctif, précipité, des Français, de prendre sur toute chose leur parti avant d’avoir délibéré ou examiné. Les uns annoncèrent des merveilles, et les autres se mirent à dénigrer à outrance des œuvres qu’ils n’avaient pas encore entendues. Encore aujourd’hui dure cette situation bouffonne, et l’on peut dire que jamais sujet inconnu ne fut tant discuté. Bref, les concerts de Wagner s’annonçaient comme une véritable bataille de doctrines, comme une de ces solennelles crises de l’art, une de ces mêlées où critiques, artistes et public ont coutume de jeter confusément toutes leurs passions ; crises heureuses qui dénotent la santé et la richesse dans la vie intellectuelle d’une nation, et que nous avions, pour ainsi dire, désapprises depuis les grands jours de Victor Hugo. J’emprunte les lignes suivantes au feuilleton de M. Berlioz (9 février 1860). « Le foyer du Théâtre-Italien était curieux à observer le soir du premier concert. C’étaient des fureurs, des cris, des discussions qui semblaient toujours sur le point de dégénérer en voies de fait. » Sans la présence du souverain, le même scandale aurait pu se produire, il y a quelques jours, à l’Opéra, surtout avec un public plus vrai. Je me souviens d’avoir vu, à la fin d’une des répétitions générales, un des critiques parisiens accrédités, planté prétentieusement devant le bureau du contrôle, faisant face à la foule au point d’en gêner l’issue, et s’exerçant à rire comme un maniaque, comme un de ces infortunés qui, dans les maisons de santé, sont appelés des agités. Ce pauvre homme, croyant son visage connu de toute la foule, avait l’air de dire : « Voyez comme je ris, moi, le célèbre S… ! » Ainsi ayez soin de conformer votre jugement au mien. » Dans le feuilleton auquel je faisais tout à l’heure allusion, M. Berlioz, qui montra cependant beaucoup moins de chaleur qu’on aurait pu en attendre de sa part, ajoutait : « Ce qui se débite alors de non-sens, d’absurdités et même de mensonges est vraiment prodigieux, et prouve avec évidence que, chez nous au moins, lorsqu’il s’agit d’apprécier une musique différente de celle qui court les rues, la passion, le parti pris prennent seuls la parole et empêchent le bon sens et le bon goût de parler. »
Wagner avait été audacieux : le programme de son concert ne comprenait ni solos d’instruments, ni chansons, ni aucune des exhibitions si chères à un public amoureux des virtuoses et de leurs tours de force. Rien que des morceaux d’ensemble, chœurs ou symphonies. La lutte fut violente, il est vrai ; mais le public, étant abandonné à lui-même, prit feu à quelques-uns de ces irrésistibles morceaux dont la pensée était pour lui plus nettement exprimée, et la musique de Wagner triompha par sa propre force. L’ouverture de Tannhäuser, la marche pompeuse du deuxième acte, l’ouverture de Lohengrin particulièrement, la musique de noces et l’épithalame furent magnifiquement acclamés. Beaucoup de choses restaient obscures sans doute, mais les esprits impartiaux se disaient : « Puisque ces compositions sont faites pour la scène, il faut attendre ; les choses non suffisamment définies seront expliquées par la plastique. » En attendant, il restait avéré que, comme symphoniste, comme artiste traduisant par les mille combinaisons du son les tumultes de l’âme humaine, Richard Wagner était à la hauteur de ce qu’il y a de plus élevé, aussi grand, certes, que les plus grands.
J’ai souvent entendu dire que la musique ne pouvait pas se vanter de traduire quoi que ce soit avec certitude, comme fait la parole ou la peinture. Cela est vrai dans une certaine proportion, mais n’est pas tout à fait vrai. Elle traduit à sa manière, et par les moyens qui lui sont propres. Dans la musique, comme dans la peinture et même dans la parole écrite, qui est cependant le plus positif des arts, il y a toujours une lacune complétée par l’imagination de l’auditeur.
Ce sont sans doute ces considérations qui ont poussé Wagner à considérer l’art dramatique, c’est-à-dire la réunion, la coïncidence de plusieurs arts, comme l’art par excellence, le plus synthétique et le plus parfait. Or, si nous écartons un instant le secours de la plastique, du décor, de l’incorporation des types rêvés dans des comédiens vivants, et même de la parole chantée, il reste encore incontestable que plus la musique est éloquente, plus la suggestion est rapide et juste, et plus il y a de chances pour que les hommes sensibles conçoivent des idées en rapport avec celles qui inspiraient l’artiste. Je prends tout de suite un exemple, la fameuse ouverture de Lohengrin, dont M. Berlioz a écrit un magnifique éloge en style technique ; mais je veux me contenter ici d’en vérifier la valeur par les suggestions qu’elle procure.
Je lis dans le programme distribué à cette époque au Théâtre-Italien : « Dès les premières mesures, l’âme du pieux solitaire qui attend le vase sacré plonge dans les espaces infinis. Il voit se former peu à peu une apparition étrange qui prend un corps, une figure. Cette apparition se précise davantage, et la troupe miraculeuse des anges, portant au milieu d’eux la coupe sacrée, passe devant lui. Le saint cortège approche ; le cœur de l’élu de Dieu s’exalte peu à peu ; il s’élargit, il se dilate ; d’ineffables aspirations s’éveillent en lui ; il cède à une béatitude croissante, en se trouvant toujours rapproché de la lumineuse apparition, et quand enfin le Saint-Graal lui-même apparaît au milieu du cortège sacré, il s’abîme dans une adoration extatique, comme si le monde entier eût soudainement disparu.
Cependant le Saint-Graal répand ses bénédictions sur le saint en prière et le consacre son chevalier. Puis les flammes brûlantes adoucissent progressivement leur éclat ; dans sa sainte allégresse, la troupe des anges, souriant à la terre qu’elle abandonne, regagne les célestes hauteurs. Elle a laissé le Saint-Graal à la garde des hommes purs, dans le cœur desquels la divine liqueur s’est répandue, et l’auguste troupe s’évanouit dans les profondeurs de l’espace, de la même manière qu’elle en était sortie. »
Le lecteur comprendra tout à l’heure pourquoi je souligne ces passages. Je prends maintenant le livre de Liszt, et je l’ouvre à la page où l’imagination de l’illustre pianiste (qui est un artiste et un philosophe) traduit à sa manière le même morceau :
« Cette introduction renferme et révèle l’élément mystique, toujours présent et toujours caché dans la pièce… Pour nous apprendre l’inénarrable puissance de ce secret, Wagner nous montre d’abord la beauté ineffable du sanctuaire, habité par un Dieu qui venge les opprimés et ne demande qu’amour et foi à ses fidèles. Il nous initie au Saint-Graal ; il fait miroiter à nos yeux le temple de bois incorruptible, aux murs odorants, aux portes d’or, aux solives d’asbeste, aux colonnes d’opale, aux parois de cymophane, dont les splendides portiques ne sont approchés que de ceux qui ont le cœur élevé et les mains pures. Il ne nous le fait point apercevoir dans son imposante et réelle structure, mais, comme ménageant nos faibles sens, il nous le montre d’abord reflété dans quelque onde azurée ou reproduit par quelque nuage irisé.