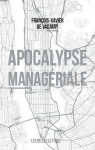Citations de François-Xavier de Vaujany (6)
Les modes d’activité collective et les infrastructures dans lesquelles elles s’insèrent contribuent aux continuités et surtout, aux discontinuités nécessaires à la visibilité et à la pérennité du management d’aujourd’hui. Le phénomène managérial est ainsi surtout fait de « changements », « modernisations », « performances », « nouveautés », « innovations », « disruptions » et de « modes ». Il faut montrer que les produits et les pratiques d’aujourd’hui sont déjà « inadaptés », « décalés », « démodés ».
Cela passe par la production de grands récits. Le manager est un narrateur exprimant le plus matériellement possible son histoire. Les interfaces, les visuels, les prototypes, les formes du produit physique ou numérique, les slogans, le rythme des renouvellements des offres, les algorithmes des plateformes, constituent la trame d’une histoire sans fin. Telle Shéhérazade dans les Mille et Une Nuits, les acteurs du management proposent un récit dont l’interruption provisoire nourrit sa propre dynamique. Chaque incomplétude ouvre sur l’incomplétude suivante. L’histoire devient un recommencement continu. La matière même du récit digital (les produits) sont périssables, inscrits dans un récit plus large les condamnant à être dépassés par l’instant d’après. En arrière-plan, la planète tout entière est une « ressource » infinie exploitée par une narration elle-même infinie. La spatialité inépuisable de la première est la condition de la temporalité accélérée de la seconde.
Les apocalypses managériales doivent être resituées dans ce devenir recommencé.
Cela passe par la production de grands récits. Le manager est un narrateur exprimant le plus matériellement possible son histoire. Les interfaces, les visuels, les prototypes, les formes du produit physique ou numérique, les slogans, le rythme des renouvellements des offres, les algorithmes des plateformes, constituent la trame d’une histoire sans fin. Telle Shéhérazade dans les Mille et Une Nuits, les acteurs du management proposent un récit dont l’interruption provisoire nourrit sa propre dynamique. Chaque incomplétude ouvre sur l’incomplétude suivante. L’histoire devient un recommencement continu. La matière même du récit digital (les produits) sont périssables, inscrits dans un récit plus large les condamnant à être dépassés par l’instant d’après. En arrière-plan, la planète tout entière est une « ressource » infinie exploitée par une narration elle-même infinie. La spatialité inépuisable de la première est la condition de la temporalité accélérée de la seconde.
Les apocalypses managériales doivent être resituées dans ce devenir recommencé.
L’attente est là, mais l’attente n’est plus. Déjà engagé dans le flux digital, le moment d’après n’est plus vraiment attendu. On revient encore et toujours vers cette bulle éternelle, cette grande continuité mesure de toutes nos discontinuités, de ce qui « nous arrive ».
Avec l’instantanéité du digital, l’attente trop évidente devient intolérable. Seuls face à nous-même, nous devenons comptables du temps perdu.
Avec l’instantanéité du digital, l’attente trop évidente devient intolérable. Seuls face à nous-même, nous devenons comptables du temps perdu.
Il est temps de quitter Beekman Place et de laisser le Petit Prince continuer à interroger le monde. Notre promenade nous amène maintenant à aller plus haut sur l’île de Manhattan, pour quitter le sud de Central Park et marcher deux blocs à l’est de celui-ci.
En plein milieu du séjour new-yorkais de Saint-Exupéry (en 1942), mais également trois ans plus tard en 1946, les ingénieurs d’un nouveau monde sont au travail. Le rêve saint-exupérien d’une planète couverte de boutons va bientôt devenir réalité.
En plein milieu du séjour new-yorkais de Saint-Exupéry (en 1942), mais également trois ans plus tard en 1946, les ingénieurs d’un nouveau monde sont au travail. Le rêve saint-exupérien d’une planète couverte de boutons va bientôt devenir réalité.
Aujourd’hui, nombre des événements du monde sont digitaux. Si dans la grammaire des réseaux sociaux, des blogues, des systèmes divers de messagerie, le « je » a une place visible (sans doute trop visible), il n’est pas encore une subjectivité. Plaçant d’emblée l’utilisateur à la première personne, le situant bien au centre d’un écran (« son » écran), l’hébergeant dans le pli de l’interface, il n’ouvre pas à la durée, à la résistance et à l’affect dont toute subjectivité a besoin pour s’exprimer.
Mais la question du digital n’est pas seulement dans l’extraordinaire de ces empiétements. Elle est aussi dans tout ce que fait la digitalité sans quitter le chemin de notre vie ordinaire, avec notre complicité. Le digital assigne des rôles ou des statuts, alloue des moyens, hiérarchise l’information, arbitre des priorités, anime des processus, transforme l’expérience en service, produit des valeurs amplifiées par sa connectivité, autant de fonctions traditionnellement assurées par le management. Il le fait instantanément, loin de la temporalité d’une pensée « humaine ». Les techniques de Google, Facebook, Amazon et Apple sont si simples. Elles sont pour nous une médiation invisible. On a tous l’impression de converser directement avec nos données, avec nos proches, avec nos outils. La digitalité s’efface pour mieux nous accompagner et nous contrôler. Avec les « techniques de quantification de soi », le digital va même jusqu’à mesurer et catégoriser tout notre être physique, biologique et social. Notre individualité devient un événement digital.
Ces dernières années , j’ai pu parcourir longuement l’espace strié de Manhattan, du nord au sud, du sud au nord, de l’est à l’ouest, de l’ouest à l’est… Je me suis parfois senti happé par les grandes avenues, ces perspectives pleines de promesses bien droites. J’ai alors recherché un lieu de pause, un banc, une oasis de calme, sans les trouver. De nombreux espoirs de repos ont été déçus. S’asseoir sur les marches d’une Brownstone House n’a pas toujours été un moment heureux. On y trouve vite la compagnie que l’on ne cherchait pas.
Parfois, je suis entré à l’intérieur de magasins pour me glisser dans cette bulle rêvée de l’extérieur. En quête de repos, je n’y ai trouvé que mouvement.
Plus étrange. À New York, je me suis également senti « handicapé », incapable d’être et d’agir dans cette ville-horizon handicapante. Le handicap n’est pas seulement un « faire » que l’on ne peut pas ou que l’on ne peut plus, un potentiel d’activités perdu. Il est aussi et surtout ces passivités désormais absentes. On ne peut pas ou on ne peut plus faire confiance à son corps, le laisser en sommeil dans l’activité. Il faut « faire attention », peut-être même plus attention. Par « attention », je n’entends pas quelque chose de cognitif, comme avoir son « esprit » focalisé en permanence sur quelque chose. J’entends plutôt une tension très physique. Une émotion sans achèvement. Quelque part, le corps d’un handicapé est plus grand que celui des autres. Il ou elle ne peut pas s’autoriser les multiples passivités des gens dits « normaux ».
Lors de mes marches à New York, j’ai parfois senti cela. Cette bande-son permanente sature tout le champ auditif. Elle crée une tension dans nos oreilles. Les sirènes des ambulances et des camions de pompiers, le bruit métallique du métro, les klaxons, ces personnes marchant un petit baffle audio en bandoulière, ces conversations criées sur le kit main libre d’un smartphone… tout concourt à ce grand vacarme sans fin. Ces immeubles répétés à l’infini, cette circulation, ces paquets livrés partout, les annonces publicitaires et les panneaux lumineux, ces corps marchant trop vite, tous saturent le champ visuel. Il faut là aussi « faire » attention et reprojeter en permanence son espace. Les odeurs multiples prennent le nez. Odeurs de « fast-foods » et de gras, sorties fumantes sur la rue et les trottoirs, respiration de l’humidité marine, incinérateur dont le souffle est rabattu par le vent…, ces senteurs sont suspendues partout dans l’air. Le champ gustatif n’est pas en reste. Toutes les gastronomies se retrouvent à Manhattan. Et notre tactilité ne sait plus trop où donner des pieds et des mains. On marche sur tous les types de sol à New York, de la terre de Central Park aux rues pavées de Greenwhich Village en passant par les tapis moelleux des magasins de luxe de Park Avenue. On touche le béton le plus mort comme on est touché par le vent marin le plus vivant.
Dans le sens de cette réflexion, je me demande parfois si New York n’est pas une ville handicapée. Une ville avec un corps trop grand pour elle. Une ville avec un corps trop grand pour nous.
Parfois, je suis entré à l’intérieur de magasins pour me glisser dans cette bulle rêvée de l’extérieur. En quête de repos, je n’y ai trouvé que mouvement.
Plus étrange. À New York, je me suis également senti « handicapé », incapable d’être et d’agir dans cette ville-horizon handicapante. Le handicap n’est pas seulement un « faire » que l’on ne peut pas ou que l’on ne peut plus, un potentiel d’activités perdu. Il est aussi et surtout ces passivités désormais absentes. On ne peut pas ou on ne peut plus faire confiance à son corps, le laisser en sommeil dans l’activité. Il faut « faire attention », peut-être même plus attention. Par « attention », je n’entends pas quelque chose de cognitif, comme avoir son « esprit » focalisé en permanence sur quelque chose. J’entends plutôt une tension très physique. Une émotion sans achèvement. Quelque part, le corps d’un handicapé est plus grand que celui des autres. Il ou elle ne peut pas s’autoriser les multiples passivités des gens dits « normaux ».
Lors de mes marches à New York, j’ai parfois senti cela. Cette bande-son permanente sature tout le champ auditif. Elle crée une tension dans nos oreilles. Les sirènes des ambulances et des camions de pompiers, le bruit métallique du métro, les klaxons, ces personnes marchant un petit baffle audio en bandoulière, ces conversations criées sur le kit main libre d’un smartphone… tout concourt à ce grand vacarme sans fin. Ces immeubles répétés à l’infini, cette circulation, ces paquets livrés partout, les annonces publicitaires et les panneaux lumineux, ces corps marchant trop vite, tous saturent le champ visuel. Il faut là aussi « faire » attention et reprojeter en permanence son espace. Les odeurs multiples prennent le nez. Odeurs de « fast-foods » et de gras, sorties fumantes sur la rue et les trottoirs, respiration de l’humidité marine, incinérateur dont le souffle est rabattu par le vent…, ces senteurs sont suspendues partout dans l’air. Le champ gustatif n’est pas en reste. Toutes les gastronomies se retrouvent à Manhattan. Et notre tactilité ne sait plus trop où donner des pieds et des mains. On marche sur tous les types de sol à New York, de la terre de Central Park aux rues pavées de Greenwhich Village en passant par les tapis moelleux des magasins de luxe de Park Avenue. On touche le béton le plus mort comme on est touché par le vent marin le plus vivant.
Dans le sens de cette réflexion, je me demande parfois si New York n’est pas une ville handicapée. Une ville avec un corps trop grand pour elle. Une ville avec un corps trop grand pour nous.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Lecteurs de François-Xavier de Vaujany (4)Voir plus
Quiz
Voir plus
Interro surprise(1) :))
De quelle figure féminine du xxe siècle est-il question dans "Alabama Song" de Gilles Leroy, prix Goncourt 2007 ?
Nina Simone
Frida Kahlo
Bette Davis
Zelda Fitzgerald
Simone de Beauvoir
14 questions
71 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, histoire
, peinture
, musique
, écrivainCréer un quiz sur cet auteur71 lecteurs ont répondu