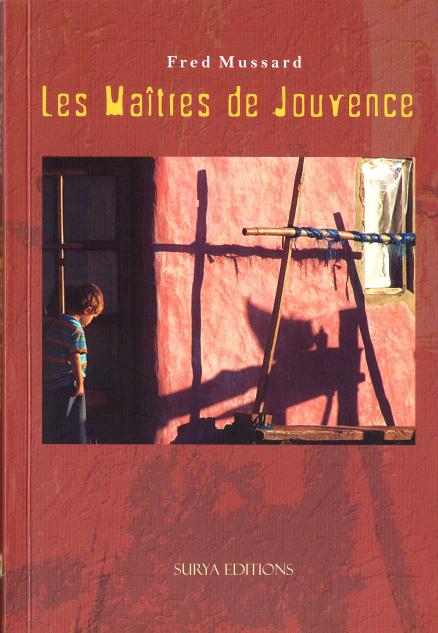Nationalité : France
Né(e) à : Saint-Joseph, La Réunion , le 19/10/1953
Né(e) à : Saint-Joseph, La Réunion , le 19/10/1953
Biographie :
Fred Mussard est un écrivain.
Ancien élève de l'École normale de Saint-Denis, il a exercé une dizaine d'années en tant qu'instituteur dans différentes écoles.
En 1983, il est admis au concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel. Après une année de formation à l'ENNA (école normale nationale d'apprentissage) de Toulouse, il retourne à la Réunion.
Depuis 1986, il a enseigné le français et l'histoire-géographie au lycée professionnel Paul Langevin, de Saint-Joseph.
Fred Mussard a publié son premier roman, "Rutile, esclave à Bourbon", en 2003. Une dizaine d'ouvrages suivront.
Il fut membre de l’Académie de l’Ile de La Réunion de 2012 à 2018.
Il vit à Saint-Joseph, île de La Réunion.
son site : https://www.jeanfredmussard.fr/accueil?mobile=true
+ Voir plusFred Mussard est un écrivain.
Ancien élève de l'École normale de Saint-Denis, il a exercé une dizaine d'années en tant qu'instituteur dans différentes écoles.
En 1983, il est admis au concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel. Après une année de formation à l'ENNA (école normale nationale d'apprentissage) de Toulouse, il retourne à la Réunion.
Depuis 1986, il a enseigné le français et l'histoire-géographie au lycée professionnel Paul Langevin, de Saint-Joseph.
Fred Mussard a publié son premier roman, "Rutile, esclave à Bourbon", en 2003. Une dizaine d'ouvrages suivront.
Il fut membre de l’Académie de l’Ile de La Réunion de 2012 à 2018.
Il vit à Saint-Joseph, île de La Réunion.
son site : https://www.jeanfredmussard.fr/accueil?mobile=true
Source : www.adbenreunion.com
Ajouter des informations
étiquettes
Citations et extraits (11)
Voir plus
Ajouter une citation
L'origine des esclaves et leur transport vers les colonies
Les marchands utilisaient toutes sortes de stratagèmes pour faire paraître leurs esclaves plus jeunes, plus gras et mieux portants. Quelques jours avant la vente, pour mieux tromper les acheteurs, on leur enduisait la peau d’huile de palmier et on les faisait manger et boire à volonté. Cependant, les acheteurs blancs avaient plus d’un tour dans leur sac. Ils dépouillaient les Noirs de tout ce qui leur tenait lieu de vêtement et les inspectaient dans les moindres détails, y compris dans les parties les plus intimes de leur anatomie. Ils leur faisaient ouvrir la bouche, tirer la langue, courir, sauter… Maman se souvenait même avoir vu un Blanc lécher le menton de quelques hommes : il tâchait ainsi de s’assurer, grâce au goût de la sueur, qu’ils n’étaient pas malades et que le poil de leur menton n’indiquait pas un âge plus avancé que l’apparence le laissait croire.
Grâce à ces précautions, étaient impitoyablement écartés les vieux Nègres à peau ridée et testicules pendants, les Nègres efflanqués aux yeux égarés. Quant à ma mère, elle fut du premier coup d’œil cataloguée « pièce d’Inde », c’est-à-dire évaluée au plus haut prix que pouvait atteindre une esclave : elle avait toutes ses dents, elle ne boitait pas et au surplus passait pour être jolie. Sa grossesse, dont on s’aperçut à ce moment-là, contribua encore à augmenter son prix. A titre de comparaison, avec l’argent que le capitaine avait dépensé pour l’avoir, il aurait pu acheter à Bourbon une douzaine de fusils ou de pièces de toile bleue.
Le voyage qui sembla durer une éternité fut très pénible autant pour l’équipage que pour la cargaison de bétail humain. Chaque esclave devait se contenter d’un espace calculé au plus juste de quarante centimètres en largeur et quatre-vingt-trois en hauteur. Les hommes, enchaînés deux par deux, subissaient des contraintes humiliantes et parfois fatales. Quand un désespéré se jetait à l’eau – ce qui arrivait surtout au début du voyage, beaucoup ne supportant pas de quitter à jamais les côtes africaines –, il entraînait son compagnon dans la mort. Les femmes et les enfants étaient libres durant la journée, mais la nuit, eux aussi souffraient de l’entassement.
L’entrepont, où les esclaves enchaînés étaient réduits à faire leurs besoins sur place, dégageait une odeur insoutenable d’excréments et de vomissures. Dans la journée, quand le temps le permettait, on rassemblait les captifs sur le pont. Les matelots en profitaient pour les nettoyer à l’eau de mer, pour désinfecter l’entrepont au vinaigre et y brûler de la poudre. Pour lutter contre l’ankylose des nuits, on les occupait à des exercices physiques et à des travaux manuels. Les jours de beau temps, le tillac se transformait en village d’artisans : on enfilait des perles, on tressait des cordes, on fabriquait des paniers. Quelquefois, sur le pont devenu salle de bal, on dansait au son d’un orchestre improvisé par des matelots musiciens. Ce n’était pas de bon cœur : ceux qui refusaient de gambiller étaient fouettés.
Les marchands utilisaient toutes sortes de stratagèmes pour faire paraître leurs esclaves plus jeunes, plus gras et mieux portants. Quelques jours avant la vente, pour mieux tromper les acheteurs, on leur enduisait la peau d’huile de palmier et on les faisait manger et boire à volonté. Cependant, les acheteurs blancs avaient plus d’un tour dans leur sac. Ils dépouillaient les Noirs de tout ce qui leur tenait lieu de vêtement et les inspectaient dans les moindres détails, y compris dans les parties les plus intimes de leur anatomie. Ils leur faisaient ouvrir la bouche, tirer la langue, courir, sauter… Maman se souvenait même avoir vu un Blanc lécher le menton de quelques hommes : il tâchait ainsi de s’assurer, grâce au goût de la sueur, qu’ils n’étaient pas malades et que le poil de leur menton n’indiquait pas un âge plus avancé que l’apparence le laissait croire.
Grâce à ces précautions, étaient impitoyablement écartés les vieux Nègres à peau ridée et testicules pendants, les Nègres efflanqués aux yeux égarés. Quant à ma mère, elle fut du premier coup d’œil cataloguée « pièce d’Inde », c’est-à-dire évaluée au plus haut prix que pouvait atteindre une esclave : elle avait toutes ses dents, elle ne boitait pas et au surplus passait pour être jolie. Sa grossesse, dont on s’aperçut à ce moment-là, contribua encore à augmenter son prix. A titre de comparaison, avec l’argent que le capitaine avait dépensé pour l’avoir, il aurait pu acheter à Bourbon une douzaine de fusils ou de pièces de toile bleue.
Le voyage qui sembla durer une éternité fut très pénible autant pour l’équipage que pour la cargaison de bétail humain. Chaque esclave devait se contenter d’un espace calculé au plus juste de quarante centimètres en largeur et quatre-vingt-trois en hauteur. Les hommes, enchaînés deux par deux, subissaient des contraintes humiliantes et parfois fatales. Quand un désespéré se jetait à l’eau – ce qui arrivait surtout au début du voyage, beaucoup ne supportant pas de quitter à jamais les côtes africaines –, il entraînait son compagnon dans la mort. Les femmes et les enfants étaient libres durant la journée, mais la nuit, eux aussi souffraient de l’entassement.
L’entrepont, où les esclaves enchaînés étaient réduits à faire leurs besoins sur place, dégageait une odeur insoutenable d’excréments et de vomissures. Dans la journée, quand le temps le permettait, on rassemblait les captifs sur le pont. Les matelots en profitaient pour les nettoyer à l’eau de mer, pour désinfecter l’entrepont au vinaigre et y brûler de la poudre. Pour lutter contre l’ankylose des nuits, on les occupait à des exercices physiques et à des travaux manuels. Les jours de beau temps, le tillac se transformait en village d’artisans : on enfilait des perles, on tressait des cordes, on fabriquait des paniers. Quelquefois, sur le pont devenu salle de bal, on dansait au son d’un orchestre improvisé par des matelots musiciens. Ce n’était pas de bon cœur : ceux qui refusaient de gambiller étaient fouettés.
A la question « Pourquoi voulez-vous rejoindre notre association ? » il explique d’abord qu’il s’ennuie ferme depuis qu’il a abandonné ses fonctions de chef d’entreprise. Après plusieurs mois de farniente, de voyages, de repas conviviaux, de grasse matinée et de sieste ; après avoir épuisé toutes les facettes de la jouissance oisive, il est parvenu à un point de saturation insupportable. Au terme d’une longue réflexion, il a fini par comprendre qu’il devait donner un nouveau sens à sa vie s’il ne voulait pas sombrer dans la médiocrité et ressentir le reste de sa vie un malaise profond et indéfinissable. Ainsi, était-il arrivé à la conclusion que « faire œuvre utile » était le remède absolu pour sortir du marasme dans lequel l’avait plongé une trop longue inaction.
Pressé de questions, il répond avec tact et bon sens.
- Il existe des quantités d’associations dans lesquelles un retraité dynamique peut encore s’épanouir, dit Gérard. Pourquoi choisir la nôtre précisément ?
- Certes, je pourrais militer dans une de ces organisations non gouvernementales à vocation humanitaire qui courent le monde, à la recherche de victimes à secourir. Mais il me semble que les volontaires pour ce genre de mission ne manquent pas. Et je serai franc avec vous : j’aime ce qui est nouveau, original, sensationnel. Avec vous, on ne sait pas où on va : c’est précisément ce qui me plaît. Dans les activités que vous proposez il y a de la place pour les trois i : initiative, innovation, improvisation. Il n’y a rien de tel qu’un peu de fantaisie pour agrémenter les vieux jours d’un homme qui a été hyperactif durant sa vie.
- Vous n’avez pas de petits-enfants à gâter ?
- Le destin a voulu que je ne laisse pas de descendance et ma femme est morte il y a trois ans. Je n’ai pas eu le courage d’adopter l’enfant d’un inconnu.
Pressé de questions, il répond avec tact et bon sens.
- Il existe des quantités d’associations dans lesquelles un retraité dynamique peut encore s’épanouir, dit Gérard. Pourquoi choisir la nôtre précisément ?
- Certes, je pourrais militer dans une de ces organisations non gouvernementales à vocation humanitaire qui courent le monde, à la recherche de victimes à secourir. Mais il me semble que les volontaires pour ce genre de mission ne manquent pas. Et je serai franc avec vous : j’aime ce qui est nouveau, original, sensationnel. Avec vous, on ne sait pas où on va : c’est précisément ce qui me plaît. Dans les activités que vous proposez il y a de la place pour les trois i : initiative, innovation, improvisation. Il n’y a rien de tel qu’un peu de fantaisie pour agrémenter les vieux jours d’un homme qui a été hyperactif durant sa vie.
- Vous n’avez pas de petits-enfants à gâter ?
- Le destin a voulu que je ne laisse pas de descendance et ma femme est morte il y a trois ans. Je n’ai pas eu le courage d’adopter l’enfant d’un inconnu.
Lorsque nous franchissons l’entrée de la réserve de Nahampohana, nous savons qu’il faudra compter avec la pluie dans le courant de la matinée : le ciel gris et très bas ne présage rien de bon. Passons pour le confort de la promenade, pourvu que cela ne nous empêche pas de lever le nez pour observer les habitants des lieux et les spécimens végétaux soigneusement conservés !
Assurément, les solides bâtiments de pierre et les charrues rouillées de Nahampohana portent encore la marque de son passé colonial. Les premiers êtres à nous accueillir dans ce parc magnifiquement entretenu sont les lémuriens. Je ne dis pas qu’ils viennent de suite nous trotter entre les jambes : ces primates sont trop malins et méfiants pour s’approcher de leurs cousins bipèdes, avant de les avoir sérieusement étudiés. Ils nous examinent d’abord de loin, discrètement, assis ou gambadant sur le toit de chaume de la bâtisse abritant la réception et le restaurant du domaine. Même les bananes dont ils raffolent ne suffisent pas à les faire descendre tout de suite de leur perchoir. Arias, lycéen de dix-huit ans qui profite de ses vacances pour se faire un peu d’argent de poche en guidant les touristes dans le parc, n’a pas son pareil pour faire réagir les lémuriens. « Makimakimakimakiiiii ! » lance-t-il d’une voix stridente en agitant une banane dont la couleur jaune vif contraste avec le vert du gazon et des massifs de camélias. Aussitôt ils arrivent l’un après l’autre, plantés sur leurs quatre membres, la queue, immense et blanche cerclée d’anneaux noirs, dressée comme un mât. Puis sans autre forme de politesse, ils se précipitent sur les bananes que nous tenons dans les mains. Tardez-vous à manifester votre générosité, ils saisissent au vol le fruit convoité et si celui-ci n’est pas à leur portée, d’un bond léger ils sont sur votre dos ou votre poitrine, en s’agrippant à vos vêtements. Mais qu’on se rassure : leur pelage est doux comme celui d’un chat et ils savent faire patte de velours pour ne pas vous égratigner de leurs griffes. La scène est d’un comique irrésistible ; tout le monde est aux anges, petits et grands, au point de dire : « Rien que pour ça, je suis content d’être à Madagascar. » Nous sommes maintenant envahis de tous les côtés par la tribu des primates, ils sont autour de nous et sur nous. Chirine en a un sur le ventre et un autre sur le dos ; le petit Djemil est aux prises avec un maki qui arc-bouté sur ses pattes de derrière lui tire sur le bras. Ces lémuriens au corps musclé, à la fourrure gris roux, sont les plus hardis qu’il nous sera donné d’approcher : le maki Catta est, dit-on, le plus populaire des lémuriens et le moins farouche.
Un peu plus loin, quatre individus appartenant à une autre espèce nous guettent, perchés en enfilade sur le tronc d’un papayer. Ils fixent avec avidité nos bananes mais la prudence l’emporte sur la gourmandise et ils n’osent pas s’approcher de nous. Ceux-ci ont un pelage presqu’entièrement blanc et portent, plaqué sur le visage comme un masque, un triangle isocèle noir pointe en bas, dont chaque angle supérieur est orné d’un gros œil rond. Le propithèque de Verreaux – tel est son nom –, aussi appelé lémurien dansant, est connu pour son mode de locomotion : il se déplace en faisant de grands bonds, sans se servir de ses pattes de devant.
Assurément, les solides bâtiments de pierre et les charrues rouillées de Nahampohana portent encore la marque de son passé colonial. Les premiers êtres à nous accueillir dans ce parc magnifiquement entretenu sont les lémuriens. Je ne dis pas qu’ils viennent de suite nous trotter entre les jambes : ces primates sont trop malins et méfiants pour s’approcher de leurs cousins bipèdes, avant de les avoir sérieusement étudiés. Ils nous examinent d’abord de loin, discrètement, assis ou gambadant sur le toit de chaume de la bâtisse abritant la réception et le restaurant du domaine. Même les bananes dont ils raffolent ne suffisent pas à les faire descendre tout de suite de leur perchoir. Arias, lycéen de dix-huit ans qui profite de ses vacances pour se faire un peu d’argent de poche en guidant les touristes dans le parc, n’a pas son pareil pour faire réagir les lémuriens. « Makimakimakimakiiiii ! » lance-t-il d’une voix stridente en agitant une banane dont la couleur jaune vif contraste avec le vert du gazon et des massifs de camélias. Aussitôt ils arrivent l’un après l’autre, plantés sur leurs quatre membres, la queue, immense et blanche cerclée d’anneaux noirs, dressée comme un mât. Puis sans autre forme de politesse, ils se précipitent sur les bananes que nous tenons dans les mains. Tardez-vous à manifester votre générosité, ils saisissent au vol le fruit convoité et si celui-ci n’est pas à leur portée, d’un bond léger ils sont sur votre dos ou votre poitrine, en s’agrippant à vos vêtements. Mais qu’on se rassure : leur pelage est doux comme celui d’un chat et ils savent faire patte de velours pour ne pas vous égratigner de leurs griffes. La scène est d’un comique irrésistible ; tout le monde est aux anges, petits et grands, au point de dire : « Rien que pour ça, je suis content d’être à Madagascar. » Nous sommes maintenant envahis de tous les côtés par la tribu des primates, ils sont autour de nous et sur nous. Chirine en a un sur le ventre et un autre sur le dos ; le petit Djemil est aux prises avec un maki qui arc-bouté sur ses pattes de derrière lui tire sur le bras. Ces lémuriens au corps musclé, à la fourrure gris roux, sont les plus hardis qu’il nous sera donné d’approcher : le maki Catta est, dit-on, le plus populaire des lémuriens et le moins farouche.
Un peu plus loin, quatre individus appartenant à une autre espèce nous guettent, perchés en enfilade sur le tronc d’un papayer. Ils fixent avec avidité nos bananes mais la prudence l’emporte sur la gourmandise et ils n’osent pas s’approcher de nous. Ceux-ci ont un pelage presqu’entièrement blanc et portent, plaqué sur le visage comme un masque, un triangle isocèle noir pointe en bas, dont chaque angle supérieur est orné d’un gros œil rond. Le propithèque de Verreaux – tel est son nom –, aussi appelé lémurien dansant, est connu pour son mode de locomotion : il se déplace en faisant de grands bonds, sans se servir de ses pattes de devant.
Dans les milieux autorisés, on s’accorde à dire que la responsable de cet hécatombe sans précédent, survenant insolemment en période de paix dans un pays riche et « civilisé », c’est la canicule.
Qui aurait pu s’attendre à pareille traîtrise de la part de la nature ? On connaît la fureur des inondations qui changent les paisibles ruisselets en torrents dévastateurs et celle des tsunamis engloutisseurs de cités qui transforment les paradis touristiques en gigantesques charniers. On redoute les tremblements de terre qui réduisent en poussière les monuments historiques les plus choyés et les plus solides constructions de béton. On sait prévoir les tornades qui emportent les toits comme des fétus de paille, soulèvent les ponts et déracinent les arbres centenaires. On imagine avec effroi les épidémies meurtrières du Moyen-âge qu’on dit révolues.
Mais les Français n’avaient pas envisagé que la chaleur torride pouvait tuer aussi sûrement qu’un cyclone, un raz-de-marée ou un glissement de terrain. Ils ne savaient pas que le beau temps pouvait tuer…
Qui aurait pu s’attendre à pareille traîtrise de la part de la nature ? On connaît la fureur des inondations qui changent les paisibles ruisselets en torrents dévastateurs et celle des tsunamis engloutisseurs de cités qui transforment les paradis touristiques en gigantesques charniers. On redoute les tremblements de terre qui réduisent en poussière les monuments historiques les plus choyés et les plus solides constructions de béton. On sait prévoir les tornades qui emportent les toits comme des fétus de paille, soulèvent les ponts et déracinent les arbres centenaires. On imagine avec effroi les épidémies meurtrières du Moyen-âge qu’on dit révolues.
Mais les Français n’avaient pas envisagé que la chaleur torride pouvait tuer aussi sûrement qu’un cyclone, un raz-de-marée ou un glissement de terrain. Ils ne savaient pas que le beau temps pouvait tuer…
Ile de la Réunion, 1974
Dès quatorze ans, ma silhouette gracieuse excitait la convoitise d’une nuée d’admirateurs opiniâtres qui, à défaut de pouvoir de m’approcher, me contemplaient de loin avec des yeux langoureux, en attendant – espoir combien hypothétique – que je daigne m’intéresser à leur petite personne. Sensuelle et snob comme une star, je me prêtais à leurs jeux tout en gardant la distance d’une jeune fille prude et respectable. Jusqu’au jour où le mariage est venu me cueillir en pleine adolescence, avec toute mon innocence et mes rêves, alors que je ne connaissais rien de l’amour, rien de la vie.
Ce qui m’avait attirée vers cet instituteur de cinq ans mon aîné ? Outre un charme indéniable, c’étaient surtout la perspective d’échapper à une routine médiocre, le besoin de fuir un milieu familial nauséabond – des parents en instance de divorce toujours en train de se disputer, des conditions matérielles proches de la gêne –, de même que la hâte de jouir sans plus attendre des plaisirs de la vie. Qu’aurais-je fait d’autre ? J’étais pauvre et trop médiocre à l’école pour prétendre à une carrière professionnelle sérieuse alors que le mariage, à 17 ans passés, m’offrait un refuge et un statut.
Je ne saurai jamais si mon premier époux était sincèrement amoureux de moi. Il me respectait, de cela j’en suis sûre. En tout cas, ce beau jeune homme un peu efféminé, élève de l’Ecole Normale d’Instituteurs, ne m’a pas rejetée lorsqu’un jour je lui ai lancé subitement, en lui montrant mon baluchon : « J’ai quitté mes parents. » Il se contenta de me demander : « As-tu bien réfléchi ? Es-tu consciente de ce que tu fais ? » Ma démarche, audacieuse, l’avait sans doute pris de court, mais il ne laissa rien paraître de son embarras. En agissant ainsi je ne prenais pas beaucoup de risque : jamais ce garçon bien élevé n’aurait eu le cœur de me jeter à la rue !
Ce mercredi, il était venu me chercher avec sa voiture à la sortie du lycée pour une balade en amoureux, à travers les prairies de la Plaine des Cafres. Mais cette fois, à la fin de la journée, au lieu de me ramener au bahut, il dut sous la pression des événements me conduire dans un hôtel, en attendant de trouver une solution plus raisonnable. A ce moment-là, j’éprouvais pour lui un vague sentiment de sympathie, rien de plus. Les circonstances avaient favorisé notre rencontre ; par sa position sociale et son physique plutôt agréable, il servait provisoirement mes obscurs projets. J’avais saisi ce qu’on appelle une opportunité. Je crois que lui ou un autre, cela aurait été pareil. Sur le moment, cependant, je me gardais bien de dévoiler mes véritables pensées.
Dès quatorze ans, ma silhouette gracieuse excitait la convoitise d’une nuée d’admirateurs opiniâtres qui, à défaut de pouvoir de m’approcher, me contemplaient de loin avec des yeux langoureux, en attendant – espoir combien hypothétique – que je daigne m’intéresser à leur petite personne. Sensuelle et snob comme une star, je me prêtais à leurs jeux tout en gardant la distance d’une jeune fille prude et respectable. Jusqu’au jour où le mariage est venu me cueillir en pleine adolescence, avec toute mon innocence et mes rêves, alors que je ne connaissais rien de l’amour, rien de la vie.
Ce qui m’avait attirée vers cet instituteur de cinq ans mon aîné ? Outre un charme indéniable, c’étaient surtout la perspective d’échapper à une routine médiocre, le besoin de fuir un milieu familial nauséabond – des parents en instance de divorce toujours en train de se disputer, des conditions matérielles proches de la gêne –, de même que la hâte de jouir sans plus attendre des plaisirs de la vie. Qu’aurais-je fait d’autre ? J’étais pauvre et trop médiocre à l’école pour prétendre à une carrière professionnelle sérieuse alors que le mariage, à 17 ans passés, m’offrait un refuge et un statut.
Je ne saurai jamais si mon premier époux était sincèrement amoureux de moi. Il me respectait, de cela j’en suis sûre. En tout cas, ce beau jeune homme un peu efféminé, élève de l’Ecole Normale d’Instituteurs, ne m’a pas rejetée lorsqu’un jour je lui ai lancé subitement, en lui montrant mon baluchon : « J’ai quitté mes parents. » Il se contenta de me demander : « As-tu bien réfléchi ? Es-tu consciente de ce que tu fais ? » Ma démarche, audacieuse, l’avait sans doute pris de court, mais il ne laissa rien paraître de son embarras. En agissant ainsi je ne prenais pas beaucoup de risque : jamais ce garçon bien élevé n’aurait eu le cœur de me jeter à la rue !
Ce mercredi, il était venu me chercher avec sa voiture à la sortie du lycée pour une balade en amoureux, à travers les prairies de la Plaine des Cafres. Mais cette fois, à la fin de la journée, au lieu de me ramener au bahut, il dut sous la pression des événements me conduire dans un hôtel, en attendant de trouver une solution plus raisonnable. A ce moment-là, j’éprouvais pour lui un vague sentiment de sympathie, rien de plus. Les circonstances avaient favorisé notre rencontre ; par sa position sociale et son physique plutôt agréable, il servait provisoirement mes obscurs projets. J’avais saisi ce qu’on appelle une opportunité. Je crois que lui ou un autre, cela aurait été pareil. Sur le moment, cependant, je me gardais bien de dévoiler mes véritables pensées.
Un matin, j’ai eu l’impression bizarre d’être différent des autres jours. Il me semblait en effet que mon corps, au lieu d’avoir la consistance d’une masse de chair et d’os attachée au sol par l’effet de la gravité universelle, flottait comme un petit nuage, léger, compact. J’ai cherché à comprendre ce qui m’arrivait. J’ai tenté de reprendre le contrôle de mes mouvements, mais en vain. J’ai dû me rendre à l’évidence : rien n’obéissait plus à ma volonté ; je dérivais de ça, de là, comme un objet en apesanteur.
Soudain, mes narines ont capté des effluves inattendus : un mélange composé d’éther, de teinture d’iode et d’eau de Javel. Une de ces émanations caractéristiques de l’univers aseptisé des hôpitaux. Trois substances à qui est généralement dévolue la mission radicale d’éliminer les micro-organismes indésirables et qui évoquent inévitablement le combat incessant de l’homme contre l’un de ses plus redoutables ennemis, l’infiniment petit. Lorsque l’on sent cette odeur, on sait que la maladie et la mort ne sont pas loin. Aussi je me suis dit :
« Raphaël, ton corps sain et vigoureux ne souffre d’aucune maladie ; alors que fais-tu dans un hôpital ? »
C’est vrai, je n’étais pas malade : en tout cas, pas au moment de me coucher hier soir, à une heure du matin, le cœur amer, après avoir regardé France-Italie, sur Canal Satellite.
Mon étonnement était sans mesure.
J’ai perçu alors des cliquetis très légers, un peu comme des bruits de vaisselle mais en plus délicats. J’en ai déduit que mon épouse s’activait dans la cuisine, autour de la cafetière et du grille-pain. Hypothèse bien peu probable, je le savais forcément, étant donné que j’étais toujours le premier à me lever : c’était moi, invariablement, qui lui apportais son café chaud au lit ; en vingt ans de vie commune, jamais le rôle ne s’était inversé.
Nonchalamment, j’ai étendu mon bras en direction de ma compagne. Surprise : ma main n’a rencontré que le vide ; au bout de mon bras il n’y avait ni femme, ni drap, ni matelas, ni couverture. J’ai scruté ma chambre à la recherche des objets familiers au milieu desquels je m’endormais chaque soir mais il n’y avait rien sur quoi fixer mon attention : l’écran fluorescent du radio-réveil ne trouait pas l’obscurité, l’armoire en teck massif ne dressait pas sa masse robuste et tranquille contre le mur, la table de chevet ne montait pas la garde près de mon lit et mon matelas se dérobait à mes mains baladeuses.
J’ai commencé à paniquer pour de bon et à me poser des questions embarrassantes :
Et si mon corps s’était désolidarisé de mon esprit ?
Cette pensée m’est venue parce qu’une nuit, dans mon enfance, j’avais vécu une curieuse expérience : j’avais rêvé que mon esprit, évadé momentanément, ne parvenait plus à réintégrer mon corps. Epouvanté, je m’étais débattu puis je m’étais réveillé quelques minutes plus tard, en sueur, pour constater que tout était normal.
Cette fois, j’avais tout lieu de croire que c’était différent, que c’était du sérieux.
Affolé, je me suis mis à crier et à gesticuler : « Au secours ! Que m’arrive-t-il ? Où suis-je ? »
Tandis que je flottais, en frôlant un plafond blanc et lisse, avec la gaucherie d’un canard de basse-cour qui s’entraîne à voler, un remue-ménage s’est produit au niveau du sol.
Des silhouettes blanches portant blouses, masques et bonnets, s’affairaient – avec ce zèle épatant que l’on ne voit que dans les séries télévisées – autour d’un être humain étendu sur le dos. C’était vraisemblablement une équipe d’infirmières et de médecins qui tentaient, avec une farouche pugnacité, d’arracher à la mort la probable victime d’un accident quelconque. Sous la lumière vive dispensée par des ampoules puissantes, leurs ombres agrandies gesticulaient dans un ballet fantastique.
Je me suis dit : « Que fais-tu, Raphaël Lefèvre, dans cette salle blanche, aseptisée et impersonnelle » ?
L’objet de ces soins intensifs – de sexe masculin, un mètre soixante-dix environ, de type créole blanc –, doit avoir dans les quarante ans. Des électrodes posées sur son cuir chevelu transmettent à un moniteur une série de tracés sinusoïdaux accompagnés d’ondes alpha plus ou moins accidentées et complexes. Sur son visage boursouflé saillent trois grains de beauté dont la disposition et la forme ne laissent aucun doute sur l’identité du comateux.
Surprise : la face disgracieuse que je contemple avec commisération ressemble en effet étrangement à celle d’un certain Raphaël L., chef d’entreprise notoire.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Tout à coup, il m’a semblé prendre de l’altitude et mon champ visuel s’est élargi. Sans perdre de vue le bloc opératoire où s’agitait avec frénésie le même personnel dévoué, de nombreuses autres images se sont présentées simultanément à ma vue. Dans une chambre double, deux femmes en peignoir, assises sur leur lit, papotaient en tricotant, pendant qu’un téléviseur posé sur un support mural diffusait une énigmatique publicité en faveur de « l’artisanat, première entreprise de France ». Dans un couloir sombre au parquet en damier, luisant, interminable, un aide-soignant poussait nonchalamment un chariot, en faisant claquer ses galoches. Dans un vestiaire, une infirmière revêtait sa blouse de travail avec une précipitation et une maladresse trahissant son retard.
Tiens donc, voilà que je vois à travers les murs à présent ! me suis-je émerveillé.
Soudain, mes narines ont capté des effluves inattendus : un mélange composé d’éther, de teinture d’iode et d’eau de Javel. Une de ces émanations caractéristiques de l’univers aseptisé des hôpitaux. Trois substances à qui est généralement dévolue la mission radicale d’éliminer les micro-organismes indésirables et qui évoquent inévitablement le combat incessant de l’homme contre l’un de ses plus redoutables ennemis, l’infiniment petit. Lorsque l’on sent cette odeur, on sait que la maladie et la mort ne sont pas loin. Aussi je me suis dit :
« Raphaël, ton corps sain et vigoureux ne souffre d’aucune maladie ; alors que fais-tu dans un hôpital ? »
C’est vrai, je n’étais pas malade : en tout cas, pas au moment de me coucher hier soir, à une heure du matin, le cœur amer, après avoir regardé France-Italie, sur Canal Satellite.
Mon étonnement était sans mesure.
J’ai perçu alors des cliquetis très légers, un peu comme des bruits de vaisselle mais en plus délicats. J’en ai déduit que mon épouse s’activait dans la cuisine, autour de la cafetière et du grille-pain. Hypothèse bien peu probable, je le savais forcément, étant donné que j’étais toujours le premier à me lever : c’était moi, invariablement, qui lui apportais son café chaud au lit ; en vingt ans de vie commune, jamais le rôle ne s’était inversé.
Nonchalamment, j’ai étendu mon bras en direction de ma compagne. Surprise : ma main n’a rencontré que le vide ; au bout de mon bras il n’y avait ni femme, ni drap, ni matelas, ni couverture. J’ai scruté ma chambre à la recherche des objets familiers au milieu desquels je m’endormais chaque soir mais il n’y avait rien sur quoi fixer mon attention : l’écran fluorescent du radio-réveil ne trouait pas l’obscurité, l’armoire en teck massif ne dressait pas sa masse robuste et tranquille contre le mur, la table de chevet ne montait pas la garde près de mon lit et mon matelas se dérobait à mes mains baladeuses.
J’ai commencé à paniquer pour de bon et à me poser des questions embarrassantes :
Et si mon corps s’était désolidarisé de mon esprit ?
Cette pensée m’est venue parce qu’une nuit, dans mon enfance, j’avais vécu une curieuse expérience : j’avais rêvé que mon esprit, évadé momentanément, ne parvenait plus à réintégrer mon corps. Epouvanté, je m’étais débattu puis je m’étais réveillé quelques minutes plus tard, en sueur, pour constater que tout était normal.
Cette fois, j’avais tout lieu de croire que c’était différent, que c’était du sérieux.
Affolé, je me suis mis à crier et à gesticuler : « Au secours ! Que m’arrive-t-il ? Où suis-je ? »
Tandis que je flottais, en frôlant un plafond blanc et lisse, avec la gaucherie d’un canard de basse-cour qui s’entraîne à voler, un remue-ménage s’est produit au niveau du sol.
Des silhouettes blanches portant blouses, masques et bonnets, s’affairaient – avec ce zèle épatant que l’on ne voit que dans les séries télévisées – autour d’un être humain étendu sur le dos. C’était vraisemblablement une équipe d’infirmières et de médecins qui tentaient, avec une farouche pugnacité, d’arracher à la mort la probable victime d’un accident quelconque. Sous la lumière vive dispensée par des ampoules puissantes, leurs ombres agrandies gesticulaient dans un ballet fantastique.
Je me suis dit : « Que fais-tu, Raphaël Lefèvre, dans cette salle blanche, aseptisée et impersonnelle » ?
L’objet de ces soins intensifs – de sexe masculin, un mètre soixante-dix environ, de type créole blanc –, doit avoir dans les quarante ans. Des électrodes posées sur son cuir chevelu transmettent à un moniteur une série de tracés sinusoïdaux accompagnés d’ondes alpha plus ou moins accidentées et complexes. Sur son visage boursouflé saillent trois grains de beauté dont la disposition et la forme ne laissent aucun doute sur l’identité du comateux.
Surprise : la face disgracieuse que je contemple avec commisération ressemble en effet étrangement à celle d’un certain Raphaël L., chef d’entreprise notoire.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Tout à coup, il m’a semblé prendre de l’altitude et mon champ visuel s’est élargi. Sans perdre de vue le bloc opératoire où s’agitait avec frénésie le même personnel dévoué, de nombreuses autres images se sont présentées simultanément à ma vue. Dans une chambre double, deux femmes en peignoir, assises sur leur lit, papotaient en tricotant, pendant qu’un téléviseur posé sur un support mural diffusait une énigmatique publicité en faveur de « l’artisanat, première entreprise de France ». Dans un couloir sombre au parquet en damier, luisant, interminable, un aide-soignant poussait nonchalamment un chariot, en faisant claquer ses galoches. Dans un vestiaire, une infirmière revêtait sa blouse de travail avec une précipitation et une maladresse trahissant son retard.
Tiens donc, voilà que je vois à travers les murs à présent ! me suis-je émerveillé.
Avec une énergie peu commune, tous les hommes – excepté Fabien qui encore très affaibli, s’exerce à écrire de la main gauche – s’emploient à sauver leur bateau du naufrage. En un instant, sur l’épave devenue atelier, plusieurs corps de métier entrent en action : charpentiers maniant la hache, la scie et le marteau, voiliers rafistolant les toiles déchirées, cordeliers assemblant des torons, calfats s’appliquant à boucher les trous creusés dans la coque par les boulets. Brisé au niveau du grand hunier, privé du grand cacatois et du grand perroquet, le grand mât va devoir se contenter de la grand-voile.
Enfin, après quatre jours de labeur acharné sur place, Le Sans-Pitié présente une silhouette trapue, peu élégante à la vérité – on dirait un de ces animaux au corps allongé et courts sur patte – mais il est sauvé.
- Voilà le travail ! dit le charpentier qui, ayant pris jusqu’ici la direction des opérations, se révèle être un excellent meneur d’hommes. Avec une bonne brise, ce bateau nous conduira en Afrique ou à Madagascar. Pourvu qu’on ne lui en demande pas trop. Maintenant, en route !
Hector le charpentier qu’on découvre sous son vrai jour, est un homme aussi respecté que le chirurgien du bord et que l’aumônier. De courte taille, il passerait inaperçu au sein de l’équipage sans sa barbe solaire et sa chevelure d’argent qui lui donnent un vénérable air de patriarche.
Enfin, après quatre jours de labeur acharné sur place, Le Sans-Pitié présente une silhouette trapue, peu élégante à la vérité – on dirait un de ces animaux au corps allongé et courts sur patte – mais il est sauvé.
- Voilà le travail ! dit le charpentier qui, ayant pris jusqu’ici la direction des opérations, se révèle être un excellent meneur d’hommes. Avec une bonne brise, ce bateau nous conduira en Afrique ou à Madagascar. Pourvu qu’on ne lui en demande pas trop. Maintenant, en route !
Hector le charpentier qu’on découvre sous son vrai jour, est un homme aussi respecté que le chirurgien du bord et que l’aumônier. De courte taille, il passerait inaperçu au sein de l’équipage sans sa barbe solaire et sa chevelure d’argent qui lui donnent un vénérable air de patriarche.
http://www.fredmussard.fr/index.htm
Surmontant mes craintes, je me résolus enfin à lever les yeux sur mes camarades de circonstance. Premier soulagement : non, ils n’avaient pas l’apparence effroyable que je redoutais. Seconde constatation : moi qui, avec ma taille d’un mètre soixante-cinq, passais sur la Terre quasiment pour un nain, j’avais fière allure devant ces individus dont pas un ne dépassait un mètre cinquante. Autre détail immédiatement remarquable, aucun ne paraissait avoir plus de quarante ans. Pour le reste, ils avaient grosso-modo la même apparence que nous les Terriens. Quelques spécificités, bien sûr, ne plaidaient pas en leur faveur – des détails d’ordre esthétique. D’abord, ils n’avaient pas de gros traits mais ce n’étaient pas des Apollon non plus. Puis une spécificité qui passerait peut-être inaperçue chez un grand nombre de Terriens mais pas chez quelqu’un particulièrement fier de son système pileux comme moi, toute la population masculine de cette planète avait le crâne entièrement lisse comme un œuf et pointu. Enfin, l’élément qui me troublait le plus dans la physionomie de ces étrangers était sans conteste leurs yeux humides et verts qui dispensaient un regard fixe, certainement doté d’une acuité extraordinaire, mais vide de toute signification. Ce regard, à cause d’une configuration particulière des paupières, descendait obliquement vers le sol, de sorte que pour voir mon visage, ils étaient obligés de basculer leur tête vers le ciel. En d’autres termes, avec par-dessus le marché une peau bleuâtre, ces extra-terrestres n’étaient pas en mesure de faire tourner la tête à nos jolies filles, mais ce n’était pas l’essentiel. Non, le plus important pour moi, en ce moment, était qu’ils fussent dépourvus de toute monstruosité.
C’était un de ces dimanches qui font dire aux personnes qui se lèvent tôt et entendent profiter pleinement de la vie, comme ces sportifs qui ont soigneusement planifié leurs activités et se préparent à faire le plein de sensations fortes — parapentistes, parachutistes, cyclistes, adeptes de canyoning ou de plongée, randonneurs — ; ou ces pique-niqueurs en quête de plein air qui s’apprêtent à envahir les bords de mer ou de rivière : « C’est une belle journée ! »
Ce dimanche, tous les ingrédients étaient réunis pour que les Réunionnais dans leur ensemble passent une douzaine d’heures agréables sans être incommodés par les sautes d’humeur de la météo. Les sommets du Grand Bénare, du Piton des Neiges et du Piton de La Fournaise, mis en relief par un soleil encore timide, dessinaient des arabesques joyeuses sur le ciel bleu des Hauts, aussi limpide que les eaux de Boucan Canot avant qu’elles ne soient troublées par les baigneurs, où de rares petits nuages, pourchassés par le beau temps triomphant, achevaient de s’effilocher.
Mais les plus belles journées connaissent elles aussi leur lot de calamités, les dimanches et les jours fériés comme le reste. Car, à l’inverse des épicuriens, il y a aussi les autres, ceux qui n’ont rien prévu, qui s’ennuient englués dans leur routine, et ceux qui ruminent de sombres pensées, pleines d’amertume et de colère. C’est parmi ces êtres désorientés, insensibles à l’appel de la vie et à la beauté de la nature, que le Malheur recrute ses artisans. Ce n’est pas un dimanche ensoleillé ni un ciel bleu qui vont arrêter un individu déterminé à plonger une famille dans le deuil en donnant ou se donnant la mort. Le meurtre comme le suicide font fi du beau ou du mauvais temps. Et lorsque personne ne se jette du pont de l’Entre-Deux (ou du pont Vinh San) ou ne trucide son prochain, s’il n’y a pas un noctambule attardé qui rentrant chez lui au petit matin, gavé d’alcools et de stupéfiants, pour précipiter sa voiture dans un ravin ou contre une famille paisible qui part matinalement en villégiature, c’est la Camarde elle-même qui se charge de trancher dans le vif et d’éclaircir les rangs : une noyade par-ci, un AVC fatal par là... Le malheur a l’imagination fertile.
Ce dimanche, tous les ingrédients étaient réunis pour que les Réunionnais dans leur ensemble passent une douzaine d’heures agréables sans être incommodés par les sautes d’humeur de la météo. Les sommets du Grand Bénare, du Piton des Neiges et du Piton de La Fournaise, mis en relief par un soleil encore timide, dessinaient des arabesques joyeuses sur le ciel bleu des Hauts, aussi limpide que les eaux de Boucan Canot avant qu’elles ne soient troublées par les baigneurs, où de rares petits nuages, pourchassés par le beau temps triomphant, achevaient de s’effilocher.
Mais les plus belles journées connaissent elles aussi leur lot de calamités, les dimanches et les jours fériés comme le reste. Car, à l’inverse des épicuriens, il y a aussi les autres, ceux qui n’ont rien prévu, qui s’ennuient englués dans leur routine, et ceux qui ruminent de sombres pensées, pleines d’amertume et de colère. C’est parmi ces êtres désorientés, insensibles à l’appel de la vie et à la beauté de la nature, que le Malheur recrute ses artisans. Ce n’est pas un dimanche ensoleillé ni un ciel bleu qui vont arrêter un individu déterminé à plonger une famille dans le deuil en donnant ou se donnant la mort. Le meurtre comme le suicide font fi du beau ou du mauvais temps. Et lorsque personne ne se jette du pont de l’Entre-Deux (ou du pont Vinh San) ou ne trucide son prochain, s’il n’y a pas un noctambule attardé qui rentrant chez lui au petit matin, gavé d’alcools et de stupéfiants, pour précipiter sa voiture dans un ravin ou contre une famille paisible qui part matinalement en villégiature, c’est la Camarde elle-même qui se charge de trancher dans le vif et d’éclaircir les rangs : une noyade par-ci, un AVC fatal par là... Le malheur a l’imagination fertile.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Lecteurs de Fred Mussard (6)Voir plus
Quiz
Voir plus
Retour au sens premier ... 🧐 📖
Une polémique fait rage. Vous êtes dans l'œil du cyclone :
en pleine tourmente
ouf ! un moment de répit
5 questions
83 lecteurs ont répondu
Thèmes :
expressions françaises
, sens
, Faux amis
, bisous
, bisous
, baba yagaCréer un quiz sur cet auteur83 lecteurs ont répondu