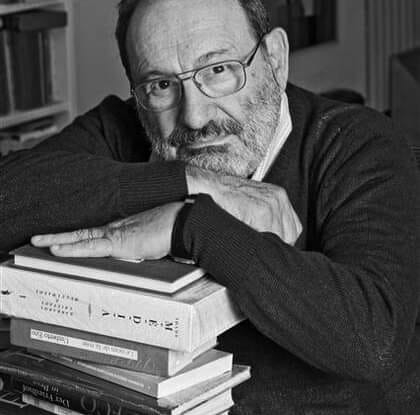Citation de Partemps
Citons encore le procédé pictural mis au point par Bruno Munari, dont les effets sont étonnants. On projette au moyen d'une lanterne magique un collage d'éléments plastiques — composition abstraite de feuilles minces, plissées ou superposées, toutes de matière incolore — et on fait passer les rayons lumineux à travers une lentille « polaroïd ». On obtient sur l'écran, une composition d'une intense beauté chromatique. On fait ensuite tourner lentement la lentille : la figure projetée change de couleur, passe par toutes celles de l'arc-en-ciel, et la réaction chromatique des diverses matières plastiques superposées détermine une série de métamorphoses qui agissent sur les formes mêmes. En réglant à volonté la lentille, le spectateur collabore effectivement à la création de l'objet esthétique dans les limites ménagées par la gamme des couleurs et la disposition plastique des diapositives.
Dans un domaine plus modeste, le dessin industriel est à l'origine de toute une gamme d'œuvres en mouvement: fauteuils et lampes démontables, bibliothèques par éléments qui permettent à l'homme d'aujourd'hui de créer et de disposer les formes parmi lesquelles il vit, selon son goût et ses besoins.
Dans le domaine littéraire enfin, il existe une étonnante anticipation de 1' oeuvre en mouvement : le Livre de Mallarmé, cette œuvre colossale et totale, cette Œuvre par excellence, qui devait constituer l'aboutissement de l'activité du poète, mieux: l'accomplissement du monde entier (« Le monde existe pour aboutir à un livre »). Bien qu'il y ait travaillé toute sa vie, Mallarmé ne devait jamais le réaliser. Seules des ébauches nous en sont parvenues, et depuis peu, au terme d'une délicate recherche philologique 8. Les intentions métaphysiques qui justifient cette entreprise mallarméenne peuvent sembler discutables, mais nous nous bornerons ici à considérer la structure dynamique de l'œuvre, laquelle entendait réaliser un principe poétique très précis : « Un livre ne commence ni ne finit ; tout au plus fait-il semblant. » Le Livre devait être un édifice « ouvert » et mobile et pas seulement au sens où l'était déjà une composition comme le Coup de dés, dans laquelle grammaire, syntaxe et disposition typographique introduisaient une pluralité d'éléments polymorphes dont les rapports restaient indéterminés.
Les pages du Livre devaient non pas se succéder selon un ordre déterminé, mais se prêter à plusieurs groupements réglés par un système de permutation. L'œuvre se serait composée d'une série de fascicules non reliés entre eux; la première et la dernière page de chaque fascicule auraient été rédigées sur une même grande feuille pliée en deux, marquant le début et la fin du fascicule; à l'intérieur, un jeu de feuilles simples, mobiles, aurait permis toutes les combinaisons possibles, sans qu'aucune soit privée de sens. Il est bien évident que le poète n'entendait pas obtenir de chaque combinaison une valeur syntactique, ou une signification discursive. La structure même des phrases et des mots — considérés comme doués d'un pouvoir de suggestion, et comme aptes à entrer en relation suggestive avec d'autres phrases et d'autres mots — autorisait toutes les permutations, s'offrant à de nouvelles relations, par conséquent à de nouveaux horizons suggestifs. « Le volume, malgré l'impression fixe, devient, par ce jeu, mobile de mort il devient vie. » Une analyse combinatoire, à mi-chemin entre les jeux de la scolastique finissante (ceux du Lullisme en particulier) et les techniques des mathématiques modernes, permettait ainsi au poète d'offrir, à partir d'une quantité limitée d'éléments mobiles, un nombre astronomique de combinaisons. La présentation de l'œuvre sous forme de fascicules, en imposant aux permutations certaines limites, devait ancrer le Livre dans un champ de suggestion déterminé, que d'ailleurs l'auteur visait déjà par le choix des éléments verbaux et l'accent mis sur leur aptitude à se combiner.
Le fait que cette mécanique combinatoire soit ici au service d'une révélation de type « orphique » n'influe pas sur la réalité structurale du livre comme objet mobile et ouvert. En rendant possible la permutation des éléments d'un texte déjà destiné par lui-même à évoquer des relations ouvertes, le Livre prétendait être un monde en fusion continue, qui ne cesserait de se renouveler aux yeux du lecteur. Il montrerait sans cesse des aspects nouveaux de cette « polyédricité » de l'absolu qu'il entendait nous ne dirons pas exprimer, mais remplacer et réaliser. Dans une telle structure, il était impossible de concevoir un seul passage doté d'un sens défini et univoque, fermé aux influences du contexte ; ç'aurait été bloquer le mécanisme tout entier.
L'entreprise utopique de Mallarmé, qui s'assortissait d'aspirations et de naïvetés vraiment déconcertantes, ne devait jamais aboutir. Il est bien difficile de savoir si l'expérience achevée aurait eu quelque valeur, ou si elle serait apparue comme l'incarnation équivoque, mystique et ésotérique d'une sensibilité décadente parvenue au terme de sa parabole. Nous penchons vers la seconde hypothèse. Il n'en est pas moins intéressant de trouver, à l'aube de notre époque, une ébauche aussi significative d' oeuvre en mouvement : elle est le signe que certaines exigences se faisaient jour, dont l'existence est à elle seule une justification, et qui font partie intégrante du panorama culturel de l'époque.
Dans un domaine plus modeste, le dessin industriel est à l'origine de toute une gamme d'œuvres en mouvement: fauteuils et lampes démontables, bibliothèques par éléments qui permettent à l'homme d'aujourd'hui de créer et de disposer les formes parmi lesquelles il vit, selon son goût et ses besoins.
Dans le domaine littéraire enfin, il existe une étonnante anticipation de 1' oeuvre en mouvement : le Livre de Mallarmé, cette œuvre colossale et totale, cette Œuvre par excellence, qui devait constituer l'aboutissement de l'activité du poète, mieux: l'accomplissement du monde entier (« Le monde existe pour aboutir à un livre »). Bien qu'il y ait travaillé toute sa vie, Mallarmé ne devait jamais le réaliser. Seules des ébauches nous en sont parvenues, et depuis peu, au terme d'une délicate recherche philologique 8. Les intentions métaphysiques qui justifient cette entreprise mallarméenne peuvent sembler discutables, mais nous nous bornerons ici à considérer la structure dynamique de l'œuvre, laquelle entendait réaliser un principe poétique très précis : « Un livre ne commence ni ne finit ; tout au plus fait-il semblant. » Le Livre devait être un édifice « ouvert » et mobile et pas seulement au sens où l'était déjà une composition comme le Coup de dés, dans laquelle grammaire, syntaxe et disposition typographique introduisaient une pluralité d'éléments polymorphes dont les rapports restaient indéterminés.
Les pages du Livre devaient non pas se succéder selon un ordre déterminé, mais se prêter à plusieurs groupements réglés par un système de permutation. L'œuvre se serait composée d'une série de fascicules non reliés entre eux; la première et la dernière page de chaque fascicule auraient été rédigées sur une même grande feuille pliée en deux, marquant le début et la fin du fascicule; à l'intérieur, un jeu de feuilles simples, mobiles, aurait permis toutes les combinaisons possibles, sans qu'aucune soit privée de sens. Il est bien évident que le poète n'entendait pas obtenir de chaque combinaison une valeur syntactique, ou une signification discursive. La structure même des phrases et des mots — considérés comme doués d'un pouvoir de suggestion, et comme aptes à entrer en relation suggestive avec d'autres phrases et d'autres mots — autorisait toutes les permutations, s'offrant à de nouvelles relations, par conséquent à de nouveaux horizons suggestifs. « Le volume, malgré l'impression fixe, devient, par ce jeu, mobile de mort il devient vie. » Une analyse combinatoire, à mi-chemin entre les jeux de la scolastique finissante (ceux du Lullisme en particulier) et les techniques des mathématiques modernes, permettait ainsi au poète d'offrir, à partir d'une quantité limitée d'éléments mobiles, un nombre astronomique de combinaisons. La présentation de l'œuvre sous forme de fascicules, en imposant aux permutations certaines limites, devait ancrer le Livre dans un champ de suggestion déterminé, que d'ailleurs l'auteur visait déjà par le choix des éléments verbaux et l'accent mis sur leur aptitude à se combiner.
Le fait que cette mécanique combinatoire soit ici au service d'une révélation de type « orphique » n'influe pas sur la réalité structurale du livre comme objet mobile et ouvert. En rendant possible la permutation des éléments d'un texte déjà destiné par lui-même à évoquer des relations ouvertes, le Livre prétendait être un monde en fusion continue, qui ne cesserait de se renouveler aux yeux du lecteur. Il montrerait sans cesse des aspects nouveaux de cette « polyédricité » de l'absolu qu'il entendait nous ne dirons pas exprimer, mais remplacer et réaliser. Dans une telle structure, il était impossible de concevoir un seul passage doté d'un sens défini et univoque, fermé aux influences du contexte ; ç'aurait été bloquer le mécanisme tout entier.
L'entreprise utopique de Mallarmé, qui s'assortissait d'aspirations et de naïvetés vraiment déconcertantes, ne devait jamais aboutir. Il est bien difficile de savoir si l'expérience achevée aurait eu quelque valeur, ou si elle serait apparue comme l'incarnation équivoque, mystique et ésotérique d'une sensibilité décadente parvenue au terme de sa parabole. Nous penchons vers la seconde hypothèse. Il n'en est pas moins intéressant de trouver, à l'aube de notre époque, une ébauche aussi significative d' oeuvre en mouvement : elle est le signe que certaines exigences se faisaient jour, dont l'existence est à elle seule une justification, et qui font partie intégrante du panorama culturel de l'époque.