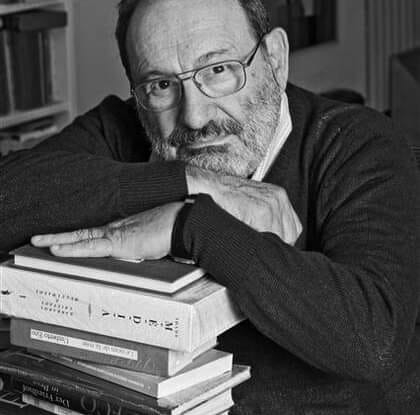Citation de Partemps
Nous l'avons vu, les œuvres « ouvertes » en mouvement se caractérisent par une invitation à faire l'œuvre avec l'auteur. A un niveau plus vaste, nous avons signalé (en tant que genre de l' espèce « œuvre en mouvement ») un type d'œuvres qui, bien que matériellement achevées, restent ouvertes à une continuelle germination de relations internes, qu'il appartient à chacun de découvrir et de choisir au cours même de sa perception. Plus généralement encore, nous avons vu que toute ouuvre d'art, même si elle est explicitement ou implicitement le fruit d'une poétique de la nécessité, reste ouverte à une série virtuellement infinie de lectures possibles : chacune de ces lectures fait revivre l'œuvre selon une perspective, un goût, une « exécution » personnelle.
Voilà donc trois aspects d'un même problème. Mais la réflexion esthétique, même contemporaine, s'est surtout attachée au troisième : à l'infinité, donc, de l'œuvre pourtant achevée. Voici par exemple ce qu'écrit Pareyson en des pages qui sont parmi les meilleures qu'on ait consacrées à la phénoménologie de l'interprétation : « L'œuvre d'art (...) est une forme, c'est-à-dire un mouvement arrivé à sa conclusion : en quelque sorte, un infini inclus dans le fini. Sa totalité résulte de sa conclusion et doit donc être considérée non comme la fermeture d'une réalité statique et immobile, mais comme l'ouverture d'un infini qui s'est rassemblé dans une forme. L'œuvre a, de ce fait, une infinité d'aspects qui ne sont pas des « fragments » ou des « parties » mais dont chacun la contient tout entière et la révèle dans une perspective déterminée. La diversité des exécutions a son fondement dans la complexité tant de l'individu qui l'interprète que de l'œuvre même (...). Les innombrables points de vue des interprètes et les innombrables aspects de l'œuvre se répondent, se rencontrent et s'éclairent mutuellement, en sorte que l'interprète doit, pour révéler l'œuvre dans son intégralité, la saisir sous l'un de ses aspects particuliers, et qu'inversement un aspect particulier de l'œuvre doit attendre l'interprète susceptible de le capter et de donner ainsi de l'intégra- lité une vision renouvelée. » Pareyson va jusqu'à affirmer que « toutes les interprétations sont définitives en ce sens que chacune d'elles est pour l'interprète l'oeuvre même; mais elles sont en même temps provisoires puisque l'interprète sait qu'il devra indéfiniment approfondir sa propre interprétation. Dans la mesure où elles sont définitives, ces interprétations sont parallèles, en sorte que l'une exclut les autres sans pour autant les nier 18... »
Ces affirmations — faites au niveau de l'esthétique théorique — sont applicables à toutes les formes d'art et à l'art de tous les temps. Ce n'est pourtant pas par hasard qu'il a fallu attendre notre époque pour voir naître et se développer une véritable problématique de l' « ouverture ». Ce que l'esthétique fait ici valoir sur un plan général reprend certaines exigences plus explicites et plus rigoureuses propres à la poétique de l'œuvre « ouverte ». Cela ne signifie pas, inversement, que la notion d'œuvre « ouverte » et d'oeuvre en mouvement n'ajoute rien à une expérience séculaire, tout étant dans l'art depuis toujours, et toute découverte ayant déjà été faite (au moins) par les Chinois : il convient de distiguer soigneusement entre le plan théorique de l'esthétique en tant que discipline philosophique, et le plan pratique de la poétique en tant que programme de création. L'esthétique, en faisant valoir une exigence particulièrement vive à notre époque, découvre la possibilité d'un certain type d'expérience applicable à toute œuvre d'art, indépendamment des critères opératoires qui ont présidé à sa création. Mais les poétiques (et la pratique) de l' oeuvre en mouvement voient dans cette même possibilité leur vocation spécifique en synchronisation avec tout le courant de la culture contemporaine. Ce qui est, pour l'esthétique, la condition générale de toute interprétation, devient ici un véritable programme d'action. L' « ouverture » constitue dès lors la possibilité fondamentale de l'interprète et de l'artiste contemporains. A son tour, l'esthétique reconnaîtra, dans leurs expériences, une confirmation de ses intuitions, la manifestation extrême d'une situation interprétative susceptible de se réaliser à divers degrés d'intensité.
En fait, ces considérations ne relèvent pas seulement de l'esthétique mais de. la sociologie et de la pédagogie. La poétique de l'oeuvre en mouvement (et en partie aussi, celle de l' œuvre « ouverte ») instaure un nouveau type de rapports entre l'artiste et son public, un nouveau fonctionnement de la perception esthétique ; elle assure au produit artistique une place nouvelle dans la société. Elle établit enfin un rapport inédit entre la contemplation et l'utilisation de l'œuvre d'art.
Ainsi éclairée dans ses racines historiques, et dans le jeu de références ou d'analogies qui l'apparentent à d'autres aspects du monde contemporain, la forme nouvelle d'art que nous avons analysée reste en pleine évolution. Loin d'être parfaitement expliquée et cataloguée, elle instaure une problématique, sur plusieurs plans: il s'agit, en somme, d'une situation ouverte et en mouvement.
Voilà donc trois aspects d'un même problème. Mais la réflexion esthétique, même contemporaine, s'est surtout attachée au troisième : à l'infinité, donc, de l'œuvre pourtant achevée. Voici par exemple ce qu'écrit Pareyson en des pages qui sont parmi les meilleures qu'on ait consacrées à la phénoménologie de l'interprétation : « L'œuvre d'art (...) est une forme, c'est-à-dire un mouvement arrivé à sa conclusion : en quelque sorte, un infini inclus dans le fini. Sa totalité résulte de sa conclusion et doit donc être considérée non comme la fermeture d'une réalité statique et immobile, mais comme l'ouverture d'un infini qui s'est rassemblé dans une forme. L'œuvre a, de ce fait, une infinité d'aspects qui ne sont pas des « fragments » ou des « parties » mais dont chacun la contient tout entière et la révèle dans une perspective déterminée. La diversité des exécutions a son fondement dans la complexité tant de l'individu qui l'interprète que de l'œuvre même (...). Les innombrables points de vue des interprètes et les innombrables aspects de l'œuvre se répondent, se rencontrent et s'éclairent mutuellement, en sorte que l'interprète doit, pour révéler l'œuvre dans son intégralité, la saisir sous l'un de ses aspects particuliers, et qu'inversement un aspect particulier de l'œuvre doit attendre l'interprète susceptible de le capter et de donner ainsi de l'intégra- lité une vision renouvelée. » Pareyson va jusqu'à affirmer que « toutes les interprétations sont définitives en ce sens que chacune d'elles est pour l'interprète l'oeuvre même; mais elles sont en même temps provisoires puisque l'interprète sait qu'il devra indéfiniment approfondir sa propre interprétation. Dans la mesure où elles sont définitives, ces interprétations sont parallèles, en sorte que l'une exclut les autres sans pour autant les nier 18... »
Ces affirmations — faites au niveau de l'esthétique théorique — sont applicables à toutes les formes d'art et à l'art de tous les temps. Ce n'est pourtant pas par hasard qu'il a fallu attendre notre époque pour voir naître et se développer une véritable problématique de l' « ouverture ». Ce que l'esthétique fait ici valoir sur un plan général reprend certaines exigences plus explicites et plus rigoureuses propres à la poétique de l'œuvre « ouverte ». Cela ne signifie pas, inversement, que la notion d'œuvre « ouverte » et d'oeuvre en mouvement n'ajoute rien à une expérience séculaire, tout étant dans l'art depuis toujours, et toute découverte ayant déjà été faite (au moins) par les Chinois : il convient de distiguer soigneusement entre le plan théorique de l'esthétique en tant que discipline philosophique, et le plan pratique de la poétique en tant que programme de création. L'esthétique, en faisant valoir une exigence particulièrement vive à notre époque, découvre la possibilité d'un certain type d'expérience applicable à toute œuvre d'art, indépendamment des critères opératoires qui ont présidé à sa création. Mais les poétiques (et la pratique) de l' oeuvre en mouvement voient dans cette même possibilité leur vocation spécifique en synchronisation avec tout le courant de la culture contemporaine. Ce qui est, pour l'esthétique, la condition générale de toute interprétation, devient ici un véritable programme d'action. L' « ouverture » constitue dès lors la possibilité fondamentale de l'interprète et de l'artiste contemporains. A son tour, l'esthétique reconnaîtra, dans leurs expériences, une confirmation de ses intuitions, la manifestation extrême d'une situation interprétative susceptible de se réaliser à divers degrés d'intensité.
En fait, ces considérations ne relèvent pas seulement de l'esthétique mais de. la sociologie et de la pédagogie. La poétique de l'oeuvre en mouvement (et en partie aussi, celle de l' œuvre « ouverte ») instaure un nouveau type de rapports entre l'artiste et son public, un nouveau fonctionnement de la perception esthétique ; elle assure au produit artistique une place nouvelle dans la société. Elle établit enfin un rapport inédit entre la contemplation et l'utilisation de l'œuvre d'art.
Ainsi éclairée dans ses racines historiques, et dans le jeu de références ou d'analogies qui l'apparentent à d'autres aspects du monde contemporain, la forme nouvelle d'art que nous avons analysée reste en pleine évolution. Loin d'être parfaitement expliquée et cataloguée, elle instaure une problématique, sur plusieurs plans: il s'agit, en somme, d'une situation ouverte et en mouvement.