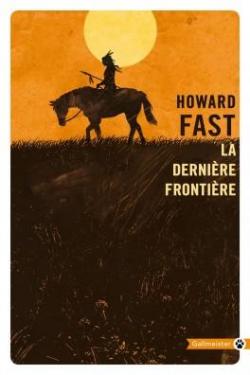>
Critique de Ingannmic
Oklahoma, torride été 1878.
Cela fait un an que les tribus cheyennes des Black Hills (situées à plus de mille kilomètres au nord) ont été parquées sur cet aride territoire pour permettre l'expansion de l'homme blanc sur leurs terres originelles. Peuple chasseur et carnivore, ils dépérissent dans cet Oklahoma dépourvu des plaines herbeuses et du gibier qui assuraient leur subsistance ; la malnutrition et la malaria ont décimés leurs rangs. Aussi, lorsque trois cents d'entre eux sollicitent auprès de l'agence indienne dont ils dépendent l'autorisation de rentrer chez eux, c'est une question de survie. Leur requête est pourtant refusée... Quelques jours plus tard, une rumeur douteuse évoque la fuite vers le nord de trois cheyennes. Cette soi-disant désobéissance à l'injonction faite de ne pas quitter la réserve est un affront qui ne peut rester impuni : les autorités menacent d'emprisonner, en guise d'otages, dix membres de la tribu, qui ne seront relâchés qu'au retour des trois fuyards. Face à cette attitude bornée et à ses conséquences mortelles, les trois cents indiens décident de partir.
C'est le début d'une épopée héroïque et désespérée pour retrouver leur terre ancestrale et leur liberté qui n'arrivera à son terme qu'en avril 1879, au cours de laquelle, affaiblis par une année de famine, ne comptant que quatre-vingt hommes dont la moitié seulement est en âge de combattre, ils vont parcourir à poney et à pied mille six cents kilomètres d'un territoire défendu par une armée qui totalisera au fil de leur parcours jusqu'à neuf mille soldats, secondés de trois mille miliciens. Stratèges hors pair, faisant corps avec l'environnement naturel et avec des montures qu'ils pratiquent depuis leur plus jeune âge, les cheyennes sont insaisissables... mais cette ultime lutte qu'ils mènent contre leur extinction et pour leur honneur, préférant mourir libre que vivre contraints et diminués, risque de leur coûter leurs dernières forces...
Howard Fast adopte pour présenter cet épisode, à propos duquel il a pu recueillir les témoignages de survivants ou de leurs enfants ("La dernière frontière" a été écrit en 1941, soit une petite soixantaine d'années après les événements), un point de vue auquel on ne peut que souscrire...
D'un côté les derniers représentants exsangues d'un peuple fier et brave, une minorité que l'on tient à écraser en oubliant qu'elle est dans son bon droit et s'en justifiant en les considérant comme des primitifs, inventant des crimes qu'ils auraient commis... de l'autre, un homme blanc dont la soif d'expansion ne connaît aucune limite morale, chez lequel cette chasse à l'indien excite la soif de domination et de violence, attise le sentiment de supériorité. Les rares voix critiques ou miséricordieuses qui reconnaissent la bêtise de cette obstination, et dénoncent les travers bureaucratiques ayant conduit à l'absurdité de la situation, sont vite assourdies par leur propre lâcheté ou par le consensus public autour de la nécessité de "mater ces sauvages".
"La dernière frontière", en évoquant cette "anecdote" tombée dans l'oubli, se veut un soufflet à la face d'une Histoire américaine soi-disant fondée sur un idéal de démocratie et de liberté (tout dépend de qui s'en revendique, sans doute). Mais c'est aussi un récit poignant, car Howard Fast nous donne à voir, de manière très concrète, le dernier sursaut d'un peuple que l'on s'est obstiné à anéantir.
Lien : https://bookin-ingannmic.blo..
Cela fait un an que les tribus cheyennes des Black Hills (situées à plus de mille kilomètres au nord) ont été parquées sur cet aride territoire pour permettre l'expansion de l'homme blanc sur leurs terres originelles. Peuple chasseur et carnivore, ils dépérissent dans cet Oklahoma dépourvu des plaines herbeuses et du gibier qui assuraient leur subsistance ; la malnutrition et la malaria ont décimés leurs rangs. Aussi, lorsque trois cents d'entre eux sollicitent auprès de l'agence indienne dont ils dépendent l'autorisation de rentrer chez eux, c'est une question de survie. Leur requête est pourtant refusée... Quelques jours plus tard, une rumeur douteuse évoque la fuite vers le nord de trois cheyennes. Cette soi-disant désobéissance à l'injonction faite de ne pas quitter la réserve est un affront qui ne peut rester impuni : les autorités menacent d'emprisonner, en guise d'otages, dix membres de la tribu, qui ne seront relâchés qu'au retour des trois fuyards. Face à cette attitude bornée et à ses conséquences mortelles, les trois cents indiens décident de partir.
C'est le début d'une épopée héroïque et désespérée pour retrouver leur terre ancestrale et leur liberté qui n'arrivera à son terme qu'en avril 1879, au cours de laquelle, affaiblis par une année de famine, ne comptant que quatre-vingt hommes dont la moitié seulement est en âge de combattre, ils vont parcourir à poney et à pied mille six cents kilomètres d'un territoire défendu par une armée qui totalisera au fil de leur parcours jusqu'à neuf mille soldats, secondés de trois mille miliciens. Stratèges hors pair, faisant corps avec l'environnement naturel et avec des montures qu'ils pratiquent depuis leur plus jeune âge, les cheyennes sont insaisissables... mais cette ultime lutte qu'ils mènent contre leur extinction et pour leur honneur, préférant mourir libre que vivre contraints et diminués, risque de leur coûter leurs dernières forces...
Howard Fast adopte pour présenter cet épisode, à propos duquel il a pu recueillir les témoignages de survivants ou de leurs enfants ("La dernière frontière" a été écrit en 1941, soit une petite soixantaine d'années après les événements), un point de vue auquel on ne peut que souscrire...
D'un côté les derniers représentants exsangues d'un peuple fier et brave, une minorité que l'on tient à écraser en oubliant qu'elle est dans son bon droit et s'en justifiant en les considérant comme des primitifs, inventant des crimes qu'ils auraient commis... de l'autre, un homme blanc dont la soif d'expansion ne connaît aucune limite morale, chez lequel cette chasse à l'indien excite la soif de domination et de violence, attise le sentiment de supériorité. Les rares voix critiques ou miséricordieuses qui reconnaissent la bêtise de cette obstination, et dénoncent les travers bureaucratiques ayant conduit à l'absurdité de la situation, sont vite assourdies par leur propre lâcheté ou par le consensus public autour de la nécessité de "mater ces sauvages".
"La dernière frontière", en évoquant cette "anecdote" tombée dans l'oubli, se veut un soufflet à la face d'une Histoire américaine soi-disant fondée sur un idéal de démocratie et de liberté (tout dépend de qui s'en revendique, sans doute). Mais c'est aussi un récit poignant, car Howard Fast nous donne à voir, de manière très concrète, le dernier sursaut d'un peuple que l'on s'est obstiné à anéantir.
Lien : https://bookin-ingannmic.blo..