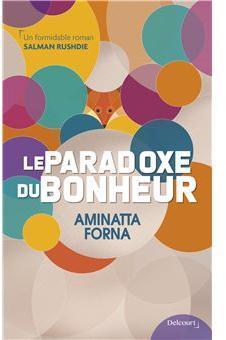>
Critique de Klasina
Un livre à lire comme une belle quête du bonheur. Il s'ouvre sur trois perspectives : le renard, Attila, Jean. La contingence ouvre une possibilité dans le réel d'une rencontre marquante. C'est par le choc, un heurt qu'elle se manifeste : Jean à la recherche d'un renard court et percute Attila. Voici, en quelques peu de seconde, les débuts de ligne d'une histoire, un livre qui s'ouvre dans la vie.
Nos deux personnages ont leurs préoccupations spécifiques : Jean s'intéresse à la faune sauvage en milieu urbain. Elle réalise aussi des jardins. Attila, lui est psychiatre, intervenant pendant les conflits internationaux ( Irak, Sierra Leone…). Par là, l'une s'attache à défendre des espèces menacées, l'autre s'attache à défendre une psyché menacée, victime de traumatismes.
C'est de là, que j'estime voir, des réflexions, interrogations qui préoccupent notre monde contemporain. En effet, la planète est en danger, l'Humanité l'est également, à travers les violences, les conflits, les guerres. Au-delà d'une intrigue et son aboutissement au bonheur, on peut dégager plusieurs portes de réflexions que l'auteur nous ouvre.
Ce livre suggère-t-il un nouvel anthropocène, c'est-à-dire une nouvelle relation entre l'urbanité et la nature ? Les renards envahissent les villes, en l'occurrence Londres. Jean défend leur cause, et leurs possibilités d'adaptation. Or, la plupart refuse leur présence. Cette vision dégage qu'on est dans un monde où l'homme ne se repend pas de sa destruction du milieu naturel. Dans un autre sens, le point de vue de Jean démontre une conscience du problème et une volonté d'y remédier. Elle participe à des émissions, mais ses propos sont tournés en dérision : c'est une voix écologique au milieu de coeurs muets, indifférents au sort des animaux et de notre planète. Dès lors, notre monde est divisé quant à la santé de la nature.
J'y vois dans ce livre un attachement à la nature. Il maintient cette illusion consolatrice que la nature est un être vivant, près duquel on se recueille, on souffre, on aime également. Par là, le lien originel du rapport nature/homme se dévoile peut-être : celui de notre Mère première. L'homme, comme un enfant rebelle, a laissé sa mère et a voulu faire ses propres expériences mais sans conseils de sagesse.
Autre point qui paraît intéressant : c'est la question de notre existence, quel sens lui conférer ? Ce livre, par le personnage d'Attila, mène une réflexion sur la psychologie et les traumatismes. C'est « une dérive psychologisante » qui est pointée. On est simplement humain, on souffre alors on nous diagnostique. On y voit un problème, un traumatisme. Cette réflexion s'ouvre à propos du dossier d'Adama Sherriff, une femme en colère et triste, suite à la mort accidentelle de son mari. Les autres passantes l'évitent. Atilla en déduit qu'elles refusent de voir la souffrance, espérant y échapper.
Par conséquent, la réflexion se base contre la doxa. Les « fous » ou malades ne sont pas tant ceux qui ont souffert, mais ceux qui refusent cette part de la vie, ceux qui restent en constant évitement, en indifférence parfaite, avec la peur de souffrir. Par conséquent, ils refusent leur condition mortelle, humaine. En fait, la souffrance et la joie font partie de la vie. Ce n'est pas parce qu'on souffre, qu'on doit être diagnostiqué comme si nous étions malades. Non, la vie fait souffrir. L'auteur se base sur le concept de « résilience », c'est-à-dire aller de l'avant malgré le choc. Que la souffrance peut amener à un état positif, plus grand que nous n'étions.
Donc le bonheur peut exister dans son paradoxe. Malgré les circonstances extérieures, à savoir les malheurs, les morts, la planète qui se fane, belle fleur dont le jardinier ne prend plus soin ; il existe une possibilité d'être heureux. Ce roman nous apprend à accepter la vie et ses contingences, et ses lots de souffrance. Ainsi, à la mort de Rosie, tendre amie d'Attila, on danse, on rit. On affirme qu'au-delà la souffrance, la joie est possible. Rosie n'aurait pas voulu qu'il se mortifie, mais qu'il continue à vivre.
A cet égard, la formule de Nietzsche est répétée comme un adage populaire : « ce qui ne tue pas rend plus fort ». C'est à prendre dans le sens que la vie est une épreuve, vers laquelle l'homme doit se diriger.
C'est l'amor fati : dire oui à l'existence tragique. La souffrance est. Elle n'a pas de valeur intrinsèque. Mais cette souffrance est un test et nous accroît dans notre potentiel créateur. C'est notre rapport à elle qui a un sens. Il consiste à affirmer la vie malgré tout, pas sa mortification.
Non, on a pas le droit à un joker « j'évite la souffrance, je passe mon tour, à la prochaine », on ne joue pas avec la vie, il faut dès maintenant gagner notre partie.
Nos deux personnages ont leurs préoccupations spécifiques : Jean s'intéresse à la faune sauvage en milieu urbain. Elle réalise aussi des jardins. Attila, lui est psychiatre, intervenant pendant les conflits internationaux ( Irak, Sierra Leone…). Par là, l'une s'attache à défendre des espèces menacées, l'autre s'attache à défendre une psyché menacée, victime de traumatismes.
C'est de là, que j'estime voir, des réflexions, interrogations qui préoccupent notre monde contemporain. En effet, la planète est en danger, l'Humanité l'est également, à travers les violences, les conflits, les guerres. Au-delà d'une intrigue et son aboutissement au bonheur, on peut dégager plusieurs portes de réflexions que l'auteur nous ouvre.
Ce livre suggère-t-il un nouvel anthropocène, c'est-à-dire une nouvelle relation entre l'urbanité et la nature ? Les renards envahissent les villes, en l'occurrence Londres. Jean défend leur cause, et leurs possibilités d'adaptation. Or, la plupart refuse leur présence. Cette vision dégage qu'on est dans un monde où l'homme ne se repend pas de sa destruction du milieu naturel. Dans un autre sens, le point de vue de Jean démontre une conscience du problème et une volonté d'y remédier. Elle participe à des émissions, mais ses propos sont tournés en dérision : c'est une voix écologique au milieu de coeurs muets, indifférents au sort des animaux et de notre planète. Dès lors, notre monde est divisé quant à la santé de la nature.
J'y vois dans ce livre un attachement à la nature. Il maintient cette illusion consolatrice que la nature est un être vivant, près duquel on se recueille, on souffre, on aime également. Par là, le lien originel du rapport nature/homme se dévoile peut-être : celui de notre Mère première. L'homme, comme un enfant rebelle, a laissé sa mère et a voulu faire ses propres expériences mais sans conseils de sagesse.
Autre point qui paraît intéressant : c'est la question de notre existence, quel sens lui conférer ? Ce livre, par le personnage d'Attila, mène une réflexion sur la psychologie et les traumatismes. C'est « une dérive psychologisante » qui est pointée. On est simplement humain, on souffre alors on nous diagnostique. On y voit un problème, un traumatisme. Cette réflexion s'ouvre à propos du dossier d'Adama Sherriff, une femme en colère et triste, suite à la mort accidentelle de son mari. Les autres passantes l'évitent. Atilla en déduit qu'elles refusent de voir la souffrance, espérant y échapper.
Par conséquent, la réflexion se base contre la doxa. Les « fous » ou malades ne sont pas tant ceux qui ont souffert, mais ceux qui refusent cette part de la vie, ceux qui restent en constant évitement, en indifférence parfaite, avec la peur de souffrir. Par conséquent, ils refusent leur condition mortelle, humaine. En fait, la souffrance et la joie font partie de la vie. Ce n'est pas parce qu'on souffre, qu'on doit être diagnostiqué comme si nous étions malades. Non, la vie fait souffrir. L'auteur se base sur le concept de « résilience », c'est-à-dire aller de l'avant malgré le choc. Que la souffrance peut amener à un état positif, plus grand que nous n'étions.
Donc le bonheur peut exister dans son paradoxe. Malgré les circonstances extérieures, à savoir les malheurs, les morts, la planète qui se fane, belle fleur dont le jardinier ne prend plus soin ; il existe une possibilité d'être heureux. Ce roman nous apprend à accepter la vie et ses contingences, et ses lots de souffrance. Ainsi, à la mort de Rosie, tendre amie d'Attila, on danse, on rit. On affirme qu'au-delà la souffrance, la joie est possible. Rosie n'aurait pas voulu qu'il se mortifie, mais qu'il continue à vivre.
A cet égard, la formule de Nietzsche est répétée comme un adage populaire : « ce qui ne tue pas rend plus fort ». C'est à prendre dans le sens que la vie est une épreuve, vers laquelle l'homme doit se diriger.
C'est l'amor fati : dire oui à l'existence tragique. La souffrance est. Elle n'a pas de valeur intrinsèque. Mais cette souffrance est un test et nous accroît dans notre potentiel créateur. C'est notre rapport à elle qui a un sens. Il consiste à affirmer la vie malgré tout, pas sa mortification.
Non, on a pas le droit à un joker « j'évite la souffrance, je passe mon tour, à la prochaine », on ne joue pas avec la vie, il faut dès maintenant gagner notre partie.