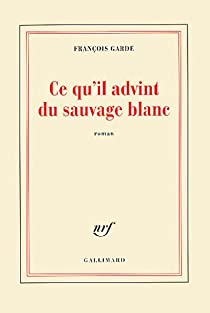>
Critique de horline
On pourrait se contenter du titre pour résumer l'histoire de ce matelot français, Narcisse Pelletier qui, après avoir été recueilli dix-sept ans au sein d'une tribu aborigène du Nord Est de l'Australie, est miraculeusement « sauvé » pour réintégrer la société civilisée.
Pourtant il y a bien plus qu'une histoire réelle romancée dans ce récit. Ces quelques trois cent pages interrogent notre rapport à la civilisation et à l'autre, bousculent s'il en est besoin nos idées sur les sociétés dites sauvage et civilisée car « ce qui a commencé sur une plage déserte d'Australie oblige à penser l'Homme autrement ».
Oublié sur une terre inconnue en apparence hostile, sans eau potable ni nourriture, muni d'un seul couteau et d'un pantalon pour seuls biens, le jeune matelot a dû apprendre à survivre pour espérer un jour être retrouvé par une chaloupe…
Fortuitement découvert par un équipage en route pour Sydney, on aurait pu croire son calvaire terminé. Et pourtant le retour à la société n'est pas aisé pour celui qui a oublié sa langue, ses origines, sa culture.
Comment un « homme blanc » que le récit ne privera pas d'intelligence a pu s'oublier soi-même au point de ne plus reconnaître les codes et les usages « des siens » et s'exprimer uniquement avec une voix gutturale et des claquements de langue ?
C'est l'énigme que tente de résoudre Octave, géographe de formation et enthousiaste sous l'oeil de la communauté scientifique puis de la population.
Avec un style appliqué et une rigueur méthodique, François Garde s'intéresse à cette question de l'homme sauvage, maintenue en suspens par un sentiment permanent de fragilité et de tâtonnement mêlés. On suit les observations et les raisonnements de chacun sur cette aventure inédite. On arpente le chemin parsemé d'obstacles et parfois douloureux de ces deux hommes confrontés à des questions nouvelles dans ce qui apparaît comme une démarche plus ou moins volontaire de rapprocher deux mondes différents.
Vont-ils y parvenir ? Rien n'est moins sûr dés lors que l'on franchit les portes de l'inconnu. La progression lente du récit maintient habilement le doute et la perplexité : on parcourt un récit à double voix qui alterne entre le poids écrasant de la culture occidentale au sein d'une tribu primitive et la volonté farouche de réveiller les sonorités familières comme les apprentissages élémentaires chez ce sauvage blanc pour qu'il se réapproprie ce qu'il a gardé au fond de lui et auquel il a renoncé.
Ainsi présenté, on se dit que les récits sont amenés à ne jamais se croiser. Mais c'est un roman où rien n'est acquis, rien n'est intangible. Les frontières du monde connu vacillent.
Si l'auteur privilégie la dimension romanesque de ce fait divers, il n'oublie pas pour autant de faire cohabiter le récit avec un formidable élan en faveur de quelques perspectives anthropologiques inédites pour l'époque en introduisant la nécessité de redéfinir l'Homme et son environnement. Il annonce l'ouverture de nouveaux champs d'interprétation pour la science mais le talent de François Garde est certainement de raconter cette histoire avec les perspectives, les enthousiasmes et les déceptions du XIXe.
Pourtant il y a bien plus qu'une histoire réelle romancée dans ce récit. Ces quelques trois cent pages interrogent notre rapport à la civilisation et à l'autre, bousculent s'il en est besoin nos idées sur les sociétés dites sauvage et civilisée car « ce qui a commencé sur une plage déserte d'Australie oblige à penser l'Homme autrement ».
Oublié sur une terre inconnue en apparence hostile, sans eau potable ni nourriture, muni d'un seul couteau et d'un pantalon pour seuls biens, le jeune matelot a dû apprendre à survivre pour espérer un jour être retrouvé par une chaloupe…
Fortuitement découvert par un équipage en route pour Sydney, on aurait pu croire son calvaire terminé. Et pourtant le retour à la société n'est pas aisé pour celui qui a oublié sa langue, ses origines, sa culture.
Comment un « homme blanc » que le récit ne privera pas d'intelligence a pu s'oublier soi-même au point de ne plus reconnaître les codes et les usages « des siens » et s'exprimer uniquement avec une voix gutturale et des claquements de langue ?
C'est l'énigme que tente de résoudre Octave, géographe de formation et enthousiaste sous l'oeil de la communauté scientifique puis de la population.
Avec un style appliqué et une rigueur méthodique, François Garde s'intéresse à cette question de l'homme sauvage, maintenue en suspens par un sentiment permanent de fragilité et de tâtonnement mêlés. On suit les observations et les raisonnements de chacun sur cette aventure inédite. On arpente le chemin parsemé d'obstacles et parfois douloureux de ces deux hommes confrontés à des questions nouvelles dans ce qui apparaît comme une démarche plus ou moins volontaire de rapprocher deux mondes différents.
Vont-ils y parvenir ? Rien n'est moins sûr dés lors que l'on franchit les portes de l'inconnu. La progression lente du récit maintient habilement le doute et la perplexité : on parcourt un récit à double voix qui alterne entre le poids écrasant de la culture occidentale au sein d'une tribu primitive et la volonté farouche de réveiller les sonorités familières comme les apprentissages élémentaires chez ce sauvage blanc pour qu'il se réapproprie ce qu'il a gardé au fond de lui et auquel il a renoncé.
Ainsi présenté, on se dit que les récits sont amenés à ne jamais se croiser. Mais c'est un roman où rien n'est acquis, rien n'est intangible. Les frontières du monde connu vacillent.
Si l'auteur privilégie la dimension romanesque de ce fait divers, il n'oublie pas pour autant de faire cohabiter le récit avec un formidable élan en faveur de quelques perspectives anthropologiques inédites pour l'époque en introduisant la nécessité de redéfinir l'Homme et son environnement. Il annonce l'ouverture de nouveaux champs d'interprétation pour la science mais le talent de François Garde est certainement de raconter cette histoire avec les perspectives, les enthousiasmes et les déceptions du XIXe.