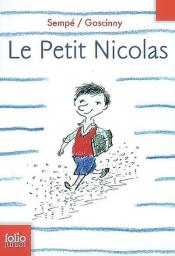>
Critique de JulienDjeuks
Peu nombreuses, si on les compare aux planches d'une bande dessinée, les illustrations de Sempé, avec ce style caricature, participent pleinement à l'univers du Petit Nicolas, celui de l'espièglerie enfantine. Ils en donnent une image simple et sans particularités (tous les personnages sont blancs, long nez en cigare… la grande majorité des personnages sont des garçons) : on pourrait aujourd'hui trouver suspect cette homogénéité, manque qui peut être comblé à l'occasion de tel ou tel récit qui fait surgir, met en relief, cette diversité absente du souvenir (l'anglais, le pauvre, le riche, la fille… On découvre ainsi dans "Louisette" que la fille jusqu'alors absente reçoit à l'avance les clichés machistes, mais s'en détache justement pour obtenir au nom des filles une identité forte ; "Djodjo" lui aussi donnant son nom au chapitre, a une identité forte, valorisée par le récit).
Le jeu de compilation sur les bons souvenirs d'école, événements marquants, les bonnes blagues et les grosses bêtises, prend des allures de journal fictif d'un enfant (l'absence de dates précises, de noms de famille, permet comme une transformation de l'anecdote en mythe symbolique, l'universalisation de la parole : le petit Nicolas, c'est tout un chacun, dans l'enfance, et dans ses souvenirs d'enfance). Mais c'est la fausse voix enfantine de Nicolas qui fait toute la magie du récit. Les événements, racontés comme du jour même, comme un journal rédigé par le Petit Nicolas, font entendre aussi bien l'innocence de l'enfant et le regard acéré d'un auteur – voix révélatrice des incohérences, absurdités du monde adulte (notamment sur l'éducation, que ce soit à l'école ou à la maison, ou bien sur l'illusion des adultes qui sont en fait de grands enfants cachant difficilement les mêmes envies de jeu, de bêtises…).
« – Assez ! À vos places ! Vous ne jouerez pas cette pièce pendant la fête. Je ne veux pas que monsieur le directeur voie ça ! Nous sommes tous restés la bouche ouverte. C'était la première fois que nous entendions la maîtresse punir le directeur. » (p. 118). La conclusion ou pseudo-morale proposée par la voix de l'enfant fait rire évidemment parce qu'elle trahit une erreur d'interprétation sur les paroles de la maîtresse. Mais la double référence de « ça » (le spectacle prévu, les bêtises des enfants) permet aussi de faire surgir une critique sociale du monde adulte qui refuse de voir l'enfant tel qu'il est, qui le veut autrement, figé, petit adulte, très calme, sage, attentif. Qui veut le voir dans un spectacle d'adulte, jouer à imiter l'adulte. Alors que même le personnage d'Agnan porte des lunettes (symbole du sérieux adulte rendant impossible la bagarre), comme il porterait un masque : chaque scène révèle comme sa nature profonde d'enfant le porte à la « bêtise » enfantine, non au sérieux calme. Sa nature se révèle d'ailleurs totalement dans « Je fréquente Agnan », le Petit Nicolas étant davantage qu'une mauvaise influence, le révélateur de cette nature reniée par Aignan (celui qui accepte ce jeu contre-nature imposé par les adultes). Nicolas est celui qui fait émerger cette nature humaine de l'enfant, qui communique au lecteur ce souvenir enfoui de ces bons temps d'innocence et de jeu.
Les personnages d'adulte dans « le vélo » (ou la concurrence du père et du voisin apparaît encore plus guignolesque que celle des enfants), dans « Rex » (où les deux parents cèdent au même penchant d'émerveillement naïf pour le petit chien). Dans « Monsieur Bordenave n'aime pas le soleil », le surveillant de récré, à cause de la difficulté absurde de son travail – imposer le carcan de la discipline aux enfants lors de la récré – en vient à un comportement aussi incohérent que celui d'un enfant capricieux. le photographe de « Un souvenir qu'on va chérir » est fortement ébranlé de jalousie devant les critiques de Geoffroy sur son appareil.
Tour à tour, les adultes (surveillant Bouillon, la maîtresse, le directeur, l'inspecteur…) essayant ou croyant avoir la solution pour domestiquer les petits sauvageons – pleine essence d'enfance – se cassent les dents sur la ressource infinie de bêtises impossibles à faire taire.
Mais Goscinny ne fait pas du Petit Nicolas un symbole soixante-huitard non plus. L'enfant ne sait pas toujours ce qu'il veut – Nicolas et Alceste sont vite ennuyés de leur école buissonnière dans l'ironique « On a bien rigolé ». Les fréquentes envies de fugue de Nicolas (« Je quitte la maison ») en sont un excellent symbole. Ce n'est pas parce que la nature de l'enfant – ou de l'humain – est d'être joueuse, fanfaronne, bêtisière, qu'il faut abandonner toute forme de discipline, d'éducation… Les enfants aiment la maîtresse, comme quelque part ils aiment et comprennent leurs parents qui se fâchent de leurs bêtises et mauvais « carnets ». C'est qu'instinctivement ils savent le besoin de règles et de limites, celles-là même qui donnent toute la saveur de la bêtise (« je fume »).
Ainsi, prendre conscience de la nature profonde de l'enfant, de l'humain, ce n'est pas pour autant la laisser s'exprimer sans restrictions, sans essai de détermination de ce qui est bon ou mal. Dans « Djodjo », on voit l'immense plaisir de la manipulation du gros mot par les enfants, répété bêtement, ou tout à fait volontairement, par l'anglais – a-t-il senti même ce plaisir et cette puissance dans la bouche de ses nouveaux camarades, ce qui l'a amené à les répéter fièrement ? Ces mots défendus, réservés aux adultes, ne perdraient-ils pas tout pouvoir de subversion s'ils étaient acceptés ? La « Louisette » est le parfait exemple de cette synthèse entre monde sérieux adulte et malice de l'enfant. La jeune fille, un peu plus âgée semble-t-il, s'approprie les codes du monde adulte, ce qui lui permet de retirer encore plus de plaisir de ses jeux et ses blagues, elle en obtient le respect et l'admiration de Nicolas. Il y a comme là une belle illustration de la conception du métier de scénariste-humoriste-caricaturiste-bédéiste de l'auteur : celui qui s'amuse avec les codes adultes, les fait parler, crève le sérieux adulte, cette mécanique défaillante qui en devient risible, tel que le décrit Bergson dans le Rire. Et c'est par ce rire malicieux qui fait éclater les enflures sociales que Goscinny retrouve un autre sérieux – presque celui d'un Socrate –, une recherche de l'humain, du sens de l'existence, de l'humilité, du plaisir simple…
Lien : https://leluronum.art.blog/2..
Le jeu de compilation sur les bons souvenirs d'école, événements marquants, les bonnes blagues et les grosses bêtises, prend des allures de journal fictif d'un enfant (l'absence de dates précises, de noms de famille, permet comme une transformation de l'anecdote en mythe symbolique, l'universalisation de la parole : le petit Nicolas, c'est tout un chacun, dans l'enfance, et dans ses souvenirs d'enfance). Mais c'est la fausse voix enfantine de Nicolas qui fait toute la magie du récit. Les événements, racontés comme du jour même, comme un journal rédigé par le Petit Nicolas, font entendre aussi bien l'innocence de l'enfant et le regard acéré d'un auteur – voix révélatrice des incohérences, absurdités du monde adulte (notamment sur l'éducation, que ce soit à l'école ou à la maison, ou bien sur l'illusion des adultes qui sont en fait de grands enfants cachant difficilement les mêmes envies de jeu, de bêtises…).
« – Assez ! À vos places ! Vous ne jouerez pas cette pièce pendant la fête. Je ne veux pas que monsieur le directeur voie ça ! Nous sommes tous restés la bouche ouverte. C'était la première fois que nous entendions la maîtresse punir le directeur. » (p. 118). La conclusion ou pseudo-morale proposée par la voix de l'enfant fait rire évidemment parce qu'elle trahit une erreur d'interprétation sur les paroles de la maîtresse. Mais la double référence de « ça » (le spectacle prévu, les bêtises des enfants) permet aussi de faire surgir une critique sociale du monde adulte qui refuse de voir l'enfant tel qu'il est, qui le veut autrement, figé, petit adulte, très calme, sage, attentif. Qui veut le voir dans un spectacle d'adulte, jouer à imiter l'adulte. Alors que même le personnage d'Agnan porte des lunettes (symbole du sérieux adulte rendant impossible la bagarre), comme il porterait un masque : chaque scène révèle comme sa nature profonde d'enfant le porte à la « bêtise » enfantine, non au sérieux calme. Sa nature se révèle d'ailleurs totalement dans « Je fréquente Agnan », le Petit Nicolas étant davantage qu'une mauvaise influence, le révélateur de cette nature reniée par Aignan (celui qui accepte ce jeu contre-nature imposé par les adultes). Nicolas est celui qui fait émerger cette nature humaine de l'enfant, qui communique au lecteur ce souvenir enfoui de ces bons temps d'innocence et de jeu.
Les personnages d'adulte dans « le vélo » (ou la concurrence du père et du voisin apparaît encore plus guignolesque que celle des enfants), dans « Rex » (où les deux parents cèdent au même penchant d'émerveillement naïf pour le petit chien). Dans « Monsieur Bordenave n'aime pas le soleil », le surveillant de récré, à cause de la difficulté absurde de son travail – imposer le carcan de la discipline aux enfants lors de la récré – en vient à un comportement aussi incohérent que celui d'un enfant capricieux. le photographe de « Un souvenir qu'on va chérir » est fortement ébranlé de jalousie devant les critiques de Geoffroy sur son appareil.
Tour à tour, les adultes (surveillant Bouillon, la maîtresse, le directeur, l'inspecteur…) essayant ou croyant avoir la solution pour domestiquer les petits sauvageons – pleine essence d'enfance – se cassent les dents sur la ressource infinie de bêtises impossibles à faire taire.
Mais Goscinny ne fait pas du Petit Nicolas un symbole soixante-huitard non plus. L'enfant ne sait pas toujours ce qu'il veut – Nicolas et Alceste sont vite ennuyés de leur école buissonnière dans l'ironique « On a bien rigolé ». Les fréquentes envies de fugue de Nicolas (« Je quitte la maison ») en sont un excellent symbole. Ce n'est pas parce que la nature de l'enfant – ou de l'humain – est d'être joueuse, fanfaronne, bêtisière, qu'il faut abandonner toute forme de discipline, d'éducation… Les enfants aiment la maîtresse, comme quelque part ils aiment et comprennent leurs parents qui se fâchent de leurs bêtises et mauvais « carnets ». C'est qu'instinctivement ils savent le besoin de règles et de limites, celles-là même qui donnent toute la saveur de la bêtise (« je fume »).
Ainsi, prendre conscience de la nature profonde de l'enfant, de l'humain, ce n'est pas pour autant la laisser s'exprimer sans restrictions, sans essai de détermination de ce qui est bon ou mal. Dans « Djodjo », on voit l'immense plaisir de la manipulation du gros mot par les enfants, répété bêtement, ou tout à fait volontairement, par l'anglais – a-t-il senti même ce plaisir et cette puissance dans la bouche de ses nouveaux camarades, ce qui l'a amené à les répéter fièrement ? Ces mots défendus, réservés aux adultes, ne perdraient-ils pas tout pouvoir de subversion s'ils étaient acceptés ? La « Louisette » est le parfait exemple de cette synthèse entre monde sérieux adulte et malice de l'enfant. La jeune fille, un peu plus âgée semble-t-il, s'approprie les codes du monde adulte, ce qui lui permet de retirer encore plus de plaisir de ses jeux et ses blagues, elle en obtient le respect et l'admiration de Nicolas. Il y a comme là une belle illustration de la conception du métier de scénariste-humoriste-caricaturiste-bédéiste de l'auteur : celui qui s'amuse avec les codes adultes, les fait parler, crève le sérieux adulte, cette mécanique défaillante qui en devient risible, tel que le décrit Bergson dans le Rire. Et c'est par ce rire malicieux qui fait éclater les enflures sociales que Goscinny retrouve un autre sérieux – presque celui d'un Socrate –, une recherche de l'humain, du sens de l'existence, de l'humilité, du plaisir simple…
Lien : https://leluronum.art.blog/2..