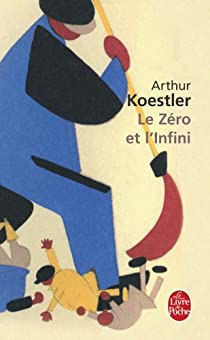>
Critique de frandj
Même pour un sexagénaire, relire ce livre au XXIème siècle c'est plonger dans un univers presque oublié, celui de l'URSS du "petit père des peuples". le roman évoque les incroyables procès intentés aux opposants (réels ou supposés) à Staline, au cours des années '30. Certes, encore à notre époque, de nombreux dictateurs sévissent contre leurs peuples respectifs qu'ils oppriment sans vergogne, mais ce sont pour ainsi dire des amateurs qui "roulent" pour eux-mêmes. La répression en Russie, c'était autre chose: elle était considérée comme dérivant naturellement du déterminisme marxiste-léniniste et indispensable pour assurer le triomphe final de la Révolution. Il n'y avait aucun moralisme là-dedans, car les impératifs de la lutte des classes (définis par Staline lui-même) primaient sur toute autre considération.
"Le zéro et l'infini" est difficile à lire en 2014, car tous les protagonistes - y compris l'accusé lui-même, dénommé Roubachoff - sont prisonniers du système de pensée communiste et donc développent inlassablement une phraséologie "révolutionnaire", qui nous parait maintenant désuète et presque vide de sens. Sur le fond, Roubachoff se retrouve coincé entre ses récentes velléités d'opposition à Staline et sa philosophie habituelle selon laquelle la fin justifie les moyens. Lui-même s'est montré autrefois sans pitié à l'égard des individus suspectés d'entraver la marche en avant de la Révolution. Et maintenant, c'est son tour d'être du mauvais côté de la barrière.
L'intrigue du roman est simple: Roubachoff, autrefois important responsable communiste, est arrêté, incarcéré, puis confronté à un premier juge d'instruction qu'il connait personnellement et qui essaie de le faire "craquer" par la simple force des syllogismes révolutionnaires, que l'accusé n'a toujours pas reniés. Mais cela ne suffit pas et un second juge d'instruction emploie la manière forte: il n'utilise pas la torture, certes, mais il exerce des pressions extrêmes qui obligent Roubachoff à "coopérer" et signer des aveux (mensongers). Par la suite, son procès public servira d'avertissement aux opposants potentiels et édifiera le peuple soviétique (qui gobe tout ou qui fait semblant). Une balle dans la nuque sera le destin de Roubachoff et on n'en parlera plus... jusqu'à une future réhabilitation ??
Pendant son incarcération, l'accusé se dépouille partiellement de ses habits de dur-à-cuire. Pendant les temps morts où il se retrouve seul dans sa cellule, il échange avec un de ses voisins en "tapotant" ses messages sur la tuyauterie, selon un certain code. Il s'interroge sur l'individu qu'il est - insignifiant devant le Parti tout-puissant, comme un zéro devant l'infini. Peu avant son exécution, il éprouve le besoin de "tapoter" sur le tuyau le simple mot JE, ce "moi" qu'il considère tardivement à sa juste valeur et qui va disparaitre incessamment.
A présent on connait très bien les moyens qu'utilisait la police politique dans les pays communistes pour briser toute résistance chez les personnes arrêtées. En revanche, quand "Le zéro et l'infini" a été publié (1941), de l'audace était nécessaire pour dire la vérité. Il a même fallu beaucoup de courage à l'auteur, A. Koestler, car il fut avant la seconde guerre mondiale membre d'un parti communiste. Donc, même si ce roman peut sembler maintenant "daté", il ne faudrait pas oublier dans quelle situation tragique il a été écrit.
"Le zéro et l'infini" est difficile à lire en 2014, car tous les protagonistes - y compris l'accusé lui-même, dénommé Roubachoff - sont prisonniers du système de pensée communiste et donc développent inlassablement une phraséologie "révolutionnaire", qui nous parait maintenant désuète et presque vide de sens. Sur le fond, Roubachoff se retrouve coincé entre ses récentes velléités d'opposition à Staline et sa philosophie habituelle selon laquelle la fin justifie les moyens. Lui-même s'est montré autrefois sans pitié à l'égard des individus suspectés d'entraver la marche en avant de la Révolution. Et maintenant, c'est son tour d'être du mauvais côté de la barrière.
L'intrigue du roman est simple: Roubachoff, autrefois important responsable communiste, est arrêté, incarcéré, puis confronté à un premier juge d'instruction qu'il connait personnellement et qui essaie de le faire "craquer" par la simple force des syllogismes révolutionnaires, que l'accusé n'a toujours pas reniés. Mais cela ne suffit pas et un second juge d'instruction emploie la manière forte: il n'utilise pas la torture, certes, mais il exerce des pressions extrêmes qui obligent Roubachoff à "coopérer" et signer des aveux (mensongers). Par la suite, son procès public servira d'avertissement aux opposants potentiels et édifiera le peuple soviétique (qui gobe tout ou qui fait semblant). Une balle dans la nuque sera le destin de Roubachoff et on n'en parlera plus... jusqu'à une future réhabilitation ??
Pendant son incarcération, l'accusé se dépouille partiellement de ses habits de dur-à-cuire. Pendant les temps morts où il se retrouve seul dans sa cellule, il échange avec un de ses voisins en "tapotant" ses messages sur la tuyauterie, selon un certain code. Il s'interroge sur l'individu qu'il est - insignifiant devant le Parti tout-puissant, comme un zéro devant l'infini. Peu avant son exécution, il éprouve le besoin de "tapoter" sur le tuyau le simple mot JE, ce "moi" qu'il considère tardivement à sa juste valeur et qui va disparaitre incessamment.
A présent on connait très bien les moyens qu'utilisait la police politique dans les pays communistes pour briser toute résistance chez les personnes arrêtées. En revanche, quand "Le zéro et l'infini" a été publié (1941), de l'audace était nécessaire pour dire la vérité. Il a même fallu beaucoup de courage à l'auteur, A. Koestler, car il fut avant la seconde guerre mondiale membre d'un parti communiste. Donc, même si ce roman peut sembler maintenant "daté", il ne faudrait pas oublier dans quelle situation tragique il a été écrit.