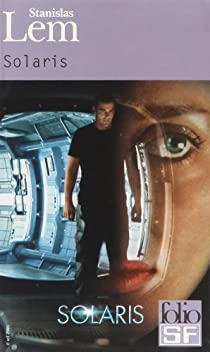>
Critique de Desimoni
Ce livre de Lem, lu il y a fort longtemps (probablement plus de 30 ou 40 ans), m'a récemment inspiré le commentaire suivant sur Babelio : « Solaris est, pour moi, l'un des sommets de la SF, combinant de manière géniale anticipation scientifique originale, mystère insondable et pauvre psychologie humaine mise à l'épreuve d'une intelligence extraterrestre inaccessible, hors de proportion avec l'esprit humain. »
A la relecture du roman, sans renier ces louanges, je lui trouve néanmoins quelques limites et imperfections, essentiellement en termes de construction narrative.
L'histoire débute certes de manière très classique par l'arrivée du chercheur psychologue Kris Kelvin à bord de la station Solaris, en provenance du vaisseau interstellaire Prométhée. Une arrivée quelque peu bousculée où il se voit d'emblée confronté au comportement étrange de son collègue Snaut, l'un des trois chercheurs présents dans la station. Suit alors un second chapitre (Les Solaristes) surtout consacré à exposer les recherches et les diverses théories développées au fil du temps par les scientifiques pour comprendre l'existence et le fonctionnement de l'Océan vivant qui enveloppe la planète Solaris.
Une première fois, la progression dramatique du récit se fige pour ne reprendre qu'à la fin du chapitre (« Je regardai ma montre. Il était temps de rejoindre Snaut ») (p. 46). Dans les cinq suivants (« Les visiteurs » - « Sartorius » - « Harey » - « le Petit Apocryphe » - « La conférence ») l'action progresse, quoique parfois par à coups. Puis à nouveau, dans celui qui suit (« Les monstres »), environ 30 pages sont consacrées à répertorier les diverses formations énigmatiques engendrées par l'Océan : « longus » - « fongosités » - « mimoïdes » - « symétriades et asymétriades » - « vertébridés »… une longue énumération descriptive de structures imaginaires qui, si elle témoigne de l'inventivité de l'auteur, se révèle assez fastidieuse. Et surtout sans rapport direct avec les événements mystérieux qui prennent place dans la station. Vers la fin du chapitre (p. 197), le fil de la narration reprend (« Quand je reposai sur son rayon le neuvième volume de la monographie de Giese… »).
Et ainsi de suite jusqu'à la conclusion du roman. Une fin assez banale et plutôt décevante, pas vraiment ouverte en ce qu'elle n'incite nullement le lecteur, la lectrice à imaginer une suite possible, intrigante ou captivante, un développement inattendu de l'intrigue ou une évolution des relations entre les personnages, Océan compris.
Cela dit, Solaris, en dépit de la progression maladroite et heurtée du récit, reste un livre phare de la SF en ce qu'il pose de manière originale beaucoup de questions pertinentes – philosophiques et anthropologiques – sur le mythe du « contact » avec une hypothétique entité vivante extraterrestre. Voire sur les buts, les limites, et la possibilité même d'un tel contact. Cela tout en préservant jusqu'au bout le mystère que constituent l'Océan et ses créatures. Lem pousse ainsi la réflexion notablement plus loin que d'autres auteurs de SF – tels, par exemple, Clarke et Kubrick dans 2001 – qui imaginent les modalités et les conséquences possibles d'un contact sans pour autant dépasser la perspective strictement rationaliste et scientifique (encore que l'apparition du foetus astral, à la fin du film, soit susceptible d'interprétations fort diverses). Pour Clarke, notamment, cette quête et les avancées technologiques sur lesquelles elle s'appuie, prend les accents d'une odyssée, d'une véritable épopée. de ce point de vue, le pessimisme critique de Lem est plus proche de la vision contemporaine d'un futur très probablement dystopique, où l'humain se verra dépassé par les conséquences désastreuses de son engouement technolâtre. Une impasse, qui relèguera, par voie de conséquence, la recherche et l'éventualité d'un « contact » à un ordre d'importance très secondaire, voire négligeable.
Autre facette de Lem moraliste : l'ironie implicite consistant, dans Solaris, à exhiber le contraste patent entre le volume considérable d'efforts – et de crédits – consacrés par la communauté scientifique à l'exploration et à la recherche visant à communiquer avec une entité vivante non humaine, en regard de la piètre qualité de cette même communication souvent dysfonctionnelle entre humains, en particulier chez les personnages du roman, ce qui conduit certains d'entre eux au suicide et au meurtre.
A la relecture du roman, sans renier ces louanges, je lui trouve néanmoins quelques limites et imperfections, essentiellement en termes de construction narrative.
L'histoire débute certes de manière très classique par l'arrivée du chercheur psychologue Kris Kelvin à bord de la station Solaris, en provenance du vaisseau interstellaire Prométhée. Une arrivée quelque peu bousculée où il se voit d'emblée confronté au comportement étrange de son collègue Snaut, l'un des trois chercheurs présents dans la station. Suit alors un second chapitre (Les Solaristes) surtout consacré à exposer les recherches et les diverses théories développées au fil du temps par les scientifiques pour comprendre l'existence et le fonctionnement de l'Océan vivant qui enveloppe la planète Solaris.
Une première fois, la progression dramatique du récit se fige pour ne reprendre qu'à la fin du chapitre (« Je regardai ma montre. Il était temps de rejoindre Snaut ») (p. 46). Dans les cinq suivants (« Les visiteurs » - « Sartorius » - « Harey » - « le Petit Apocryphe » - « La conférence ») l'action progresse, quoique parfois par à coups. Puis à nouveau, dans celui qui suit (« Les monstres »), environ 30 pages sont consacrées à répertorier les diverses formations énigmatiques engendrées par l'Océan : « longus » - « fongosités » - « mimoïdes » - « symétriades et asymétriades » - « vertébridés »… une longue énumération descriptive de structures imaginaires qui, si elle témoigne de l'inventivité de l'auteur, se révèle assez fastidieuse. Et surtout sans rapport direct avec les événements mystérieux qui prennent place dans la station. Vers la fin du chapitre (p. 197), le fil de la narration reprend (« Quand je reposai sur son rayon le neuvième volume de la monographie de Giese… »).
Et ainsi de suite jusqu'à la conclusion du roman. Une fin assez banale et plutôt décevante, pas vraiment ouverte en ce qu'elle n'incite nullement le lecteur, la lectrice à imaginer une suite possible, intrigante ou captivante, un développement inattendu de l'intrigue ou une évolution des relations entre les personnages, Océan compris.
Cela dit, Solaris, en dépit de la progression maladroite et heurtée du récit, reste un livre phare de la SF en ce qu'il pose de manière originale beaucoup de questions pertinentes – philosophiques et anthropologiques – sur le mythe du « contact » avec une hypothétique entité vivante extraterrestre. Voire sur les buts, les limites, et la possibilité même d'un tel contact. Cela tout en préservant jusqu'au bout le mystère que constituent l'Océan et ses créatures. Lem pousse ainsi la réflexion notablement plus loin que d'autres auteurs de SF – tels, par exemple, Clarke et Kubrick dans 2001 – qui imaginent les modalités et les conséquences possibles d'un contact sans pour autant dépasser la perspective strictement rationaliste et scientifique (encore que l'apparition du foetus astral, à la fin du film, soit susceptible d'interprétations fort diverses). Pour Clarke, notamment, cette quête et les avancées technologiques sur lesquelles elle s'appuie, prend les accents d'une odyssée, d'une véritable épopée. de ce point de vue, le pessimisme critique de Lem est plus proche de la vision contemporaine d'un futur très probablement dystopique, où l'humain se verra dépassé par les conséquences désastreuses de son engouement technolâtre. Une impasse, qui relèguera, par voie de conséquence, la recherche et l'éventualité d'un « contact » à un ordre d'importance très secondaire, voire négligeable.
Autre facette de Lem moraliste : l'ironie implicite consistant, dans Solaris, à exhiber le contraste patent entre le volume considérable d'efforts – et de crédits – consacrés par la communauté scientifique à l'exploration et à la recherche visant à communiquer avec une entité vivante non humaine, en regard de la piètre qualité de cette même communication souvent dysfonctionnelle entre humains, en particulier chez les personnages du roman, ce qui conduit certains d'entre eux au suicide et au meurtre.