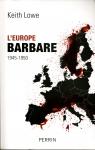Citations sur Inferno. La dévastation de Hambourg, 1943 (9)
Si la destruction matérielle est à couper le souffle, le coût humain des raids aériens atteignit véritablement une dimension tragique. En tout juste une semaine, 45 000 personnes avaient perdu la vie. Qui plus est, 37 439 autres avaient été blessés, alors que presque un million de gens, ayant fuit l'agglomération, étaient désormais officiellement sans abri. Tout ce qu'ils possédaient – tout, depuis leurs vêtements et leurs meubles jusqu'à leurs bibelots, leurs lettres et leurs photographies – avait fini brûlé ou réduit en miettes.
Pour restituer ces chiffres dans leur contexte, rappelons que le bilan des morts de Hambourg fut plus de dix fois supérieur à celui de tout autre raid antérieur. A Nagasaki, où les Américains larguèrent leur deuxième bombe atomique, le bilan immédiat fut de 40 000 morts – environ 5000 de moins qu'à Hambourg. Il serait dès lors inexact de comparer la dévastation de cette cité hanséatique avec le type de destruction normalement associé au bombardement conventionnel. Elle s'apparente davantage à l'annihilation qui serait bientôt possible à l'ère nucléaire.
Pour restituer ces chiffres dans leur contexte, rappelons que le bilan des morts de Hambourg fut plus de dix fois supérieur à celui de tout autre raid antérieur. A Nagasaki, où les Américains larguèrent leur deuxième bombe atomique, le bilan immédiat fut de 40 000 morts – environ 5000 de moins qu'à Hambourg. Il serait dès lors inexact de comparer la dévastation de cette cité hanséatique avec le type de destruction normalement associé au bombardement conventionnel. Elle s'apparente davantage à l'annihilation qui serait bientôt possible à l'ère nucléaire.
[témoignage de Ludwig Faupel, pompier Hambourgeois]
Je voulais m'extraire de ce chaos et, sur mon chemin, je suis tombé sur un tram calciné. Les vitres avaient fondu sous l'effet de la chaleur. A l'intérieur de la voiture, des corps morts gisaient nus, les uns sur les autres. Leurs vêtements, désintégrés, étaient réduits à de petits tas de braises. C'était là que ces gens avaient tenté de s'abriter de la tempête de feu. Dans l'Eiffestrasse, ils avaient lutté pour leur survie. Englués dans la macadam brûlant, ils avaient essayé de se maintenir en s'appuyant sur les mains, et ils étaient restés dans cette position, à genoux. Leur vie s'était achevée dans des hurlements de terreur et de douleur. J'étais incapable de les aider.
Je voulais m'extraire de ce chaos et, sur mon chemin, je suis tombé sur un tram calciné. Les vitres avaient fondu sous l'effet de la chaleur. A l'intérieur de la voiture, des corps morts gisaient nus, les uns sur les autres. Leurs vêtements, désintégrés, étaient réduits à de petits tas de braises. C'était là que ces gens avaient tenté de s'abriter de la tempête de feu. Dans l'Eiffestrasse, ils avaient lutté pour leur survie. Englués dans la macadam brûlant, ils avaient essayé de se maintenir en s'appuyant sur les mains, et ils étaient restés dans cette position, à genoux. Leur vie s'était achevée dans des hurlements de terreur et de douleur. J'étais incapable de les aider.
Et qu'en est-il de la population d'Hambourg proprement dite – comment perçoit-elle le supplice qu'elle a traversé ? En veut-elle aux Britanniques et aux Américains de la dévastation qu'ils ont semée dans sa cité ? Est-elle en colère ? Chaque fois que j'ai posé la question à un Hambourgeois, j'ai invariablement reçu la même réponse, qui reflète exactement le sentiment de leurs ennemis : « C'est nous qui avons commencé. » Ou, formule encore plus éloquente : « Nous le méritions. » Pour la plupart de ces gens, la colère, le ressentiment, l'indignation – et même la tristesse – semblent hors de propos, car ce qui compte vraiment, c'est que les Allemands regrettent.
Même pendant la guerre, beaucoup de gens à Hambourg ont compris qu'ils n'étaient pas irréprochables, et que, à un certain degré du moins, c'était eux qui s'étaient attiré ce désastre. Beaucoup voyaient la catastrophe comme une conséquence logique des attaques de la Luftwaffe contre la Grande-Bretagne ; certains pensaient même que c'était le juste châtiment du traitement réservé par les Hambourgeois aux Juifs de la ville. En tout cas, un sentiment de honte indicible était déjà ancré dans l'inconscient collectif allemand longtemps avant la fin de la guerre.
[…]
Après la guerre, le sentiment que l'Allemagne avait mérité ce châtiment alla grandissant, alimenté par le découverte de ce qui s'était perpétré à Bergen-Belsen, Auschwitz et même dans le camp de concentration de Neuengamme, au sud-est de Hambourg. Le caractère impitoyable de ces atrocités sembla devoir éclipser tout ce que les forces aériennes alliées avaient pu provoquer. Avec l'ouverture puis la clôture des procès de Nuremberg, la capacité de Hambourg à la colère fut étouffée sous le poids colossal de la culpabilité collective.
Même pendant la guerre, beaucoup de gens à Hambourg ont compris qu'ils n'étaient pas irréprochables, et que, à un certain degré du moins, c'était eux qui s'étaient attiré ce désastre. Beaucoup voyaient la catastrophe comme une conséquence logique des attaques de la Luftwaffe contre la Grande-Bretagne ; certains pensaient même que c'était le juste châtiment du traitement réservé par les Hambourgeois aux Juifs de la ville. En tout cas, un sentiment de honte indicible était déjà ancré dans l'inconscient collectif allemand longtemps avant la fin de la guerre.
[…]
Après la guerre, le sentiment que l'Allemagne avait mérité ce châtiment alla grandissant, alimenté par le découverte de ce qui s'était perpétré à Bergen-Belsen, Auschwitz et même dans le camp de concentration de Neuengamme, au sud-est de Hambourg. Le caractère impitoyable de ces atrocités sembla devoir éclipser tout ce que les forces aériennes alliées avaient pu provoquer. Avec l'ouverture puis la clôture des procès de Nuremberg, la capacité de Hambourg à la colère fut étouffée sous le poids colossal de la culpabilité collective.
Si Stalingrad fut le grand tournant le de la guerre pour l'armée allemande, Hambourg fut un tournant décisif du même ordre pour les civils allemands. Avant la tempête de feu, la plupart des gens croyaient leurs villes dûment protégées contre les bombardiers alliés ; après coup, ils comprirent que ces mêmes villes auraient de la chance de ne pas être rayées de la carte. Hambourg révélait clairement que les Alliés, et en particulier les Britanniques, avaient l'intention d'annihiler une ville après l'autre, jusqu'à la capitulation allemande. Il semblait que les terribles prédictions de Douhet, formulées dans les années 1920, se vérifiaient enfin : les villes de l'arrière présentaient désormais plus de danger que les champs de bataille eux-mêmes.
[…]
L'effet psychologique que ce cataclysme eut sur le pays dans son ensemble est incalculable. Des années plus tard, ils furent nombreux à se le rappeler comme un tournant décisif du conflit. Par exemple, le général Adolf Galland, le plus haut gradé de la chasse au sein de la Luftwaffe, affirma dans ses Mémoires que ce flot constant de réfugiés brisés, terrorisés, dissémina ce qu'il appela la « terreur de Hambourg » jusque dans les villages les plus reculés du Reich : « Une vague de terreur se propagea depuis la cité meurtrie et se répandit dans toute l'Allemagne. […] Au plan psychologique, à ce moment, la guerre avait peut-être atteint son seuil le plus critique. »
[…]
L'effet psychologique que ce cataclysme eut sur le pays dans son ensemble est incalculable. Des années plus tard, ils furent nombreux à se le rappeler comme un tournant décisif du conflit. Par exemple, le général Adolf Galland, le plus haut gradé de la chasse au sein de la Luftwaffe, affirma dans ses Mémoires que ce flot constant de réfugiés brisés, terrorisés, dissémina ce qu'il appela la « terreur de Hambourg » jusque dans les villages les plus reculés du Reich : « Une vague de terreur se propagea depuis la cité meurtrie et se répandit dans toute l'Allemagne. […] Au plan psychologique, à ce moment, la guerre avait peut-être atteint son seuil le plus critique. »
De telles visions sont certes poignantes, mais ne sont encore rien comparées aux scènes éprouvantes qui eurent lieu lorsque certains réfugiés subirent la fouille de leurs bagages. Un garçon de douze ans qui fuyait Hambourg fut arrêté à la frontière danoise. Il voyageait seul et portait deux sacs. Quand les douaniers le lui firent ouvrir, ils constatèrent qu'ils contenaient, l'un, le cadavre de son frère de deux ans, tué au cours du raid, et l'autre les cadavres des deux lapins de compagnie du garçon.
S'agissant d'un témoignage de troisième main, sa véracité demeure sujette à caution, mais il est certainement vrai que nombre de réfugiés emportèrent avec eux les corps de leurs êtres chers lorsqu'ils fuirent Hambourg. Friedrich Reck raconte avoir vu une femme lâcher sa valise au moment où elle embarquait à bord d'un train, en Bavière. Le contenu se répandit sur le quai, et, parmi les jouets, une trousse de manucure et des sous-vêtements roussis par le feu, il y avait « le corps rôti d'un enfant, ratatiné comme une momie, que sa mère au cerveau à moitié dérangé transportait avec elle, relique d'un passé qui était encore intact quelques jours plus tôt ».
[…]
Il y en eut beaucoup d'autres qui emportèrent avec eux les cadavres d'enfants morts asphyxiés alors que leur famille tentait de s'échapper. Ce n'est guère surprenant de leur part. Dans leur fuite précipitée, ils n'avaient pas eu le temps de les inhumer, et abandonner les cadavres était impensable. En conséquence, beaucoup de citoyens, d'un bout à l'autre de l'Allemagne, n'entendirent pas seulement parler de ces morts survenues à Hambourg : ils virent les cadavres.
S'agissant d'un témoignage de troisième main, sa véracité demeure sujette à caution, mais il est certainement vrai que nombre de réfugiés emportèrent avec eux les corps de leurs êtres chers lorsqu'ils fuirent Hambourg. Friedrich Reck raconte avoir vu une femme lâcher sa valise au moment où elle embarquait à bord d'un train, en Bavière. Le contenu se répandit sur le quai, et, parmi les jouets, une trousse de manucure et des sous-vêtements roussis par le feu, il y avait « le corps rôti d'un enfant, ratatiné comme une momie, que sa mère au cerveau à moitié dérangé transportait avec elle, relique d'un passé qui était encore intact quelques jours plus tôt ».
[…]
Il y en eut beaucoup d'autres qui emportèrent avec eux les cadavres d'enfants morts asphyxiés alors que leur famille tentait de s'échapper. Ce n'est guère surprenant de leur part. Dans leur fuite précipitée, ils n'avaient pas eu le temps de les inhumer, et abandonner les cadavres était impensable. En conséquence, beaucoup de citoyens, d'un bout à l'autre de l'Allemagne, n'entendirent pas seulement parler de ces morts survenues à Hambourg : ils virent les cadavres.
Toutefois, les forces de l'ordre ne pouvaient être partout à la fois, et il y eut d'innombrables exemples de gens ordinaires, à l'écart des points de regroupements principaux, exprimant ouvertement leur hostilité envers les autorités nazies. Hans J. Massaquoi décrit un incident dans une gare où « un homme en uniforme brun du parti nazi fit son apparition, et une femme lui hurla dessus depuis le train : " Espèce de porcs, tout est votre faute ! " ». Elle continua de hurler des imprécations non moins menaçantes jusqu'à ce que quelqu'un de son entourage « la bâillonne littéralement en lui maintenant une serviette sur la bouche ». Il raconte aussi l'histoire d'un de ses amis, un soldat bien déterminé à déserter, au motif qu'au lendemain de cette catastrophe « la guerre ne pourra[it] pas durer plus de deux semaines, et peut-être même pas plus de deux jours ».
[…]
S'ils avaient su à quel point ces débordements étaient fréquents, les Alliés en auraient été ravis. C'était exactement ce qui était censé se passer dans le sillage d'un gigantesque raid de bombardements : la colère contre les autorités conduisant à des actes de défiance sans retenue aucune et, finalement, à la révolution. Mais le dernier maillon de cette chaîne ne prit jamais corps. La vitesse et la relative efficacité de l'évacuation furent certainement un facteur qui permit d'éviter toute atteinte grave à l'ordre public : en conduisant les survivants loin de la ville, les autorités dispersèrent les sources potentielles de troubles. Sans compter que le désastre avait laissé la plupart de ces gens trop épuisés et trop apathiques pour susciter autre chose qu'une agitation de façade. L’événement était tout simplement trop écrasant pour qu'on l'impute totalement aux nazis. Il semble que la plupart des rescapés aient presque considéré cette tempête de feu comme un signe de Dieu : en de telles circonstances, l’État se révélait « une entité complètement dépourvue de poids, qu'on ne pouvait rendre responsable d'un destin comme celui qu'avait subi Hambourg et dont on ne pouvait non plus attendre qu'il puisse rien y faire ». [Cf Hans Erich Nossak]
[…]
S'ils avaient su à quel point ces débordements étaient fréquents, les Alliés en auraient été ravis. C'était exactement ce qui était censé se passer dans le sillage d'un gigantesque raid de bombardements : la colère contre les autorités conduisant à des actes de défiance sans retenue aucune et, finalement, à la révolution. Mais le dernier maillon de cette chaîne ne prit jamais corps. La vitesse et la relative efficacité de l'évacuation furent certainement un facteur qui permit d'éviter toute atteinte grave à l'ordre public : en conduisant les survivants loin de la ville, les autorités dispersèrent les sources potentielles de troubles. Sans compter que le désastre avait laissé la plupart de ces gens trop épuisés et trop apathiques pour susciter autre chose qu'une agitation de façade. L’événement était tout simplement trop écrasant pour qu'on l'impute totalement aux nazis. Il semble que la plupart des rescapés aient presque considéré cette tempête de feu comme un signe de Dieu : en de telles circonstances, l’État se révélait « une entité complètement dépourvue de poids, qu'on ne pouvait rendre responsable d'un destin comme celui qu'avait subi Hambourg et dont on ne pouvait non plus attendre qu'il puisse rien y faire ». [Cf Hans Erich Nossak]
Malgré tout ce qu'elle avait enduré, et toutes les souffrances qu'elle subissait encore, la population de Hambourg n'avait pas baissé les bras.
Les symboles de sa détermination à survivre étaient tout autour d'elle, dans le déblaiement progressif des décombres, le rétablissement de l'électricité et de l'eau, et dans ces poches de survie acharnée parmi les ruines. D'un bout à l'autre de la ville, on lisait encore de ces messages inscrits à la craie sur les façades des maisons soufflées par les bombes, annonçant « Wir leben » (« Nous sommes vivants »). Il s'agissait à l'origine de messages destinés à rassurer des amis et voisins au lendemain immédiat de la catastrophe – à présent, ils apparaissaient davantage comme un défi.
Au début du mois de septembre, tout juste un mois après la tempête de feu, se produisit un événement qui eut un immense effet psychologique sur la population : les arbres se mirent à fleurir. Il existe de nombreux récits de ce phénomène naturel étrange. Il s'agissait probablement d'un mécanisme de défense de la végétation, destiné à assurer la survie de l'espèce – mais, pour le peuple de Hambourg, la vision de ces arbres apparemment morts revenant à la vie de manière éclatante devint un symbole d'espoir sans égal.
Les symboles de sa détermination à survivre étaient tout autour d'elle, dans le déblaiement progressif des décombres, le rétablissement de l'électricité et de l'eau, et dans ces poches de survie acharnée parmi les ruines. D'un bout à l'autre de la ville, on lisait encore de ces messages inscrits à la craie sur les façades des maisons soufflées par les bombes, annonçant « Wir leben » (« Nous sommes vivants »). Il s'agissait à l'origine de messages destinés à rassurer des amis et voisins au lendemain immédiat de la catastrophe – à présent, ils apparaissaient davantage comme un défi.
Au début du mois de septembre, tout juste un mois après la tempête de feu, se produisit un événement qui eut un immense effet psychologique sur la population : les arbres se mirent à fleurir. Il existe de nombreux récits de ce phénomène naturel étrange. Il s'agissait probablement d'un mécanisme de défense de la végétation, destiné à assurer la survie de l'espèce – mais, pour le peuple de Hambourg, la vision de ces arbres apparemment morts revenant à la vie de manière éclatante devint un symbole d'espoir sans égal.
Le bruit des bombes était terrifiant, mais le plus effrayant, c'était peut-être cet instant où la bombe était si proche qu'elle n'était plus audible. Comme l'explique une femme qui a survécu à cette succession de raids, la terreur qu’inspiraient ces bombes atteignait véritablement son paroxysme quand on cessait de les entendre et qu'on se mettait à les sentir.
C'était la guerre, et ils savaient ce que nous ignorons, que la guerre est une réalité terrible dont personne ne sort sous un jour flatteur.
Les Dernières Actualités
Voir plus

Violences politiques
art-bsurde
68 livres

Hambourg pour décor
lina224
21 livres
Autres livres de Keith Lowe (2)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3247 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3247 lecteurs ont répondu