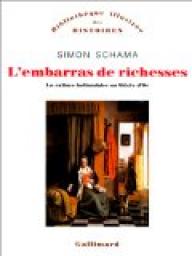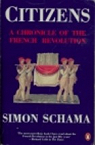Citations sur L'embarras de richesses (4)
incipit :
Le génie singulier des Hollandais est de paraître, tout à la fois, familier et incompréhensible. C'est une réflexion de ce genre qui traversa l'esprit énergique de Henry James en 1874 tandis qu'il observait une bonne hollandaise qui lavait le porche. Ce qui n'aurait dû être qu'une banale corvée se révéla, au terme d'un examen plus attentif, un tantinet bizarre, et même un peu obsédant. La scène était d'autant plus étrange que pour un oeil distrait il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire disparaître. Les promenades longeant le canal étaient "périodiquement ratissées au balai et à la brosse en chiendent puis religieusement engraissées d'eau de savon". Mais plus une surface paraissait propre, plus on s'acharnait à la récurer.
Le génie singulier des Hollandais est de paraître, tout à la fois, familier et incompréhensible. C'est une réflexion de ce genre qui traversa l'esprit énergique de Henry James en 1874 tandis qu'il observait une bonne hollandaise qui lavait le porche. Ce qui n'aurait dû être qu'une banale corvée se révéla, au terme d'un examen plus attentif, un tantinet bizarre, et même un peu obsédant. La scène était d'autant plus étrange que pour un oeil distrait il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire disparaître. Les promenades longeant le canal étaient "périodiquement ratissées au balai et à la brosse en chiendent puis religieusement engraissées d'eau de savon". Mais plus une surface paraissait propre, plus on s'acharnait à la récurer.
Imaginez un parangon de vertu érasmienne : un garçon hollandais de douze ans, intelligent, convenablement chrétien et curieux d'apprendre la place qui est la sienne dans l'ordre des choses qui prévaut au XVIIe siècle. Les vieux volumes lui eussent appris qu'il était un nouveau Batave, un rejeton d'une vieille souche. Les histoires contemporaines lui eussent rappelé qu'il était d'une génération de martyrs et que le manteau de sa liberté était tout imbibé de sang. Mais le texte imprimé ou l'image n'étaient point seuls à former sa sensibilité. Tous les dimanches (au moins) se déversait du haut de la chaire une cascade rhétorique, invoquant la destinée des Hébreux comme si l'assemblée des fidèles était elle-même une tribu d'Israël. Les lignes de démarcation entre l'histoire et l'Écriture s'estompaient cependant dès lors que l'on attribuait le sens de l'indépendance et de la puissance hollandaise à la Providence qui avait élu un nouveau peuple pour éclairer les nations. Dans cette addition néerlandaise à l'Ancien Testament, les Provinces-Unies apparaissaient telle la nouvelle Sion, Philippe II en roi d'Assyrie et Guillaume le Taciturne comme le pieux capitaine de Juda. Notre garçon, que nous pourrions prénommer Jacob Isaakszoon, Jacob fils d'Isaac, devait comprendre qu'il était Fils d'Israël, l'un des nederkinderen, et qu'il vivrait sous la protection du Tout-Puissant aussi longtemps qu'il observerait ses commandements. C'est par la vertu de l'alliance conclue avec le Seigneur que la nation à laquelle il appartenait avait été délivrée de ses chaînes pour connaître la prospérité et la puissance. Qu'elle s'éloignât des sentiers de la droiture, et elle pouvait compter que Dieu l'abaisserait comme il avait abaissé Israël et Juda avant elle. Le garçon approchant de l'âge d'homme, sa conduite devait illustrer l'acceptation de cette alliance, en conséquence de quoi les bienfaits pleuvraient sur lui.
Dans une large mesure, cette exhortation biblique était l'idiome commun de toutes les cultures calvinistes et puritaines du début du XVIIe siècle. Des Abraham, des Isaac et des Jacob, on en retrouverait à Rouen, Dundee, Norwich et Bâle aussi bien qu'à Leyde et à Zierikzee. Le rejet de l'hagiographie postbiblique autant que de l'autorité légale que revendiquaient les successeurs de saint Pierre à Rome étaient une caractéristique centrale de la Réforme, en sorte que l'Écriture s'en trouvait investie d'une valeur proportionnellement plus grande. Chez les calvinistes et autres dévots de la "Réforme radicale", l'abolition du rite traditionnel et de l'intercession du clergé mais aussi la préférence pour des formes directes de communion donnaient davantage d'importance encore à l'écriture dans le culte. Le train incessant des lectures, chants et exégèses qui se déroulaient dans les églises, écoles et foyers calvinistes familiarisaient les fidèles aux faits et gestes les plus insignifiants des patriarches, juges, rois et prophètes, quand jadis ils s'attardaient à la couleur de la chevelure d'un saint ou au rayonnement de son auréole. De surcroît, liée à l'obsession calviniste de la bonne conduite, la distinction entre la nature entièrement sacrée du Nouveau Testament et le caractère "mondain" de l'Ancien Testament faisait de ce dernier un fond de sagesse exemplaire et de vérité historique sans le moindre soupçon de blasphème. Tout cela avait pour résultat d'arracher l'Ancien Testament à la position qui était la sienne dans la théologie catholique – celle de préface nécessaire, de "deuxième étape" dans la téléologie du péché originel et de l'ultime rédemption – pour rendre au lien entre les deux livres une espèce de symétrie complémentaire. Dans la vision catholique du monde, l'incontournable distinction entre les chrétiens et les juifs, pour ainsi dire, déicides dès le commencement, reléguait dans l'ombre la nature exemplaire des histoires de l'Ancien Testament. Dans la mentalité calviniste, en revanche, l'ultime chronique messianique ne se laissait comprendre qu'à travers l'histoire des juifs, par qui le Tout-Puissant avait manifesté sa volonté.
Dans une large mesure, cette exhortation biblique était l'idiome commun de toutes les cultures calvinistes et puritaines du début du XVIIe siècle. Des Abraham, des Isaac et des Jacob, on en retrouverait à Rouen, Dundee, Norwich et Bâle aussi bien qu'à Leyde et à Zierikzee. Le rejet de l'hagiographie postbiblique autant que de l'autorité légale que revendiquaient les successeurs de saint Pierre à Rome étaient une caractéristique centrale de la Réforme, en sorte que l'Écriture s'en trouvait investie d'une valeur proportionnellement plus grande. Chez les calvinistes et autres dévots de la "Réforme radicale", l'abolition du rite traditionnel et de l'intercession du clergé mais aussi la préférence pour des formes directes de communion donnaient davantage d'importance encore à l'écriture dans le culte. Le train incessant des lectures, chants et exégèses qui se déroulaient dans les églises, écoles et foyers calvinistes familiarisaient les fidèles aux faits et gestes les plus insignifiants des patriarches, juges, rois et prophètes, quand jadis ils s'attardaient à la couleur de la chevelure d'un saint ou au rayonnement de son auréole. De surcroît, liée à l'obsession calviniste de la bonne conduite, la distinction entre la nature entièrement sacrée du Nouveau Testament et le caractère "mondain" de l'Ancien Testament faisait de ce dernier un fond de sagesse exemplaire et de vérité historique sans le moindre soupçon de blasphème. Tout cela avait pour résultat d'arracher l'Ancien Testament à la position qui était la sienne dans la théologie catholique – celle de préface nécessaire, de "deuxième étape" dans la téléologie du péché originel et de l'ultime rédemption – pour rendre au lien entre les deux livres une espèce de symétrie complémentaire. Dans la vision catholique du monde, l'incontournable distinction entre les chrétiens et les juifs, pour ainsi dire, déicides dès le commencement, reléguait dans l'ombre la nature exemplaire des histoires de l'Ancien Testament. Dans la mentalité calviniste, en revanche, l'ultime chronique messianique ne se laissait comprendre qu'à travers l'histoire des juifs, par qui le Tout-Puissant avait manifesté sa volonté.
Cats était-il un "bourgeois" ? Qui ne l'était pas ? Les mendiants, les prostituées et les courtisans de Hionselaarsdijk, mais cela laisse une foule de gens entre les deux extrêmes. Ailleurs en Europe, le terme désigne un si petit nombre de types sociaux qu'il peut en garder une grande force descriptive. Aux Pays-Bas, son champ d'application est si vaste qu'il en devient parfaitement inutile. Ce terme, après tout, appartient au vocabulaire classificatoire de la science sociale matérialiste des XIXe et XXe siècles – laquelle posa en postulat que les systèmes de croyance étaient des appendices du pouvoir social. Il est bien connu que ces cadres d'analyse culturelle insistent de manière réductrice sur un continuum social qui va de la division du travail à la destination de l'âme. Et cette tautologie, qui n'est qu'une invite à la paresse, s'est donc fixée, telle un vert-de-gris intellectuel, sur des descriptions culturelles qui commencent (et ne finissent que trop souvent aussi) en invoquant l'éthos "bourgeois". Même un historien aussi profond que Huizinga accouplait "bourgeois" et "absence d'héroïsme" (pusillanimité), comme si pareille association allait de soi, quand par ce dernier terme il voulait dire, semble-t-il, "non féodal". Après tout, qu'est-ce qui pouvait être plus évidemment héroïque qu'une culture diluvienne (flood culture) ? Que pouvait-il y avoir de plus épique que la vantardise universelle incrustée dans le sol de la Burgerzaal de l'hôtel de ville d'Amsterdam, où, à l'instar de la Jérusalem médiévale, la ville est située au centre géographique, aussi bien que métaphorique, de l'univers ? Que pouvait-il y avoir de plus fantastique que la manie des tulipes, que les banquets des schutters, de plus flamboyant que les pignons sur la Huis Bartolotti, de plus orgiaque que la cuisine d'une kermis de Steen ? Et si je cite ces entorses évidentes aux lieux communs de la tempérance, de l'ascétisme et de la rationalité capitalistes censés caractériser la culture "bourgeoise", ce n'est point malice de ma part afin de suggérer le contraire. Mon souhait serait plutôt de libérer la description d'une culture moderne à ses débuts de son emprisonnement dans la terminologie du XIXe siècle, en particulier de celle qui arase les paradoxes sociaux et autres contradictions ou asymétries, afin d'arriver à la surface lisse d'un modèle économique. La Hollande de Rembrandt était plus riche en mystères de la chair et de l'esprit que ne le permet le cliché sociologique.
En plein été, Amsterdam sent la friture, le tabac fort et les verres à bière non lavés. Dans les rues étroites, où la cohue des passants ajoute son odeur à elle, ces vapeurs restent suspendues dans l'air tel un brouillard de chaleur aromatique. Et dans la Kalverstraat, l'ancienne et tumultueuse ruelle qui serpente au sud du Dam, la nuée des touristes se coagulent à quatre heures de l'après-midi en une masse visqueuse. Mais à Amsterdam, les ruelles attirent, les avenues repoussent. Le tapage et la vulgarité riante de la Kalverstraat sont l'authentique réponse des Hollandais à la largeur aliénante du boulevard – élément de boursouflure urbaine qui n'a jamais eu grand succès dans les villes. Les mêmes touristes qui se pressent aux Champs-Élysées ou à Picadilly fuient d'instinct, à Amsterdam, le pompeux espace du Rokin pour la bousculade et le coudoiement moites de la Kalverstraat.
À certains endroits, cette implacable procession de fourmis vers la Rembrandtsplein (jadis le Botermarkt) est coupée par des voies de traverse – dont une qui porte encore son nom médiéval, le Heiligeweg (la Voie sacrée). C'est à cet endroit désormais bien profane qu'à la fin juillet, tandis que les vacances scolaires touchent à leur fin, de petites bandes d'enfants jouent des coudes pour se frayer un chemin à travers la foule jusqu'à une porte ombragée donnant sur le Heiligeweg. Avant la Réforme, la rue tenait son nom de diverses fondations religieuses qui se partageaient le quartier avec les échoppes des marchands et les boutiques des artisans. Sur le site de l'édifice dans lequel disparaissent les enfants, des palmes et des serviettes de bain aux couleurs criardes à la main, s'élevait jadis un couvent de clarisses, le Klarissenklooster. Les grands cris qui se perdent dans l'espace et les relents de chlore qui nous parviennent depuis l'entrée confirment qu'il s'agit bien de l'une des piscines publiques d'Amsterdam. Et c'est ainsi qu'en attestèrent des voyageurs au XVIIe siècle, que les hommes étaient confrontés à un choix impératif : périr noyé ou être Hollandais.
À certains endroits, cette implacable procession de fourmis vers la Rembrandtsplein (jadis le Botermarkt) est coupée par des voies de traverse – dont une qui porte encore son nom médiéval, le Heiligeweg (la Voie sacrée). C'est à cet endroit désormais bien profane qu'à la fin juillet, tandis que les vacances scolaires touchent à leur fin, de petites bandes d'enfants jouent des coudes pour se frayer un chemin à travers la foule jusqu'à une porte ombragée donnant sur le Heiligeweg. Avant la Réforme, la rue tenait son nom de diverses fondations religieuses qui se partageaient le quartier avec les échoppes des marchands et les boutiques des artisans. Sur le site de l'édifice dans lequel disparaissent les enfants, des palmes et des serviettes de bain aux couleurs criardes à la main, s'élevait jadis un couvent de clarisses, le Klarissenklooster. Les grands cris qui se perdent dans l'espace et les relents de chlore qui nous parviennent depuis l'entrée confirment qu'il s'agit bien de l'une des piscines publiques d'Amsterdam. Et c'est ainsi qu'en attestèrent des voyageurs au XVIIe siècle, que les hommes étaient confrontés à un choix impératif : périr noyé ou être Hollandais.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Simon Schama (6)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3249 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3249 lecteurs ont répondu