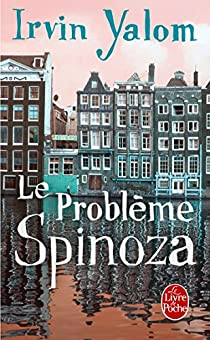>
Le problème Spinoza peut se ranger sous de multiples étiquettes tant il est riche.
Tout d'abord, il s'agit bien d'un roman, un roman de la vie intérieure de deux hommes, Spinoza, au XVIIes, et Rosenberg, au XXes. Comment ces deux biographies ont-elles pu se croiser?
Yalom s'est intéressé à la vie intérieure de ses personnages, car, surtout pour pour Spinoza, il y a peu de sources en raison du mode de vie qu'il a choisi.
Spinoza est un juif d'Amsterdam du XVIIes, promis à un bel avenir de théoricien de la religion. Mais, à l'âge de 23, il est exclu de la communauté, pour avoir professé des idées hérétiques (du point de vue des rabbins). Il choisi de vivre libre, ''la liberté comme antidote (...) libéré du joug de la tradition''. Il vit selon sa conscience, en essayant de coordonner ses actes à ses idées.
Alfred Rosenberg est un jeune homme balte d'origine allemande, qui se prend très tôt d'engouement pour le théoricien raciste Chamberlain, à qui il vouera un culte. C'est le déclencheur de tout un raisonnement et d'un processus de pensées qui vont faire de lui le téoricien de l'idéologie nazie. C'est lui qui soulève le problème Spinoza, qui le hantera toute sa vie. Comment un juif (même bani, le reste impure) peut-il développer des idées dans lesquelles lui, Rosenberg, pur allemand (selon lui, car des doutes sont cependant permis), se reconnait aussi profondément?
C'est grâce à ce problème que le roman a pu voir le jour. Cette rencontre (Rosenberg prend possession au nom du Reich de la bibliothèque de Spinoza) donne du relief à l'histoire du philosophe du XVIIes et permet à Irvin Yalom d'avoir une ''histoire'' pour écrire uun roman. Il va donc ainsi rédiger ''un roman qui aurait pu se produire'' en reconstituant, à l'aide de personnages et de faits réels, deux vies, dont certains éléments sont cependant fictifs, pour dynamiser la narration.
Parmi la fiction, deux personnages qui interviennent comme des révélateurs. Franco et le Dr Pfister.
C'est devant Franco que Spinoza dévoile pour la première fois de façon structurée sa pensée hérétique (ce qui le perdra). Cependant, ce jeune marane avide de connaissances et d'études va rester en contact avec le philosophe. Leurs rares entretiens clandestins vont permettre à Franco de mettre le doigt sur les faiblesses du raisonnement de Spinoza. Celui-ci en a conscience et ne s'en offusque pas. Il apprécie au contraire ces remarques qui lui permettent de progresser.
Le Dr Pfister, ami d'enfance du frère de Rosenberg, devenu psychanalyste, va tenter de mettre Alfred Rosenberg devant ses contradictions et ses excès. En vain.
L'un, à l'esprit ouvert, fait tout pour que la raison l'emporte sur les passions, l'autre, obtus, laisse ses passions dominer sa raison.
Deux idéologues.
L'un de l'universalité de DIeu en dehors de toute religion, un Dieu qui est Nature et qui n'interfère pas dans la destinée des hommes, cet aspect relevant de la superstition, banie par la raison.
L'autre de la supériorité d'une race sur toutes les autres, et n'hésitant pas pour cela à cautionner les pires horreurs de l'histoire. Il sera pour cela condamné à mort à Nuremberg.
Irvin Yalon nous présente donc deux portraits, comme deux miroirs inversés. Un livre qui se lit lentement, pour bien comprendre, mais facilement, en raison de l'alternance des chapitres consacrés à tour de rôle à Spinoza et à Rosenberg. Ces portraits sont aussi des miroirs du XVIIe et du XXes, pour comprendre comment ces pensées naissent et se développent, en raisonnance avec les événements qui influencent leurs auteurs.
Critique de bina
Le problème Spinoza peut se ranger sous de multiples étiquettes tant il est riche.
Tout d'abord, il s'agit bien d'un roman, un roman de la vie intérieure de deux hommes, Spinoza, au XVIIes, et Rosenberg, au XXes. Comment ces deux biographies ont-elles pu se croiser?
Yalom s'est intéressé à la vie intérieure de ses personnages, car, surtout pour pour Spinoza, il y a peu de sources en raison du mode de vie qu'il a choisi.
Spinoza est un juif d'Amsterdam du XVIIes, promis à un bel avenir de théoricien de la religion. Mais, à l'âge de 23, il est exclu de la communauté, pour avoir professé des idées hérétiques (du point de vue des rabbins). Il choisi de vivre libre, ''la liberté comme antidote (...) libéré du joug de la tradition''. Il vit selon sa conscience, en essayant de coordonner ses actes à ses idées.
Alfred Rosenberg est un jeune homme balte d'origine allemande, qui se prend très tôt d'engouement pour le théoricien raciste Chamberlain, à qui il vouera un culte. C'est le déclencheur de tout un raisonnement et d'un processus de pensées qui vont faire de lui le téoricien de l'idéologie nazie. C'est lui qui soulève le problème Spinoza, qui le hantera toute sa vie. Comment un juif (même bani, le reste impure) peut-il développer des idées dans lesquelles lui, Rosenberg, pur allemand (selon lui, car des doutes sont cependant permis), se reconnait aussi profondément?
C'est grâce à ce problème que le roman a pu voir le jour. Cette rencontre (Rosenberg prend possession au nom du Reich de la bibliothèque de Spinoza) donne du relief à l'histoire du philosophe du XVIIes et permet à Irvin Yalom d'avoir une ''histoire'' pour écrire uun roman. Il va donc ainsi rédiger ''un roman qui aurait pu se produire'' en reconstituant, à l'aide de personnages et de faits réels, deux vies, dont certains éléments sont cependant fictifs, pour dynamiser la narration.
Parmi la fiction, deux personnages qui interviennent comme des révélateurs. Franco et le Dr Pfister.
C'est devant Franco que Spinoza dévoile pour la première fois de façon structurée sa pensée hérétique (ce qui le perdra). Cependant, ce jeune marane avide de connaissances et d'études va rester en contact avec le philosophe. Leurs rares entretiens clandestins vont permettre à Franco de mettre le doigt sur les faiblesses du raisonnement de Spinoza. Celui-ci en a conscience et ne s'en offusque pas. Il apprécie au contraire ces remarques qui lui permettent de progresser.
Le Dr Pfister, ami d'enfance du frère de Rosenberg, devenu psychanalyste, va tenter de mettre Alfred Rosenberg devant ses contradictions et ses excès. En vain.
L'un, à l'esprit ouvert, fait tout pour que la raison l'emporte sur les passions, l'autre, obtus, laisse ses passions dominer sa raison.
Deux idéologues.
L'un de l'universalité de DIeu en dehors de toute religion, un Dieu qui est Nature et qui n'interfère pas dans la destinée des hommes, cet aspect relevant de la superstition, banie par la raison.
L'autre de la supériorité d'une race sur toutes les autres, et n'hésitant pas pour cela à cautionner les pires horreurs de l'histoire. Il sera pour cela condamné à mort à Nuremberg.
Irvin Yalon nous présente donc deux portraits, comme deux miroirs inversés. Un livre qui se lit lentement, pour bien comprendre, mais facilement, en raison de l'alternance des chapitres consacrés à tour de rôle à Spinoza et à Rosenberg. Ces portraits sont aussi des miroirs du XVIIe et du XXes, pour comprendre comment ces pensées naissent et se développent, en raisonnance avec les événements qui influencent leurs auteurs.