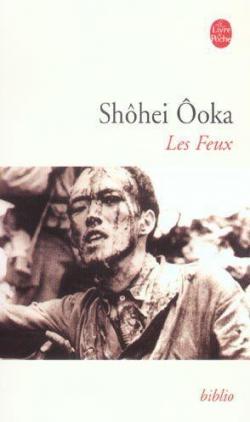>
Critique de nebalfr
Première partie d'une chronique portant aussi sur les deux adaptations cinématographiques du roman : http://nebalestuncon.over-blog.com/2019/03/les-feux-de-shohei-ooka/feux-dans-la-plaine-de-kon-ichikawa/fires-on-the-plain-de-shinya-tsukamoto.html
Je vais retenter la même expérience que pour Narayama il y a quelque temps de cela, en chroniquant en même temps un roman japonais, en l'espèce Les Feux (Nobi 野火) d'Ôoka Shôhei, datant de 1952, et ses deux adaptations cinématographiques japonaises, tout d'abord Feux dans la plaine, d'Ichikawa Kon (1959), et ensuite, bien plus récente, Fires on the Plain, de Tsukamoto Shinya (2014).
Et attention, les gens : si parler de SPOILERS est à vue de nez un peu étrange pour ce roman et ces films, je vais, dans cet article, révéler des éléments cruciaux du récit – alors à vous de voir…
À l'origine, il y avait donc un livre : Les Feux, roman d'Ôoka Shôhei, paru en 1952, et qui a considérablement marqué la littérature japonaise de son temps en envoyant aux orties un certain nombre de tabous. C'est que l'auteur y revenait sur son expérience de la guerre, et des atrocités qui lui étaient liées. Or, à cette époque, c'était là un sujet très difficile à traiter au Japon : les Japonais n'étaient guère disposés à revenir sur ce qui, pour eux, avait constitué une humiliante défaite, et encore moins enclins à mettre dans la balance les crimes commis par l'armée japonaise, en son sein mais plus encore contre les populations conquises (à vrai dire, sur ce point, c'est toujours compliqué aujourd'hui...) – et, durant les années qui ont suivi immédiatement la capitulation, les autorités d'occupation américaines préféraient de même que l'on évite de traiter de certains sujets jugés trop noirs et dangereux en étant tournés vers le passé, là où il valait bien mieux « construire ensemble » un avenir plus lumineux et démocratique : la censure pouvait donc se montrer très sévère.
Ôoka Shôhei, critique et spécialiste de la littérature française (notamment De Stendhal), a combattu sur le front : il a été appelé courant 1944, alors que la situation était déjà catastrophique pour le Japon depuis bien deux ans, et, après une formation hâtive, il a été envoyé sur le théâtre d'opérations philippin, qui devait sceller le sort de l'armée japonaise : fin 1944, début 1945, les Américains et les partisans philippins emportent la bataille terrestre sur l'île de Leyte, tandis que la flotte japonaise est anéantie durant la bataille dite du golfe de Leyte – la plus grande bataille navale de l'histoire.
Là-bas, Ôoka Shôhei, comme tant d'autres de ses compatriotes (pensez à ce que raconte Mizuki Shigeru dans les tomes 1 et 2 de Vie de Mizuki, par exemple), subit un véritable enfer et assiste à des atrocités sans nom. Il erre dans la forêt, seul, pendant des dizaines de jours, avant d'être capturé, en janvier 1945, par les Américains, et envoyé dans un camp de prisonniers – il ne rentrera au Japon qu'à la fin de 1945.
L'expérience avait constitué un véritable traumatisme – et, exceptionnellement, l'emploi de ce terme n'est pas une figure de style, ainsi qu'on aura l'occasion de le voir. Ôoka ressent le besoin de parler, de témoigner, dans un contexte qui, on l'a vu, n'y était pas très favorable. C'est le moteur de sa carrière littéraire : à la suggestion d'amis, mais aussi semble-t-il de son psychiatre, il rédige ses mémoires, Journal d'un prisonnier de guerre, ce qui lui impose de jongler avec les sentiments de la censure américaine. Un premier roman, sur un tout autre sujet, La Dame de Musashino, lui vaut également l'attention de la critique. Mais il n'en a pas fini avec la guerre, et, en 1952, il publie donc Les Feux, qui revient sur son expérience aux Philippines ; il s'agit cette fois d'un roman, pas de mémoires, mais les traits autobiographiques sont nombreux, personne n'en doute. Et le livre fait l'effet d'une bombe, si j'ose dire : Ôoka y dénonce frontalement les méfaits du commandement impérial qui avait totalement abandonné ses soldats sans le moindre ravitaillement, les amenant par la force des choses à perdre toujours un peu plus leur humanité, jusqu'à franchir la ligne rouge – celle… du cannibalisme. le réquisitoire est impitoyable, et ce d'autant plus qu'il sonne vrai, même sous sa forme romanesque ; il en résulte un tableau proprement terrifiant, une condamnation sans appel des horreurs de la guerre et des crimes de l'armée japonaise.
Le roman met en scène un soldat du nom de Tamura, qui souffre de tuberculose – une mauvaise idée, sur le front… Son supérieur, le jugeant incapable de se montrer utile, l'en rend responsable, et le chasse pour qu'il retourne à l'hôpital de campagne qui l'avait pourtant renvoyé, avec de maigres rations – mais on le chasse également de l'hôpital… Alors il n'a que se suicider ! Il a bien une grenade, qu'il s'en serve, c'est le seul moyen pour lui de se montrer utile à son pays ! Autant dire que ça commence bien…
Mais l'hôpital est bombardé, et Tamura contraint d'errer seul dans la jungle. Puis, attiré par la croix surmontant un clocher, il arrive dans un village abandonné, et y trouve quelque chose de très précieux : du sel ! Hélas, c'est le moment que choisit un couple de jeunes Philippins pour retourner au village – et, sous le coup de la panique, Tamura abat la femme ; l'homme prend la fuite, et il ne fait aucun doute qu'il va chercher les partisans – qui effrayent les soldats japonais bien plus que les soldats américains : les guérilleros philippins entendent leur faire payer les rigueurs de l'occupation… Et c'est à cela que renvoient ces « feux dans la plaine » : des fumées qui s'élèvent çà et là, dont les soldats japonais ne comprennent pas très bien le propos, mais qu'ils sont portés à envisager comme un moyen de communication employé par les partisans – ces feux sont une menace permanente, d'autant plus terrifiante qu'elle est impalpable…
Les errances solitaires de Tamura, qui a abandonné son fusil par dégoût, sont interrompues par la rencontre d'autres soldats japonais, qui l'informent qu'ils doivent traverser l'île et se rendre à Palompon pour y continuer le combat – mais atteindre cette destination implique de franchir les lignes américaines, autant dire que c'est du suicide…
Et la situation est rendue plus terrible encore par la faim omniprésente. L'armée japonaise ne s'est jamais montrée très généreuse avec ses soldats, pour ce qui est des rations – mais, à ce stade du conflit, elle les a tout bonnement abandonnés… Il n'y a aucun ravitaillement : les soldats de l'empereur sont supposés vivre du terrain, Demerden Sie sich autrement dit, et la situation est toujours plus catastrophique…
La faim est le motif central des Feux – et son moteur, et un outil métaphorique de choix. Tout y renvoie à la faim – et ce dès le tout début du roman comme des films, avec ces bien maigres rations, de patates douces ou de manioc, qui sont censées « acheter » une place temporaire à l'hôpital ; de même quand Tamura tombe sur un Philippin en train de cuisiner, ou trouve le sel dans le village, etc.
Mais ce thème à la base très dur devient plus sombre encore à mesure que la menace du cannibalisme est introduite dans le récit. Dans les premières occurrences, notamment quand Tamura rencontre un petit groupe de trois soldats très intéressés par son sel, cela sonne comme une mauvaise blague – un peu inquiétante d'ores et déjà, cela dit : cela semble beaucoup amuser le caporal que de faire trembler Tamura en lui racontant que son groupe, pour survivre en Nouvelle-Guinée, a bien dû recourir à la consommation de chair humaine… Mais chaque nouvelle mention du cannibalisme sonne plus concrète que celle qui précède, et la mauvaise blague n'a très vite plus rien de drôle. Ainsi quand Tamura tombe sur un soldat devenu fou, et emporté par une crise mystique bouddhique (nous verrons que Tamura n'est pas insensible à ces pensées, même si, dans son cas, c'est la mystique chrétienne qui l'emportera), qui lui offre de le manger une fois qu'il sera mort…
Et le cauchemar devient toujours plus matériel. Lors de ses pérégrinations, seul ou en groupe, Tamura ne cesse de recroiser les mêmes deux personnages : Yasuda, un vieux bonhomme cynique à la jambe cassée, et Nagamatsu, un jeunot naïf que le précédent exploite sans vergogne – Yasuda a accumulé une réserve de tabac, que Nagamatsu (peu doué…) est supposé échanger contre du manioc ou des patates douces. Mais, lors de cette ultime rencontre, les choses ont changé – c'est qu'ils ont à manger ! Yasuda a appris à Nagamatsu comment chasser « les singes »… et Tamura ne se fait guère d'illusions sur ce que cela signifie : Nagamatsu chasse des êtres humains, des soldats japonais ! L'ultime ligne rouge a été franchie, la déshumanisation est totale… Et double, en fait, car cela s'applique aussi bien au prédateur, qui abandonne de lui-même son humanité, qu'à la proie, hypocritement animalisée par cette désignation de « singe ». Or la confiance ne règne pas entre les trois soldats, en toute logique, et tout cela s'achèvera dans une tuerie…
Mais, ici, le roman et les films (surtout celui d'Ichikawa Kon) se concluent de manière très différente. le roman, en effet, se termine par un épilogue assez développé, quelques années plus tard : Tamura est dans un hôpital psychiatrique, où on le soigne en raison du véritable traumatisme qu'il a vécu sur Leyte – on le voit, le mot n'est pas employé gratuitement ici, c'est bien d'une pathologie psychiatrique qu'il s'agit. Ce traumatisme affecte la mémoire de Tamura, qui ne sait plus très bien ce qui s'est passé « à la fin », en même temps que le souvenir de la femme qu'il a tuée continue de l'obnubiler.
Mais l'esprit malade de Tamura a eu recours à un moyen un peu tordu pour lui permettre de « survivre » et de composer avec les atrocités qu'il a vécues. Lui, « l'intellectuel », qui dissertait sur Bergson durant ses errances solitaires, mais tout autant théologie, après son expérience dans l'église, a développé une sorte de complexe messianique d'inspiration essentiellement chrétienne (avec quelques traits bouddhiques cela dit – notamment concernant le respect de tout le vivant, animal ou végétal, qu'il ne faut pas tuer pour manger), doté d'une symbolique forte qui englobe aussi bien la croix que les feux des partisans, dont la signification devient en quelque sorte apocalyptique, un délire dans lequel l'idée de l'eucharistie se teinte de nuances forcément plus sombres au regard des pratiques cannibales des soldats japonais abandonnés. La foi et la faim sont ainsi imbriquées jusqu'à la folie obsessionnelle, et Tamura halluciné se figure tantôt en ange exterminateur, tantôt en ascète, tel un bouddha christique porteur de la bonne parole de la faim ; écrire doit lui permettre de ramener du sens dans son passé traumatique et absurde…
Les Feux est un roman très éprouvant – on conçoit bien à quel point ce livre, en 1952, dans un contexte où le Japon refusait de se repencher sur son passé immédiat (ce qui confère d'ailleurs au traumatisme de Tamura une signification supplémentaire), ce livre donc a pu produire un tel choc. Il a contribué, avec d'autres, à libérer la parole des conscrits – ces jeunes gens qui, au nom du fantasme impérial, et au travers de mille mensonges de l'élite militaire, ont vécu sur le terrain un véritable enfer. S'il n'adopte pas les atours d'un pamphlet, le roman d'Ôoka Shôhei n'en dénonce pas moins les impostures de la guerre comme du nationalisme, avec la force de la colère et de la honte : il n'y a rien d'héroïque dans la guerre, qui n'est qu'une entreprise de déshumanisation poussée jusque dans ses extrêmes limites – et même la franche et fraternelle camaraderie du front, tant vantée dans quantité de romans, de BD, de films ou de séries pas avares de clichés et de flonflons, cette idée naïve et creuse à la Band of Brothers, sonne en définitive comme une mauvaise blague, quand votre semblable s'interroge sur la possibilité de vous manger pour survivre, ou, pire encore, quand c'est vous-même qui vous posez la question quant à votre semblable.
J'ai trouvé très intéressante, par ailleurs, la manière dont Ôoka traite du thème du traumatisme – et, pour le coup, de manière assez visionnaire, anticipant notamment sur quantité de récits portant sur la guerre du Vietnam, mais en posant la question frontalement, au travers de cet épilogue tout dédié aux considérations psychiatriques liées à l'expérience militaire. Or cette dimension est totalement absente du film d'Ichikawa Kon, et seulement allusive dans celui de Tsukamoto Shinya.
Mon regret, ici, porte sur une traduction parfois pas tout à fait à la hauteur (la première traduction de ce roman était semble-t-il bien pire, mais, concernant Rose-Marie Makino-Fayolle, que j'ai souvent lue traduisant Ogawa Yôko notamment, le niveau m'apparaît globalement très variable), et un texte pas ou mal relu, avec de nombreuses coquilles, dont un certain nombre qui semblent provenir d'un OCR imprécis. C'est dommage, même si le plaisir de lecture demeure…
Lien : http://nebalestuncon.over-bl..
Je vais retenter la même expérience que pour Narayama il y a quelque temps de cela, en chroniquant en même temps un roman japonais, en l'espèce Les Feux (Nobi 野火) d'Ôoka Shôhei, datant de 1952, et ses deux adaptations cinématographiques japonaises, tout d'abord Feux dans la plaine, d'Ichikawa Kon (1959), et ensuite, bien plus récente, Fires on the Plain, de Tsukamoto Shinya (2014).
Et attention, les gens : si parler de SPOILERS est à vue de nez un peu étrange pour ce roman et ces films, je vais, dans cet article, révéler des éléments cruciaux du récit – alors à vous de voir…
À l'origine, il y avait donc un livre : Les Feux, roman d'Ôoka Shôhei, paru en 1952, et qui a considérablement marqué la littérature japonaise de son temps en envoyant aux orties un certain nombre de tabous. C'est que l'auteur y revenait sur son expérience de la guerre, et des atrocités qui lui étaient liées. Or, à cette époque, c'était là un sujet très difficile à traiter au Japon : les Japonais n'étaient guère disposés à revenir sur ce qui, pour eux, avait constitué une humiliante défaite, et encore moins enclins à mettre dans la balance les crimes commis par l'armée japonaise, en son sein mais plus encore contre les populations conquises (à vrai dire, sur ce point, c'est toujours compliqué aujourd'hui...) – et, durant les années qui ont suivi immédiatement la capitulation, les autorités d'occupation américaines préféraient de même que l'on évite de traiter de certains sujets jugés trop noirs et dangereux en étant tournés vers le passé, là où il valait bien mieux « construire ensemble » un avenir plus lumineux et démocratique : la censure pouvait donc se montrer très sévère.
Ôoka Shôhei, critique et spécialiste de la littérature française (notamment De Stendhal), a combattu sur le front : il a été appelé courant 1944, alors que la situation était déjà catastrophique pour le Japon depuis bien deux ans, et, après une formation hâtive, il a été envoyé sur le théâtre d'opérations philippin, qui devait sceller le sort de l'armée japonaise : fin 1944, début 1945, les Américains et les partisans philippins emportent la bataille terrestre sur l'île de Leyte, tandis que la flotte japonaise est anéantie durant la bataille dite du golfe de Leyte – la plus grande bataille navale de l'histoire.
Là-bas, Ôoka Shôhei, comme tant d'autres de ses compatriotes (pensez à ce que raconte Mizuki Shigeru dans les tomes 1 et 2 de Vie de Mizuki, par exemple), subit un véritable enfer et assiste à des atrocités sans nom. Il erre dans la forêt, seul, pendant des dizaines de jours, avant d'être capturé, en janvier 1945, par les Américains, et envoyé dans un camp de prisonniers – il ne rentrera au Japon qu'à la fin de 1945.
L'expérience avait constitué un véritable traumatisme – et, exceptionnellement, l'emploi de ce terme n'est pas une figure de style, ainsi qu'on aura l'occasion de le voir. Ôoka ressent le besoin de parler, de témoigner, dans un contexte qui, on l'a vu, n'y était pas très favorable. C'est le moteur de sa carrière littéraire : à la suggestion d'amis, mais aussi semble-t-il de son psychiatre, il rédige ses mémoires, Journal d'un prisonnier de guerre, ce qui lui impose de jongler avec les sentiments de la censure américaine. Un premier roman, sur un tout autre sujet, La Dame de Musashino, lui vaut également l'attention de la critique. Mais il n'en a pas fini avec la guerre, et, en 1952, il publie donc Les Feux, qui revient sur son expérience aux Philippines ; il s'agit cette fois d'un roman, pas de mémoires, mais les traits autobiographiques sont nombreux, personne n'en doute. Et le livre fait l'effet d'une bombe, si j'ose dire : Ôoka y dénonce frontalement les méfaits du commandement impérial qui avait totalement abandonné ses soldats sans le moindre ravitaillement, les amenant par la force des choses à perdre toujours un peu plus leur humanité, jusqu'à franchir la ligne rouge – celle… du cannibalisme. le réquisitoire est impitoyable, et ce d'autant plus qu'il sonne vrai, même sous sa forme romanesque ; il en résulte un tableau proprement terrifiant, une condamnation sans appel des horreurs de la guerre et des crimes de l'armée japonaise.
Le roman met en scène un soldat du nom de Tamura, qui souffre de tuberculose – une mauvaise idée, sur le front… Son supérieur, le jugeant incapable de se montrer utile, l'en rend responsable, et le chasse pour qu'il retourne à l'hôpital de campagne qui l'avait pourtant renvoyé, avec de maigres rations – mais on le chasse également de l'hôpital… Alors il n'a que se suicider ! Il a bien une grenade, qu'il s'en serve, c'est le seul moyen pour lui de se montrer utile à son pays ! Autant dire que ça commence bien…
Mais l'hôpital est bombardé, et Tamura contraint d'errer seul dans la jungle. Puis, attiré par la croix surmontant un clocher, il arrive dans un village abandonné, et y trouve quelque chose de très précieux : du sel ! Hélas, c'est le moment que choisit un couple de jeunes Philippins pour retourner au village – et, sous le coup de la panique, Tamura abat la femme ; l'homme prend la fuite, et il ne fait aucun doute qu'il va chercher les partisans – qui effrayent les soldats japonais bien plus que les soldats américains : les guérilleros philippins entendent leur faire payer les rigueurs de l'occupation… Et c'est à cela que renvoient ces « feux dans la plaine » : des fumées qui s'élèvent çà et là, dont les soldats japonais ne comprennent pas très bien le propos, mais qu'ils sont portés à envisager comme un moyen de communication employé par les partisans – ces feux sont une menace permanente, d'autant plus terrifiante qu'elle est impalpable…
Les errances solitaires de Tamura, qui a abandonné son fusil par dégoût, sont interrompues par la rencontre d'autres soldats japonais, qui l'informent qu'ils doivent traverser l'île et se rendre à Palompon pour y continuer le combat – mais atteindre cette destination implique de franchir les lignes américaines, autant dire que c'est du suicide…
Et la situation est rendue plus terrible encore par la faim omniprésente. L'armée japonaise ne s'est jamais montrée très généreuse avec ses soldats, pour ce qui est des rations – mais, à ce stade du conflit, elle les a tout bonnement abandonnés… Il n'y a aucun ravitaillement : les soldats de l'empereur sont supposés vivre du terrain, Demerden Sie sich autrement dit, et la situation est toujours plus catastrophique…
La faim est le motif central des Feux – et son moteur, et un outil métaphorique de choix. Tout y renvoie à la faim – et ce dès le tout début du roman comme des films, avec ces bien maigres rations, de patates douces ou de manioc, qui sont censées « acheter » une place temporaire à l'hôpital ; de même quand Tamura tombe sur un Philippin en train de cuisiner, ou trouve le sel dans le village, etc.
Mais ce thème à la base très dur devient plus sombre encore à mesure que la menace du cannibalisme est introduite dans le récit. Dans les premières occurrences, notamment quand Tamura rencontre un petit groupe de trois soldats très intéressés par son sel, cela sonne comme une mauvaise blague – un peu inquiétante d'ores et déjà, cela dit : cela semble beaucoup amuser le caporal que de faire trembler Tamura en lui racontant que son groupe, pour survivre en Nouvelle-Guinée, a bien dû recourir à la consommation de chair humaine… Mais chaque nouvelle mention du cannibalisme sonne plus concrète que celle qui précède, et la mauvaise blague n'a très vite plus rien de drôle. Ainsi quand Tamura tombe sur un soldat devenu fou, et emporté par une crise mystique bouddhique (nous verrons que Tamura n'est pas insensible à ces pensées, même si, dans son cas, c'est la mystique chrétienne qui l'emportera), qui lui offre de le manger une fois qu'il sera mort…
Et le cauchemar devient toujours plus matériel. Lors de ses pérégrinations, seul ou en groupe, Tamura ne cesse de recroiser les mêmes deux personnages : Yasuda, un vieux bonhomme cynique à la jambe cassée, et Nagamatsu, un jeunot naïf que le précédent exploite sans vergogne – Yasuda a accumulé une réserve de tabac, que Nagamatsu (peu doué…) est supposé échanger contre du manioc ou des patates douces. Mais, lors de cette ultime rencontre, les choses ont changé – c'est qu'ils ont à manger ! Yasuda a appris à Nagamatsu comment chasser « les singes »… et Tamura ne se fait guère d'illusions sur ce que cela signifie : Nagamatsu chasse des êtres humains, des soldats japonais ! L'ultime ligne rouge a été franchie, la déshumanisation est totale… Et double, en fait, car cela s'applique aussi bien au prédateur, qui abandonne de lui-même son humanité, qu'à la proie, hypocritement animalisée par cette désignation de « singe ». Or la confiance ne règne pas entre les trois soldats, en toute logique, et tout cela s'achèvera dans une tuerie…
Mais, ici, le roman et les films (surtout celui d'Ichikawa Kon) se concluent de manière très différente. le roman, en effet, se termine par un épilogue assez développé, quelques années plus tard : Tamura est dans un hôpital psychiatrique, où on le soigne en raison du véritable traumatisme qu'il a vécu sur Leyte – on le voit, le mot n'est pas employé gratuitement ici, c'est bien d'une pathologie psychiatrique qu'il s'agit. Ce traumatisme affecte la mémoire de Tamura, qui ne sait plus très bien ce qui s'est passé « à la fin », en même temps que le souvenir de la femme qu'il a tuée continue de l'obnubiler.
Mais l'esprit malade de Tamura a eu recours à un moyen un peu tordu pour lui permettre de « survivre » et de composer avec les atrocités qu'il a vécues. Lui, « l'intellectuel », qui dissertait sur Bergson durant ses errances solitaires, mais tout autant théologie, après son expérience dans l'église, a développé une sorte de complexe messianique d'inspiration essentiellement chrétienne (avec quelques traits bouddhiques cela dit – notamment concernant le respect de tout le vivant, animal ou végétal, qu'il ne faut pas tuer pour manger), doté d'une symbolique forte qui englobe aussi bien la croix que les feux des partisans, dont la signification devient en quelque sorte apocalyptique, un délire dans lequel l'idée de l'eucharistie se teinte de nuances forcément plus sombres au regard des pratiques cannibales des soldats japonais abandonnés. La foi et la faim sont ainsi imbriquées jusqu'à la folie obsessionnelle, et Tamura halluciné se figure tantôt en ange exterminateur, tantôt en ascète, tel un bouddha christique porteur de la bonne parole de la faim ; écrire doit lui permettre de ramener du sens dans son passé traumatique et absurde…
Les Feux est un roman très éprouvant – on conçoit bien à quel point ce livre, en 1952, dans un contexte où le Japon refusait de se repencher sur son passé immédiat (ce qui confère d'ailleurs au traumatisme de Tamura une signification supplémentaire), ce livre donc a pu produire un tel choc. Il a contribué, avec d'autres, à libérer la parole des conscrits – ces jeunes gens qui, au nom du fantasme impérial, et au travers de mille mensonges de l'élite militaire, ont vécu sur le terrain un véritable enfer. S'il n'adopte pas les atours d'un pamphlet, le roman d'Ôoka Shôhei n'en dénonce pas moins les impostures de la guerre comme du nationalisme, avec la force de la colère et de la honte : il n'y a rien d'héroïque dans la guerre, qui n'est qu'une entreprise de déshumanisation poussée jusque dans ses extrêmes limites – et même la franche et fraternelle camaraderie du front, tant vantée dans quantité de romans, de BD, de films ou de séries pas avares de clichés et de flonflons, cette idée naïve et creuse à la Band of Brothers, sonne en définitive comme une mauvaise blague, quand votre semblable s'interroge sur la possibilité de vous manger pour survivre, ou, pire encore, quand c'est vous-même qui vous posez la question quant à votre semblable.
J'ai trouvé très intéressante, par ailleurs, la manière dont Ôoka traite du thème du traumatisme – et, pour le coup, de manière assez visionnaire, anticipant notamment sur quantité de récits portant sur la guerre du Vietnam, mais en posant la question frontalement, au travers de cet épilogue tout dédié aux considérations psychiatriques liées à l'expérience militaire. Or cette dimension est totalement absente du film d'Ichikawa Kon, et seulement allusive dans celui de Tsukamoto Shinya.
Mon regret, ici, porte sur une traduction parfois pas tout à fait à la hauteur (la première traduction de ce roman était semble-t-il bien pire, mais, concernant Rose-Marie Makino-Fayolle, que j'ai souvent lue traduisant Ogawa Yôko notamment, le niveau m'apparaît globalement très variable), et un texte pas ou mal relu, avec de nombreuses coquilles, dont un certain nombre qui semblent provenir d'un OCR imprécis. C'est dommage, même si le plaisir de lecture demeure…
Lien : http://nebalestuncon.over-bl..