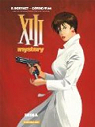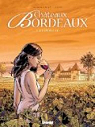Que Fréjus renaisse !
-
Ce tome contient une histoire complète et indépendante de toute autre. La première édition de cet ouvrage date de 2014. Elle a été réalisée par Éric Corbeyran pour le scénario et par Horne Perreard pour le dessin, l'encrage et les nuances de gris.
Toulon en janvier 1960, un monsieur se présente dans un pressing avec des draps encore pliés. L'employé s'en étonne car ils semblent parfaitement propres : il explique qu'il les a retrouvés dans une armoire et que lorsque la vague est passée, la boue s'est infiltrée partout. Les draps se trouvaient dans une armoire au premier étage et quand la vague a déferlé, elle a emporté tout ce qui se trouvait au rez-de-chaussée et inondé tout ce qui était à l'étage, mais personne n'est mort. À Fréjus dans le Var le 2 décembre 1959, tout le monde est confortablement installé dans son lit ou autour d'un dîner, devant son poste de radio ou la télé. À 21h13, le barrage cède libérant une vague de 60 mètres de haut. 50 millions de mètres cubes d'eau se déversent d'un seul coup dans la vallée, projetant des rochers, de la terre et des énormes blocs de béton, arrachant les arbres, anéantissant les habitations, emportant tout sur leur passage. Dix kilomètres séparent Fréjus du barrage. La vague met 25 minutes pour les parcourir avant de se jeter dans la mer. 450 personnes trouvent la mort cette nuit-là, dont près d'un tiers sont des enfants. Au matin on ne dénombre pas moins de 4.000 sinistrés. Aucune famille n'est épargnée. Tout le monde a perdu quelqu'un.
Georges Sénéquier est né en 1929 et il a eu 30 ans le 30 décembre 1959, le lendemain de la rupture du barrage. À l'époque, il était technicien de la Défense Nationale. Il travaillait à l'usine de torpilles de Saint Tropez. Il était également conseiller municipal depuis peu. Pour lui et toute l'équipe municipale, Malpasset a été leur baptême du feu. Il était revenu chez lui assez tard le 02 décembre 1959, sa fille de 4 ans dormait déjà. Après le dîner, il révisait ses cours pour un examen à passer, et il a entendu comme le bruit apporté par le mistral de dizaines de trains qui passaient en même temps. Après ce boucan, la lumière s'est éteinte, il n'y avait plus d'électricité. L'énorme grondement qu'ils entendaient avec sa femme était celui de l'eau qui déferlait. Leur maison était sur une butte que l'eau a contournée. Quand il est sorti après le passage de la vague, tout avait disparu autour de la butte, tout avait été emporté. En 1959, Simone Infantolino avait 12 ans, et elle vivait avec ses parents et ses deux frères dans la vallée du Reyran. Les deux frères avaient été punis et avaient dû aller se coucher. Son père dormait aussi épuisé par sa journée de travail. La maison abritait également un frère et une belle-soeur et leurs deux filles. À un moment donné, elle a entendu un bruit incroyable, énorme affreux et il s'est rapproché.
En choisissant cette bande dessinée, il est probable que le lecteur en connaisse déjà le sujet : le 2 décembre 1959, des précipitations intenses font monter l'eau de la retenue du barrage de Malpasset, au-dessus du niveau maximum, et entraîne sa rupture. Une vague de plusieurs millions de mètres cubes d'eau déferle vers la mer, s'abattant sur des habitations isolées et sur Fréjus. Les faits sont relatés en 5 pages en noir & blanc avec des nuances de gris, par des dessins en plan large (des cases de la largeur de la page) ne mettant en scène aucun être humain. Les cartouches de texte sont concis et factuels, apportant des informations très synthétiques. le chapitre 1 commence en page 12, et le mode narratif change : au temps présent (2014 parution de l'ouvrage, ou un peu avant), un premier témoin (Georges Sénéquier, 30 ans au moment des faits) s'adresse à un interlocuteur, comme s'il s'adressait en direct au lecteur, et fait part de ses souvenirs de cette nuit-là. Tout l'ouvrage est conçu ainsi : sur la base d'entretiens, ou plutôt de recueil de souvenirs, sans que l'intervieweur ne pose de questions, sans son intervention. C'est donc un dispositif très particulier, reposant essentiellement sur des cadrages plan poitrine du témoin, parfois un peu plus larges, régulièrement plus serrés. Tout l'art de l'artiste est de donner vie à ces individus, par le biais des expressions de visage, de la posture, accompagnées occasionnellement d'un geste de la main. Horne Perreard s'en sort très bien. Par la force des choses, les témoins de l'époque ont maintenant tous dépassé les 60 ans. Les cadrages permettent de se focaliser sur leur visage, de voir le calme qui vient avec l'âge, mais aussi les émotions qui prennent le dessus accompagnant un souvenir particulier, une souffrance encore vivante. le lecteur éprouve la sensation que ces survivants s'adressent directement à lui, qu'il les écoute assis à côté ou en face d'eux. Dans la postface, le scénariste explique qu'après avoir entendu ces différentes personnes, il ne pouvait plus simplement raconter les faits comme une reconstitution, que la parole de ces personnes devait primer sur tout. Cette façon de raconter s'avère parfaitement adaptée et le lecteur sent son coeur se serrer régulièrement.
Ce dispositif très rigoureux ne s'avère ni figé, ni pesant. Les auteurs ont également réalisé une sorte de prologue ou d'interlude pour chacun des 3 chapitres : le prologue montrant le barrage et le parcours de la vague, la présentation de Jean-Paul Vieu qui a réalisé les photographies de la catastrophe, la présentation d'Yvon Allamand adolescent et pompiste occasionnel à la station-service de son père. Ces passages font sens permettant d'élargir un peu le propos, avec des dessins qui semblent parfois un peu léger, mais qui donnent à voir une reconstitution historique soignée en particulier pour les voitures et les trains. Par ailleurs, les témoignages sont nombreux et les intervenants avaient des âges différents au moment de la catastrophe : Annie Brodin (8 ans), Pierre Trujillo (1 jour), Denise Laugier (13 ans), Michel Ruby (8 ans), Louis Infantolino (15 ans), Fernand Martini (artisan électricien), Daniel Castelli (11 ans), Huguette Epuron (31 ans), Alfred Bertini (30 ans, employé de mairie), Michèle Guillermin (14 ans, en pensionnat), Irène Jodar (19 ans, avec un fiancé). Au fil des propos, il revient plusieurs éléments communs comme le bruit de la vague titanesque ou la coupure d'électricité. le choix de la narration n'étant pas une reconstitution ou une mise en situation, les auteurs font apparaître ces éléments communs par le biais d'une image, celles-ci pouvant se répéter lors d'un autre témoignage. Ainsi il apparaît des leitmotivs visuels comme une onomatopée pour le bruit de la vague, les phylactères vides, les couvertures, l'ampoule éteinte, le barrage rempli à ras-bord, les tuiles de toit, la locomotive, le pupitre vide, le panneau H pour Hôpital, l'arbre nu, le camion de pompier avec la grande échelle, les petites maisons de Monopoly.
S'intercalant avec les plans rapprochés des survivants et les leitmotivs visuels, les auteurs intègrent sporadiquement des cases représentant la situation : les arènes de Fréjus intactes, une tombe de deux frères morts dans l'inondation, des canisses, un hélicoptère survolant la retenue d'eau, une vue aérienne le lendemain de la catastrophe, des maisons en ruine, des rues recouvertes de boue, des ruines du barrage, un verger de pêchers, etc. En début du chapitre 2, Alfred Bertini explique quelques-unes des particularités du barrage et de sa construction. Dans le chapitre 3, Georges Sénéquier évoque la gestion de la crise dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi la rupture du barrage, toujours sous cette forme de témoignage lors d'un entretien. Ainsi, les auteurs apportent des éléments de contexte, revenant sur la construction du barrage, sur l'activité économique de la région, sur la prise en charge des sinistrés. Ils réalisent un ouvrage qui n'est pas une enquête, pas une reconstruction des faits, pas un reportage des décennies plus tard. Ils ont conçu un format qui donne la parole aux survivants, qui permet à la fois de prendre du recul, les années ayant passé, à la fois de faire passer le traumatisme inimaginable vécu par ces personnes. Cela constitue à la fois un devoir de mémoire, à la fois une forme de thérapie pour des individus marqués à vie. En creux se dessine des vies bouleversées par une catastrophe arbitraire, l'impossibilité pour certains de faire leur deuil, ainsi qu'une autre époque. Avec le recul, il apparaît par exemple qu'il n'y avait aucun dispositif d'accompagnement psychologique. le lecteur a du mal à contenir ses émotions, que ce soit pour des souvenirs atroces (la jeune femme regardant depuis son balcon la vague engloutir des automobilistes qu'elle ne peut pas prévenir), ou incongrus (un homme sorti pour comprendre ce qui se passe et qui voit son voisin partir à la chasse). Il se dit que le plus horrible reste implicite : tous ces êtres humains qui sont morts dans des conditions effroyables.
Voilà un ouvrage qui ne ressemble à aucun autre. Dans un premier temps, le lecteur peut avoir des doutes a priori sur un ouvrage de plus sur le sujet, sur le format très austère en apparence de la narration. Il ne faut que quelques pages pour se rendre compte de l'incroyable intelligence émotionnelle et du respect total que représente ce mode de narratif relatant la parole des survivants. Tout aussi rapidement, ses réserves s'envolent quant aux dessins : l'artiste est totalement au service du projet, sachant insuffler de la vie et de l'émotion dans chaque témoin, avec une densité d'informations visuelles et d'interaction avec les mots, qu'un simple feuilletage ne permet pas de soupçonner. Une réussite extraordinaire.
-
Ce tome contient une histoire complète et indépendante de toute autre. La première édition de cet ouvrage date de 2014. Elle a été réalisée par Éric Corbeyran pour le scénario et par Horne Perreard pour le dessin, l'encrage et les nuances de gris.
Toulon en janvier 1960, un monsieur se présente dans un pressing avec des draps encore pliés. L'employé s'en étonne car ils semblent parfaitement propres : il explique qu'il les a retrouvés dans une armoire et que lorsque la vague est passée, la boue s'est infiltrée partout. Les draps se trouvaient dans une armoire au premier étage et quand la vague a déferlé, elle a emporté tout ce qui se trouvait au rez-de-chaussée et inondé tout ce qui était à l'étage, mais personne n'est mort. À Fréjus dans le Var le 2 décembre 1959, tout le monde est confortablement installé dans son lit ou autour d'un dîner, devant son poste de radio ou la télé. À 21h13, le barrage cède libérant une vague de 60 mètres de haut. 50 millions de mètres cubes d'eau se déversent d'un seul coup dans la vallée, projetant des rochers, de la terre et des énormes blocs de béton, arrachant les arbres, anéantissant les habitations, emportant tout sur leur passage. Dix kilomètres séparent Fréjus du barrage. La vague met 25 minutes pour les parcourir avant de se jeter dans la mer. 450 personnes trouvent la mort cette nuit-là, dont près d'un tiers sont des enfants. Au matin on ne dénombre pas moins de 4.000 sinistrés. Aucune famille n'est épargnée. Tout le monde a perdu quelqu'un.
Georges Sénéquier est né en 1929 et il a eu 30 ans le 30 décembre 1959, le lendemain de la rupture du barrage. À l'époque, il était technicien de la Défense Nationale. Il travaillait à l'usine de torpilles de Saint Tropez. Il était également conseiller municipal depuis peu. Pour lui et toute l'équipe municipale, Malpasset a été leur baptême du feu. Il était revenu chez lui assez tard le 02 décembre 1959, sa fille de 4 ans dormait déjà. Après le dîner, il révisait ses cours pour un examen à passer, et il a entendu comme le bruit apporté par le mistral de dizaines de trains qui passaient en même temps. Après ce boucan, la lumière s'est éteinte, il n'y avait plus d'électricité. L'énorme grondement qu'ils entendaient avec sa femme était celui de l'eau qui déferlait. Leur maison était sur une butte que l'eau a contournée. Quand il est sorti après le passage de la vague, tout avait disparu autour de la butte, tout avait été emporté. En 1959, Simone Infantolino avait 12 ans, et elle vivait avec ses parents et ses deux frères dans la vallée du Reyran. Les deux frères avaient été punis et avaient dû aller se coucher. Son père dormait aussi épuisé par sa journée de travail. La maison abritait également un frère et une belle-soeur et leurs deux filles. À un moment donné, elle a entendu un bruit incroyable, énorme affreux et il s'est rapproché.
En choisissant cette bande dessinée, il est probable que le lecteur en connaisse déjà le sujet : le 2 décembre 1959, des précipitations intenses font monter l'eau de la retenue du barrage de Malpasset, au-dessus du niveau maximum, et entraîne sa rupture. Une vague de plusieurs millions de mètres cubes d'eau déferle vers la mer, s'abattant sur des habitations isolées et sur Fréjus. Les faits sont relatés en 5 pages en noir & blanc avec des nuances de gris, par des dessins en plan large (des cases de la largeur de la page) ne mettant en scène aucun être humain. Les cartouches de texte sont concis et factuels, apportant des informations très synthétiques. le chapitre 1 commence en page 12, et le mode narratif change : au temps présent (2014 parution de l'ouvrage, ou un peu avant), un premier témoin (Georges Sénéquier, 30 ans au moment des faits) s'adresse à un interlocuteur, comme s'il s'adressait en direct au lecteur, et fait part de ses souvenirs de cette nuit-là. Tout l'ouvrage est conçu ainsi : sur la base d'entretiens, ou plutôt de recueil de souvenirs, sans que l'intervieweur ne pose de questions, sans son intervention. C'est donc un dispositif très particulier, reposant essentiellement sur des cadrages plan poitrine du témoin, parfois un peu plus larges, régulièrement plus serrés. Tout l'art de l'artiste est de donner vie à ces individus, par le biais des expressions de visage, de la posture, accompagnées occasionnellement d'un geste de la main. Horne Perreard s'en sort très bien. Par la force des choses, les témoins de l'époque ont maintenant tous dépassé les 60 ans. Les cadrages permettent de se focaliser sur leur visage, de voir le calme qui vient avec l'âge, mais aussi les émotions qui prennent le dessus accompagnant un souvenir particulier, une souffrance encore vivante. le lecteur éprouve la sensation que ces survivants s'adressent directement à lui, qu'il les écoute assis à côté ou en face d'eux. Dans la postface, le scénariste explique qu'après avoir entendu ces différentes personnes, il ne pouvait plus simplement raconter les faits comme une reconstitution, que la parole de ces personnes devait primer sur tout. Cette façon de raconter s'avère parfaitement adaptée et le lecteur sent son coeur se serrer régulièrement.
Ce dispositif très rigoureux ne s'avère ni figé, ni pesant. Les auteurs ont également réalisé une sorte de prologue ou d'interlude pour chacun des 3 chapitres : le prologue montrant le barrage et le parcours de la vague, la présentation de Jean-Paul Vieu qui a réalisé les photographies de la catastrophe, la présentation d'Yvon Allamand adolescent et pompiste occasionnel à la station-service de son père. Ces passages font sens permettant d'élargir un peu le propos, avec des dessins qui semblent parfois un peu léger, mais qui donnent à voir une reconstitution historique soignée en particulier pour les voitures et les trains. Par ailleurs, les témoignages sont nombreux et les intervenants avaient des âges différents au moment de la catastrophe : Annie Brodin (8 ans), Pierre Trujillo (1 jour), Denise Laugier (13 ans), Michel Ruby (8 ans), Louis Infantolino (15 ans), Fernand Martini (artisan électricien), Daniel Castelli (11 ans), Huguette Epuron (31 ans), Alfred Bertini (30 ans, employé de mairie), Michèle Guillermin (14 ans, en pensionnat), Irène Jodar (19 ans, avec un fiancé). Au fil des propos, il revient plusieurs éléments communs comme le bruit de la vague titanesque ou la coupure d'électricité. le choix de la narration n'étant pas une reconstitution ou une mise en situation, les auteurs font apparaître ces éléments communs par le biais d'une image, celles-ci pouvant se répéter lors d'un autre témoignage. Ainsi il apparaît des leitmotivs visuels comme une onomatopée pour le bruit de la vague, les phylactères vides, les couvertures, l'ampoule éteinte, le barrage rempli à ras-bord, les tuiles de toit, la locomotive, le pupitre vide, le panneau H pour Hôpital, l'arbre nu, le camion de pompier avec la grande échelle, les petites maisons de Monopoly.
S'intercalant avec les plans rapprochés des survivants et les leitmotivs visuels, les auteurs intègrent sporadiquement des cases représentant la situation : les arènes de Fréjus intactes, une tombe de deux frères morts dans l'inondation, des canisses, un hélicoptère survolant la retenue d'eau, une vue aérienne le lendemain de la catastrophe, des maisons en ruine, des rues recouvertes de boue, des ruines du barrage, un verger de pêchers, etc. En début du chapitre 2, Alfred Bertini explique quelques-unes des particularités du barrage et de sa construction. Dans le chapitre 3, Georges Sénéquier évoque la gestion de la crise dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi la rupture du barrage, toujours sous cette forme de témoignage lors d'un entretien. Ainsi, les auteurs apportent des éléments de contexte, revenant sur la construction du barrage, sur l'activité économique de la région, sur la prise en charge des sinistrés. Ils réalisent un ouvrage qui n'est pas une enquête, pas une reconstruction des faits, pas un reportage des décennies plus tard. Ils ont conçu un format qui donne la parole aux survivants, qui permet à la fois de prendre du recul, les années ayant passé, à la fois de faire passer le traumatisme inimaginable vécu par ces personnes. Cela constitue à la fois un devoir de mémoire, à la fois une forme de thérapie pour des individus marqués à vie. En creux se dessine des vies bouleversées par une catastrophe arbitraire, l'impossibilité pour certains de faire leur deuil, ainsi qu'une autre époque. Avec le recul, il apparaît par exemple qu'il n'y avait aucun dispositif d'accompagnement psychologique. le lecteur a du mal à contenir ses émotions, que ce soit pour des souvenirs atroces (la jeune femme regardant depuis son balcon la vague engloutir des automobilistes qu'elle ne peut pas prévenir), ou incongrus (un homme sorti pour comprendre ce qui se passe et qui voit son voisin partir à la chasse). Il se dit que le plus horrible reste implicite : tous ces êtres humains qui sont morts dans des conditions effroyables.
Voilà un ouvrage qui ne ressemble à aucun autre. Dans un premier temps, le lecteur peut avoir des doutes a priori sur un ouvrage de plus sur le sujet, sur le format très austère en apparence de la narration. Il ne faut que quelques pages pour se rendre compte de l'incroyable intelligence émotionnelle et du respect total que représente ce mode de narratif relatant la parole des survivants. Tout aussi rapidement, ses réserves s'envolent quant aux dessins : l'artiste est totalement au service du projet, sachant insuffler de la vie et de l'émotion dans chaque témoin, avec une densité d'informations visuelles et d'interaction avec les mots, qu'un simple feuilletage ne permet pas de soupçonner. Une réussite extraordinaire.
2 décembre 1959, 21h13 : le barrage de Malpasset cède : déferlement d'une cinquantaine de millions de mètres cubes d'eau, qui 25 mn plus tard immerge Fréjus. 423 victimes. C'est une des plus grandes catastrophes civiles françaises du XXe siècle.
C'est tellement fort qu'il est difficile de lire cette BD d'une traite. Les témoignages sont poignants sans aller dans l'indécence, sans blâmer qui que ce soit. Comme celui de cette femme qui s'est mariée à titre posthume, suite à sa demande au Général de Gaulle. Les dessins, en noir et blanc, ont la pudeur de ne pas faire de voyeurisme.
C'est juste, sobre, parfait, quoi ! J'ai eu l'occasion de voir ce lieu qui m'avait bouleversée, donnant l'impression, en voyant les blocs de béton et les ferrailles sur le Reyran que cette catastrophe s'était passée il y a moins de 5 ans.
Bravo aux auteurs et aux témoignages tout en pudeur.
C'est tellement fort qu'il est difficile de lire cette BD d'une traite. Les témoignages sont poignants sans aller dans l'indécence, sans blâmer qui que ce soit. Comme celui de cette femme qui s'est mariée à titre posthume, suite à sa demande au Général de Gaulle. Les dessins, en noir et blanc, ont la pudeur de ne pas faire de voyeurisme.
C'est juste, sobre, parfait, quoi ! J'ai eu l'occasion de voir ce lieu qui m'avait bouleversée, donnant l'impression, en voyant les blocs de béton et les ferrailles sur le Reyran que cette catastrophe s'était passée il y a moins de 5 ans.
Bravo aux auteurs et aux témoignages tout en pudeur.
La bande dessinée permet également de rendre hommage, de se souvenir. Il est vrai que Malpasset est tombé dans l'oubli. C'est pourtant l'une des pires catastrophes meurtrières qu'a connu notre pays. Cela s'est passé à Fréjus et il y a eu 423 morts sans compter des dégâts matériels considérables.
En effet, beaucoup de gens ont perdu leurs maisons, leurs exploitations, leurs usines ce fameux 2 décembre 1959. Des millions de mètres cubes d'eau se sont déversés dans la vallée suite à un barrage mal construit pour des raisons d'économies. Pour autant, les responsabilités humaines ont été écartés lors des suites juridiques mais la bd ne fera pas état de cela.
On a droit à des témoignages qui se compilent les uns avec les autres dans une sobriété absolue et qui est voulue par les auteurs. C'est un documentaire de 144 pages. Il y a une certaine authenticité. C'est assez poignant par moment. On a l'impression que ces faits ont été oubliés de manière volontaires afin de passer à autre chose. le général De Gaulle avait écrit lors de sa visite que Fréjus devait renaître.
Corbeyran montre un talent dans la composition de quelque chose de différent, loin de l'univers des Stryges. Quant à Horne, le dessin réaliste lui va bien. Cependant, malgré toutes les qualités de cette oeuvre dans le genre "devoir de mémoire", c'est assez monotone dans la construction. Certes, cette rigueur imposée permet de donner le ton juste. A travers les témoignages, on arrive à revivre cette catastrophe. On peut le prendre comme un avertissement contre toutes les catastrophes civiles futures.
En effet, beaucoup de gens ont perdu leurs maisons, leurs exploitations, leurs usines ce fameux 2 décembre 1959. Des millions de mètres cubes d'eau se sont déversés dans la vallée suite à un barrage mal construit pour des raisons d'économies. Pour autant, les responsabilités humaines ont été écartés lors des suites juridiques mais la bd ne fera pas état de cela.
On a droit à des témoignages qui se compilent les uns avec les autres dans une sobriété absolue et qui est voulue par les auteurs. C'est un documentaire de 144 pages. Il y a une certaine authenticité. C'est assez poignant par moment. On a l'impression que ces faits ont été oubliés de manière volontaires afin de passer à autre chose. le général De Gaulle avait écrit lors de sa visite que Fréjus devait renaître.
Corbeyran montre un talent dans la composition de quelque chose de différent, loin de l'univers des Stryges. Quant à Horne, le dessin réaliste lui va bien. Cependant, malgré toutes les qualités de cette oeuvre dans le genre "devoir de mémoire", c'est assez monotone dans la construction. Certes, cette rigueur imposée permet de donner le ton juste. A travers les témoignages, on arrive à revivre cette catastrophe. On peut le prendre comme un avertissement contre toutes les catastrophes civiles futures.
Le 2 décembre 1959, en début de soirée, le barrage de Malpasset se brise. En quelques minutes, une vague de millions de mètres cubes d'eau emporte sur son passage des tonnes de terre, des centaines de fermes et de maisons, faisant plus de 400 morts et des milliers de sinistrés.
Après plus de 50 ans, Corbeyran revient sur les lieux. Il rencontre les témoins, recueille leurs témoignages. Pourquoi une telle tragédie ? Qui en sont les responsables ? Là n'est pas l'essentiel pour l'auteur qui s'attache dans cette bande dessinée documentaire à son aspect intime. Ces femmes et ces hommes d'un certain âge disent avec une émotion contenue et une très grande humanité la terreur, l'effroi qui les ont frappé alors qu'ils étaient enfant et marqué à tout jamais.
Si la première partie est consacrée à une succession de récits du drame, la seconde relate l'après : les secours, les réparations matérielles et les traumas qui ne passent pas.
Nul pathos mais du sensible. La sobriété du dessin, la délicatesse du noir et blanc rendent hommage à la dignité des habitants de de la vallée martyr. Poignant.
Après plus de 50 ans, Corbeyran revient sur les lieux. Il rencontre les témoins, recueille leurs témoignages. Pourquoi une telle tragédie ? Qui en sont les responsables ? Là n'est pas l'essentiel pour l'auteur qui s'attache dans cette bande dessinée documentaire à son aspect intime. Ces femmes et ces hommes d'un certain âge disent avec une émotion contenue et une très grande humanité la terreur, l'effroi qui les ont frappé alors qu'ils étaient enfant et marqué à tout jamais.
Si la première partie est consacrée à une succession de récits du drame, la seconde relate l'après : les secours, les réparations matérielles et les traumas qui ne passent pas.
Nul pathos mais du sensible. La sobriété du dessin, la délicatesse du noir et blanc rendent hommage à la dignité des habitants de de la vallée martyr. Poignant.
Cette BD tient du documentaire, des témoignages. Elle est inclassable. Son sujet : la catastrophe du Malpasset. Il s'agit de la plus grande catastrophe civile française du XXème siècle : 423 morts suite à la rupture d'un barrage en décembre 1959. La vague monstrueuse qui s'est abattu en quelques minutes sur Fréjus faisait 30 mètres de haut, elle a entraîné au passage 14 piles du pont de l'autoroute en construction, 85 tonnes chacune. C'est inimaginable.
La forme de cette BD est très particulière, particulièrement bien adaptée à son sujet.
Ce livre commence par une partie documentaire de 5 pages qui racontent les faits bruts. Les dessins sont un peu comme des photos en noir et blanc, sans aucun être humain, avec des textes brefs et informatifs. Ensuite suivent les chapitres des témoignages, tous présentés au présent par des survivants, qui bien sûr ont tous au moment du récit plus de 60 ans. Chacun son tour s'adresse au lecteur pour raconter dans un chapitre ses souvenirs de la nuit de la catastrophe. Les cadrages sont régulièrement en très gros plan, et le dessinateur a fait un travail remarquable de rendu des émotions. le lecteur a l'impression d'être vraiment face à chaque survivant, comme s'il était dans la même pièce. Entre ces chapitres l'auteur nous présente l'auteur des photographies de la catastrophe, et un adolescent et pompiste occasionnel à la station-service de son père pour que l'on comprenne de quoi il parle quand il sort du cinéma :"Soudain, la séance a été interrompue par une coupure d'électricité. Quand nous sommes sortis, c'était le chaos, avec des centaines de véhicules qui fuyaient. Les gens nous ont dit que le barrage venait de rompre. Je suis parti vers la station-service de mes parents en suivant la voie ferrée. J'ai croisé un cheminot qui m'a dit de ne pas aller plus loin, que c'était dangereux. Dans le faisceau de sa lampe torche, j'ai vu les rails coupés net. Il n'y avait plus un seul bâtiment, juste un grand trou". Avec le prologue ce sont les seules pages où l'on voit les lieux avant la catastrophe.
Ensuite l'auteur explique dans une postface comment il s'y est pris et pourquoi il a choisi ce dispositif très particulier. "C'était une autre époque, sans cellule psychologique, ni soutien aux victimes. On a fait semblant d'oublier, on est passé à autre chose tout en sachant que c'était toujours là " dira l'une des survivantes. Il est apparu essentiel de redonner la parole aux survivants pendant qu'il en était encore temps. « Les survivants disparaissaient peu à peu. Les jeunes ne savaient plus ce qui s'était passé, parce que nous, qui l'avions vécu, n'avions pas trouvé la force de leur dire ce qui s'était passé. »
La lecture est parfois difficilement soutenable, ce n'est pas forcément à lire d'une seule traite. Mais ceux qui ont vu l'état actuel des lieux tant d'années après (le barrage n'a pas été reconstruit sur le même cours d'eau) comprendront : restes de blocs de béton, de ferrailles qui donnent l'impression bouleversante d'une tragédie relativement récente.
Ce livre a le ton nécessaire - juste et sobre - il laisse l'imaginaire du lecteur digérer les témoignages, il suggère, ne se substitue pas à la parole des témoins, ce qui est paradoxal pour une BD.
La forme de cette BD est très particulière, particulièrement bien adaptée à son sujet.
Ce livre commence par une partie documentaire de 5 pages qui racontent les faits bruts. Les dessins sont un peu comme des photos en noir et blanc, sans aucun être humain, avec des textes brefs et informatifs. Ensuite suivent les chapitres des témoignages, tous présentés au présent par des survivants, qui bien sûr ont tous au moment du récit plus de 60 ans. Chacun son tour s'adresse au lecteur pour raconter dans un chapitre ses souvenirs de la nuit de la catastrophe. Les cadrages sont régulièrement en très gros plan, et le dessinateur a fait un travail remarquable de rendu des émotions. le lecteur a l'impression d'être vraiment face à chaque survivant, comme s'il était dans la même pièce. Entre ces chapitres l'auteur nous présente l'auteur des photographies de la catastrophe, et un adolescent et pompiste occasionnel à la station-service de son père pour que l'on comprenne de quoi il parle quand il sort du cinéma :"Soudain, la séance a été interrompue par une coupure d'électricité. Quand nous sommes sortis, c'était le chaos, avec des centaines de véhicules qui fuyaient. Les gens nous ont dit que le barrage venait de rompre. Je suis parti vers la station-service de mes parents en suivant la voie ferrée. J'ai croisé un cheminot qui m'a dit de ne pas aller plus loin, que c'était dangereux. Dans le faisceau de sa lampe torche, j'ai vu les rails coupés net. Il n'y avait plus un seul bâtiment, juste un grand trou". Avec le prologue ce sont les seules pages où l'on voit les lieux avant la catastrophe.
Ensuite l'auteur explique dans une postface comment il s'y est pris et pourquoi il a choisi ce dispositif très particulier. "C'était une autre époque, sans cellule psychologique, ni soutien aux victimes. On a fait semblant d'oublier, on est passé à autre chose tout en sachant que c'était toujours là " dira l'une des survivantes. Il est apparu essentiel de redonner la parole aux survivants pendant qu'il en était encore temps. « Les survivants disparaissaient peu à peu. Les jeunes ne savaient plus ce qui s'était passé, parce que nous, qui l'avions vécu, n'avions pas trouvé la force de leur dire ce qui s'était passé. »
La lecture est parfois difficilement soutenable, ce n'est pas forcément à lire d'une seule traite. Mais ceux qui ont vu l'état actuel des lieux tant d'années après (le barrage n'a pas été reconstruit sur le même cours d'eau) comprendront : restes de blocs de béton, de ferrailles qui donnent l'impression bouleversante d'une tragédie relativement récente.
Ce livre a le ton nécessaire - juste et sobre - il laisse l'imaginaire du lecteur digérer les témoignages, il suggère, ne se substitue pas à la parole des témoins, ce qui est paradoxal pour une BD.
J'ai étais ému par ce récit,
Les auteurs ont su éviter les récits plombants qui s'enchaînent
Horne alterne les portraits et des images d'illustration (qui se répètent) et donnent un rythme à cette histoire magnifiquement scénarisée par Corbeyran
Bouleversant, et instructif
et c'est terrible de se dire que cela c'est Malpasset
Les auteurs ont su éviter les récits plombants qui s'enchaînent
Horne alterne les portraits et des images d'illustration (qui se répètent) et donnent un rythme à cette histoire magnifiquement scénarisée par Corbeyran
Bouleversant, et instructif
et c'est terrible de se dire que cela c'est Malpasset
Ce livre est le résultat d'un projet de Thierry Joor directeur éditorial chez Delcourt. L'idée est de rendre compte des grandes catastrophes qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. Pour Corbeyran, l'évidence se situe à Fréjus ou pas très loin, là ou vie familiale et amitiés l'emmènent régulièrement. 2009, cinquantenaire de la tragédie de Malpasset, on en parle beaucoup et Corbeyran découvre cette tragédie. L'idée lui vient alors de construire un récit. Mais son point de vue l'éloignera du sensationnalisme et de la relation chronologique classique, c'est en faisant un travail d'enquête auprès de rescapés, en recueillant des témoignages que l'idée lui vient de se concentrer sur les paroles et les émotions, sur la relations de vie brisées par une tragédie et leurs effets encore visible et touchant cinquante années plus tard.
Angle d'attaque original, assez loin du pathos, difficile car sans reconstitutions d'« images » édifiantes (la tragédie s'est passée une nuit de décembre) et pourtant réussite scénaristique de Corbeyran, et défi pour le dessinateur de rendre compte de la douleur des gens et des interviews.
Seuls trois passages (une dizaine de pages) nous renvoient au moment des faits, le reste nous montre les personnes interviewées. Horne a su trouver des images simples illustrant les propos des rescapés en montrant des objets (un escalier, quand les gens se réfugient dans les étages, une radio, des fils électriques – alors que le courant a sauté – des bottes sales, des briques, un canot de sauvetage, etc…) qui nous permettent d'imaginer, de reconstruire à partir de ces quelques indices ce qui a pu se produire. Des mots, quelques images, le son (trouvaille d'une case rayée de grosses lignes blanches reproduisant un K R O entremêlés rendant le fracas de l'eau déchainée) et notre imaginaire reconstruisent l'horreur de cette nuit tragique.
Paradoxe pour un médium de l'image de finalement ne rien montrer d'explicite, mais de suggérer et de laisser l'imaginaire du lecteur faire son travail.
Une bande dessinée réussie qui reste au plus près des victimes, n'éludant pas les polémiques (beaucoup d'argent fut récolté et distribué, mais aucun suivi psychologique) sans prendre parti, montrant simplement les ravages de la catastrophe.
Lien : http://legenepietlargousier...
Angle d'attaque original, assez loin du pathos, difficile car sans reconstitutions d'« images » édifiantes (la tragédie s'est passée une nuit de décembre) et pourtant réussite scénaristique de Corbeyran, et défi pour le dessinateur de rendre compte de la douleur des gens et des interviews.
Seuls trois passages (une dizaine de pages) nous renvoient au moment des faits, le reste nous montre les personnes interviewées. Horne a su trouver des images simples illustrant les propos des rescapés en montrant des objets (un escalier, quand les gens se réfugient dans les étages, une radio, des fils électriques – alors que le courant a sauté – des bottes sales, des briques, un canot de sauvetage, etc…) qui nous permettent d'imaginer, de reconstruire à partir de ces quelques indices ce qui a pu se produire. Des mots, quelques images, le son (trouvaille d'une case rayée de grosses lignes blanches reproduisant un K R O entremêlés rendant le fracas de l'eau déchainée) et notre imaginaire reconstruisent l'horreur de cette nuit tragique.
Paradoxe pour un médium de l'image de finalement ne rien montrer d'explicite, mais de suggérer et de laisser l'imaginaire du lecteur faire son travail.
Une bande dessinée réussie qui reste au plus près des victimes, n'éludant pas les polémiques (beaucoup d'argent fut récolté et distribué, mais aucun suivi psychologique) sans prendre parti, montrant simplement les ravages de la catastrophe.
Lien : http://legenepietlargousier...
Je ne suis pas fan de BD et je ne pensais pas être un jour autant émue devant un album. C'est une succession de témoignages de la même catastrophe ... et comme une rengaine : le bruit et la coupure de courant, dans une première partie.
Dans une seconde partie, on trouve un bref "dossier technique" qui replace le contexte de l'époque de la construction, le manque d'argent, les études techniques faites au préable ...
Pour finir, c'est de la gestion de l'après catastrophe que les personnages rencontrées au début parlent : les prises en charge, les aides, les travaux
Tout en noir et blanc, les dessins de la catastrophe sont aussi précis que des photos et les visages ridés, les regards perdus qui se souviennent sont emplis d'émotions mais au final peu de larmes.
Tout est émouvant : les mots, les illustrations, les expressions, cette ampoule éteinte et ce bruit illustré comme un tag illisible qui reviennent sans arrêt. La dernière partie est moins prenante mais tout aussi intéressante.
Tellement prenant que je n'ai pu le lire d'une seule traite, j'ai fait des pauses et me suis replongée à chaque fois avec autant d'émoi pour le refermer abasourdie.
Lien : http://keskonfe.eklablog.com..
Dans une seconde partie, on trouve un bref "dossier technique" qui replace le contexte de l'époque de la construction, le manque d'argent, les études techniques faites au préable ...
Pour finir, c'est de la gestion de l'après catastrophe que les personnages rencontrées au début parlent : les prises en charge, les aides, les travaux
Tout en noir et blanc, les dessins de la catastrophe sont aussi précis que des photos et les visages ridés, les regards perdus qui se souviennent sont emplis d'émotions mais au final peu de larmes.
Tout est émouvant : les mots, les illustrations, les expressions, cette ampoule éteinte et ce bruit illustré comme un tag illisible qui reviennent sans arrêt. La dernière partie est moins prenante mais tout aussi intéressante.
Tellement prenant que je n'ai pu le lire d'une seule traite, j'ai fait des pauses et me suis replongée à chaque fois avec autant d'émoi pour le refermer abasourdie.
Lien : http://keskonfe.eklablog.com..
La rupture du barrage de Malpasset n'est pas due à la fatalité...
Il était important de rappeler cet épisode, cette catastrophe due essentiellement à des fautes humaines et ses conséquences. Des témoignages poignants sont livrés pour raviver la mémoire, car comme souvent les fautifs n'ont jamais été poursuivi.
Eric Corbeyran a choisi un noir et blanc sobre et rend ainsi hommage aux milliers d victimes directes et indirectes de ce cruel accident.
Il était important de rappeler cet épisode, cette catastrophe due essentiellement à des fautes humaines et ses conséquences. Des témoignages poignants sont livrés pour raviver la mémoire, car comme souvent les fautifs n'ont jamais été poursuivi.
Eric Corbeyran a choisi un noir et blanc sobre et rend ainsi hommage aux milliers d victimes directes et indirectes de ce cruel accident.
Il avait vraiment beaucoup plu les jours précédents, alors quand le barrage de Malpasset a cédé, le 2 décembre 1959 à 21 h 13, ce sont 50 millions de mètres cubes qui ont été libérés, ainsi que des rochers, de la terre, du béton, mettant 25 minutes pour parcourir les 10 km jusqu'à la ville de Fréjus. Une vague de 60 m de haut. Bilan : des centaines de morts, des milliers de sinistrés.
Voilà pour les chiffres. Les auteurs se sont concentrés sur l'humain, ont retrouvé des survivants et les ont laissés raconter leur histoire. Sans effets, avec sobriété, pas besoin. J'avoue avoir frissonné à plusieurs reprises, avoir été émue.
Les causes vraisemblables de la 'plus importante catastrophe civile au XX siècle en France' sont évoquées, la pluie, le déplacement de la construction sans étude géologique supplémentaire, la construction d'un pont dans le coin? Bref, ce barrage avait 5 ans et a craqué.
La solidarité a beaucoup joué, les gens n'avaient plus rien du tout. Et il y a eu quelques polémiques, le livre en parle.
Mais il faut absolument lire tous ces témoignages, différents et semblables à la fois (le bruit, quand c'est arrivé, l'électricité coupée)
Lien : https://enlisantenvoyageant...
Voilà pour les chiffres. Les auteurs se sont concentrés sur l'humain, ont retrouvé des survivants et les ont laissés raconter leur histoire. Sans effets, avec sobriété, pas besoin. J'avoue avoir frissonné à plusieurs reprises, avoir été émue.
Les causes vraisemblables de la 'plus importante catastrophe civile au XX siècle en France' sont évoquées, la pluie, le déplacement de la construction sans étude géologique supplémentaire, la construction d'un pont dans le coin? Bref, ce barrage avait 5 ans et a craqué.
La solidarité a beaucoup joué, les gens n'avaient plus rien du tout. Et il y a eu quelques polémiques, le livre en parle.
Mais il faut absolument lire tous ces témoignages, différents et semblables à la fois (le bruit, quand c'est arrivé, l'électricité coupée)
Lien : https://enlisantenvoyageant...
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Éric Corbeyran (403)
Voir plus
Quiz
Voir plus
La Métamorphose
En quelle année est paru pour la première fois "La Métamorphose" ?
1938
1912
1915
11 questions
238 lecteurs ont répondu
Thème : La Métamorphose de Franz Kafka de
Éric CorbeyranCréer un quiz sur ce livre238 lecteurs ont répondu