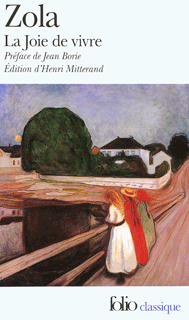>
Critique de Nastasia-B
« Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes » concluait le poète dans La Mort et le Bûcheron et peut-être est-ce également la morale qu'a voulu donner Émile Zola à sa Joie de vivre ?
Après un volume parisien que j'avais adoré, Au Bonheur des dames, le père des Rougon-Macquart a voulu changer totalement d'atmosphère pour son n° 12, emmenant son héroïne, Pauline Quenu, la fille de la charcutière qu'on avait perdue de vue à la fin du Ventre de Paris, sur les plages crayeuses de la côte normande.
Personnellement — et bien qu'appréciant particulièrement ce littoral pour y avoir séjourné un certain temps, si vous voyez ce que je veux dire —, je n'ai pas pris beaucoup de plaisir à la lecture de ce volume. Pendant tout ce temps, je me suis demandée quel était le pouvoir de généralisation que revêtait cet ouvrage. Car c'est un peu ça la marque de fabrique des Rougon-Macquart : regarder par le prisme de cette famille agrandie un élément typique ou révélateur de la sociologie française sous le second Empire.
Quand Gervaise devient alcoolique dans L'Assommoir, ça me parle et ça m'intéresse énormément car j'imagine que cela recouvre une réalité dans les milieux ouvriers ou petits commerçants d'alors. Quand on nous dresse le portrait de tous les habitants d'un immeuble haussmannien dans Pot-Bouille, j'imagine que, même si l'on ne peut généraliser outre mesure, c'est tout de même une espèce de moyenne de ce à quoi devait ressembler un immeuble bourgeois parisien sous le second Empire, etc. Et c'est bien sûr le cas pour la grande majorité des thèmes abordés dans les romans qui constituent ce cycle littéraire et que, pour bon nombre d'entre eux, j'apprécie beaucoup.
En revanche, pour certains tomes, je peine à voir la valeur de généralisation qu'ils revêtent. C'était le cas, par exemple, d'Une Page d'amour. Là, je m'étais franchement ennuyée car, outre le fait qu'à mes yeux, sociologiquement, cela ne me présentait rien de bien spécial ou qui puisse être typique de cette période de l'histoire, je trouvais que, psychologiquement, ça n'était pas non plus d'un grand intérêt, ni d'une finesse d'écriture indépassable.
Eh bien ici, d'après moi, c'est rebelote (dur, dur de se relancer après avoir signé un excellent roman comme ce fut le cas pour L'Assommoir et comme c'est ici le contre-coup avec Au Bonheur des dames) : on a affaire à une histoire qui ne dépasse pas beaucoup ses protagonistes, et, si l'on souhaite absolument chercher à généraliser, à voir plus loin que les personnages, cette généralisation ne m'apparaît en rien spécifique du second Empire.
J'ai plutôt le sentiment qu'Émile Zola a construit ce roman à partir de ses propres névroses et qu'elles ne sont en rien révélatrices ni d'une époque, ni d'une catégorie de personnes. (Je peux me tromper, bien entendu, mais c'est l'impression que cela me donne.)
Je n'arrive pas à me retirer de l'esprit qu'Émile Zola a voulu surfer sur la vague d'Une Vie, roman publié peu avant par son ami Guy de Maupassant. On y retrouve beaucoup de ressorts similaires, mais un peu moins bien exploités à mon goût.
Car Zola, qu'on le veuille ou non, c'est un journaliste engagé, un sociologue peut-être, mais pas un fin psychologue ; il sait décrire une partie d'échecs, mesurer les enjeux et les conséquences de chaque coup mais pas spécialement rendre perceptible, sensitif et intime ce qui se passe tout au fond, dans la tête des joueurs. C'est comme ça que je le perçois et je peux évidemment, là encore, me tromper.
On apprend au début de la Joie de vivre que la petite Pauline Quenu a perdu coup sur coup ses deux parents (qui tenaient la charcuterie florissante au pied des halles à Paris, cf. le Ventre de Paris) et qu'elle est donc recueillie chez un oncle, M. Chanteau, dans le Calvados, du côté de Port-en-Bessin (du moins c'est comme ça que je me l'imagine car le village imaginaire est dénommé Bonneville, probablement de façon ironique, quoiqu'on trouve effectivement, ailleurs dans le Calvados, un village s'appelant Bonneville-sur-Touques et un peu plus loin un autre qui répond au joli nom de Bonneville-la-Louvet).
Comme dans Une Vie (sus-mentionné) on va suivre une héroïne, jeune et naïve au départ, rattrapée par la mesquinerie et la nullité des hommes. D'année en année, on va l'observer se casser peu à peu les dents, volant de ratage en ratage, de désillusion en désillusion.
Il y a selon moi de très nombreux parallèles entre la Pauline d'ici et la Jeanne d'Une Vie. le personnage nul, qui échoue dans tout ce qu'il entreprend et qui ruine au passage l'héroïne était son fils unique, Paul, dans Une Vie, c'est ici Lazare, le fils unique du couple Chanteau.
Il y avait une scène terrible d'accouchement d'un bébé semi avorton dans Une Vie, il y en a un ici aussi (et les deux seront des petits garçons nommés Paul). Il y avait l'injustice et la douleur de l'adultère dans Une Vie, elle est aussi présente dans La Joie de Vivre. Il y avait même un chien subclaquant (Massacre, pour mémoire) et il y en un ici aussi, c'est le chien Mathieu.
Il y avait encore un parent gros mangeur et impotent (la mère de Jeanne dans Une Vie), c'est ici l'oncle, M. Chanteau avec ses crises de goutte mémorables. Il y avait également l'amie d'enfance qui se révélait rivale amoureuse (la bonne Rosalie dans Une Vie), ce sera ici Louise.
Il y avait enfin l'être malsain, le véritable ennemi de l'héroïne, quoique très proche d'elle. C'était le mari dans Une Vie, c'est la tante, Mme Chanteau dans La Joie de vivre. Chacun mourant prématurément et entraînant un changement radical dans la vie de l'héroïne.
On pourrait comme cela presque transférer point par point tous les éléments d'Une Vie (j'ai passé sous silence le père bienveillant mais faible, dont le rôle est tenu ici par le docteur Cazenove). Mais la question que je me pose, moi, c'est : quel est le projet littéraire de ce roman ?
Nous montrer que la descente aux enfers qu'a connu l'aristocratie régionale dans la première moitié du XIXème siècle est susceptible de frapper également la bourgeoisie commerçante dans la seconde moitié du siècle ? On s'en serait douté, non ?
L'héroïne de Maupassant était nostalgique et plutôt faible. Sa vie semble avoir été une vie pour rien. Au contraire, Pauline ici, est très positive et d'un optimisme à toute épreuve, mais, finalement, pour elle aussi, cela semble être une vie pour rien.
Le personnage de Lazare est très développé ici. On lit dans les notes de différentes éditions que l'auteur y a injecté énormément de ses propres doutes existentiels, notamment suite au décès de sa propre mère et aussi quant à ses manies & tics divers et plus ou moins superstitieux qui le conduisent à la dépression chronique et à l'inaction.
Finalement, le seul personnage qui apparaisse pleinement lucide semble être Véronique, la bonne, dont on appréciera la décision finale. Mais, là encore, que veut nous dire l'auteur, au juste, et qui soit contenu dans son projet littéraire des Rougon-Macquart ? Personnellement, je ne vois pas. J'ai trouvé la mouture beaucoup moins réussie que celle De Maupassant. Globalement, je me suis plutôt ennuyée à la lecture et il aura fallu que j'attende un fugace instant au chapitre VIII pour jouir d'une certaine tension narrative. Laquelle tension ne se maintint pas longtemps.
En somme, un opus décevant pour moi, que je rapproche de ma déception quant à Une Page d'amour, un tome que j'avais trouvé plutôt creux et gratuit après l'excellent Assommoir. À vous de voir à présent et de vous forger votre propre opinion à son sujet car je ne voudrais pas vous gâcher votre joie de vivre avec ce qui n'est, finalement, que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Après un volume parisien que j'avais adoré, Au Bonheur des dames, le père des Rougon-Macquart a voulu changer totalement d'atmosphère pour son n° 12, emmenant son héroïne, Pauline Quenu, la fille de la charcutière qu'on avait perdue de vue à la fin du Ventre de Paris, sur les plages crayeuses de la côte normande.
Personnellement — et bien qu'appréciant particulièrement ce littoral pour y avoir séjourné un certain temps, si vous voyez ce que je veux dire —, je n'ai pas pris beaucoup de plaisir à la lecture de ce volume. Pendant tout ce temps, je me suis demandée quel était le pouvoir de généralisation que revêtait cet ouvrage. Car c'est un peu ça la marque de fabrique des Rougon-Macquart : regarder par le prisme de cette famille agrandie un élément typique ou révélateur de la sociologie française sous le second Empire.
Quand Gervaise devient alcoolique dans L'Assommoir, ça me parle et ça m'intéresse énormément car j'imagine que cela recouvre une réalité dans les milieux ouvriers ou petits commerçants d'alors. Quand on nous dresse le portrait de tous les habitants d'un immeuble haussmannien dans Pot-Bouille, j'imagine que, même si l'on ne peut généraliser outre mesure, c'est tout de même une espèce de moyenne de ce à quoi devait ressembler un immeuble bourgeois parisien sous le second Empire, etc. Et c'est bien sûr le cas pour la grande majorité des thèmes abordés dans les romans qui constituent ce cycle littéraire et que, pour bon nombre d'entre eux, j'apprécie beaucoup.
En revanche, pour certains tomes, je peine à voir la valeur de généralisation qu'ils revêtent. C'était le cas, par exemple, d'Une Page d'amour. Là, je m'étais franchement ennuyée car, outre le fait qu'à mes yeux, sociologiquement, cela ne me présentait rien de bien spécial ou qui puisse être typique de cette période de l'histoire, je trouvais que, psychologiquement, ça n'était pas non plus d'un grand intérêt, ni d'une finesse d'écriture indépassable.
Eh bien ici, d'après moi, c'est rebelote (dur, dur de se relancer après avoir signé un excellent roman comme ce fut le cas pour L'Assommoir et comme c'est ici le contre-coup avec Au Bonheur des dames) : on a affaire à une histoire qui ne dépasse pas beaucoup ses protagonistes, et, si l'on souhaite absolument chercher à généraliser, à voir plus loin que les personnages, cette généralisation ne m'apparaît en rien spécifique du second Empire.
J'ai plutôt le sentiment qu'Émile Zola a construit ce roman à partir de ses propres névroses et qu'elles ne sont en rien révélatrices ni d'une époque, ni d'une catégorie de personnes. (Je peux me tromper, bien entendu, mais c'est l'impression que cela me donne.)
Je n'arrive pas à me retirer de l'esprit qu'Émile Zola a voulu surfer sur la vague d'Une Vie, roman publié peu avant par son ami Guy de Maupassant. On y retrouve beaucoup de ressorts similaires, mais un peu moins bien exploités à mon goût.
Car Zola, qu'on le veuille ou non, c'est un journaliste engagé, un sociologue peut-être, mais pas un fin psychologue ; il sait décrire une partie d'échecs, mesurer les enjeux et les conséquences de chaque coup mais pas spécialement rendre perceptible, sensitif et intime ce qui se passe tout au fond, dans la tête des joueurs. C'est comme ça que je le perçois et je peux évidemment, là encore, me tromper.
On apprend au début de la Joie de vivre que la petite Pauline Quenu a perdu coup sur coup ses deux parents (qui tenaient la charcuterie florissante au pied des halles à Paris, cf. le Ventre de Paris) et qu'elle est donc recueillie chez un oncle, M. Chanteau, dans le Calvados, du côté de Port-en-Bessin (du moins c'est comme ça que je me l'imagine car le village imaginaire est dénommé Bonneville, probablement de façon ironique, quoiqu'on trouve effectivement, ailleurs dans le Calvados, un village s'appelant Bonneville-sur-Touques et un peu plus loin un autre qui répond au joli nom de Bonneville-la-Louvet).
Comme dans Une Vie (sus-mentionné) on va suivre une héroïne, jeune et naïve au départ, rattrapée par la mesquinerie et la nullité des hommes. D'année en année, on va l'observer se casser peu à peu les dents, volant de ratage en ratage, de désillusion en désillusion.
Il y a selon moi de très nombreux parallèles entre la Pauline d'ici et la Jeanne d'Une Vie. le personnage nul, qui échoue dans tout ce qu'il entreprend et qui ruine au passage l'héroïne était son fils unique, Paul, dans Une Vie, c'est ici Lazare, le fils unique du couple Chanteau.
Il y avait une scène terrible d'accouchement d'un bébé semi avorton dans Une Vie, il y en a un ici aussi (et les deux seront des petits garçons nommés Paul). Il y avait l'injustice et la douleur de l'adultère dans Une Vie, elle est aussi présente dans La Joie de Vivre. Il y avait même un chien subclaquant (Massacre, pour mémoire) et il y en un ici aussi, c'est le chien Mathieu.
Il y avait encore un parent gros mangeur et impotent (la mère de Jeanne dans Une Vie), c'est ici l'oncle, M. Chanteau avec ses crises de goutte mémorables. Il y avait également l'amie d'enfance qui se révélait rivale amoureuse (la bonne Rosalie dans Une Vie), ce sera ici Louise.
Il y avait enfin l'être malsain, le véritable ennemi de l'héroïne, quoique très proche d'elle. C'était le mari dans Une Vie, c'est la tante, Mme Chanteau dans La Joie de vivre. Chacun mourant prématurément et entraînant un changement radical dans la vie de l'héroïne.
On pourrait comme cela presque transférer point par point tous les éléments d'Une Vie (j'ai passé sous silence le père bienveillant mais faible, dont le rôle est tenu ici par le docteur Cazenove). Mais la question que je me pose, moi, c'est : quel est le projet littéraire de ce roman ?
Nous montrer que la descente aux enfers qu'a connu l'aristocratie régionale dans la première moitié du XIXème siècle est susceptible de frapper également la bourgeoisie commerçante dans la seconde moitié du siècle ? On s'en serait douté, non ?
L'héroïne de Maupassant était nostalgique et plutôt faible. Sa vie semble avoir été une vie pour rien. Au contraire, Pauline ici, est très positive et d'un optimisme à toute épreuve, mais, finalement, pour elle aussi, cela semble être une vie pour rien.
Le personnage de Lazare est très développé ici. On lit dans les notes de différentes éditions que l'auteur y a injecté énormément de ses propres doutes existentiels, notamment suite au décès de sa propre mère et aussi quant à ses manies & tics divers et plus ou moins superstitieux qui le conduisent à la dépression chronique et à l'inaction.
Finalement, le seul personnage qui apparaisse pleinement lucide semble être Véronique, la bonne, dont on appréciera la décision finale. Mais, là encore, que veut nous dire l'auteur, au juste, et qui soit contenu dans son projet littéraire des Rougon-Macquart ? Personnellement, je ne vois pas. J'ai trouvé la mouture beaucoup moins réussie que celle De Maupassant. Globalement, je me suis plutôt ennuyée à la lecture et il aura fallu que j'attende un fugace instant au chapitre VIII pour jouir d'une certaine tension narrative. Laquelle tension ne se maintint pas longtemps.
En somme, un opus décevant pour moi, que je rapproche de ma déception quant à Une Page d'amour, un tome que j'avais trouvé plutôt creux et gratuit après l'excellent Assommoir. À vous de voir à présent et de vous forger votre propre opinion à son sujet car je ne voudrais pas vous gâcher votre joie de vivre avec ce qui n'est, finalement, que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.