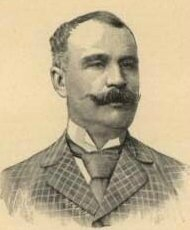Citations de Robert de Bonnières (14)
Les femmes et les enfants du faubourg Saint-Jacques dépavent les rues pour faire des barricades. La poudrière Saint.Marceau fournit de la poudre. On fond des balles, on fait des cartouches que les femmes distribuent. Les armes manquent. On crie « à l'Arsenal. ! A l’Arsenal ». On apprend avec enthousiasme que la commune de Clichy-la-Garenne, n'ayant pas d'armes, a fait forger soixante-quinze piques qui ont bien coûté cent vingt-neuf francs. Enfin Franconi et les théâtres de la Cac er de l'Ambigu-Comique distribuent les armes dont ils se servent pour les représentations militaires. Entre temps, les bourgeois tirent en l'air pour essayer leurs fusils, et donnent ainsi dans le quartier qu'ils habitent de fâcheuses alertes.
Paru dans : Anthologie des poètes français du 19eme siècle :
Le fer empoisonné apparaît même parfois dans la main de M. de Bonnières romancier. Les Monach ne nous présentent-ils pas une collection de personnages réels à qui l’auteur a voulu démontrer toute la vivacité de ses sentiments ? Deux autres romans plus récents,Le Baiser de Maïna, rapporté de Bénarès, et Jeanne Avril, qui nous semble le chef-d’œuvre de M. de Bonnières, témoignent d’un peu d’apaisement dans cet esprit hautain et tourmenté. Il y a de l’indulgence délicate et même des larmes dans Jeanne Avril. Mais il est à craindre que cet adoucissement ne soit que passager chez M. de Bonnières, et que bientôt il ne revienne à ses véritables goûts. Lui-même ne considère-t-il pas un peu comme des distractions et des haltes légères les histoires d’amour où il s’est un instant complu et les jolis Contes dorés d’où nous tirons les vers suivants d’une forme si précise et dune fermeté d’acier ?
Le fer empoisonné apparaît même parfois dans la main de M. de Bonnières romancier. Les Monach ne nous présentent-ils pas une collection de personnages réels à qui l’auteur a voulu démontrer toute la vivacité de ses sentiments ? Deux autres romans plus récents,Le Baiser de Maïna, rapporté de Bénarès, et Jeanne Avril, qui nous semble le chef-d’œuvre de M. de Bonnières, témoignent d’un peu d’apaisement dans cet esprit hautain et tourmenté. Il y a de l’indulgence délicate et même des larmes dans Jeanne Avril. Mais il est à craindre que cet adoucissement ne soit que passager chez M. de Bonnières, et que bientôt il ne revienne à ses véritables goûts. Lui-même ne considère-t-il pas un peu comme des distractions et des haltes légères les histoires d’amour où il s’est un instant complu et les jolis Contes dorés d’où nous tirons les vers suivants d’une forme si précise et dune fermeté d’acier ?
Et puis à la pensée qu'elle aussi mourrait un jour, qu'elle aussi fermerait ses yeux pour jamais, que d'elle aussi il ne resterait qu'un peu de poussière, il se sentait ému d'une grande pitié...
— Un peu plus tôt, un peu plus tard, songeait-il,... et ils auront cessé d'être; eux aussi sont condamnés...
A sa pitié pourtant se mêlait malgré lui une joie amère... celle de l'universelle et égale destruction.
Tant d'hommes étaient morts avant lui depuis des siècles et si différents
— Un peu plus tôt, un peu plus tard, songeait-il,... et ils auront cessé d'être; eux aussi sont condamnés...
A sa pitié pourtant se mêlait malgré lui une joie amère... celle de l'universelle et égale destruction.
Tant d'hommes étaient morts avant lui depuis des siècles et si différents
La première fois qu’elle a eu la notion de l’amour, ce fut à l’âge de quatorze ans.
Elle était à la campagne, par une chaude journée de juillet, dans une chambre située près de la lingerie et qu’on appelait la chambre aux confitures. (…)
Elle était très curieuse mais sans savoir de quoi. Mais il lui semblait que les livres devaient contenir de grands mystères, puisqu’en bas on avait toujours eu soin d’enlever les clés des bibliothèques et que, si cette malle n’était pas fermée comme les bibliothèques, ce n’était sans doute que par mégarde.
Elle était à la campagne, par une chaude journée de juillet, dans une chambre située près de la lingerie et qu’on appelait la chambre aux confitures. (…)
Elle était très curieuse mais sans savoir de quoi. Mais il lui semblait que les livres devaient contenir de grands mystères, puisqu’en bas on avait toujours eu soin d’enlever les clés des bibliothèques et que, si cette malle n’était pas fermée comme les bibliothèques, ce n’était sans doute que par mégarde.
— « Mon bon Jeannot, aime-moi seulement, »
Reprit la Fée ; « il n’est point de tendresses
Et de baisers et de bonnes caresses,
Que je ne fasse à mon fidèle amant.
Aime-moi bien, puisque je suis jolie,
Aime-moi bien aussi pour ma bonté.
Je suis liée à cet arbre enchanté :
Romps, en m’aimant, le charme qui me lié ».
Reprit la Fée ; « il n’est point de tendresses
Et de baisers et de bonnes caresses,
Que je ne fasse à mon fidèle amant.
Aime-moi bien, puisque je suis jolie,
Aime-moi bien aussi pour ma bonté.
Je suis liée à cet arbre enchanté :
Romps, en m’aimant, le charme qui me lié ».
« Chut! dit-elle en posant le doigt sur ses lèvres.
Et comme il fallait renouveler l'appareil, Hélène prépara les gâteaux de charpie. Puis, tandis que la générale enroulait les bandes, en prenant garde de comprimer les côtes, la jeune fille soulevait le corps de Roger. Elle lui mit ensuite des oreillers derrière le dos. Assis sur son lit plutôt que couché,
afin de prévenir les suffocations qui s'augmentaient d'instant en instant, Roger lui dit « Reste auprès de moi. Oh! vous vivrez, répondit-elle dans un élan de confiance; vous vivrez! »
Le bonheur éclatait dans ses yeux. depuis qu’Hélène était là, elle ne croyait pas qu’il pût mourir.
En entendant ce cri de joie et d'amour, Roger comprit ce qui était en elle et qu'il était aimé. Il avait de cette faiblesse de malade qu'un rien émeut, qu'un rien fait comprendre sa sensibilité s'aiguisait. Les yeux devenaient clairs comme ceux des mourants. Il songea, en la voyant autour de lui, que son bonheur et sa vie eussent été avec elle.
« Combien ai-je été fou se disait-il; comme je me suis trompé! comme les désirs me tournaient l’esprit. »
Et comme il fallait renouveler l'appareil, Hélène prépara les gâteaux de charpie. Puis, tandis que la générale enroulait les bandes, en prenant garde de comprimer les côtes, la jeune fille soulevait le corps de Roger. Elle lui mit ensuite des oreillers derrière le dos. Assis sur son lit plutôt que couché,
afin de prévenir les suffocations qui s'augmentaient d'instant en instant, Roger lui dit « Reste auprès de moi. Oh! vous vivrez, répondit-elle dans un élan de confiance; vous vivrez! »
Le bonheur éclatait dans ses yeux. depuis qu’Hélène était là, elle ne croyait pas qu’il pût mourir.
En entendant ce cri de joie et d'amour, Roger comprit ce qui était en elle et qu'il était aimé. Il avait de cette faiblesse de malade qu'un rien émeut, qu'un rien fait comprendre sa sensibilité s'aiguisait. Les yeux devenaient clairs comme ceux des mourants. Il songea, en la voyant autour de lui, que son bonheur et sa vie eussent été avec elle.
« Combien ai-je été fou se disait-il; comme je me suis trompé! comme les désirs me tournaient l’esprit. »
M. About n'avait pas encore trente-neufans. Il était alors tout blond, au lieu d'être tout gris comme il est à présent, et n'avait point encore de poches sous les yeux.
Toute sa barbe, le nez un peu fort, l'œil mobile et pétillant, les cheveux épais et drus marchant tout d'une pièce, ramassé, râblé, un peu solennel et dandinant, parlant facilement, caustique avec de feintes modesties, tranchant et riant, n'ayant qu'une pointe, mais acérée, un hanneton nourri de miel et de verjus.
Enfin plus jeune et ressemblant mieux au portrait sur fond bleu que M. Baudry a fait de lui en t872 ou1873.
M. About se montrait bon enfant, galant et spirituel, bien qu'on sentît qu'il se lâchât un peu trop dans les mots aussi bien que dans les attitudes et toute la personne. Car il n'a ni le goût parfait, ni la mesure. Ses familiarités soudaines se tournaient facilement en une camaraderie impertinente mais qui n'était voulue que par gène et manque d'usage. Il se retenait le pre-
mier jour, mais il débordaitau second. C'était très bien un homme à pousser ce compliment « Mais, Madame,
vous n'êtes pas si sotte que M. X. m'avait dit." Il a de ces mots qui vous laissent coi. Bref, il avait l'art d'interloquer les gens par des façons particu- lières.
On appelle quelquefois cela avoir de l'esprit.
Toute sa barbe, le nez un peu fort, l'œil mobile et pétillant, les cheveux épais et drus marchant tout d'une pièce, ramassé, râblé, un peu solennel et dandinant, parlant facilement, caustique avec de feintes modesties, tranchant et riant, n'ayant qu'une pointe, mais acérée, un hanneton nourri de miel et de verjus.
Enfin plus jeune et ressemblant mieux au portrait sur fond bleu que M. Baudry a fait de lui en t872 ou1873.
M. About se montrait bon enfant, galant et spirituel, bien qu'on sentît qu'il se lâchât un peu trop dans les mots aussi bien que dans les attitudes et toute la personne. Car il n'a ni le goût parfait, ni la mesure. Ses familiarités soudaines se tournaient facilement en une camaraderie impertinente mais qui n'était voulue que par gène et manque d'usage. Il se retenait le pre-
mier jour, mais il débordaitau second. C'était très bien un homme à pousser ce compliment « Mais, Madame,
vous n'êtes pas si sotte que M. X. m'avait dit." Il a de ces mots qui vous laissent coi. Bref, il avait l'art d'interloquer les gens par des façons particu- lières.
On appelle quelquefois cela avoir de l'esprit.
Les années s’écoulent ; la vie distrait et sépare ; nous ne sommes les uns aux autres que des fantômes entrevus qui, en chemin, se perdent, et rarement se retrouvent.
Après l’avoir d’abord rencontré sur le bateau qui nous ramena des Indes, je revis, cependant, lord Hyland à Londres une première et même une seconde fois qui fut la dernière, celle aussi où il me dicta ses dernières pensées.
On me fit cette fois monter dans sa chambre, où je le trouvai alité, sans maladie grave, mais épuisé, si l’on peut ainsi dire, par l’inépuisable effort de son universelle charité. A de longs intervalles il m’avait écrit ou fait dire qu’il ne m’oubliait pas et de ne le point oublier. Il s’était encore rappelé à moi d’une autre façon. Je n’avais pas en effet ouvert un journal depuis dix ans, sans avoir vu son nom en tête de toutes nos listes de souscription. Quel que fût l’esprit des œuvres et pourvu qu’il les crût bonnes, il les soutenait de l’infinité de ses dons.
A son nom, le plus souvent, étaient joints ceux de ses petits-enfans, deux filles ou plutôt deux fillettes, que l’aïeul associait à ses bienfaits. Ce fut d’elles qu’après s’être amicalement informé de moi, ce fut d’elles, des deux têtes blondes qu’il m’entretint tout d’abord et dont, en me les nommant, il me fît admirer les ravissantes miniatures.
Lord Hyland était fort changé d’aspect et de visage ; les joues pâlissantes, les traits, les mains, le corps diminués, les yeux seulement plus limpides, plus clairs que je ne les avais jamais vus.
Il sourit en voyant que je l’examinais, et me demanda si, comme le premier médecin de la Reine, — qui s’entêtait pourtant à le vouloir soigner, — moi aussi j’allais lui dire qu’il vivrait cent ans et, par excès de flatterie, qu’un personnage de son importance ne pouvait mourir?
Après l’avoir d’abord rencontré sur le bateau qui nous ramena des Indes, je revis, cependant, lord Hyland à Londres une première et même une seconde fois qui fut la dernière, celle aussi où il me dicta ses dernières pensées.
On me fit cette fois monter dans sa chambre, où je le trouvai alité, sans maladie grave, mais épuisé, si l’on peut ainsi dire, par l’inépuisable effort de son universelle charité. A de longs intervalles il m’avait écrit ou fait dire qu’il ne m’oubliait pas et de ne le point oublier. Il s’était encore rappelé à moi d’une autre façon. Je n’avais pas en effet ouvert un journal depuis dix ans, sans avoir vu son nom en tête de toutes nos listes de souscription. Quel que fût l’esprit des œuvres et pourvu qu’il les crût bonnes, il les soutenait de l’infinité de ses dons.
A son nom, le plus souvent, étaient joints ceux de ses petits-enfans, deux filles ou plutôt deux fillettes, que l’aïeul associait à ses bienfaits. Ce fut d’elles qu’après s’être amicalement informé de moi, ce fut d’elles, des deux têtes blondes qu’il m’entretint tout d’abord et dont, en me les nommant, il me fît admirer les ravissantes miniatures.
Lord Hyland était fort changé d’aspect et de visage ; les joues pâlissantes, les traits, les mains, le corps diminués, les yeux seulement plus limpides, plus clairs que je ne les avais jamais vus.
Il sourit en voyant que je l’examinais, et me demanda si, comme le premier médecin de la Reine, — qui s’entêtait pourtant à le vouloir soigner, — moi aussi j’allais lui dire qu’il vivrait cent ans et, par excès de flatterie, qu’un personnage de son importance ne pouvait mourir?
Ne tardez pas, quand l’heure heureuse sonne,
Gentils amants. Aimez-vous sans façon.
Le bel Amour n’a besoin de leçon,
Le bel Amour ne consulte personne
Gentils amants. Aimez-vous sans façon.
Le bel Amour n’a besoin de leçon,
Le bel Amour ne consulte personne
Il est des hommes qui gardent le goût du passé et l’amour des choses mortes ; il en est d’autres qui en conservent l’esprit. Les premiers évoquent les temps abolis, ils les font revivre et les restaurent ; les seconds les expriment et en conservent le sens. M. de Bonnières est de ceux-là. Il ne se plaît pas à imaginer le xviie siècle ; mais sa langue et son tour d’idées nous y ramènent. C’est un homme qui aurait écouté avec profit Tallemant des Réaux ; il lui eût donné la réplique avec agrément, et aurait facilement marié ses discours aux siens. Plus tard, il aurait été le compagnon de route de Bachaumont et de Chapelle, mais il les eût conduits aux Indes, et a sans doute regretté de n’y point aller avec eux.
On parle souvent d’un certain esprit français qui serait net, un peu sec, élégant et correct, spirituel et d’une certaine étroitesse, esprit charmant, d’une belle ligne, apparié parfaitement aux jardins que dessina Lenôtre, d’une rectitude et d’une raideur même qui n’est pas sans grâce. M. de Bonnières est assurément dans la tradition de cet esprit et il fait tout pour s’y maintenir
Sa critique est malicieuse, méchante souvent, mais mesurée ; elle tient au goût plus qu’à la force ; en la pratiquant, M. de Bonnières a eu le souci de l’anecdote vivante plutôt que celui des idéologies abstraites. Il n’a pas l’amour de la métaphysique, il la trouve trop brumeuse et trop lointaine ; il a même de l’éloignement pour les idées générales. Aussi, il a peint les hommes dont il parlait et il s’est ingénié à restituer leurs sentiments par leurs gestes, par les actes de leur vie et non par des raisonnements.
Cette préoccupation l’a poursuivi dans ses romans ; ils y ont gagné de la précision et de la sécheresse, mais ils n’y ont pas acquis de profondeur ; ce sont des dessins au trait, mais ils sont privés d’atmosphère. Il en est de même pour ses vers : ils sont classiques et clairs, ils coulent de la source où s’abreuvèrent Boileau, Voltaire et Béranger ; mais cette source n’a jamais été l’Hippocrène.
C’est que M. de Bonnières n’est pas un lyrique ni un imaginaif : c’est un conteur délicat, un essayiste discret, et surtout un bon écrivain. L’éloge n’est point commun.
B. Lazare, dans Figures Contemporaines
On parle souvent d’un certain esprit français qui serait net, un peu sec, élégant et correct, spirituel et d’une certaine étroitesse, esprit charmant, d’une belle ligne, apparié parfaitement aux jardins que dessina Lenôtre, d’une rectitude et d’une raideur même qui n’est pas sans grâce. M. de Bonnières est assurément dans la tradition de cet esprit et il fait tout pour s’y maintenir
Sa critique est malicieuse, méchante souvent, mais mesurée ; elle tient au goût plus qu’à la force ; en la pratiquant, M. de Bonnières a eu le souci de l’anecdote vivante plutôt que celui des idéologies abstraites. Il n’a pas l’amour de la métaphysique, il la trouve trop brumeuse et trop lointaine ; il a même de l’éloignement pour les idées générales. Aussi, il a peint les hommes dont il parlait et il s’est ingénié à restituer leurs sentiments par leurs gestes, par les actes de leur vie et non par des raisonnements.
Cette préoccupation l’a poursuivi dans ses romans ; ils y ont gagné de la précision et de la sécheresse, mais ils n’y ont pas acquis de profondeur ; ce sont des dessins au trait, mais ils sont privés d’atmosphère. Il en est de même pour ses vers : ils sont classiques et clairs, ils coulent de la source où s’abreuvèrent Boileau, Voltaire et Béranger ; mais cette source n’a jamais été l’Hippocrène.
C’est que M. de Bonnières n’est pas un lyrique ni un imaginaif : c’est un conteur délicat, un essayiste discret, et surtout un bon écrivain. L’éloge n’est point commun.
B. Lazare, dans Figures Contemporaines
Le duc de Margemont mariait sa fille au comte de Turdis. C'est dire tout de suite que ces Turdis étaient aussi riches que bien nés; car, si le duc était terrible sur la naissance, il ne l'était pas moins sur l'argent. Si noble que fût son gendre, un bien médiocre lui eût paru fâcheux. Lui- même était fort riche. Il est vrai qu'il était en même temps plus avare qu'il n'est permis, sordide, avec un train minable, et qu'il n'en rougissait pas. Comme, en son genre, il ne manquait ni d'esprit, ni même de cynisme, il disait encore «qu'être avare n'était petit qu'avec une petite fortune, et que la sienne ne l'était pas ».
Quoi qu'il en eût, il avait dû se mettre en frais pour le mariage de sa fille. C'est ainsi qu'il avait donné deux dîners suivis de grandes réceptions, et qu'en ce moment même un lunch attendait les mariés au. Retour de l'archevêché.
Devant le vieil hôtel de la rue Saint-Guillaume, quelques curieux stationnaient, malgré la pluie. Ils plongeaient leurs regards dans la vaste cour au fond de laquelle s'élevait le monument.
Quoi qu'il en eût, il avait dû se mettre en frais pour le mariage de sa fille. C'est ainsi qu'il avait donné deux dîners suivis de grandes réceptions, et qu'en ce moment même un lunch attendait les mariés au. Retour de l'archevêché.
Devant le vieil hôtel de la rue Saint-Guillaume, quelques curieux stationnaient, malgré la pluie. Ils plongeaient leurs regards dans la vaste cour au fond de laquelle s'élevait le monument.
C’est que, voyez-vous, mon cher Bonnières, quoi que l’on puisse penser de son Journal — et je n’en pense pas toujours du bien, et, dans l’avant-dernier volume, par exemple, j’y trouve beaucoup de choses qui me heurtent dans mes idées et ma façon de sentir la vie, et je l’eusse discuté, ce livre, si j’avais été chargé d’en rendre compte —, le cas de M. de Goncourt est assez rare, dans la littérature, et je vous souhaiterais d’en être atteint. Et je souhaiterais aussi, pour la beauté morale de votre profession et de la mienne, que des écrivain illustres, avilis par les caresses du monde et par les agenouillements d’une presse civilisée qui estime les talents au nombre des maisons où ils dînent, puissent montrer une existence aussi noble que celle de M. de Goncourt. Le cas de M. de Goncourt, comme vous dites, c’est le cas d’un homme qui a beaucoup aimé son art, qui en a durement, douloureusement souffert, qui, à travers les injustices, les insultes, et les découragements qu’elles entraînent, a toujours lutté, sans une défaillance. Cette vieillesse solitaire et abandonnée un peu, cette vieillesse, après tant d’orages, tant de déceptions supportées, tant d’amertumes hautement endurées, cette vieillesse toute vibrante encore des ardeurs d’une jeunesse passionnée de Beau, est une des choses qui me sont les plus émouvantes. et je l’ai admirée, cette vieillesse, avec des tressautements au cœur, quand, au Théâtre Libre, affrontant crânement le flot d’ordures dont elle allait être couverte, elle signait de son aristocratique honorabilité ce que, dans La Fille Élisa, il y a de révolte sociale et de pitié humaine
Octave Mirbeau, l’Echo de Paris, 17 mars 1891
Octave Mirbeau, l’Echo de Paris, 17 mars 1891
COMMENT LA FÉE ARBIANNE AVAIT DEUX AMANTS
La Fée Arbianne avait deux talismans :
Un Casque d’or qui rendait invisible,
Et, d’autre part, une Épée invincible.
Arbianne avait de même deux amants.
Si je l’en blâme, au moins que l’on m’accorde,
Au lieu d’aller se creuser le cerveau,
Qu’en avoir trois chez nous n’est pas nouveau,
Et qu’aux beaux luths, il n’est point qu’une corde.
Son choix ne fut ni bas ni hasardeux :
Tous deux étaient fils de Roi, dit le conte.
Elle donna l’Épée à l’un pour compte,
Le Casque à l’autre, et les aima tous deux.
— De garde au pied de sa tour d’émeraude,
L’un de l’Épée allait tout pourfendant,
Monstre, dragon, harpie et prétendant,
Et la gardait, en se gardant de fraude.
L’autre invisible allait surprendre ainsi
La Fée à point en son bain d’eau de rose,
Et, comme on dit, ce ne fut point en prose
Qu’il lui conta son amoureux souci.
La Fée Arbianne avait deux talismans :
Un Casque d’or qui rendait invisible,
Et, d’autre part, une Épée invincible.
Arbianne avait de même deux amants.
Si je l’en blâme, au moins que l’on m’accorde,
Au lieu d’aller se creuser le cerveau,
Qu’en avoir trois chez nous n’est pas nouveau,
Et qu’aux beaux luths, il n’est point qu’une corde.
Son choix ne fut ni bas ni hasardeux :
Tous deux étaient fils de Roi, dit le conte.
Elle donna l’Épée à l’un pour compte,
Le Casque à l’autre, et les aima tous deux.
— De garde au pied de sa tour d’émeraude,
L’un de l’Épée allait tout pourfendant,
Monstre, dragon, harpie et prétendant,
Et la gardait, en se gardant de fraude.
L’autre invisible allait surprendre ainsi
La Fée à point en son bain d’eau de rose,
Et, comme on dit, ce ne fut point en prose
Qu’il lui conta son amoureux souci.
J'ai, par les récits particuliers des témoins oculaires, restitué exactement un tableau anecdotique de ces trois journées. J'ai rétabli historiquement l'aspect des rues, l'état moyen des esprits, les propos échangés.
J'ai voulu redonner ta vie et le mouvement à ces trois journées, à ces Trois Glorieuses, dont les hasards seraient ridicules, s'il n'y avait eu quelques gens tués, et si ta chute de Charles X n'avait amené un nouvel ordre de choses.
Le lundi matin 26 juillet, les ordonnances parurent au Moniteur.
Le même jour, quarante et un journalistes signaient, rue Vivienne, dans les bureaux du National, une protestation que M. Thiers rédigea.
La voici « Le régime légal est interrompu, celui de la force est commencé. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont tes écrivains des journaux. Ils doivent donner les premiers l'exemple de la résistance à l'autorité, qui s'est dépouillée du caractère de la Ioi etc. »
M. Thiers a été payé pour savoir mieux qu'aucun autre que le droit donné aux citoyens de prendre les armes quand ils le trouvent bon, est tout de même un droit dangereux.
Les cabinets de lecture sont assiégés. Les citoyens apprennent, en lisant le National, qu'ils vont faire une révolution.
Les ouvriers qui avaient mangé leur paye du samedi au lundi prennent le vent, se mettent en bras de chemise et partent en gesticulant. Les rentiers se promènent dans les contre-allées des boulevards, d'un air entendu et agité.
J'ai voulu redonner ta vie et le mouvement à ces trois journées, à ces Trois Glorieuses, dont les hasards seraient ridicules, s'il n'y avait eu quelques gens tués, et si ta chute de Charles X n'avait amené un nouvel ordre de choses.
Le lundi matin 26 juillet, les ordonnances parurent au Moniteur.
Le même jour, quarante et un journalistes signaient, rue Vivienne, dans les bureaux du National, une protestation que M. Thiers rédigea.
La voici « Le régime légal est interrompu, celui de la force est commencé. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont tes écrivains des journaux. Ils doivent donner les premiers l'exemple de la résistance à l'autorité, qui s'est dépouillée du caractère de la Ioi etc. »
M. Thiers a été payé pour savoir mieux qu'aucun autre que le droit donné aux citoyens de prendre les armes quand ils le trouvent bon, est tout de même un droit dangereux.
Les cabinets de lecture sont assiégés. Les citoyens apprennent, en lisant le National, qu'ils vont faire une révolution.
Les ouvriers qui avaient mangé leur paye du samedi au lundi prennent le vent, se mettent en bras de chemise et partent en gesticulant. Les rentiers se promènent dans les contre-allées des boulevards, d'un air entendu et agité.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Lecteurs de Robert de Bonnières (3)Voir plus
Quiz
Voir plus
Gardiens des cités perdues
Dex:Quel est le pouvoir de la mère de Dex?
Télépathe
Pyrokinésiste
Givreuse
Phaseuse
8 questions
2 lecteurs ont répondu
Thème :
Shannon MessengerCréer un quiz sur cet auteur2 lecteurs ont répondu