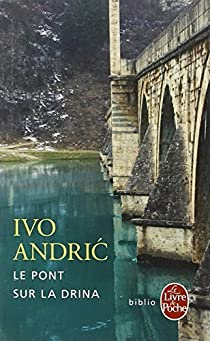>
Critique de oblo
Il est certains monuments qui, non contents d'assister aux destinées parfois funestes des hommes, participent eux-mêmes à cette grande aventure du Temps qu'est L Histoire. C'est le cas du pont sur la Drina, aujourd'hui appelé pont Mehmed Pacha Sokolovic, du nom de son bienfaiteur et créateur. Un pont né dans la douleur : l'arrachement du futur grand vizir à sa famille, les travaux transformés en corvées gratuites, le supplice du pal infligé à un saboteur (épisode si marquant qu'il occulte presque, à lui seul, le reste du livre). le pont, pourtant, est un lien indispensable entre les rives d'une rivière qui, bien plus, sépare à la fois la Bosnie et la Serbie mais aussi Visegrad, enclavée dans les Balkans, de la capitale de l'empire (Istanbul puis Vienne), mais encore des populations locales déjà distinctes, entre elles, entre Serbes et Bosniaques (c'est-à-dire musulmans de Bosnie).
Le pont, édifice majestueux, est partie intégrante du paysage. Immuable, comme les montagnes, sa beauté égale au moins celle de la rivière Drina, impétueuse onde d'émeraude. Il est un lieu de vie puisque, sur sa kapia (l'endroit central du pont où sont aménagées des terrasses), se donnent rendez-vous les jeunes gens de la ville, est bu le café, sont piquées les têtes des rebelles supposés. de part et d'autre du pont se trouve la ville, les villages des collines et la petite histoire, les pays et les idéologies de la grande histoire. Depuis la fondation au seizième siècle jusqu'au bombardement du pont en 1914 apparaît alors, comme dans un recueil de nouvelles, une multitude de récits qui témoignent, chacun, d'une époque et de la société si particulière de cet endroit d'Europe. Étrangement, on a l'impression que les années passent mais que la société reste. Une société divisée traditionnellement entre Serbes orthodoxes et Bosniaques musulmans, auxquels s'ajoutent les Tziganes et les Juifs (originaires d'Espagne puis, au 19ème siècle, d'Europe centrale), puis les fonctionnaires impériaux austro-hongrois venant qui d'Autriche, qui de Hongrie, qui de Galicie. Chronique d'un pays occupé, le pont sur la Drina évoque les divisions structurelles d'une petite ville, vue comme un échantillon de la Bosnie toute entière, capable pourtant de s'unir contre les projets de l'occupant, qu'il soit turc ou autrichien (ainsi lors du recensement opéré par les Autrichiens mais aussi, dès le début du livre, contre la construction du pont).
Les histoires se mêlent étroitement aux légendes : la femme aux enfants mort-nés qui erre dans les rues et dont on fera la mère malheureuse de jumeaux emmurés dans les piles du pont ; un jeune borgne, cible des moqueries et de la cruauté de ceux qui se prétendent ses amis et qui conquiert le respect par un exploit dangereux ; la tenancière d'une hostellerie, tenant à bout de bras les destinées de sa famille et de son établissement et qui, épuisée, verra le centre de sa vie pulvérisé par le grand tourment de la guerre. On retiendra aussi l'histoire d'Ali Hodja, descendant de la vieille famille des Mutevelic, homme de la raison se dressant contre toutes les absurdités, s'insurgeant contre la modernité (celle du chemin de fer, notamment, dont l'arrivée casse les habitudes séculaires, ouvre Visegrad au monde et, par là-même, marginalise un pont relégué au rang d'utilité locale), dont l'opiniâtreté lui vaudra bien des malheurs.
Le pont devient le témoin de l'histoire, le témoin aussi de l'animosité des hommes, qui sourde sous l'autorité intransigeante des empires et éclate au grand jour quand la guerre reparaît. Ainsi au moment de la guerre balkanique puis lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, les populations serbes et musulmanes, vivant pourtant ensemble et en bonne intelligence depuis des siècles, ayant traversé ensemble les mêmes difficultés (comme les crues de la Drina), se divisent pourtant comme deux entités ennemies, n'attendant que l'autorisation officielle pour se lancer à la chasse à l'Autre.
Évidemment, les pages d'Ivo Andric résonnent tristement à notre mémoire, augurant des sombres événements des années 1990 dont les répercussions sont toujours actuelles. Y voir une prophétie serait pourtant exagéré, tant Andric incarnait le rêve yougoslave d'une union indéfectible, lui le Serbe né de parents croates en Bosnie, lui qui préféra agir – et donc écrire – plutôt que de se montrer, lui à qui l'on décerna en 1961 le prix Nobel de Littérature, seize ans après la parution d'Un pont sur la Drina, jetant la lumière sur un territoire littéraire qui demeure encore aujourd'hui mal connu. Les derniers mots d'Ali Hodja portent pourtant en eux un espoir : celui d'un monde guidé toujours par la beauté et la vision de grands hommes, le tout sous le patronage étroit d'une divinité dont on se dispute, en Serbie ou en Bosnie, le véritable nom.
Le pont, édifice majestueux, est partie intégrante du paysage. Immuable, comme les montagnes, sa beauté égale au moins celle de la rivière Drina, impétueuse onde d'émeraude. Il est un lieu de vie puisque, sur sa kapia (l'endroit central du pont où sont aménagées des terrasses), se donnent rendez-vous les jeunes gens de la ville, est bu le café, sont piquées les têtes des rebelles supposés. de part et d'autre du pont se trouve la ville, les villages des collines et la petite histoire, les pays et les idéologies de la grande histoire. Depuis la fondation au seizième siècle jusqu'au bombardement du pont en 1914 apparaît alors, comme dans un recueil de nouvelles, une multitude de récits qui témoignent, chacun, d'une époque et de la société si particulière de cet endroit d'Europe. Étrangement, on a l'impression que les années passent mais que la société reste. Une société divisée traditionnellement entre Serbes orthodoxes et Bosniaques musulmans, auxquels s'ajoutent les Tziganes et les Juifs (originaires d'Espagne puis, au 19ème siècle, d'Europe centrale), puis les fonctionnaires impériaux austro-hongrois venant qui d'Autriche, qui de Hongrie, qui de Galicie. Chronique d'un pays occupé, le pont sur la Drina évoque les divisions structurelles d'une petite ville, vue comme un échantillon de la Bosnie toute entière, capable pourtant de s'unir contre les projets de l'occupant, qu'il soit turc ou autrichien (ainsi lors du recensement opéré par les Autrichiens mais aussi, dès le début du livre, contre la construction du pont).
Les histoires se mêlent étroitement aux légendes : la femme aux enfants mort-nés qui erre dans les rues et dont on fera la mère malheureuse de jumeaux emmurés dans les piles du pont ; un jeune borgne, cible des moqueries et de la cruauté de ceux qui se prétendent ses amis et qui conquiert le respect par un exploit dangereux ; la tenancière d'une hostellerie, tenant à bout de bras les destinées de sa famille et de son établissement et qui, épuisée, verra le centre de sa vie pulvérisé par le grand tourment de la guerre. On retiendra aussi l'histoire d'Ali Hodja, descendant de la vieille famille des Mutevelic, homme de la raison se dressant contre toutes les absurdités, s'insurgeant contre la modernité (celle du chemin de fer, notamment, dont l'arrivée casse les habitudes séculaires, ouvre Visegrad au monde et, par là-même, marginalise un pont relégué au rang d'utilité locale), dont l'opiniâtreté lui vaudra bien des malheurs.
Le pont devient le témoin de l'histoire, le témoin aussi de l'animosité des hommes, qui sourde sous l'autorité intransigeante des empires et éclate au grand jour quand la guerre reparaît. Ainsi au moment de la guerre balkanique puis lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, les populations serbes et musulmanes, vivant pourtant ensemble et en bonne intelligence depuis des siècles, ayant traversé ensemble les mêmes difficultés (comme les crues de la Drina), se divisent pourtant comme deux entités ennemies, n'attendant que l'autorisation officielle pour se lancer à la chasse à l'Autre.
Évidemment, les pages d'Ivo Andric résonnent tristement à notre mémoire, augurant des sombres événements des années 1990 dont les répercussions sont toujours actuelles. Y voir une prophétie serait pourtant exagéré, tant Andric incarnait le rêve yougoslave d'une union indéfectible, lui le Serbe né de parents croates en Bosnie, lui qui préféra agir – et donc écrire – plutôt que de se montrer, lui à qui l'on décerna en 1961 le prix Nobel de Littérature, seize ans après la parution d'Un pont sur la Drina, jetant la lumière sur un territoire littéraire qui demeure encore aujourd'hui mal connu. Les derniers mots d'Ali Hodja portent pourtant en eux un espoir : celui d'un monde guidé toujours par la beauté et la vision de grands hommes, le tout sous le patronage étroit d'une divinité dont on se dispute, en Serbie ou en Bosnie, le véritable nom.