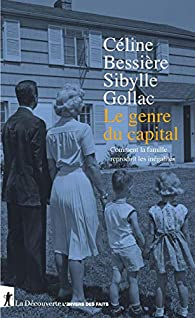Citations sur Le genre du capital (34)
A partir d'un certain niveau de fortune, la richesse est caractérisée par sa complexité. Cette complexité ne doit rien au hasard. Elle est produíte par l'activité d'un ensemble de professionnel-les du droít et des finances - gestionnaires de fortune, conseillers patrimoniaux, experts-comptables, notaires, avocat-es fiscalistes, etc. quí «travaillent et font travailler le capital », Un des objectifs principaux de ces gardien-nes de la fortune est de protéger la richesse de l'intrusion de l'administration fiscale. La production de complexité est une stratégie habituelle de production de l'ignorance des industries toxiques. Ce concept a été développé en histoire des sciences dans l'analyse de I'industrie du tabac pour casser l'opposition entre connaissance active et ignorance passive, en mettant l'accent sur l'activité nécessaire à la production de l'ignorance. C'est aussi la stratégie des professionnel les de la gestion des grandes fortunes. Le travail du capital produit I'ignorance de l'administration fiscale et, chemin faisant, des soeurs et des conjointes, grâce à des montages financiers et sociétaires complexes: holdings, sociétés imbriquées les unes dans les autres, etc.
Pour les hommes et femmes des classes moyennes et supérieures qui paient I'impôt sur le revenu, la fiscalisation des pensions alimentaires n'est donc pas neutre du point de vue de l'inégalité économique de genre. Les femmes séparées doivent déclarer des pensions au titre de leurs revenus et payer des impôts dessus, alors que les hommes débiteurs les déduisent au contraire de leurs revenus imposables. La raison d'être de cette fiscalité est mystérieuse : pourquoi un père séparé déduirait-il de ses impôts sur les revenus sa contribution à l'entretien (alimen- tation, logement, autres frais) de ses enfants, alors que ce n'est pas le cas des parents qui vivent avec leurs enfants ?
Dans d'autres pays occidentaux, des choix différents ont été faits, méconnus en France. Au Canada, les pensions alimentaires ne sont plus imposables pour la créditrice ni déductibles pour le débiteur depuis les années 1990, au nom de l'égalité économique entre les sexes mais aussi de la préservation des finances publiques. En raison de la progressivité de l'impôt et des inégalités de revenus entre hommes et femmes (les débiteurs de pensions alimentaires sont généralement plus riches que les créancières), le Québec a ainsi réalisé 75 millions de dollars de recettes fiscales supplémentaires en 1995. En France, cette neutralité fiscale des pensions alimentaires n'a jamais été envisagée.
Dans d'autres pays occidentaux, des choix différents ont été faits, méconnus en France. Au Canada, les pensions alimentaires ne sont plus imposables pour la créditrice ni déductibles pour le débiteur depuis les années 1990, au nom de l'égalité économique entre les sexes mais aussi de la préservation des finances publiques. En raison de la progressivité de l'impôt et des inégalités de revenus entre hommes et femmes (les débiteurs de pensions alimentaires sont généralement plus riches que les créancières), le Québec a ainsi réalisé 75 millions de dollars de recettes fiscales supplémentaires en 1995. En France, cette neutralité fiscale des pensions alimentaires n'a jamais été envisagée.
Est-ce que les professions libérales du droit que nous avons suivies dans ce chapitre cherchent consciemment à favoriser les hommes par rapport aux femmes ? La question de l'intentionnalité n'est sans doute pas la bonne. La comptabilité inversée est une logique de la pratique au sens de Pierre Bourdieu, c'est-à-dire un système incorporé de dispositions qui, sans l'organisation d'une intention, est néanmoins capable d'orienter les pratiques d'une façon qui est à la fois inconsciente et systématique". Des représentations genrées de l'ordre social sont charriées au travers de ces comptabilités, notamment autour de la définition d'un bon héritier ou d'un bon chef d'entreprise, d'une veuve raisonnable ou d'une bonne mère, des biens qui doivent être transmis dans a ignée ou qui peuvent être transférés à une conjointe. Les transferts économiques entre personnes apparentées sont empreints d'impensés sexistes, incorporés dans les manières même de compter des notaires et des avocat-es et, de ce fait, dissimulés et légitimes par le droit. Si les avocat-es et les notaires calculent de cette façon, c'est avant tout parce qu'ils cherchent le production d'un consensus dans les rapports familiaux.
La subordination patronymique des femmes mariées et la transmission du nom de père en fils ne sont pas ou plus inscrites dans le droit et, pourtant, elles se maintiennent dans les pratiques. Ceci n'a rien d'anodin. Contrairement aux femmes, les hommes possèdent un bien symbolique – leur nom de famille - qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants et imposer à leur conjointe, comme pour marquer leur place prépondérante dans les stratégies familiales de reproduction. A la génération suivante, les fils héritent d'un nom stable, transmissible - dans certaines sociétés paysannes, on les qualifie de ce fait de « sauve-race » -, alors que ni les mères ni les filles ne possèdent ce bien symbolique. Cette inégalité fondamentale, que le droit ne parvient pas à résorber, se retrouve dans les mécanismes d'appropriation et de transmission des biens matériels.
Non seulement le principe de l'héritage n'a pas disparu, mais il est redevenu central dans la dynamique des sociétés capitalistes contemporaines. Ce retour de l'héritage est aussi un retour de l'institution familiale comme acteur clé de l'économie, qui contribue à produire des inégalités socio- économiques fortes et à renforcer les frontières de classes, mais aussi de races.
Une nouvelle génération d'économistes, Thomas Piketty en tête, a remis sur le devant de la scène le patrimoine et l'héritage dans la compréhension des mécanismes inégalitaires du capitalisme contemporain. L'inégalité patrimoniale, dont tout le monde pensait qu'elle était vouée à se réduire avec l'essor de la société salariale au XXe siècle, est repartie à la hausse depuis trois décennies. En 2014, en France, les 10 % des individus les plus riches détiennent environ 55 % de la richesse nationale, tandis que la moitié de la population n'en détient que 5 %2.
Il existe deux façons différentes de se constituer un patrimoine : mettre de l'argent de côté ou hériter. Alors que, dans les années 1950-1960, I'héritage constituait moins de la moitié du patrimoine privé détenu par les individus en France, cette part n'a cessé d'augmenter pour redevenir majoritaire et représenter 60 % du patrimoine total en 2010. Certes, on est encore loin du niveau des années 1910 où les patrimoines hérités représentaient 80 % du patrimoine privé total, mais, si les tendances économiques et démographiques se poursuivent, la part de la richesse héritée devrait continuer à croître au cours du XXIe siècle.
Il existe deux façons différentes de se constituer un patrimoine : mettre de l'argent de côté ou hériter. Alors que, dans les années 1950-1960, I'héritage constituait moins de la moitié du patrimoine privé détenu par les individus en France, cette part n'a cessé d'augmenter pour redevenir majoritaire et représenter 60 % du patrimoine total en 2010. Certes, on est encore loin du niveau des années 1910 où les patrimoines hérités représentaient 80 % du patrimoine privé total, mais, si les tendances économiques et démographiques se poursuivent, la part de la richesse héritée devrait continuer à croître au cours du XXIe siècle.
Si, avec Pierre Bourdieu, on entend par capital un ensemble de ressources accumulées dont on peut tirer des profits sociaux, le constat que dresse ce livre est alors le suivant : tandis que le travail féminin participe activement à la production et à la reproduction de la richesse des familles, le capital au XXIe siècle reste résolument masculin.
b. Nous nous appuyons ici sur la définition de Thomas PIKETTY dans Le Capital au XXe siècle, op. cit., p. 82-89. Contrairement aux définitions marxistes classiques, Pikerty ne réserve pas la notion de capital aux éléments de patrimoine directement utilisés dans le processus de production ou dont les propriétaires attendent un rendement. Il inclut dans sa définition du capital les terres et les ressources naturelles sur lesquelles il est passible d'exercer un droit de proprieté. le parimoine comme réserve de valeur (par exemple, l'or) ou à usage de jouissance (par exemple, l'immobilier d'habitation). Sa définition du capital est donc un synonyme des définitions contemporaines de la science économique du parimoine et de la richese.
Pourquoi les femmes sont-elles en première ligne pour affronter les problèmes d'argent dans les classes populaires, tandis qu'au fur et à mesure que l'on grimpe dans la hiérarchie sociale, le pouvoir économique est accaparé par les hommes ? Historiquement, des discriminations juridiques ont empéché les femmes d'accumuler de la richesse, partout dans le monde. Dans les sociétés occidentales, l'égalité en matière de droit du travail, de droit de la famille et de droit de propriété est une conquète des XIXe et XXe siècles qui paraît désormais acquise. Pourtant, en dépit de ce droit formellement égalitaire, les hommes continuent à accumuler davantage de richesses que les femmes.
Mais, si pauvreté et richesse naissent des rapports de production, comme nous l'a appris Marx, elles ne se constituent pas uniquement dans la sphère marchande : c'est aussi dans la famille, dans les rapports de production domestique, que se jouent I'accumulation et la transmission des richesses, et donc le maintien des frontières entre les classes sociales. Christine Delphy a bien montré comment, dans les années 1960, le patrimoine familial s'est accumulé et transmis grace à l'exploitation du travail gratuit des femmes, dont les droits sur ce patrimoine étaient extrêmement réduits: la hiérarchie sociale se reproduit aux dépens des femmes. Qu'en est-il aujourd'hui dans une société majoritairement salariée, dans laquelle les droits des époux et des épouses, et plus généralement des hommes et des femmes, se sont peu à peu égalisés ?
Les Dernières Actualités
Voir plus

Bibliothèque féministe
msdk
68 livres

Florilège féministe
Mathildelalibraire
200 livres

Sociologie
LillyDeira
200 livres
Autres livres de Céline Bessière (1)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philosophes au cinéma
Ce film réalisé par Derek Jarman en 1993 retrace la vie d'un philosophe autrichien né à Vienne en 1889 et mort à Cambridge en 1951. Quel est son nom?
Ludwig Wittgenstein
Stephen Zweig
Martin Heidegger
8 questions
160 lecteurs ont répondu
Thèmes :
philosophie
, philosophes
, sociologie
, culture générale
, cinema
, adapté au cinéma
, adaptation
, littératureCréer un quiz sur ce livre160 lecteurs ont répondu