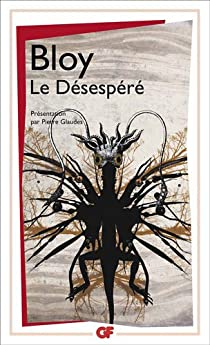>
Critique de HenryWar
Elle est défunte à présent, hélas ! puisque rejetée du si pacifiant et bêtifiant lecteur qui l'a bannie, cette littérature de la truculence où la verve artiste rencontra la fulmination ! Comme dorénavant le cumul des sous au tableau des ventes suffit à attester la gloire et puisque le succès public se confond exactement avec la valeur critique, on n'a d'égard que pour la réussite et on méprise le génie, qu'on suppose une antique ampoule élitiste !
Or, agonir d'insurrection contre la médiocrité qui fait la fortune d'idiots et le bonheur des foules ne peut être logiquement que l'entreprise acharnée d'un individu ayant, malgré un talent qu'il sait indéniable, manqué à se faire reconnaître parmi les meilleurs de son temps : on devine sa frustration à voir parvenus avant lui tant d'ineptes partisans du consensuel qui, de vanité ou d'humilité, se pavanent d'importance, et le simple se figurera toujours alors que la frustration est mauvaise conseillère, confinant à la rancune qu'il croit par définition pousser à l'injustice. C'est qu'il ignore, l'imbécile, qu'en art le mérite n'est plus couronné chez nous depuis longtemps, lui qui se contente à peu près – et qui l'avouerait lui-même – du premier livre venu dans son genre de prédilection.
Pourtant, je l'assure, on peut hurler saintement. Il y a des cris hauts de répurgateurs jusque dans l'élan de certains glaives.
La fureur de l'innocente victime a des éclairs de vérité réjouissants pour celui qui ne se contente pas de trier automatiquement les « bons » et les « méchants » affects. Il arrive qu'un éreintement soit légitime, y compris quand il se mêle de bile si la situation qu'il dénonce est elle-même nauséeuse et pestilente. Ou bien il faudrait seulement des insurrections policées, avec demande de rendez-vous et prières réitérées. Pas sûr qu'un scandale puisse naître d'une poignée de mains ou d'une formule de politesse, sans parler d'une révolution lorsque c'est tout un système qui est en cause. Critiquer poliment, c'est améliorer ; injurier avec intransigeance, c'est améliorer instamment. Il y a de l'engagement personnel à éructer, il y faut de l'individu qui se collette : celui qui chante son adorable élégie peut bien rester perché, c'est un être charmant qui n'est entendu que des délicates créatures immobiles à l'ombre de son arbre.
Léon Bloy fut, je crois, un de ces vomisseurs divins. Les parias de talent sont toujours des monstres radieux.
Le Désespéré est le récit largement autobiographique de son double, Marie-Joseph-Caïn Marchenoir, un écrivain chrétien radical et pamphlétaire qui abomine de son époque tous l'art de pacotille et les artistes clinquants et ridicules qui l'ont conspué et réduit à la misère. L'auteur y retrace avec une haine délectable les épisodes d'extrême dénuement, sa réclusion à la Grande-Chartreuse, son mystique amour avec une ancienne prostituée devenue hallucinée de Dieu, ainsi que ses tentatives dérisoires pour publier les ors ténébreux de son style et de son esprit dans un monde de journalistes abjects et puants. D'une absoluité sans compromis, il arpente un monde nauséabond de vicieux profiteurs dont il réussit à faire jaillir sur lui l'unanime haine, incapable des moindres mondanités qui suffiraient à le faire bien recevoir.
Bloy dissimule à peine les noms : tous les grands acteurs littéraires de son temps sont éclaboussés d'infamies ou de calomnies. C'est un défoulement ricanatoire qui, dans sa manière désenchantée et scandaleuse, annihilant presque les contraintes d'une intrigue et diluant le récit dans des vociférations, incombe particulièrement à ce genre fin-de-siècle qui brise les tabous et pousse très haut les rires destructeurs. On croit voir s'écouler continûment une pluie poisseuse sur un Paris d'êtres humanoïdes et infirmes auxquels l'humanité manque par nature. Un suint purulent sape d'emblée toute ambition généreuse, et il n'y a qu'à dépeindre méticuleusement la sanie ambiante que sécrète une société enferrée de vacuité en attendant le retour du Sauveur qui viendra à la parfin tout assainir.
Il est des conversions religieuses qui sont des désirs d'en finir. Bloy ne supporte plus la lénifiante tolérance des préceptes catholiques d'alors qu'il estime une trahison de l'Esprit saint dont il croit ne rencontrer la pureté qu'aux fermes rudesses du Moyen-Âge. Sa foi ne va pas dans la rose des luxes et des oraisons bourgeois ; il n'accommode rien, n'a pas le sens du compromis. Il prétend que le Jésus qu'on vénère ferait honte à Dieu Lui-même : que l'homme contemporain a fait le Christ à son odieuse image, à cause des mensonges des prêtres indulgents et plaisants et de la naïveté opportune des croyants que les premiers pardonnent et absolvent à leur honte.
Désespérer en l'homme, comme probablement le fit Huysmans, fut parfois le chemin de la foi chrétienne : de la solitude de l'artiste ignoré du monde à celle du cénobite oublié du siècle, il n'y a qu'un pas : on quitte la misère d'un logis pour gagner la froideur spartiate d'une cellule. La mentalité déjà ciselée et argutieuse, longtemps sertie d'une complexe exégèse, le spagyrique ésotérisme du chercheur es arts, n'a besoin de s'accroître que du mystère de l'Incarnation qui est en comparaison une idée toute simple et dont l'assomption est alors de peu de conséquence : c'est environ une métaphore supplémentaire qui vaut une belle page de littérature. La parousie, au surplus, achève joliment la ferveur en concrétude : la désolation dégoûtée va quelque part et se rehausse d'un fantasme ou d'un rêve. On cherche en vain un soutien tangible, alors on élit un témoin idéal, une autorité et un vengeur. le christianisme ainsi est quelquefois la doctrine refuge d'un inconsolable exilé contempteur des hommes.
Méchant, diabolique, délibérément cruel, ce livre de tous les éreintements épouvantables et orduriers composé dans un style magnifiquement sophistiqué et byzantin : une incrustation d'argent sur un pot en merde cuite, un damasquinage au scalpel sur un corps de cadavre, une orfèvrerie d'injures rares pour d'inattentives oreilles de pourceaux. le mélange apparemment antinomique de l'exécration outrageuse et de la diaphane volonté de redresser la déchéance – non sans antisémitisme forcené. Une fleur du mal, orchidée de l'excrément – sorte de scatologie eschatologique –, et qui force le lecteur à un brillant effort, mais nullement par goût des impatiences et des chinoiseries (rien n'y est volontiers obscur ou alambiqué, ce n'est pas un roman fait pour dissuader ou pédant), mais pour atteindre à l'exactitude du trait et à l'unicité de la peinture, caractéristiques essentielles de toute littérature – on ne lit pas Bloy comme on avale, il y faut du courage et du soin, un peu d'étude en somme, du mérite. On accède à quelque chose d'individuel, à un parachèvement, à un ouvrage. On peut évidemment ne pas adhérer, on ne saurait avec expertise et honnêteté dénigrer la superbe de la forme.
Pour le fond narratif, soit : il n'y a presque rien. Mais aussi, c'est si tristement banal en littérature ! Reste qu'on a toujours accédé à quelque idéal d'artiste, ce qui ne se distingue plus nulle part. Un très beau vide vaut mieux qu'un vide médiocre : on voit au moins quelque rayon pur que nul objet contrefait ne vient gâcher ; c'est – qui sait ? – peut-être le prodrome d'une merveille si la lumière quintessenciée tombe bientôt sur un motif nouveau et valeureux. Un être derrière une encre noire est préférable à une histoire devant personne. En l'occurrence, le livre est l'assemblage d'un roman en quelque sorte naturaliste – carrière, amours et piété indigentes –, d'une monographie passionnée (guère passionnante pour moi) sur la Grande-Chartreuse, de nombreux portraits défoulés des plus célèbres acteurs littéraires d'une époque, et d'articles enflammés (recyclés de journaux divers) par exemple sur la religion et sur le Riche : tout cela ne tient ensemble que par l'éloquence d'un auteur.
On discerne un caractère de grand bretteur en sous-nombre qui, pourtant défait d'avance, ne se résout pas à la plainte. Des assauts sans cesse pour dissimuler sous les suées les larmes de dépit légitime : une victime qui ne consent pas à crever sans bruyants et féroces anathèmes sous l'élégant talon dont on l'écrase. Si Victor Hugo c'est de la grandiloquence qui a réussi, Léon Bloy est un échec qui a poussé à la grandiloquence. Hugo se hausse et se rengorge parce qu'il a gagné, Bloy se dresse et plastronne parce qu'on le veut perdant. Mais à quoi tient le succès ? Hugo flatte et Bloy fustige, voilà : la différence, c'est la vérité de la peinture, sa fidélité par rapport à l'original ; des allégories ou des contemporains. Présentez un seul homme en deux circonstances de fortune : comme le premier est un triomphe populaire, il se plaît à rendre à la foule qu'il juge d'un goût merveilleux cet amour dont il est acclamé ; comme le second est un échec patent, il se satisfait à haïr ces badauds qu'il estime de déplorables amateurs. C'est le même homme, vous dis-je, exactement le même homme : le premier est bientôt riche et peut écrire beaucoup tandis que le second crève de faim et doit accomplir trois emplois pour acheter son papier. Qui a raison ? C'est pourtant aussi le même public qui permet à l'un de se dégager en héros et à l'autre de sombrer dans le dégoût ; seulement, selon qu'on flatte cette somme ou bien qu'on la corrige…
J'ai ma réponse. Discerner mal, faire d'un même homme une icône ou un gredin, c'est ne pas discerner : entiers hasards dont se satisfont quand même les caudataires et thuriféraires des nouveaux dieux : ne voit-on pas, après l'office, comme les rejetés se révoltent et bavent ! Ce n'est certes pas un Hugo, croit-on, qui aurait ainsi indigné son langage dans l'égout de la rancune !
Qui sait ? peut-être Hugo aurait-il écrit bien pire encore : il ne doit sa posture supérieure de représentant du peuple qu'à l'encouragement qu'il reçut à ses débuts ; il bénéficia en tous cas d'un bon lançage dont Bloy ne put se prévaloir, et ses ambitions initiales étaient aussi mille fois plus impérieuses, de sorte qu'un échec lui eût peut-être été d'une violence inouïe. Ce n'est pas pour médire Hugo, mais pour relativiser la fondation et la représentation des idoles en un cas où le talent fut à peu près égal. Cette observation, je crois, d'une nature psychologique autant que sociale, focalise sur notre inaptitude collective à récompenser l'art et le mérite : je pense que ce vice rencontra à la fin du XIXe siècle un sommet d'ingratitude qui produisit cette tonalité littéraire si particulière qu'on doit à une société dont le paradoxe consiste en l'extrême raffinement de ses artistes confronté à l'indifférence générale des citoyens devenus sans souci et inconséquents. L'apogée d'un harassant effort individuel rencontrant la bêtise du troupeau satisfait, le tout avalisé par un système politique peu concerné de justice et de grandeur et qui offre au capital toute la place pour couronner des vendeurs, c'est l'avant-scène où tout se réalise aujourd'hui en un immense relâchement des exigences artistiques : j'en reparlerai bientôt, je crois, pour montrer généalogiquement comment et pourquoi notre littérature a manifestement déchu depuis ce temps au point qu'un bon écrivain d'aujourd'hui ne vaut sans doute pas un mauvais journaliste d'il y a cent cinquante ans. Mais la clé d'ores et déjà est à chercher à la fois dans l'extrême contention d'un style qu'on ne sut plus tout à coup comment dépasser, et dans le renoncement à vouloir gagner les lauriers par le mérite tandis qu'on apprit à les obtenir par d'autres moyens, le travail ne servant pas de grand-chose en un milieu uniquement de réclame, de pistons et de suaves complaisances populaires.
Or, agonir d'insurrection contre la médiocrité qui fait la fortune d'idiots et le bonheur des foules ne peut être logiquement que l'entreprise acharnée d'un individu ayant, malgré un talent qu'il sait indéniable, manqué à se faire reconnaître parmi les meilleurs de son temps : on devine sa frustration à voir parvenus avant lui tant d'ineptes partisans du consensuel qui, de vanité ou d'humilité, se pavanent d'importance, et le simple se figurera toujours alors que la frustration est mauvaise conseillère, confinant à la rancune qu'il croit par définition pousser à l'injustice. C'est qu'il ignore, l'imbécile, qu'en art le mérite n'est plus couronné chez nous depuis longtemps, lui qui se contente à peu près – et qui l'avouerait lui-même – du premier livre venu dans son genre de prédilection.
Pourtant, je l'assure, on peut hurler saintement. Il y a des cris hauts de répurgateurs jusque dans l'élan de certains glaives.
La fureur de l'innocente victime a des éclairs de vérité réjouissants pour celui qui ne se contente pas de trier automatiquement les « bons » et les « méchants » affects. Il arrive qu'un éreintement soit légitime, y compris quand il se mêle de bile si la situation qu'il dénonce est elle-même nauséeuse et pestilente. Ou bien il faudrait seulement des insurrections policées, avec demande de rendez-vous et prières réitérées. Pas sûr qu'un scandale puisse naître d'une poignée de mains ou d'une formule de politesse, sans parler d'une révolution lorsque c'est tout un système qui est en cause. Critiquer poliment, c'est améliorer ; injurier avec intransigeance, c'est améliorer instamment. Il y a de l'engagement personnel à éructer, il y faut de l'individu qui se collette : celui qui chante son adorable élégie peut bien rester perché, c'est un être charmant qui n'est entendu que des délicates créatures immobiles à l'ombre de son arbre.
Léon Bloy fut, je crois, un de ces vomisseurs divins. Les parias de talent sont toujours des monstres radieux.
Le Désespéré est le récit largement autobiographique de son double, Marie-Joseph-Caïn Marchenoir, un écrivain chrétien radical et pamphlétaire qui abomine de son époque tous l'art de pacotille et les artistes clinquants et ridicules qui l'ont conspué et réduit à la misère. L'auteur y retrace avec une haine délectable les épisodes d'extrême dénuement, sa réclusion à la Grande-Chartreuse, son mystique amour avec une ancienne prostituée devenue hallucinée de Dieu, ainsi que ses tentatives dérisoires pour publier les ors ténébreux de son style et de son esprit dans un monde de journalistes abjects et puants. D'une absoluité sans compromis, il arpente un monde nauséabond de vicieux profiteurs dont il réussit à faire jaillir sur lui l'unanime haine, incapable des moindres mondanités qui suffiraient à le faire bien recevoir.
Bloy dissimule à peine les noms : tous les grands acteurs littéraires de son temps sont éclaboussés d'infamies ou de calomnies. C'est un défoulement ricanatoire qui, dans sa manière désenchantée et scandaleuse, annihilant presque les contraintes d'une intrigue et diluant le récit dans des vociférations, incombe particulièrement à ce genre fin-de-siècle qui brise les tabous et pousse très haut les rires destructeurs. On croit voir s'écouler continûment une pluie poisseuse sur un Paris d'êtres humanoïdes et infirmes auxquels l'humanité manque par nature. Un suint purulent sape d'emblée toute ambition généreuse, et il n'y a qu'à dépeindre méticuleusement la sanie ambiante que sécrète une société enferrée de vacuité en attendant le retour du Sauveur qui viendra à la parfin tout assainir.
Il est des conversions religieuses qui sont des désirs d'en finir. Bloy ne supporte plus la lénifiante tolérance des préceptes catholiques d'alors qu'il estime une trahison de l'Esprit saint dont il croit ne rencontrer la pureté qu'aux fermes rudesses du Moyen-Âge. Sa foi ne va pas dans la rose des luxes et des oraisons bourgeois ; il n'accommode rien, n'a pas le sens du compromis. Il prétend que le Jésus qu'on vénère ferait honte à Dieu Lui-même : que l'homme contemporain a fait le Christ à son odieuse image, à cause des mensonges des prêtres indulgents et plaisants et de la naïveté opportune des croyants que les premiers pardonnent et absolvent à leur honte.
Désespérer en l'homme, comme probablement le fit Huysmans, fut parfois le chemin de la foi chrétienne : de la solitude de l'artiste ignoré du monde à celle du cénobite oublié du siècle, il n'y a qu'un pas : on quitte la misère d'un logis pour gagner la froideur spartiate d'une cellule. La mentalité déjà ciselée et argutieuse, longtemps sertie d'une complexe exégèse, le spagyrique ésotérisme du chercheur es arts, n'a besoin de s'accroître que du mystère de l'Incarnation qui est en comparaison une idée toute simple et dont l'assomption est alors de peu de conséquence : c'est environ une métaphore supplémentaire qui vaut une belle page de littérature. La parousie, au surplus, achève joliment la ferveur en concrétude : la désolation dégoûtée va quelque part et se rehausse d'un fantasme ou d'un rêve. On cherche en vain un soutien tangible, alors on élit un témoin idéal, une autorité et un vengeur. le christianisme ainsi est quelquefois la doctrine refuge d'un inconsolable exilé contempteur des hommes.
Méchant, diabolique, délibérément cruel, ce livre de tous les éreintements épouvantables et orduriers composé dans un style magnifiquement sophistiqué et byzantin : une incrustation d'argent sur un pot en merde cuite, un damasquinage au scalpel sur un corps de cadavre, une orfèvrerie d'injures rares pour d'inattentives oreilles de pourceaux. le mélange apparemment antinomique de l'exécration outrageuse et de la diaphane volonté de redresser la déchéance – non sans antisémitisme forcené. Une fleur du mal, orchidée de l'excrément – sorte de scatologie eschatologique –, et qui force le lecteur à un brillant effort, mais nullement par goût des impatiences et des chinoiseries (rien n'y est volontiers obscur ou alambiqué, ce n'est pas un roman fait pour dissuader ou pédant), mais pour atteindre à l'exactitude du trait et à l'unicité de la peinture, caractéristiques essentielles de toute littérature – on ne lit pas Bloy comme on avale, il y faut du courage et du soin, un peu d'étude en somme, du mérite. On accède à quelque chose d'individuel, à un parachèvement, à un ouvrage. On peut évidemment ne pas adhérer, on ne saurait avec expertise et honnêteté dénigrer la superbe de la forme.
Pour le fond narratif, soit : il n'y a presque rien. Mais aussi, c'est si tristement banal en littérature ! Reste qu'on a toujours accédé à quelque idéal d'artiste, ce qui ne se distingue plus nulle part. Un très beau vide vaut mieux qu'un vide médiocre : on voit au moins quelque rayon pur que nul objet contrefait ne vient gâcher ; c'est – qui sait ? – peut-être le prodrome d'une merveille si la lumière quintessenciée tombe bientôt sur un motif nouveau et valeureux. Un être derrière une encre noire est préférable à une histoire devant personne. En l'occurrence, le livre est l'assemblage d'un roman en quelque sorte naturaliste – carrière, amours et piété indigentes –, d'une monographie passionnée (guère passionnante pour moi) sur la Grande-Chartreuse, de nombreux portraits défoulés des plus célèbres acteurs littéraires d'une époque, et d'articles enflammés (recyclés de journaux divers) par exemple sur la religion et sur le Riche : tout cela ne tient ensemble que par l'éloquence d'un auteur.
On discerne un caractère de grand bretteur en sous-nombre qui, pourtant défait d'avance, ne se résout pas à la plainte. Des assauts sans cesse pour dissimuler sous les suées les larmes de dépit légitime : une victime qui ne consent pas à crever sans bruyants et féroces anathèmes sous l'élégant talon dont on l'écrase. Si Victor Hugo c'est de la grandiloquence qui a réussi, Léon Bloy est un échec qui a poussé à la grandiloquence. Hugo se hausse et se rengorge parce qu'il a gagné, Bloy se dresse et plastronne parce qu'on le veut perdant. Mais à quoi tient le succès ? Hugo flatte et Bloy fustige, voilà : la différence, c'est la vérité de la peinture, sa fidélité par rapport à l'original ; des allégories ou des contemporains. Présentez un seul homme en deux circonstances de fortune : comme le premier est un triomphe populaire, il se plaît à rendre à la foule qu'il juge d'un goût merveilleux cet amour dont il est acclamé ; comme le second est un échec patent, il se satisfait à haïr ces badauds qu'il estime de déplorables amateurs. C'est le même homme, vous dis-je, exactement le même homme : le premier est bientôt riche et peut écrire beaucoup tandis que le second crève de faim et doit accomplir trois emplois pour acheter son papier. Qui a raison ? C'est pourtant aussi le même public qui permet à l'un de se dégager en héros et à l'autre de sombrer dans le dégoût ; seulement, selon qu'on flatte cette somme ou bien qu'on la corrige…
J'ai ma réponse. Discerner mal, faire d'un même homme une icône ou un gredin, c'est ne pas discerner : entiers hasards dont se satisfont quand même les caudataires et thuriféraires des nouveaux dieux : ne voit-on pas, après l'office, comme les rejetés se révoltent et bavent ! Ce n'est certes pas un Hugo, croit-on, qui aurait ainsi indigné son langage dans l'égout de la rancune !
Qui sait ? peut-être Hugo aurait-il écrit bien pire encore : il ne doit sa posture supérieure de représentant du peuple qu'à l'encouragement qu'il reçut à ses débuts ; il bénéficia en tous cas d'un bon lançage dont Bloy ne put se prévaloir, et ses ambitions initiales étaient aussi mille fois plus impérieuses, de sorte qu'un échec lui eût peut-être été d'une violence inouïe. Ce n'est pas pour médire Hugo, mais pour relativiser la fondation et la représentation des idoles en un cas où le talent fut à peu près égal. Cette observation, je crois, d'une nature psychologique autant que sociale, focalise sur notre inaptitude collective à récompenser l'art et le mérite : je pense que ce vice rencontra à la fin du XIXe siècle un sommet d'ingratitude qui produisit cette tonalité littéraire si particulière qu'on doit à une société dont le paradoxe consiste en l'extrême raffinement de ses artistes confronté à l'indifférence générale des citoyens devenus sans souci et inconséquents. L'apogée d'un harassant effort individuel rencontrant la bêtise du troupeau satisfait, le tout avalisé par un système politique peu concerné de justice et de grandeur et qui offre au capital toute la place pour couronner des vendeurs, c'est l'avant-scène où tout se réalise aujourd'hui en un immense relâchement des exigences artistiques : j'en reparlerai bientôt, je crois, pour montrer généalogiquement comment et pourquoi notre littérature a manifestement déchu depuis ce temps au point qu'un bon écrivain d'aujourd'hui ne vaut sans doute pas un mauvais journaliste d'il y a cent cinquante ans. Mais la clé d'ores et déjà est à chercher à la fois dans l'extrême contention d'un style qu'on ne sut plus tout à coup comment dépasser, et dans le renoncement à vouloir gagner les lauriers par le mérite tandis qu'on apprit à les obtenir par d'autres moyens, le travail ne servant pas de grand-chose en un milieu uniquement de réclame, de pistons et de suaves complaisances populaires.