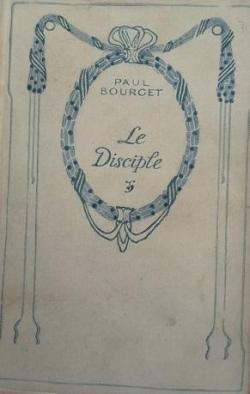Citations sur Le Disciple (86)
J’ai appris, par vos livres, le remède contre de telles épreuves, et en opposant à l’image de la mort prochaine le sentiment de l’inéluctable nécessité, en diminuant la vision de la douleur de ma mère par le rappel précis des lois psychologiques qui gouvernent les consolations, j’arriverais au calme relatif. Certaines phrases de vous y suffiraient, celle par exemple du cinquième chapitre du second livre dans votre Anatomie de la volonté, que je sais par cœur : « L’universel entrelacement des phénomènes fait que sur chacun d’eux porte le poids de tous les autres, en sorte que chaque parcelle de l’univers et à chaque seconde peut être considérée comme un résumé de tout ce qui fut, de tout ce qui est, de tout ce qui sera. C’est en ce sens qu’il est permis de dire que le monde est éternel dans son détail aussi bien que dans son ensemble. » Quelle phrase, et comme elle enveloppe, comme elle affirme et démontre l’idée que tout est nécessaire, en nous comme autour de nous, puisque nous sommes, nous aussi, une parcelle et un moment de ce monde éternel !…
Chapitre IV. Confession d'un jeune homme d'aujourd'hui
Chapitre IV. Confession d'un jeune homme d'aujourd'hui
Le souvenir de l’Allemagne subitement rappelé changea pour une seconde le cours de sa pensée. Il évoqua presque malgré lui Hegel, puis la doctrine de l’identité des contradictoires, puis la théorie de l’évolution qui en est sortie.
Chapitre III. Simple douleur
Chapitre III. Simple douleur
Comme on voit, le philosophe était arrivé, semblable sur ce point aux autres systématiques, à faire de ses doctrines le centre du monde. Il raisonnait à peu près ainsi : Étant donné un fait historique, quelle en est la cause principale ? Un état général des esprits. Cet état des esprits dérive lui-même des idées en cours. La Révolution française, par exemple, procède tout entière d’une conception fausse de l’homme qui découle de la philosophie cartésienne. Il en concluait que, pour modifier la marche des événements, il fallait d’abord modifier les notions reçues sur l’âme humaine, et installer à leur place des données précises d’où résulteraient une éducation et une politique nouvelles. Le plus curieux était que cette théorie avait fait de cet athée un monarchiste aussi passionné qu’un Bonald ou un Joseph de Maistre.
Chapitre III. Simple douleur
Chapitre III. Simple douleur
Le célèbre philosophe était, en toute chose, d’une ponctualité méthodique. Parmi les maximes adoptées, à l’imitation de Descartes, dans le début de sa vie, se trouvait celle-ci : « L’ordre affranchit la pensée. »
Chapitre 2. L'affaire Greslou
Chapitre 2. L'affaire Greslou
Peut-être M. Sixte avait-il aimé sa mère. A coup sûr, là s’était bornée son existence sentimentale. S’il était doux et indulgent pour tous les hommes, c’était par le même instinct qui lui faisait, lorsqu’il déplaçait une chaise dans son bureau, prendre ce meuble sans violence. Mais il n’avait jamais éprouvé le besoin d’avoir auprès de lui une chaude et ardente tendresse, une famille, un dévouement, un amour, pas même une amitié. Les quelques savants avec lesquels il était lié lui représentaient des conversations professionnelles, celui-ci sur la chimie, cet autre sur les hautes mathématiques, un troisième sur les maladies du système nerveux. Que ces gens-là fussent mariés, occupés d’élever leurs enfants, soucieux de se pousser dans une carrière, il n’en tenait aucun compte dans ses rapports avec eux. Et si bizarre que doive paraître une telle conclusion après une telle esquisse, il était heureux.
Chapitre 1. Un philosophe moderne
Chapitre 1. Un philosophe moderne
Dans ces deux livres se trouvait précisée la doctrine de M. Sixte, qu’il est indispensable de résumer ici, en quelques traits généraux, pour l’intelligence du drame auquel cette courte biographie sert de prologue. Avec l’école critique issue de Kant, l’auteur de ces trois traités admet que l’esprit est impuissant à connaître des causes et des substances, et qu’il doit seulement coordonner des phénomènes. Avec les psychologues anglais, il admet qu’un groupe parmi ces phénomènes, celui qui est étiqueté sous le nom d’âme, peut être l’objet d’une connaissance scientifique, à la condition d’être étudié d’après une méthode scientifique. Jusqu’ici, comme on voit, il n’y a rien dans ces théories qui les distingue de celles que MM. Taine, Ribot et leurs disciples ont développées dans leurs principaux travaux. Les deux caractères originaux des recherches de M. Sixte sont ailleurs. Le premier réside dans une analyse négative de ce qu’Herbert Spencer appelle l’Inconnaissable. On sait que le grand penseur anglais admet que toute réalité repose sur un arrière-fonds qu’il est impossible de pénétrer ; par suite, il faut, pour employer la formule de Fichte, comprendre cet arrière-fonds comme incompréhensible. Mais, comme l’atteste fortement le début des Premiers Principes, pour M. Spencer cet Inconnaissable est réel. Il vit, puisque nous vivons de lui. De là il n’y a qu’un pas à concevoir que cet arrière-fonds de toute réalité enveloppe une pensée, puisque notre pensée en sort ; un cœur, puisque notre cœur en dérive. Beaucoup d’excellents esprits entrevoient dès aujourd’hui une réconciliation probable de la Science et de la Religion sur ce terrain de l’Inconnaissable. Pour M. Sixte, c’est là une dernière forme de l’illusion métaphysique et qu’il s’est acharné à détruire avec une énergie d’argumentation que l’on n’avait pas admirée à ce degré depuis Kant.
Chapitre 1. Un philosophe moderne
Chapitre 1. Un philosophe moderne
Ce Saint Laïque, comme on l’eût appelé aussi justement que le vénérable Émile Littré, haïssait dans le Christianisme une maladie de l’humanité. Il en donnait ces deux raisons, d’abord que l’hypothèse d’un père céleste et d’un bonheur infini avait développé à l’excès dans l’âme le dégoût du réel et diminué la puissance d’acceptation des lois de la nature, – ensuite qu’en établissant l’ordre social sur l’amour, c’est-à-dire sur la sensibilité, cette religion avait ouvert la voie aux pires caprices des doctrines les plus personnelles. Il ne se doutait point d’ailleurs que sa fidèle domestique lui cousait des médailles bénites dans tous ses gilets, et son inadvertance à l’endroit de l’univers extérieur était si complète qu’il faisait maigre les vendredis et autres jours prescrits par l’Église, sans apercevoir cet effort caché de la vieille fille pour assurer le salut d’un maître dont elle disait quelquefois, reproduisant, sans le savoir elle-même, un mot célèbre : — « Le bon Dieu ne serait pas le bon Dieu, s’il avait le cœur de le damner. »
Chapitre 1. Un philosophe moderne
Chapitre 1. Un philosophe moderne
À dix heures toute lumière s’éteignait chez lui. Cette existence monastique avait son repos hebdomadaire du lundi, le philosophe ayant observé que le dimanche déverse sur la campagne un flot encombrant de promeneurs. Ces jours-là, il partait de grand matin, montait dans un train de banlieue et ne rentrait que le soir. Il ne s’était pas une fois, durant ces quinze ans, départi de cette régularité absolue. (...)
Il convient d’ajouter, pour fixer les traits principaux de cette figure singulière, qu’il avait rompu tout rapport avec sa famille, et cette rupture se fondait, comme les moindres actes de cette vie, sur une théorie. Il avait écrit dans la préface de son second livre : Anatomie de la volonté, cette phrase significative : « Les attaches sociales doivent être réduites à leur minimum pour celui qui veut connaître et dire la vérité dans le domaine des sciences psychologiques.
Chapitre 1. Un philosophe moderne
Il convient d’ajouter, pour fixer les traits principaux de cette figure singulière, qu’il avait rompu tout rapport avec sa famille, et cette rupture se fondait, comme les moindres actes de cette vie, sur une théorie. Il avait écrit dans la préface de son second livre : Anatomie de la volonté, cette phrase significative : « Les attaches sociales doivent être réduites à leur minimum pour celui qui veut connaître et dire la vérité dans le domaine des sciences psychologiques.
Chapitre 1. Un philosophe moderne
Pour mieux définir cet homme d’une qualité si rare que cette esquisse d’après nature risquera de paraître invraisemblable au lecteur peu familiarisé avec la biographie des grands manipulateurs d’idées, il est nécessaire de donner un aperçu des journées de ce puissant travailleur. Été comme hiver, M. Sixte s’asseyait à sa table dès six heures du matin, lesté seulement d’une tasse de café noir. À dix heures, il déjeunait, opération sommaire et qui lui permettait de franchir à dix heures et demie la porte du jardin des Plantes. Il se promenait là jusqu’à midi, poussant quelquefois sa flânerie vers les quais et du côté de Notre-Dame.
Chapitre 1. Un philosophe moderne
Chapitre 1. Un philosophe moderne
Toute la formule de sa vie tenait dans ce mot : penser.
Chapitre 1. Un philosophe moderne
Chapitre 1. Un philosophe moderne
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Paul Bourget (64)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les Chefs-d'oeuvre de la littérature
Quel écrivain est l'auteur de Madame Bovary ?
Honoré de Balzac
Stendhal
Gustave Flaubert
Guy de Maupassant
8 questions
11225 lecteurs ont répondu
Thèmes :
chef d'oeuvre intemporels
, classiqueCréer un quiz sur ce livre11225 lecteurs ont répondu