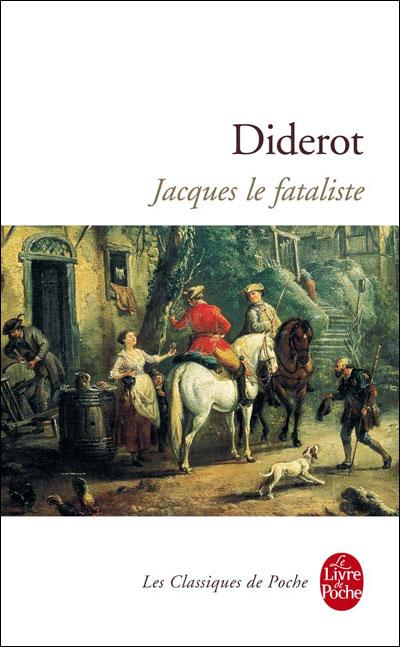>
Critique de gerardmuller
Jacques le Fataliste et son maître
Denis Diderot (1713-1784)
L'écriture de ce conte philosophique que Diderot voulait anti – philosophique, prit dix-neuf ans à Diderot, de 1765 à 1784 et sa publication ne fut que posthume, en 1792 en Allemagne et en 1796 en France, car sous le règne de Louis XV la censure avait les membres de l'Encyclopédie dans le collimateur. Alors tous les écrits philosophiques un tant soit peu subversifs étaient la cible de la censure et les auteurs devaient fuir, soit en Suisse, soit en Russie auprès de Catherine II qui reçut ainsi Voltaire et Diderot.
Sous une forme apparemment désinvolte grâce à des dialogues merveilleusement riches de liberté et des acrobaties d'écriture, Diderot pose le problème de la liberté. Ne se souciant guère du désordre de la composition, il s'accorde des licences de plume et de nombreuses digressions. Mais la verve et le sens du dialogue dramatique et philosophique entre Jacques le philosophe bavard et son maître plus sobre, alliés à un style sans égal font de ce conte un joyau d'humour, le récit des amours de Jacques n'étant qu'un prétexte au récit d'une foule de récits secondaires pour illustrer le thème.
Dans cette oeuvre insolite et déconcertante, l'histoire picaresque du vagabondage de deux personnages à cheval qui racontent, écoutent et vivent diverses aventures, il faut bien voir que Diderot a voulu divertir le lecteur tout autant que le faire réfléchir, émettant des réflexions contradictoires sur la liberté humaine notamment, sur le rôle du déterminisme et du hasard qui se conjuguent et de façon conséquente sur le sens que l'on doit accorder alors au vice et à la vertu. le véritable thème de l'oeuvre est l'enchaînement des causes et l'inextricable ensemble de circonstances qui déterminent le moindre événement. On peut déceler là l'influence de Leibniz et de Spinoza qui soutiennent la rationalité objective d'un monde unique, géométriquement inéluctable. Ce qui pour Diderot ne va en aucun cas à l'encontre de la liberté.
Diderot met habilement en avant ses thèses concernant le relativisme moral, sa critique de l'Église (abbé Hudson), son matérialisme et la sexualité en général.
Interviennent plusieurs a parte de Diderot à l'intention de son lecteur qu'il prend à témoin de ses hésitations quant au choix de la suite à donner à la narration des errances de Jacques et de son maître, le pseudo - récit des amourettes de Jacques puis celles de son capitaine, puis vers la fin celles du maître, narration sans cesse interrompues par des digressions de toutes sortes qui sont en fait la substance de l'oeuvre. Ce roman a été qualifié d'antiroman, de métaroman ou encore d'hyperroman de par la richesse et la puissance de sa nouveauté. En effet Diderot met au premier plan la joute entre l'auteur et le lecteur et fait de ce roman une oeuvre qui échappe à toute règle et à toute classification.
Comme je le disais, la trame très lâche du roman est constamment coupée par des récits secondaires ; l'un des plus importants est celui contée par l'hôtesse de l'auberge, une femme élégante et prolixe bavarde, qui met en scène le marquis des Arcis, un homme de plaisir, très aimable et croyant peu à la vertu des femmes, et la marquise de la Pommeraye, une veuve fortunée et de belle naissance, laquelle a compromis sa réputation en aimant le marquis qui peu à peu se détache d'elle après l'avoir séduite. La marquise alors feint de vouloir reprendre sa liberté : ils ne s'aiment plus disent-ils, mais cela ne les empêche pas de rester bons amis. Cruellement blessée, souffrant le martyr, affligée d'un tourment qu'elle compte bien rendre éternel pour le marquis, la marquise a soif d'une vengeance qu'elle prépare avec un machiavélisme inouï en amenant une fille de mauvaise vie, la d'Aisnon, de son nom Mlle Duquênoi, accompagnée de sa mère, affectant une vertu et une vie irréprochable qu'elle n'a pas. le marquis tombe dans le piège et s'éprend de la d'Aisnon et l'épouse…Et quand la marquise avoue le subterfuge, le marquis courroucé n'en reste pas là….Un roman dans le roman que cette histoire !
Toute cette narration est arrosée de nombreuses rasades sans ponctuation ( !) partagées entre Jacques, son maître et l'hôtesse à l'intarissable caquet, histoire de s'assurer de la sagesse de la bouteille !
On peut noter aussi le parti pris féministe de Diderot ou plus exactement sa mentalité féministe, car il met toujours la femme (c'est le cas notamment pour Mlle Duquênoi que défend vigoureusement l'hôtesse malgré les objurgations du Maître) sur le même plan moral et intellectuel que l'homme et soutient qu'elle possède le même droit que lui au bonheur des sentiments et des sens. Toute son oeuvre en atteste d'ailleurs. Diderot prend même la défense de Mme de la Pommeraye, car même si après avoir avalé tout le calice de l'amertume et le ridicule d'une délaissée, sa vengeance est atroce au dire de l'auteur, elle n'est souillée d'aucun motif d'intérêt.
Au fil des pages et des lieues de vagabondage, le maître avoue à Jacques qu'il a endossé la paternité d'un enfant dont il n'est pas le père et Jacques va épouser la gentille Denise dont il est éperdument épris.
Extrait : Jacques philosophe:
« Et quand je serais devenu amoureux d'elle, qu'est-ce qu'il y aurait à dire ? Est-ce qu'on est maître de devenir ou de ne pas devenir amoureux ? Et quand on l'est, est-on maître d'agir comme si on ne l'était pas ? »
Plus loin : le Maître, gausseur :
« La perte de son pucelage ? de tous les péchés d'une jolie pénitente, je suis sûr que le confesseur n'est attentif qu'à celui là. »
Enfin si vous voulez bonifier une tisane et en faire un vulnéraire efficace, ajoutez y un peu de vin blanc. C'est la recette de Jacques quand il ne se sent pas bien.
Véritablement un ovni littéraire.
Denis Diderot (1713-1784)
L'écriture de ce conte philosophique que Diderot voulait anti – philosophique, prit dix-neuf ans à Diderot, de 1765 à 1784 et sa publication ne fut que posthume, en 1792 en Allemagne et en 1796 en France, car sous le règne de Louis XV la censure avait les membres de l'Encyclopédie dans le collimateur. Alors tous les écrits philosophiques un tant soit peu subversifs étaient la cible de la censure et les auteurs devaient fuir, soit en Suisse, soit en Russie auprès de Catherine II qui reçut ainsi Voltaire et Diderot.
Sous une forme apparemment désinvolte grâce à des dialogues merveilleusement riches de liberté et des acrobaties d'écriture, Diderot pose le problème de la liberté. Ne se souciant guère du désordre de la composition, il s'accorde des licences de plume et de nombreuses digressions. Mais la verve et le sens du dialogue dramatique et philosophique entre Jacques le philosophe bavard et son maître plus sobre, alliés à un style sans égal font de ce conte un joyau d'humour, le récit des amours de Jacques n'étant qu'un prétexte au récit d'une foule de récits secondaires pour illustrer le thème.
Dans cette oeuvre insolite et déconcertante, l'histoire picaresque du vagabondage de deux personnages à cheval qui racontent, écoutent et vivent diverses aventures, il faut bien voir que Diderot a voulu divertir le lecteur tout autant que le faire réfléchir, émettant des réflexions contradictoires sur la liberté humaine notamment, sur le rôle du déterminisme et du hasard qui se conjuguent et de façon conséquente sur le sens que l'on doit accorder alors au vice et à la vertu. le véritable thème de l'oeuvre est l'enchaînement des causes et l'inextricable ensemble de circonstances qui déterminent le moindre événement. On peut déceler là l'influence de Leibniz et de Spinoza qui soutiennent la rationalité objective d'un monde unique, géométriquement inéluctable. Ce qui pour Diderot ne va en aucun cas à l'encontre de la liberté.
Diderot met habilement en avant ses thèses concernant le relativisme moral, sa critique de l'Église (abbé Hudson), son matérialisme et la sexualité en général.
Interviennent plusieurs a parte de Diderot à l'intention de son lecteur qu'il prend à témoin de ses hésitations quant au choix de la suite à donner à la narration des errances de Jacques et de son maître, le pseudo - récit des amourettes de Jacques puis celles de son capitaine, puis vers la fin celles du maître, narration sans cesse interrompues par des digressions de toutes sortes qui sont en fait la substance de l'oeuvre. Ce roman a été qualifié d'antiroman, de métaroman ou encore d'hyperroman de par la richesse et la puissance de sa nouveauté. En effet Diderot met au premier plan la joute entre l'auteur et le lecteur et fait de ce roman une oeuvre qui échappe à toute règle et à toute classification.
Comme je le disais, la trame très lâche du roman est constamment coupée par des récits secondaires ; l'un des plus importants est celui contée par l'hôtesse de l'auberge, une femme élégante et prolixe bavarde, qui met en scène le marquis des Arcis, un homme de plaisir, très aimable et croyant peu à la vertu des femmes, et la marquise de la Pommeraye, une veuve fortunée et de belle naissance, laquelle a compromis sa réputation en aimant le marquis qui peu à peu se détache d'elle après l'avoir séduite. La marquise alors feint de vouloir reprendre sa liberté : ils ne s'aiment plus disent-ils, mais cela ne les empêche pas de rester bons amis. Cruellement blessée, souffrant le martyr, affligée d'un tourment qu'elle compte bien rendre éternel pour le marquis, la marquise a soif d'une vengeance qu'elle prépare avec un machiavélisme inouï en amenant une fille de mauvaise vie, la d'Aisnon, de son nom Mlle Duquênoi, accompagnée de sa mère, affectant une vertu et une vie irréprochable qu'elle n'a pas. le marquis tombe dans le piège et s'éprend de la d'Aisnon et l'épouse…Et quand la marquise avoue le subterfuge, le marquis courroucé n'en reste pas là….Un roman dans le roman que cette histoire !
Toute cette narration est arrosée de nombreuses rasades sans ponctuation ( !) partagées entre Jacques, son maître et l'hôtesse à l'intarissable caquet, histoire de s'assurer de la sagesse de la bouteille !
On peut noter aussi le parti pris féministe de Diderot ou plus exactement sa mentalité féministe, car il met toujours la femme (c'est le cas notamment pour Mlle Duquênoi que défend vigoureusement l'hôtesse malgré les objurgations du Maître) sur le même plan moral et intellectuel que l'homme et soutient qu'elle possède le même droit que lui au bonheur des sentiments et des sens. Toute son oeuvre en atteste d'ailleurs. Diderot prend même la défense de Mme de la Pommeraye, car même si après avoir avalé tout le calice de l'amertume et le ridicule d'une délaissée, sa vengeance est atroce au dire de l'auteur, elle n'est souillée d'aucun motif d'intérêt.
Au fil des pages et des lieues de vagabondage, le maître avoue à Jacques qu'il a endossé la paternité d'un enfant dont il n'est pas le père et Jacques va épouser la gentille Denise dont il est éperdument épris.
Extrait : Jacques philosophe:
« Et quand je serais devenu amoureux d'elle, qu'est-ce qu'il y aurait à dire ? Est-ce qu'on est maître de devenir ou de ne pas devenir amoureux ? Et quand on l'est, est-on maître d'agir comme si on ne l'était pas ? »
Plus loin : le Maître, gausseur :
« La perte de son pucelage ? de tous les péchés d'une jolie pénitente, je suis sûr que le confesseur n'est attentif qu'à celui là. »
Enfin si vous voulez bonifier une tisane et en faire un vulnéraire efficace, ajoutez y un peu de vin blanc. C'est la recette de Jacques quand il ne se sent pas bien.
Véritablement un ovni littéraire.