
Citations sur Stop à la fatigue ! : Dire non à l'épuisement et retrouver .. (27)
Dans le stress, deux systèmes régulateurs interviennent :
le système nerveux et le système hormonal ou endocrinien.
Les réactions nerveuses, sous-estimées par Selye, sont importantes.
Quel que soit le stimulus initial et quels que soient les effecteurs, les voies nerveuses de la sensibilité sont actionnées. Des influx remontent vers les centres nerveux par la voie du système nerveux végétatif et convergent vers le cerveau, plus précisément vers la région cortico-hypothalamique. Ces centres supérieurs déclenchent des réactions végétatives par les systèmes ortho et para-sympathiques.
En revanche, Selye insiste sur la mise en jeu de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. La production des thyréo et gonadostimulines est diminuée au profit des corticostimulines qui sont augmentées.
Le rôle essentiel revient à la glande corticosurrénale qui sécrète des minéralocorticoïdes et des glucocorticoïdes. La plupart des réactions locales et humorales du contre-choc sont sous leur dépendance.
le système nerveux et le système hormonal ou endocrinien.
Les réactions nerveuses, sous-estimées par Selye, sont importantes.
Quel que soit le stimulus initial et quels que soient les effecteurs, les voies nerveuses de la sensibilité sont actionnées. Des influx remontent vers les centres nerveux par la voie du système nerveux végétatif et convergent vers le cerveau, plus précisément vers la région cortico-hypothalamique. Ces centres supérieurs déclenchent des réactions végétatives par les systèmes ortho et para-sympathiques.
En revanche, Selye insiste sur la mise en jeu de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. La production des thyréo et gonadostimulines est diminuée au profit des corticostimulines qui sont augmentées.
Le rôle essentiel revient à la glande corticosurrénale qui sécrète des minéralocorticoïdes et des glucocorticoïdes. La plupart des réactions locales et humorales du contre-choc sont sous leur dépendance.
Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que l'on s'est soucié de la défense de l'organisme et de sa capacité d'adaptation à la prolongation ou au renouvellement de l'agression. Deux écoles ont étudié ses réactions : une française avec à sa tête Reilly, et une canadienne dont Selye était le meneur.
Reilly étudiait surtout les "irritations" du système nerveux végétatif.
Selye s'est intéressé aux agressions les plus diverses, aussi bien internes qu'externes, et a pu construire un schéma d'ensemble des modifications de l'organisme, y compris les réactions hormonales.
C'est lui l'inventeur du mot "stress". Ce terme désigne l'ensemble des faits d'agressivité de l'agent nocif et des réponses organiques consécutives.
Le mot stress dans l'esprit de Selye se traduit par le tandem action-réaction.
L'action, c'est l'agression qui engendre un état de souffrance organique, un "choc" ou un "traumatisme". Celui-ci peut exercer une action locale et une autre générale avec des répercussions humorales (glycémie, kaliémie), la tension artérielle, la température ainsi que des effets allergiques.
L'organisme va opposer une double réaction à cette double agression : locale (comme une réaction inflammatoire) et générale (renversement des modifications humorales auxquelles peuvent s'ajouter un changement du catabolisme azoté, une polynucléose, une augmentation du taux des gamma-globulines).
L'importance et la durée du choc et du contre-choc dépendent des agressions et varient selon les individus. Lorsque le stimulus causal poursuit son action, l'organisme présente une troisième phase de "résistance".
Tout se passe comme si chacun d'entre nous possédait un capital de résistance, et la poursuite d'une résistance à une agression précise entraîne une diminution de la résistance aux autres agressions.
Si l'agression est trop intense ou trop longtemps soutenue, la résistance est débordée : l'organisme entre dans une phase d'épuisement
Reilly étudiait surtout les "irritations" du système nerveux végétatif.
Selye s'est intéressé aux agressions les plus diverses, aussi bien internes qu'externes, et a pu construire un schéma d'ensemble des modifications de l'organisme, y compris les réactions hormonales.
C'est lui l'inventeur du mot "stress". Ce terme désigne l'ensemble des faits d'agressivité de l'agent nocif et des réponses organiques consécutives.
Le mot stress dans l'esprit de Selye se traduit par le tandem action-réaction.
L'action, c'est l'agression qui engendre un état de souffrance organique, un "choc" ou un "traumatisme". Celui-ci peut exercer une action locale et une autre générale avec des répercussions humorales (glycémie, kaliémie), la tension artérielle, la température ainsi que des effets allergiques.
L'organisme va opposer une double réaction à cette double agression : locale (comme une réaction inflammatoire) et générale (renversement des modifications humorales auxquelles peuvent s'ajouter un changement du catabolisme azoté, une polynucléose, une augmentation du taux des gamma-globulines).
L'importance et la durée du choc et du contre-choc dépendent des agressions et varient selon les individus. Lorsque le stimulus causal poursuit son action, l'organisme présente une troisième phase de "résistance".
Tout se passe comme si chacun d'entre nous possédait un capital de résistance, et la poursuite d'une résistance à une agression précise entraîne une diminution de la résistance aux autres agressions.
Si l'agression est trop intense ou trop longtemps soutenue, la résistance est débordée : l'organisme entre dans une phase d'épuisement
Le surmenage est, selon Orth, "une fatigue réactionnelle qui devient chronique". C'est le type de fatigue qui ne cède pas au repos.
Le surmené présente non seulement des signes de fatigue aiguë qui perdurent mais aussi des troubles de l'humeur, du découragement, un désintérêt pour le travail et des pulsions agressives.
Il présente également des troubles de l'équilibre neurovégétatif, un amaigrissement, une perte d'appétit, une accélération de son rythme cardiaque, une instabilité de sa tension artérielle et enfin des troubles du sommeil (dans sa durée comme dans sa qualité). Il est agressif, se replie sur lui-même, se laissant aller à "une rumination personnelle".
Le surmené présente non seulement des signes de fatigue aiguë qui perdurent mais aussi des troubles de l'humeur, du découragement, un désintérêt pour le travail et des pulsions agressives.
Il présente également des troubles de l'équilibre neurovégétatif, un amaigrissement, une perte d'appétit, une accélération de son rythme cardiaque, une instabilité de sa tension artérielle et enfin des troubles du sommeil (dans sa durée comme dans sa qualité). Il est agressif, se replie sur lui-même, se laissant aller à "une rumination personnelle".
L'effort physique est responsable d'une fatigue musculaire tandis que le surmenage et le stress, les mauvaises conditions de travail ou une mauvaise hygiène de vie génèrent une "fatigue réactionnelle".
La maladie, un trouble hormonal, une insuffisance rénale se traduisent par une fatigue-symptôme.
Un trouble psycho-névrotique est souvent à l'origine de la fatigue chronique.
La maladie, un trouble hormonal, une insuffisance rénale se traduisent par une fatigue-symptôme.
Un trouble psycho-névrotique est souvent à l'origine de la fatigue chronique.
L'homme ne peut plus faire n'importe quel travail passé la cinquantaine.
L'adaptation aux conditions de travail, la précision du geste, la cadence de la chaîne de travail, les contraintes posturales, les performances sensorielles sont de moins en moins bonnes au fur et à mesure que l'âge s'élève.
La fatigue nerveuse et générale, les douleurs vertébrales (l'arthrose) empirent avec l'âge.
L'adaptation aux conditions de travail, la précision du geste, la cadence de la chaîne de travail, les contraintes posturales, les performances sensorielles sont de moins en moins bonnes au fur et à mesure que l'âge s'élève.
La fatigue nerveuse et générale, les douleurs vertébrales (l'arthrose) empirent avec l'âge.
Curieusement la fatigue s'accroît avec la sédentarité.
La pratique régulière d'un sport la diminue. 32% des cadres se détendent par l'activité physique contre 9% des inactifs.
La pratique régulière d'un sport la diminue. 32% des cadres se détendent par l'activité physique contre 9% des inactifs.
D'après une enquête portant sur dix mille fiches d'observations recueillies par deux mille médecins généralistes, un laboratoire pharmaceutique a tenté de dégager les caractères socioprofessionnels de la fatigue.
La fatigue psycho-intellectuelle concerne 75% des sujets.
Outre la fatigue, deux sujets sur trois avouent deux symptômes d'accompagnement comme la douleur et l'insomnie, la fièvre et l'amaigrissement.
Les fatigués ou les asthéniques consultent généralement après un délai de six semaines : il s'agit du délai entre l'apparition des troubles et la décision de consulter. Ce sont les femmes qui consultent le plus souvent. (...)
Les plaintes varient avec l'âge et ont trait :
- de 20 à 35 ans, à la fatigue intellectuelle
- de 36 à 50 ans, aux troubles du sommeil
- de 51 à 70 ans, aux troubles du comportement et à la fatigue sexuelle
- après 70 ans, aux troubles psychiques, à la fatigue musculaire et à la somatisation (...)
Chez les agriculteurs, la fatigue est musculaire et s'accompagne de troubles du sommeil. Chez les inactifs et les ouvriers, la démotivation est à l'origine de la fatigue.
Quant aux cadres moyens et supérieurs, les préoccupations professionnelles sont la cause de leur fatigue.
La fatigue psycho-intellectuelle concerne 75% des sujets.
Outre la fatigue, deux sujets sur trois avouent deux symptômes d'accompagnement comme la douleur et l'insomnie, la fièvre et l'amaigrissement.
Les fatigués ou les asthéniques consultent généralement après un délai de six semaines : il s'agit du délai entre l'apparition des troubles et la décision de consulter. Ce sont les femmes qui consultent le plus souvent. (...)
Les plaintes varient avec l'âge et ont trait :
- de 20 à 35 ans, à la fatigue intellectuelle
- de 36 à 50 ans, aux troubles du sommeil
- de 51 à 70 ans, aux troubles du comportement et à la fatigue sexuelle
- après 70 ans, aux troubles psychiques, à la fatigue musculaire et à la somatisation (...)
Chez les agriculteurs, la fatigue est musculaire et s'accompagne de troubles du sommeil. Chez les inactifs et les ouvriers, la démotivation est à l'origine de la fatigue.
Quant aux cadres moyens et supérieurs, les préoccupations professionnelles sont la cause de leur fatigue.
Les Dernières Actualités
Voir plus
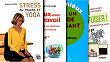
Anti-stress
petitsoleil
26 livres

Faire le plein d'énergie
petitsoleil
24 livres
Autres livres de Jean-Paul Ehrhardt (2)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Fruits et légumes
Le carrosse de Cendrillon se change en...
pastèque
potiron
citrouille
20 questions
397 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur ce livre397 lecteurs ont répondu



















