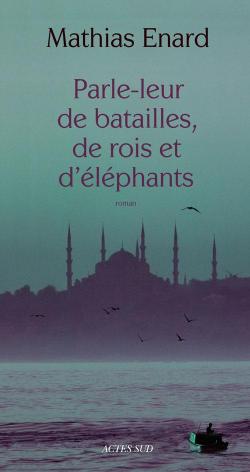>
Critique de JulienDjeuks
Roman s'appuyant sur une anecdote historique et brodant autour du peu d'éléments connus, à l'instar de Marcel Schwob dans ses Vies imaginaires (1896), Mathias Enard nous fait pénétrer dans l'intimité du grand peintre, ses questionnements artistiques, ses rivalités, ses crises et fantaisies, ses problèmes d'argent, ses contradictions sensuelles. Son esthétique est celle d'un art inspiré, moderne, poétique, sensuel, à l'opposé de la pure technique de de Vinci. L'auteur trouve par là le moyen d'exprimer ses propres questionnements artistiques. Mais, tout en intéressant son lecteur avec une anecdote croustillante sur l'un des « grands » du monde, il lui parle art, avec amour et humilité.
La menée du récit est hétérogène, faite d'extraits de listes et de croquis de Michel-Ange, de lettres authentiques envoyées par le peintre à son frère, d'un récit narré de manière naturaliste à la troisième personne et d'un étrange discours-monologue de la danseuse-danseur, voix qui tutoie Michel-Ange et donc prolonge le récit avec la deuxième personne, ayant l'effet inattendu d'élargir le personnage au monde qu'il représente, à sa culture, au lecteur. La danseuse/danseur confère également, en s'étant approchée physiquement de lui, une densité intime au peintre – peintre présenté comme caractériel, associable, coincé… –, le rendant moins froid de caractère et plus sensible, moins légendaire et plus humain. C'est un peu la voix de l'auteur qui s'est approché de son personnage historique jusqu'à en vouloir toucher la peau, l'intime humain.
C'est sur la relation artistique et humaine entre Michel-Ange et Mesihi, qui se noue et se dénoue au-delà des différences culturelles, que se construit le récit, les descriptions lors des déambulations dans la capitale musulmane, le spectacle des danses et des fêtes sur les sens du peintre, les discussions artistiques...
Enard joue sur la tentation de l'exotique, sur la fascination de l'ambiguïté de l'androgynie. Cette aventure avec ce danseurs-danseuse, cette chanteur-chanteuse, un personnage social secondaire, au niveau d'une prostituée, est presque ordinaire et acceptable quand on sait de la forte pratique homosexuelle dans l'Istanbul de l'époque. D'un oeil anachronique, on pourrait la voir comme du tourisme sexuel, aventure qui n'aura jamais d'importance dans la vie publique du peintre. Cependant, cette aventure sans grandeur (finalement non pleinement réalisée par l'artiste, dont le désir semble s'éloigner avec l'ambiguïté du sexe du danseur) apparaît bientôt comme la couverture, le refoulement d'un véritable amour homosexuel, amour inacceptable pour la conscience occidentale de Michel-Ange, ou amour fraternel pour un frère d'art, art musulman irrecevable. Comme ce pont, d'inspiration occidentale, qui ne sera pas réalisé, cet échange aussi bien artiste, culturel, que humain, n'aura pas lieu. Ce refoulement peut être vu comme le symbole du rejet de l'homosexualité par la culture chrétienne (exprimé d'une toute autre manière dans le célèbre Cruising (1980), de Friedkin avec Al Pacino), ou encore plus largement comme le rejet de l'influence musulmane dans la culture occidentale (depuis Pétrarque qui, au contraire de Dante, par haine, rejette toute influence musulmane alors que toute la pensée antique revient en Europe par l'intermédiaire des Arabes qui ont donc un rôle fondamental dans la Renaissance). Comme tout refoulement, il crée un manque dans la personnalité occidentale, manque qui se traduit parfois par des oeuvres positives, comme le pourrait être l'inspiration de Michel-Ange, mais plus souvent par une haine mutuelle inexplicable : comment l'amant refoulé pourrait-il pardonner à l'aimé de l'avoir nié, de l'avoir confondu avec une simple aventure exotique ?
Lien : https://leluronum.art.blog/2..
La menée du récit est hétérogène, faite d'extraits de listes et de croquis de Michel-Ange, de lettres authentiques envoyées par le peintre à son frère, d'un récit narré de manière naturaliste à la troisième personne et d'un étrange discours-monologue de la danseuse-danseur, voix qui tutoie Michel-Ange et donc prolonge le récit avec la deuxième personne, ayant l'effet inattendu d'élargir le personnage au monde qu'il représente, à sa culture, au lecteur. La danseuse/danseur confère également, en s'étant approchée physiquement de lui, une densité intime au peintre – peintre présenté comme caractériel, associable, coincé… –, le rendant moins froid de caractère et plus sensible, moins légendaire et plus humain. C'est un peu la voix de l'auteur qui s'est approché de son personnage historique jusqu'à en vouloir toucher la peau, l'intime humain.
C'est sur la relation artistique et humaine entre Michel-Ange et Mesihi, qui se noue et se dénoue au-delà des différences culturelles, que se construit le récit, les descriptions lors des déambulations dans la capitale musulmane, le spectacle des danses et des fêtes sur les sens du peintre, les discussions artistiques...
Enard joue sur la tentation de l'exotique, sur la fascination de l'ambiguïté de l'androgynie. Cette aventure avec ce danseurs-danseuse, cette chanteur-chanteuse, un personnage social secondaire, au niveau d'une prostituée, est presque ordinaire et acceptable quand on sait de la forte pratique homosexuelle dans l'Istanbul de l'époque. D'un oeil anachronique, on pourrait la voir comme du tourisme sexuel, aventure qui n'aura jamais d'importance dans la vie publique du peintre. Cependant, cette aventure sans grandeur (finalement non pleinement réalisée par l'artiste, dont le désir semble s'éloigner avec l'ambiguïté du sexe du danseur) apparaît bientôt comme la couverture, le refoulement d'un véritable amour homosexuel, amour inacceptable pour la conscience occidentale de Michel-Ange, ou amour fraternel pour un frère d'art, art musulman irrecevable. Comme ce pont, d'inspiration occidentale, qui ne sera pas réalisé, cet échange aussi bien artiste, culturel, que humain, n'aura pas lieu. Ce refoulement peut être vu comme le symbole du rejet de l'homosexualité par la culture chrétienne (exprimé d'une toute autre manière dans le célèbre Cruising (1980), de Friedkin avec Al Pacino), ou encore plus largement comme le rejet de l'influence musulmane dans la culture occidentale (depuis Pétrarque qui, au contraire de Dante, par haine, rejette toute influence musulmane alors que toute la pensée antique revient en Europe par l'intermédiaire des Arabes qui ont donc un rôle fondamental dans la Renaissance). Comme tout refoulement, il crée un manque dans la personnalité occidentale, manque qui se traduit parfois par des oeuvres positives, comme le pourrait être l'inspiration de Michel-Ange, mais plus souvent par une haine mutuelle inexplicable : comment l'amant refoulé pourrait-il pardonner à l'aimé de l'avoir nié, de l'avoir confondu avec une simple aventure exotique ?
Lien : https://leluronum.art.blog/2..