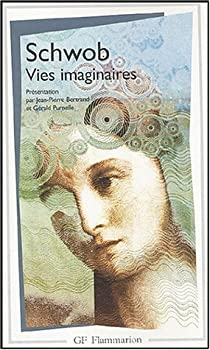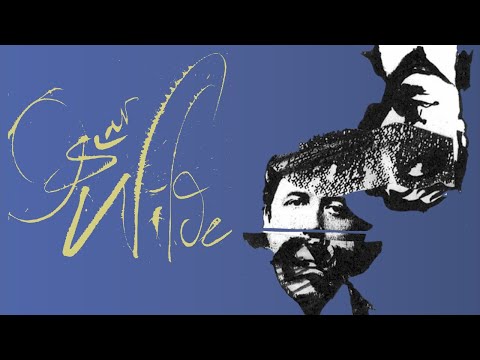Marcel Schwob
Jean-Pierre Bertrand (Éditeur scientifique)Gérald Purnelle (Éditeur scientifique)/5 77 notes
Jean-Pierre Bertrand (Éditeur scientifique)Gérald Purnelle (Éditeur scientifique)/5 77 notes
Résumé :
« Le biographe n'a pas à se préoccuper d'être vrai ; il doit créer dans un chaos de traits humains. Leibniz dit que pour faire le monde, Dieu a choisi le meilleur parmi les possibles. Le biographe, comme une divinité inférieure, sait choisir parmi les possibles humains, celui qui est unique. Il ne doit pas plus se tromper sur l'art que Dieu ne s'est trompé sur la bonté. Il est nécessaire que leur instinct à tous deux soit infaillible.
De patients démiurges o... >Voir plus
De patients démiurges o... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Vies imaginairesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (14)
Voir plus
Ajouter une critique
Suivons le titre! L'itineraire y est indique mais le chemin reservera a coup sur des surprises. de quoi sera compose l'imaginaire de Marcel Schwob quand il s'institue biographe de personnages historiques illustres, d'autres oublies ou meconnus, et de quelques uns qui semblent n'avoir existe que dans sa tete?
Schwob revendique dans sa preface l'imagination comme compagne autorisee (et des fois plus competente) de l'erudition. Il faut verifier toutes les sources officielles, choisir, et rajouter ce qui fera de la vie qu'on raconte une vie "unique". Car seule une vie "unique" merite d'etre racontee. Toutes les autres vies devront se consoler avec un passage au purgatoire de l'histoire sociale et de la sociologie historique.
Les sources de Schwob sont diverses, qu'il les cite ou qu'il nous laisse les deviner: des poetes de l'antiquite classique, des chroniques moyennageuses, Les mille et une nuits, la Divine comedie de Dante, des contes philosophiques du 18e siècle, des contes pour enfants, des mythes et des legendes, et meme des manuscrits, des temoignages et des depositions qu'il aurait consultes a la Bibliotheque Nationale, aux Archives Nationales, ou dans les registres du Chatelet.
Schwob nous offre donc des vies ameliorees, des vies que ses heros auraient reve pour eux-memes dans leurs fantasmes les plus delirants. Dans ces contes (car ces biographies imaginaires sont pour moi des contes) les protagonistes poursuivent un projet chimerique, vain, eloigne de toute realite, aveugle a la materialite du monde, et qui les projette vers la mort. Tous les contes sont empreints de solitude et de merveilleux, de souffrance et d'etrangete, de vulnerabilite et de fantastique, de doute, de cruaute et d'angoisse, de l'ambiguite de toute existence, et surtout d'une obsessive interrogation sur l'identite humaine. A contrecourant de tout positivisme, de tout scientisme, Schwob insiste sur le mystere de la vie, sur les interrogations qu'exister exige. C'est comme s'il proposait des experimentations sur l'existence, des tests verifiant des possibilites de vie. Et le point d'orgue en est toujours la mort. le livre pourrait s'appeler morts imaginaires (et si j'appuie lourdement sur l'effet: morts exemplaires). Lui-meme, deja gravement malade, voyagea jusqu'a Samoa chercher une tombe (celle de Stevenson) qu'il ne trouva pas. Ce voyage faillit lui couter la vie, ce qui fit dire a Jules Renard: "Avant sa mort il vit ses contes".
Schwob est souvent traite d'auteur mineur, mais son influence est profonde. Chez Borges, Faulkner, Perec, Bolano, Michon, pur n'en citer que quelques grands. "Dans toutes les parties du monde il y a des devots de Marcel Schwob qui se constituent en petites societes secretes", ecrivait Jorge Luis Borges. Et ce sont peut-etre ces societes qui ont travaille secretement a l'occulter aux yeux des autres, pour mieux le garder pour leurs seuls membres.
Le style fastueux de Schwob, son long souffle poetique, sa somptuosite linguistique, servent admirablement son propos. C'est un plaisir de lecture, quoique je conseillerais de ne pas franchir ce petit livre d'une seule traite. L'abus de belles histoires, de beaux textes, risque de nous gaver, de nous faire rejeter une partie. A consommer donc avec moderation. Il me faut dire que j'ai eu la chance d'avoir sous la main la merveilleuse edition de le Livre Contemporain de 1929, avec les illustrations hautes en couleur de George Barbier, gravees sur bois par Pierre Bouchet, qui enrichissent encore plus le texte.
Pas une petite friandise, un regal; ce livre a ete pour moi un regal, pour l'esprit et pour les sens.
4 etoiles.
Schwob revendique dans sa preface l'imagination comme compagne autorisee (et des fois plus competente) de l'erudition. Il faut verifier toutes les sources officielles, choisir, et rajouter ce qui fera de la vie qu'on raconte une vie "unique". Car seule une vie "unique" merite d'etre racontee. Toutes les autres vies devront se consoler avec un passage au purgatoire de l'histoire sociale et de la sociologie historique.
Les sources de Schwob sont diverses, qu'il les cite ou qu'il nous laisse les deviner: des poetes de l'antiquite classique, des chroniques moyennageuses, Les mille et une nuits, la Divine comedie de Dante, des contes philosophiques du 18e siècle, des contes pour enfants, des mythes et des legendes, et meme des manuscrits, des temoignages et des depositions qu'il aurait consultes a la Bibliotheque Nationale, aux Archives Nationales, ou dans les registres du Chatelet.
Schwob nous offre donc des vies ameliorees, des vies que ses heros auraient reve pour eux-memes dans leurs fantasmes les plus delirants. Dans ces contes (car ces biographies imaginaires sont pour moi des contes) les protagonistes poursuivent un projet chimerique, vain, eloigne de toute realite, aveugle a la materialite du monde, et qui les projette vers la mort. Tous les contes sont empreints de solitude et de merveilleux, de souffrance et d'etrangete, de vulnerabilite et de fantastique, de doute, de cruaute et d'angoisse, de l'ambiguite de toute existence, et surtout d'une obsessive interrogation sur l'identite humaine. A contrecourant de tout positivisme, de tout scientisme, Schwob insiste sur le mystere de la vie, sur les interrogations qu'exister exige. C'est comme s'il proposait des experimentations sur l'existence, des tests verifiant des possibilites de vie. Et le point d'orgue en est toujours la mort. le livre pourrait s'appeler morts imaginaires (et si j'appuie lourdement sur l'effet: morts exemplaires). Lui-meme, deja gravement malade, voyagea jusqu'a Samoa chercher une tombe (celle de Stevenson) qu'il ne trouva pas. Ce voyage faillit lui couter la vie, ce qui fit dire a Jules Renard: "Avant sa mort il vit ses contes".
Schwob est souvent traite d'auteur mineur, mais son influence est profonde. Chez Borges, Faulkner, Perec, Bolano, Michon, pur n'en citer que quelques grands. "Dans toutes les parties du monde il y a des devots de Marcel Schwob qui se constituent en petites societes secretes", ecrivait Jorge Luis Borges. Et ce sont peut-etre ces societes qui ont travaille secretement a l'occulter aux yeux des autres, pour mieux le garder pour leurs seuls membres.
Le style fastueux de Schwob, son long souffle poetique, sa somptuosite linguistique, servent admirablement son propos. C'est un plaisir de lecture, quoique je conseillerais de ne pas franchir ce petit livre d'une seule traite. L'abus de belles histoires, de beaux textes, risque de nous gaver, de nous faire rejeter une partie. A consommer donc avec moderation. Il me faut dire que j'ai eu la chance d'avoir sous la main la merveilleuse edition de le Livre Contemporain de 1929, avec les illustrations hautes en couleur de George Barbier, gravees sur bois par Pierre Bouchet, qui enrichissent encore plus le texte.
Pas une petite friandise, un regal; ce livre a ete pour moi un regal, pour l'esprit et pour les sens.
4 etoiles.
Dans sa préface, Marcel Schwob déclare que ce n'est pas la vérité qui compte dans la biographie. La messe est dite. La suite est une ribambelle de personnages factices, à l'ombre de ceux dont l'historicité est attestée, croqués sur quelques pages, par ce mémorialiste de l'affabulation.
Ce qui frappe avant tout, c'est l'érudition. Schwob n'est pas une lecture aisée. le style résolument soutenu, les précisions historiques fouillées, le vocabulaire suranné exigent une lecture plus qu'attentive.
Le piège de ces vies imaginaires sur fond d'histoire avérée, c'est le doute. le doute s'immisce, tel un mirage, dans l'esprit embrumé du lecteur. L'auteur brouille les pistes avec son « mentir-vrai » - pour reprendre le mot d'Aragon - faisant interagir un personnage fictif avec Diogène, Jeanne d'Arc, Pocahontas ou Alexandre le Grand. Commence alors la traque de chacun des détails semés par le narrateur afin d'en séparer le blanc du jaune. Est-ce « seulement » un vaste délire mythomane génial ou bien des détails extrêmement précis et réels, fruits d'une méticuleuse besogne de chercheur, s'entrelacent-ils dans les creux des reliefs de ces vies inventées ?
L'auteur déroule le fil de ces existences, naviguant au gré des civilisations antiques ou de la renaissance italienne, de leurs parfums, leurs oracles, leurs horreurs et leur philosophie, le tout dans une prose poétique.
Ces contes, défis ludiques et accomplissements créatifs pour leur auteur, nous emmènent en balade, flâneuse et alerte, à travers les recoins les plus inattendus de l'Histoire et feront passer un moment agréable aux amoureux des auteurs oubliés.
Ce qui frappe avant tout, c'est l'érudition. Schwob n'est pas une lecture aisée. le style résolument soutenu, les précisions historiques fouillées, le vocabulaire suranné exigent une lecture plus qu'attentive.
Le piège de ces vies imaginaires sur fond d'histoire avérée, c'est le doute. le doute s'immisce, tel un mirage, dans l'esprit embrumé du lecteur. L'auteur brouille les pistes avec son « mentir-vrai » - pour reprendre le mot d'Aragon - faisant interagir un personnage fictif avec Diogène, Jeanne d'Arc, Pocahontas ou Alexandre le Grand. Commence alors la traque de chacun des détails semés par le narrateur afin d'en séparer le blanc du jaune. Est-ce « seulement » un vaste délire mythomane génial ou bien des détails extrêmement précis et réels, fruits d'une méticuleuse besogne de chercheur, s'entrelacent-ils dans les creux des reliefs de ces vies inventées ?
L'auteur déroule le fil de ces existences, naviguant au gré des civilisations antiques ou de la renaissance italienne, de leurs parfums, leurs oracles, leurs horreurs et leur philosophie, le tout dans une prose poétique.
Ces contes, défis ludiques et accomplissements créatifs pour leur auteur, nous emmènent en balade, flâneuse et alerte, à travers les recoins les plus inattendus de l'Histoire et feront passer un moment agréable aux amoureux des auteurs oubliés.
Avec le temps la mémoire se meurt mais les écrits reste bien vivants. Des vies disparaissent à jamais d'autres sont immortalisées par les écrivains.
Dans cet ouvrage, des auteurs connus ou anonymes nous racontent des vies réelles ou imaginaires.
A toutes les époques, des écrivains, parmi les plus « grands » se sont essayés à la biographie, certains s'en sont fait une spécialité. Précédés à chaque fois d'une intéressante notice expliquant l'histoire des textes, ces différents écrits montrent, s'il était besoin, le pouvoir de l'écriture. Certains auteurs prenant des « libertés » avec les faits.
C'est un peu la « biographie » dans tous ses « états », sous toutes ses formes, ou les auteurs s'en donnent à coeur joie. Les méthodes varient de la recherche à partir de documents, où l'improbable est éliminé au profit du plausible à l'invention pure et simple. L'on va de l'anecdote à la biographie complète, parfois sur le ton de la « raillerie »ou sur un ton comique. Les amateurs de biographie et de jeux littéraires seront comblés, ils trouveront un intérêt dans la vie d'un personnage ou dans la manière qu'a un écrivain de la raconter.
L'idée de regrouper diverses« biographie » est originale, on peut espérer un deuxième tome, même si celui-ci n'est pas présenté comme le premier d'une éventuelle série.
Dans cet ouvrage, des auteurs connus ou anonymes nous racontent des vies réelles ou imaginaires.
A toutes les époques, des écrivains, parmi les plus « grands » se sont essayés à la biographie, certains s'en sont fait une spécialité. Précédés à chaque fois d'une intéressante notice expliquant l'histoire des textes, ces différents écrits montrent, s'il était besoin, le pouvoir de l'écriture. Certains auteurs prenant des « libertés » avec les faits.
C'est un peu la « biographie » dans tous ses « états », sous toutes ses formes, ou les auteurs s'en donnent à coeur joie. Les méthodes varient de la recherche à partir de documents, où l'improbable est éliminé au profit du plausible à l'invention pure et simple. L'on va de l'anecdote à la biographie complète, parfois sur le ton de la « raillerie »ou sur un ton comique. Les amateurs de biographie et de jeux littéraires seront comblés, ils trouveront un intérêt dans la vie d'un personnage ou dans la manière qu'a un écrivain de la raconter.
L'idée de regrouper diverses« biographie » est originale, on peut espérer un deuxième tome, même si celui-ci n'est pas présenté comme le premier d'une éventuelle série.
Ah, voilà un excellent livre! Qui s'inscrit dans la longue tradition des recueils biographiques.
Dans la préface Marcel Schwob fait une sorte de profession de foi littéraire, il insiste sur l'importance de rendre avec justesse les traits d'un caractère unique, d'une personnalité. Mais plus on avance dans le recueil, plus on se doute qu'il y a bien d'autres choses dans ces petites biographies de quelques pages.
On peut tout de même faire des parallèles, donner deux ou trois grandes lignes directrices. La figure d'Empédocle, par exemple, qui ouvre le recueil, avec sa théorie des éléments, est évoquée plusieurs fois, comme une sorte de génie tutélaire.
Dans l'ensemble, ce sont surtout des personnages historiques qui sont mis en scène, pas les plus illustres ou les plus éminents, mais dont on trouve quand même des notices biographiques sur Wikipédia (en beaucoup plus ennuyeuses et moins colorées que celles de Schwob). L'auteur a choisi des Vies un peu obscures, secondaires : Cratès plutôt que Diogène, Publius Clodius Pulcher plutôt que Cicéron, Cecco Angiolieri plutôt que Dante, Gabriel Spenser plutôt que Ben Johnson. On trouve aussi deux ou trois illustres inconnues, les vies minuscules de prostituées. Et une ou deux histoires extraordinaires ou légendaires. Toutes sont édifiantes puisqu'elles se finissent invariablement par la mort des acteurs principaux, qu'ils soient pauvres, cupides, orgueilleux ou niais.
Plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de la fin, plus on se rend compte que toutes ces vies sont de plus en plus imprégnées par l'infamie. de la décadence romaine aux tueurs en série modernes, en passant par les pirates, c'est sanglant, cruel et immoral. Et je pense surtout à la fantastique histoire de Cyril Tourneur, fils de dieu, athée et tueur de roi, un petit bijou de noirceur, magnifique du premier au dernier mot. Mais ça peut-être aussi très drôle, comme l'inénarrable et truculent pirate analphabète Walter Kennedy.
Dans la préface Marcel Schwob fait une sorte de profession de foi littéraire, il insiste sur l'importance de rendre avec justesse les traits d'un caractère unique, d'une personnalité. Mais plus on avance dans le recueil, plus on se doute qu'il y a bien d'autres choses dans ces petites biographies de quelques pages.
On peut tout de même faire des parallèles, donner deux ou trois grandes lignes directrices. La figure d'Empédocle, par exemple, qui ouvre le recueil, avec sa théorie des éléments, est évoquée plusieurs fois, comme une sorte de génie tutélaire.
Dans l'ensemble, ce sont surtout des personnages historiques qui sont mis en scène, pas les plus illustres ou les plus éminents, mais dont on trouve quand même des notices biographiques sur Wikipédia (en beaucoup plus ennuyeuses et moins colorées que celles de Schwob). L'auteur a choisi des Vies un peu obscures, secondaires : Cratès plutôt que Diogène, Publius Clodius Pulcher plutôt que Cicéron, Cecco Angiolieri plutôt que Dante, Gabriel Spenser plutôt que Ben Johnson. On trouve aussi deux ou trois illustres inconnues, les vies minuscules de prostituées. Et une ou deux histoires extraordinaires ou légendaires. Toutes sont édifiantes puisqu'elles se finissent invariablement par la mort des acteurs principaux, qu'ils soient pauvres, cupides, orgueilleux ou niais.
Plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de la fin, plus on se rend compte que toutes ces vies sont de plus en plus imprégnées par l'infamie. de la décadence romaine aux tueurs en série modernes, en passant par les pirates, c'est sanglant, cruel et immoral. Et je pense surtout à la fantastique histoire de Cyril Tourneur, fils de dieu, athée et tueur de roi, un petit bijou de noirceur, magnifique du premier au dernier mot. Mais ça peut-être aussi très drôle, comme l'inénarrable et truculent pirate analphabète Walter Kennedy.
Dans sa préface, l'auteur traite de différents biographes et montre combien peu sont ceux qui s'intéressent aux détails de la vie des hommes dont ils racontent la vie – qui est alors faite d'un ensemble, d'une succession d'événements. Pourtant, ce sont ces détails qui particularisent un homme, le rendent unique, vivant dans l'histoire des êtres génériques et interchangeables. C'est le rôle du littérateur de compléter, de remplir ces biographies d'éléments particularisant, quitte à les inventer.
Marcel Schwob rejoint dans sa préface la critique qui sera adressée à l'histoire classique – une succession d'événements. L'histoire s'est depuis intéressée à la vie commune et courantes – les modes de vie des grands, des pauvres… Marcel Schwob propose de réaliser ce travail dans la fiction pour compléter par la suggestion ces vies de légendes, pour en faire devenir des personnages vivants et uniques.
Ces vies imaginaires semblent être volontairement courtes, faites uniquement de ces petits détails cruciaux qui font l'unicité du personnage. En jouant sur les détails historiques et légendaires, Schwob construit un filet de références littéraires et historiques, il intègre les personnages parmi l'imaginaire collectif C'est ce jeu littéraire qui inspirera si fort Les Fictions de Jorge Luis Borges.
Au delà du jeu littéraire sur le travail littéraire, ces biographies fictives présentent un caractère développé jusqu'à son terme, donc exemplaire comme un mythe, se présentant alors comme un support de réflexion sur un sujet. Par exemple, très brièvement : jusqu'où aller pour s'approprier le savoir ou l'amour (Erostrate, Septima), ou l'art (Paolo Uccello), jusqu'où l'application de préceptes philosophiques ou religieux (Cratès, Frate Dolcino), peut-on se détourner du désir physique (Lucrèce, Clodia), peut-on faire partie de deux mondes (Pétrone)…
Sommaire :
A partir de quelques indices de vie en grande partie inconnue, Marcel Schwob complète à l'imagination la vie de ces nombreux personnages divers.
-Empédocle, Dieu supposé : doté de pouvoirs divins qui guérissent et sauvent, il marche au milieu des hommes comme un dieu.
-Erostrate, incendiaire : se destinant à être prêtre d'Artemis et célèbre, il viola le temple d'Artemis à Ephèse pour lire les vers secrets d'Héraclite.
-Cratès, Cynique : qui se dépouilla de ses richesses pour vivre nu dans les ordures, et y eut même un disciple et une femme.
-Septima, incantatrice : esclave qui va pour se faire aimer d'un homme libre, jusqu'à invoquer sa jeune soeur morte.
-Lucrèce, poète : qui ne pouvant accomplir l'amour avec sa femme africaine, se plongea dans les écrits d'Epicure.
-Clodia, matrone impudique : qui ne put oublier ni avec son mari, ni avec Cicéron, son amour incestueux pour son frère l'effronté Clodius.
-Pétrone, romancier : qui fréquentait le bas peuple tout en étant cultivé.
-Sufrah, géomancien : sorcier qui échoua à prendre la lampe d'Aladdin, et qui tenta ensuite de s'approprier le grand sceau du roi Salomon.
-Frate Dolcino, hérétique : qui professe une nouvelle foi encore plus modeste, refusant le travail et prônant le retour à l'innocence de l'enfant.
-Cecco Angliolieri, poète haineux : laid et pauvre car il s'opposait à son père, il vécut dans l'ombre, en double négatif de Dante.
-Paolo Uccello, peintre : observateur des oiseaux, il se détache de la réalité pour la recherche de la pureté des lignes
-Nicolas Loyseleur, juge : moine dévot à la Vierge qui se charge de faire condamner Jeanne d'Arc.
-Catherine la Dentellière, fille amoureuse : orpheline ayant appris le métier de la dentelle, prend goût aux richesses faciles d'un sergent louche.
-Alain le Gentil, soldat : recruté à 12 ans quand une armée prit sa ville, et brigand tonsuré.
-Gabriel Spenser, acteur : né dans un bordel bien fréquenté par des acteurs, devint acteur travesti car il était beau et délicat.
-Pocahantas, princesse indienne qui sauve la vie d'un capitaine avant d'être enlevée par un autre.
-Cyril Tourneur, poète tragique, auteur de la Tragédie de l'athée, né d'une prostituée et d'un dieu inconnu, un jour de peste, détestant par orgueil les rois et les dieux.
-William Phips, pêcheur de trésor : qui fait fortune en repêchant le trésor d'un galion espagnol coulé près d'une île de pirates.
-Le capitaine Kid, pirate : hanté par le fantôme d'un camarade qu'il a assommé lorsque celui-ci lui a fait remarqué qu'il enfreignait ses propres règles de piraterie.
-Walter Kennedy, pirate illettré : qui par son intégrité condamne le traître et fait confiance à un homme de Dieu.
-Le Major Stede Bonnet, pirate par humeur : noble vantant la camaraderie des pirates.
-MM Burke et Hare, assassins : qui invitent un passant, lui font raconter quelque histoire, le coupe en cours et revende son corps au docteur Knox.
-Morphiel, démiurge : chargé de créer des cheveux, il tombe amoureux de son oeuvre.
Lien : https://leluronum.art.blog/2..
Marcel Schwob rejoint dans sa préface la critique qui sera adressée à l'histoire classique – une succession d'événements. L'histoire s'est depuis intéressée à la vie commune et courantes – les modes de vie des grands, des pauvres… Marcel Schwob propose de réaliser ce travail dans la fiction pour compléter par la suggestion ces vies de légendes, pour en faire devenir des personnages vivants et uniques.
Ces vies imaginaires semblent être volontairement courtes, faites uniquement de ces petits détails cruciaux qui font l'unicité du personnage. En jouant sur les détails historiques et légendaires, Schwob construit un filet de références littéraires et historiques, il intègre les personnages parmi l'imaginaire collectif C'est ce jeu littéraire qui inspirera si fort Les Fictions de Jorge Luis Borges.
Au delà du jeu littéraire sur le travail littéraire, ces biographies fictives présentent un caractère développé jusqu'à son terme, donc exemplaire comme un mythe, se présentant alors comme un support de réflexion sur un sujet. Par exemple, très brièvement : jusqu'où aller pour s'approprier le savoir ou l'amour (Erostrate, Septima), ou l'art (Paolo Uccello), jusqu'où l'application de préceptes philosophiques ou religieux (Cratès, Frate Dolcino), peut-on se détourner du désir physique (Lucrèce, Clodia), peut-on faire partie de deux mondes (Pétrone)…
Sommaire :
A partir de quelques indices de vie en grande partie inconnue, Marcel Schwob complète à l'imagination la vie de ces nombreux personnages divers.
-Empédocle, Dieu supposé : doté de pouvoirs divins qui guérissent et sauvent, il marche au milieu des hommes comme un dieu.
-Erostrate, incendiaire : se destinant à être prêtre d'Artemis et célèbre, il viola le temple d'Artemis à Ephèse pour lire les vers secrets d'Héraclite.
-Cratès, Cynique : qui se dépouilla de ses richesses pour vivre nu dans les ordures, et y eut même un disciple et une femme.
-Septima, incantatrice : esclave qui va pour se faire aimer d'un homme libre, jusqu'à invoquer sa jeune soeur morte.
-Lucrèce, poète : qui ne pouvant accomplir l'amour avec sa femme africaine, se plongea dans les écrits d'Epicure.
-Clodia, matrone impudique : qui ne put oublier ni avec son mari, ni avec Cicéron, son amour incestueux pour son frère l'effronté Clodius.
-Pétrone, romancier : qui fréquentait le bas peuple tout en étant cultivé.
-Sufrah, géomancien : sorcier qui échoua à prendre la lampe d'Aladdin, et qui tenta ensuite de s'approprier le grand sceau du roi Salomon.
-Frate Dolcino, hérétique : qui professe une nouvelle foi encore plus modeste, refusant le travail et prônant le retour à l'innocence de l'enfant.
-Cecco Angliolieri, poète haineux : laid et pauvre car il s'opposait à son père, il vécut dans l'ombre, en double négatif de Dante.
-Paolo Uccello, peintre : observateur des oiseaux, il se détache de la réalité pour la recherche de la pureté des lignes
-Nicolas Loyseleur, juge : moine dévot à la Vierge qui se charge de faire condamner Jeanne d'Arc.
-Catherine la Dentellière, fille amoureuse : orpheline ayant appris le métier de la dentelle, prend goût aux richesses faciles d'un sergent louche.
-Alain le Gentil, soldat : recruté à 12 ans quand une armée prit sa ville, et brigand tonsuré.
-Gabriel Spenser, acteur : né dans un bordel bien fréquenté par des acteurs, devint acteur travesti car il était beau et délicat.
-Pocahantas, princesse indienne qui sauve la vie d'un capitaine avant d'être enlevée par un autre.
-Cyril Tourneur, poète tragique, auteur de la Tragédie de l'athée, né d'une prostituée et d'un dieu inconnu, un jour de peste, détestant par orgueil les rois et les dieux.
-William Phips, pêcheur de trésor : qui fait fortune en repêchant le trésor d'un galion espagnol coulé près d'une île de pirates.
-Le capitaine Kid, pirate : hanté par le fantôme d'un camarade qu'il a assommé lorsque celui-ci lui a fait remarqué qu'il enfreignait ses propres règles de piraterie.
-Walter Kennedy, pirate illettré : qui par son intégrité condamne le traître et fait confiance à un homme de Dieu.
-Le Major Stede Bonnet, pirate par humeur : noble vantant la camaraderie des pirates.
-MM Burke et Hare, assassins : qui invitent un passant, lui font raconter quelque histoire, le coupe en cours et revende son corps au docteur Knox.
-Morphiel, démiurge : chargé de créer des cheveux, il tombe amoureux de son oeuvre.
Lien : https://leluronum.art.blog/2..
Citations et extraits (27)
Voir plus
Ajouter une citation
WALTER KENNEDY
PIRATE ILLETTRÉ.
Le capitaine Kennedy était Irlandais et ne savait ni lire, ni écrire. Il parvint au grade de lieutenant, sous le grand Roberts, pour le talent qu’il avait dans la torture. Il possédait parfaitement l’art de tordre une mèche autour du front d’un prisonnier, jusqu’à lui faire sortir les yeux, ou de lui caresser la figure avec des feuilles de palmier enflammées. Sa réputation fut consacrée au jugement qui fut fait, à bord le Corsaire, de Darby Mullin, soupçonné de trahison. Les juges s’assirent contre l’habitacle du timonier, devant un grand bol de punch, avec des pipes et du tabac ; puis le procès commença. On allait voter sur la sentence, quand un des juges proposa de fumer encore une pipe avant la délibération. Alors Kennedy se leva, tira sa pipe de sa bouche, cracha, et parla en ces termes :
— Sacredieu ! messieurs et gentilshommes de fortune, le diable m’emporte si nous ne pendons pas Darby Mullin, mon vieux camarade. Darby est un bon garçon, sacredieu ! jeanfoutre qui dirait le contraire, et nous sommes gentilshommes, diable ! On a souqué ensemble, sacredieu ! et je l’aime de tout mon cœur, foutre ! Messieurs et gentilshommes de fortune, je le connais bien ; c’est un vrai bougre ; s’il vit, il ne se repentira jamais ; le diable m’emporte s’il se repent, n’est-ce pas, mon vieux Darby ? Pendons-le, sacredieu ! et, avec la permission de l’honorable compagnie, je vais boire un bon coup à sa santé. »
Ce discours parut admirable et digne des plus nobles oraisons militaires qui sont rapportées par les anciens. Roberts fut enchanté. De ce jour, Kennedy prit de l’ambition. Au large des Barbades, Roberts s’étant égaré dans une chaloupe à la poursuite d’un vaisseau portugais, Kennedy força ses compagnons à l’élire capitaine du Corsaire, et fit voile à son compte. Ils coulèrent et pillèrent nombre de brigantines et galères, chargées de sucre et de tabac du Brésil, sans compter la poudre d’or, et les sacs pleins de doublons et de pièces de huit. Leur drapeau était de soie noire, avec une tête de mort, un sablier, deux os croisés, et au-dessous un cœur surmonté d’un dard, d’où tombaient trois gouttes de sang. En cet équipage, ils rencontrèrent une chaloupe bien paisible de Virginie, dont le capitaine était un Quaker pieux, nommé Knot. Cet homme de Dieu n’avait à son bord ni rhum, ni pistolet, ni sabre, ni coutelas ; il était vêtu d’un long habit noir, et coiffé d’un chapeau à larges bords de couleur pareille.
— Sacredieu ! dit le capitaine Kennedy, c’est un bon vivant, et gai ; voilà ce que j’aime ; on ne fera pas de mal à mon ami, Monsieur le capitaine Knot, qui est habillé de façon si réjouissante.
M. Knot s’inclina, en faisant des momeries silencieuses.
— Amen, fit M. Knot. Ainsi soit-il.
Les pirates firent des cadeaux à M. Knot. Ils lui offrirent trente moidores, dix rouleaux de tabac du Brésil, et des sachets d’émeraudes. M. Knot prit très bien les moidores, les pierres précieuses et le tabac.
— Ce sont des présents qu’il est permis d’accepter, pour en faire un usage pieux. Ah ! plût au ciel que nos amis, qui sillonnent la mer, fussent tous animés de semblables sentiments ! Le Seigneur accepte toutes les restitutions. Ce sont, pour ainsi dire, les membres du veau, et les parties de l’idole Dagon, que vous lui offrez, mes amis, en sacrifice. Dagon règne encore dans ces pays profanes, et son or donne de mauvaises tentations.
— Bougre de Dagon, dit Kennedy, tais ta gueule, sacredieu ! prends ce qu’on te donne, et bois un coup.
Alors, M. Knot s’inclina paisiblement : mais il refusa son quart de rhum.
— Messieurs mes amis, dit-il…
— Gentilshommes de fortune, sacredieu ! cria Kennedy.
— Messieurs mes amis gentilshommes, reprit M. Knot, les liqueurs fortes sont, pour ainsi dire, des aiguillons de tentation que notre faible chair ne saurait point supporter. Vous autres, mes amis…
— Gentilshommes de fortune, sacredieu ! cria Kennedy.
— Vous autres, mes amis et fortunés gentilshommes, reprit M. Knot, qui êtes endurcis par de longues épreuves contre le Tentateur, il est possible, probable, dirai-je, que vous n’en souffrez point d’inconvénient ; mais vos amis seraient incommodés, gravement incommodés…
— Incommodés au diable ! dit Kennedy. Cet homme parle admirablement, mais je bois mieux. Il nous mènera en Caroline voir ses excellents amis qui possèdent sans doute d’autres membres du veau qu’il dit. N’est-ce pas, Monsieur le capitaine Dagon ?
— Ainsi soit-il, dit le Quaker, mais Knot est mon nom.
Et il s’inclina encore. Les grands bords de son chapeau tremblaient sous le vent.
Le Corsaire jeta l’ancre dans une crique favorite de l’homme de Dieu. Il promit d’amener ses amis, et revint, en effet, le soir même, avec une compagnie de soldats envoyés par M. Spotswood, gouverneur de la Caroline. L’homme de Dieu jura à ses amis, les fortunés gentilshommes, que ce n’était qu’à l’effet de les empêcher d’introduire en ces pays profanes leurs tentatrices liqueurs. Et quand les pirates furent arrêtés :
— Ah ! mes amis, dit M. Knot, acceptez toutes les mortifications, ainsi que je l’ai fait.
— Sacredieu ! mortification est le mot, jura Kennedy.
Il fut mis aux fers à bord d’un transport pour être jugé à Londres. Old Bailey le reçut. Il fit des croix sur tous ses interrogatoires, et y posa la même marque que sur ses quittances de prise. Son dernier discours fut prononcé sur le quai de l’Exécution, où la brise de mer ballottait les cadavres d’anciens gentilshommes de fortune, pendus dans leurs chaînes.
— Sacredieu ! c’est bien de l’honneur, dit Kennedy en regardant les pendus. Ils vont m’accrocher à côté du capitaine Kid. Il n’a plus d’yeux, mais cela doit bien être lui. Il n’y avait que lui pour porter un si riche habit de drap cramoisi. Kid a toujours été un homme élégant. Et il écrivait ! Il connaissait ses lettres, foutre ! Une si belle main ! Excuse, capitaine. (Il salua le corps sec en habit cramoisi.) Mais on a été aussi gentilhomme de fortune.
PIRATE ILLETTRÉ.
Le capitaine Kennedy était Irlandais et ne savait ni lire, ni écrire. Il parvint au grade de lieutenant, sous le grand Roberts, pour le talent qu’il avait dans la torture. Il possédait parfaitement l’art de tordre une mèche autour du front d’un prisonnier, jusqu’à lui faire sortir les yeux, ou de lui caresser la figure avec des feuilles de palmier enflammées. Sa réputation fut consacrée au jugement qui fut fait, à bord le Corsaire, de Darby Mullin, soupçonné de trahison. Les juges s’assirent contre l’habitacle du timonier, devant un grand bol de punch, avec des pipes et du tabac ; puis le procès commença. On allait voter sur la sentence, quand un des juges proposa de fumer encore une pipe avant la délibération. Alors Kennedy se leva, tira sa pipe de sa bouche, cracha, et parla en ces termes :
— Sacredieu ! messieurs et gentilshommes de fortune, le diable m’emporte si nous ne pendons pas Darby Mullin, mon vieux camarade. Darby est un bon garçon, sacredieu ! jeanfoutre qui dirait le contraire, et nous sommes gentilshommes, diable ! On a souqué ensemble, sacredieu ! et je l’aime de tout mon cœur, foutre ! Messieurs et gentilshommes de fortune, je le connais bien ; c’est un vrai bougre ; s’il vit, il ne se repentira jamais ; le diable m’emporte s’il se repent, n’est-ce pas, mon vieux Darby ? Pendons-le, sacredieu ! et, avec la permission de l’honorable compagnie, je vais boire un bon coup à sa santé. »
Ce discours parut admirable et digne des plus nobles oraisons militaires qui sont rapportées par les anciens. Roberts fut enchanté. De ce jour, Kennedy prit de l’ambition. Au large des Barbades, Roberts s’étant égaré dans une chaloupe à la poursuite d’un vaisseau portugais, Kennedy força ses compagnons à l’élire capitaine du Corsaire, et fit voile à son compte. Ils coulèrent et pillèrent nombre de brigantines et galères, chargées de sucre et de tabac du Brésil, sans compter la poudre d’or, et les sacs pleins de doublons et de pièces de huit. Leur drapeau était de soie noire, avec une tête de mort, un sablier, deux os croisés, et au-dessous un cœur surmonté d’un dard, d’où tombaient trois gouttes de sang. En cet équipage, ils rencontrèrent une chaloupe bien paisible de Virginie, dont le capitaine était un Quaker pieux, nommé Knot. Cet homme de Dieu n’avait à son bord ni rhum, ni pistolet, ni sabre, ni coutelas ; il était vêtu d’un long habit noir, et coiffé d’un chapeau à larges bords de couleur pareille.
— Sacredieu ! dit le capitaine Kennedy, c’est un bon vivant, et gai ; voilà ce que j’aime ; on ne fera pas de mal à mon ami, Monsieur le capitaine Knot, qui est habillé de façon si réjouissante.
M. Knot s’inclina, en faisant des momeries silencieuses.
— Amen, fit M. Knot. Ainsi soit-il.
Les pirates firent des cadeaux à M. Knot. Ils lui offrirent trente moidores, dix rouleaux de tabac du Brésil, et des sachets d’émeraudes. M. Knot prit très bien les moidores, les pierres précieuses et le tabac.
— Ce sont des présents qu’il est permis d’accepter, pour en faire un usage pieux. Ah ! plût au ciel que nos amis, qui sillonnent la mer, fussent tous animés de semblables sentiments ! Le Seigneur accepte toutes les restitutions. Ce sont, pour ainsi dire, les membres du veau, et les parties de l’idole Dagon, que vous lui offrez, mes amis, en sacrifice. Dagon règne encore dans ces pays profanes, et son or donne de mauvaises tentations.
— Bougre de Dagon, dit Kennedy, tais ta gueule, sacredieu ! prends ce qu’on te donne, et bois un coup.
Alors, M. Knot s’inclina paisiblement : mais il refusa son quart de rhum.
— Messieurs mes amis, dit-il…
— Gentilshommes de fortune, sacredieu ! cria Kennedy.
— Messieurs mes amis gentilshommes, reprit M. Knot, les liqueurs fortes sont, pour ainsi dire, des aiguillons de tentation que notre faible chair ne saurait point supporter. Vous autres, mes amis…
— Gentilshommes de fortune, sacredieu ! cria Kennedy.
— Vous autres, mes amis et fortunés gentilshommes, reprit M. Knot, qui êtes endurcis par de longues épreuves contre le Tentateur, il est possible, probable, dirai-je, que vous n’en souffrez point d’inconvénient ; mais vos amis seraient incommodés, gravement incommodés…
— Incommodés au diable ! dit Kennedy. Cet homme parle admirablement, mais je bois mieux. Il nous mènera en Caroline voir ses excellents amis qui possèdent sans doute d’autres membres du veau qu’il dit. N’est-ce pas, Monsieur le capitaine Dagon ?
— Ainsi soit-il, dit le Quaker, mais Knot est mon nom.
Et il s’inclina encore. Les grands bords de son chapeau tremblaient sous le vent.
Le Corsaire jeta l’ancre dans une crique favorite de l’homme de Dieu. Il promit d’amener ses amis, et revint, en effet, le soir même, avec une compagnie de soldats envoyés par M. Spotswood, gouverneur de la Caroline. L’homme de Dieu jura à ses amis, les fortunés gentilshommes, que ce n’était qu’à l’effet de les empêcher d’introduire en ces pays profanes leurs tentatrices liqueurs. Et quand les pirates furent arrêtés :
— Ah ! mes amis, dit M. Knot, acceptez toutes les mortifications, ainsi que je l’ai fait.
— Sacredieu ! mortification est le mot, jura Kennedy.
Il fut mis aux fers à bord d’un transport pour être jugé à Londres. Old Bailey le reçut. Il fit des croix sur tous ses interrogatoires, et y posa la même marque que sur ses quittances de prise. Son dernier discours fut prononcé sur le quai de l’Exécution, où la brise de mer ballottait les cadavres d’anciens gentilshommes de fortune, pendus dans leurs chaînes.
— Sacredieu ! c’est bien de l’honneur, dit Kennedy en regardant les pendus. Ils vont m’accrocher à côté du capitaine Kid. Il n’a plus d’yeux, mais cela doit bien être lui. Il n’y avait que lui pour porter un si riche habit de drap cramoisi. Kid a toujours été un homme élégant. Et il écrivait ! Il connaissait ses lettres, foutre ! Une si belle main ! Excuse, capitaine. (Il salua le corps sec en habit cramoisi.) Mais on a été aussi gentilhomme de fortune.
« - Ne t'ai-je pas commandé, dit Xantus, d'acheter ce qu'il y aurait de meilleur ?
-Et qu'y a-t-il de meilleur que la langue ? Reprit Esope. C'est le lien de la vie civile, la clef des sciences, l'organe de la vérité et de la raison : par elle on bâtit les villes et on les police ; on instruit, on persuade, on règne dans les assemblées ; on s'acquitte du premier de tous les devoirs, qui est de louer les Dieux.
-Eh bien ! Dit Xantus qui prétendait l'attraper, achète-moi demain ce qui est de pire : ces mêmes personnes viendront chez moi ; et je veux diversifier . »
Le lendemain Esope ne fit encore servir que le même mets, disant que la langue est la pire chose qui soit au monde.
- » C'est la mère de tous débats, la nourrice des procès, la source des divisions et des guerres. Si on dit qu'elle est l'organe de la vérité, c'est aussi celui de l'erreur, et qui pis est, de la calomnie. Par elle on détruit les villes, on persuade de méchantes choses. Si d'un côté elle loue les Dieux, de l'autre elle profère des blasphèmes contre leur puissance. »
( la vie d'Esope le Phrygien )
-Et qu'y a-t-il de meilleur que la langue ? Reprit Esope. C'est le lien de la vie civile, la clef des sciences, l'organe de la vérité et de la raison : par elle on bâtit les villes et on les police ; on instruit, on persuade, on règne dans les assemblées ; on s'acquitte du premier de tous les devoirs, qui est de louer les Dieux.
-Eh bien ! Dit Xantus qui prétendait l'attraper, achète-moi demain ce qui est de pire : ces mêmes personnes viendront chez moi ; et je veux diversifier . »
Le lendemain Esope ne fit encore servir que le même mets, disant que la langue est la pire chose qui soit au monde.
- » C'est la mère de tous débats, la nourrice des procès, la source des divisions et des guerres. Si on dit qu'elle est l'organe de la vérité, c'est aussi celui de l'erreur, et qui pis est, de la calomnie. Par elle on détruit les villes, on persuade de méchantes choses. Si d'un côté elle loue les Dieux, de l'autre elle profère des blasphèmes contre leur puissance. »
( la vie d'Esope le Phrygien )
"Mais elle pleurera, elle, à ton silence; passée aux bras d'un autre, elle te regrettera toute sa vie, et tu auras corrompu sa destinée. Oui, elle pleurera, durant huit jours, d'un regret mêlé de dépit; elle rougira et pâlira tour à tour à mon nom; elle soupirera même, sans le vouloir, à la première nouvelle de ma mort. Mais, dès la seconde pensée, elle se félicitera d'en avoir épousé un qui vit; chaque enfant de plus l'attachera à sa condition nouvelle; elle y sera heureuse, si elle doit l'être; et, arrivé un jour au terme de l'âge, à propos d'une scène d'enfance racontée un soir à la veillée, elle se souviendra de moi par hasard, comme de quelqu'un qui s'y trouvait présent et qu'elle aura autrefois connu."
( Vie de Joseph Delorme )
( Vie de Joseph Delorme )
LUCRÈCE
POÈTE
Lucrèce apparut dans une grande famille qui s’était retirée loin de la vie civile. Ses premiers jours reçurent l’ombre du porche noir d’une haute maison dressée dans la montagne. L’atrium était sévère et les esclaves muets. Il fut entouré, dès l’enfance, par le mépris de la politique et des hommes. Le noble Memmius, qui avait son âge, subit, dans la forêt, les jeux que Lucrèce lui imposa. Ensemble, ils s’étonnèrent devant les rides des vieux arbres et épièrent le tremblement des feuilles sous le soleil, comme un voile viride de lumière jonché de taches d’or. Ils considérèrent souvent les dos rayés des pourceaux sauvages qui humaient le sol. Ils traversèrent des fusées frémissantes d’abeilles et des bandes mobiles de fourmis en marche. Et un jour ils parvinrent, en débouchant d’un taillis, à une clairière tout entourée d’anciens chênes-lièges, si étroitement assis, que leur cercle creusait dans le ciel un puits de bleu. Le repos de cet asile était infini. Il semblait qu’on fût dans une large route claire qui allait vers le haut de l’air divin. Lucrèce y fut touché par la bénédiction des espaces calmes.
Avec Memmius il quitta le temple serein de la forêt pour étudier l’éloquence à Rome. L’ancien gentilhomme qui gouvernait la haute maison lui donna un professeur grec et lui enjoignit de ne revenir que lorsqu’il posséderait l’art de mépriser les actions humaines. Lucrèce ne le revit plus. Il mourut solitaire, exécrant le tumulte de la société. Quand Lucrèce revint, il ramenait dans la haute maison vide, vers l’atrium sévère et parmi les esclaves muets, une femme africaine, belle, barbare et méchante. Memmius était retourné dans la maison de ses pères. Lucrèce avait vu les factions sanglantes, les guerres de partis et la corruption politique. Il était amoureux.
POÈTE
Lucrèce apparut dans une grande famille qui s’était retirée loin de la vie civile. Ses premiers jours reçurent l’ombre du porche noir d’une haute maison dressée dans la montagne. L’atrium était sévère et les esclaves muets. Il fut entouré, dès l’enfance, par le mépris de la politique et des hommes. Le noble Memmius, qui avait son âge, subit, dans la forêt, les jeux que Lucrèce lui imposa. Ensemble, ils s’étonnèrent devant les rides des vieux arbres et épièrent le tremblement des feuilles sous le soleil, comme un voile viride de lumière jonché de taches d’or. Ils considérèrent souvent les dos rayés des pourceaux sauvages qui humaient le sol. Ils traversèrent des fusées frémissantes d’abeilles et des bandes mobiles de fourmis en marche. Et un jour ils parvinrent, en débouchant d’un taillis, à une clairière tout entourée d’anciens chênes-lièges, si étroitement assis, que leur cercle creusait dans le ciel un puits de bleu. Le repos de cet asile était infini. Il semblait qu’on fût dans une large route claire qui allait vers le haut de l’air divin. Lucrèce y fut touché par la bénédiction des espaces calmes.
Avec Memmius il quitta le temple serein de la forêt pour étudier l’éloquence à Rome. L’ancien gentilhomme qui gouvernait la haute maison lui donna un professeur grec et lui enjoignit de ne revenir que lorsqu’il posséderait l’art de mépriser les actions humaines. Lucrèce ne le revit plus. Il mourut solitaire, exécrant le tumulte de la société. Quand Lucrèce revint, il ramenait dans la haute maison vide, vers l’atrium sévère et parmi les esclaves muets, une femme africaine, belle, barbare et méchante. Memmius était retourné dans la maison de ses pères. Lucrèce avait vu les factions sanglantes, les guerres de partis et la corruption politique. Il était amoureux.
PAOLO UCCELLO
PEINTRE
Il se nommait vraiment Paolo di Dono ; mais les Florentins l’appelèrent Uccelli, ou Paul les Oiseaux, à cause du grand nombre d’oiseaux figurés et de bêtes peintes qui remplissaient sa maison : car il était trop pauvre pour nourrir des animaux ou pour se procurer ceux qu’il ne connaissait point. On dit même qu’à Padoue il exécuta une fresque des quatre éléments, et qu’il donna pour attribut à l’air l’image du caméléon. Mais il n’en avait jamais vu, de sorte qu’il représenta un chameau ventru qui a la gueule bée. (Or le caméléon, explique Vasari, est semblable à un petit lézard sec, au lieu que le chameau est une grande bête dégingandée.) Car Uccello ne se souciait point de la réalité des choses, mais de leur multiplicité et de l’infini des lignes ; de sorte qu’il fit des champs bleus, et des cités rouges, et des cavaliers vêtus d’armures noires sur des chevaux d’ébène dont la bouche est enflammée, et des lances dirigées comme des rayons de lumière vers tous les points du ciel. Et il avait coutume de dessiner des mazocchi, qui sont des cercles de bois recouvert de drap que l’on place sur la tête, de façon que les plis de l’étoffe rejetée entourent tout le visage. Uccello en figura de pointus, d’autres carrés, d’autres à facettes, disposés en pyramides et en cônes, suivant toutes les apparences de la perspective, si bien qu’il trouvait un monde de combinaisons dans les replis du mazocchio. Et le sculpteur Donatello lui disait : « Ah ! Paolo, tu laisses la substance pour l’ombre ! »
Mais l’Oiseau continuait son œuvre patiente, et il assemblait les cercles, et il divisait les angles, et il examinait toutes les créatures sous tous leurs aspects, et il allait demander l’interprétation des problèmes d’Euclide à son ami le mathématicien Giovanni Manetti ; puis il s’enfermait et couvrait ses parchemins et ses bois de points et de courbes. Il s’employa perpétuellement à l’étude de l’architecture, en quoi il se fit aider par Filippo Brunelleschi ; mais ce n’était point dans l’intention de construire. Il se bornait à remarquer les directions des lignes, depuis les fondations jusqu’aux corniches, et la convergence des droites à leurs intersections, et la manière dont les voûtes tournaient à leurs clefs, et le raccourci en éventail des poutres de plafond qui semblaient s’unir à l’extrémité des longues salles. Il représentait aussi toutes les bêtes et leurs mouvements, et les gestes des hommes, afin de les réduire en lignes simples.
Ensuite, semblable à l’alchimiste qui se penchait sur les mélanges de métaux et d’organes et qui épiait leur fusion à son fourneau pour trouver l’or, Uccello versait toutes les formes dans le creuset des formes. Il les réunissait, et les combinait, et les fondait, afin d’obtenir leur transmutation dans la forme simple, d’où dépendent toutes les autres. Voilà pourquoi Paolo Uccello vécut comme un alchimiste au fond de sa petite maison. Il crut qu’il pourrait muer toutes les lignes en un seul aspect idéal. Il voulut concevoir l’univers créé ainsi qu’il se reflétait dans l’œil de Dieu, qui voit jaillir toutes les figures hors d’un centre complexe. Autour de lui vivaient Ghiberti, della Robbia, Brunelleschi, Donatello, chacun orgueilleux et maître de son art, raillant le pauvre Uccello, et sa folie de la perspective, plaignant sa maison pleine d’araignées, vide de provisions ; mais Uccello était plus orgueilleux encore. À chaque nouvelle combinaison de lignes, il espérait avoir découvert le mode de créer. Ce n’était pas l’imitation où il mettait son but, mais la puissance de développer souverainement toutes choses, et l’étrange série de chaperons à plis lui semblait plus révélatrice que les magnifiques figures de marbre du grand Donatello.
Ainsi vivait l’Oiseau, et sa tête pensive était enveloppée dans sa cape ; et il ne s’apercevait ni de ce qu’il mangeait ni de ce qu’il buvait, mais il était entièrement pareil à un ermite. En sorte que dans une prairie, près d’un cercle de vieilles pierres enfoncées parmi l’herbe, il aperçut un jour une jeune fille qui riait, la tête ceinte d’une guirlande. Elle portait une longue robe délicate soutenue aux reins par un ruban pâle, et ses mouvements étaient souples comme les tiges qu’elle courbait. Son nom était Selvaggia, et elle sourit à Uccello. Il nota la flexion de son sourire. Et quand elle le regarda, il vit toutes les petites lignes de ses cils, et les cercles de ses prunelles, et la courbe de ses paupières, et les enlacements subtils de ses cheveux, et il fit décrire dans sa pensée à la guirlande qui ceignait son front une multitude de positions. Mais Selvaggia ne sut rien de cela, parce qu’elle avait seulement treize ans. Elle prit Uccello par la main et elle l’aima. C’était la fille d’un teinturier de Florence, et sa mère était morte. Une autre femme était venue dans la maison, et elle avait battu Selvaggia. Uccello la ramena chez lui.
Selvaggia demeurait accroupie tout le jour devant la muraille sur laquelle Uccello traçait les formes universelles. Jamais elle ne comprit pourquoi il préférait considérer des lignes droites et des lignes arquées à regarder la tendre figure qui se levait vers lui. Le soir, quand Brunelleschi ou Manetti venaient étudier avec Uccello, elle s’endormait, après minuit, au pied des droites entrecroisées, dans le cercle d’ombre qui s’étendait sous la lampe. Le matin, elle s’éveillait, avant Uccello, et se réjouissait parce qu’elle était entourée d’oiseaux peints et de bêtes de couleur. Uccello dessina ses lèvres, et ses yeux, et ses cheveux, et ses mains, et fixa toutes les attitudes de son corps ; mais il ne fit point son portrait, ainsi que faisaient les autres peintres qui aimaient une femme. Car l’Oiseau ne connaissait pas la joie de se limiter à l’individu ; il ne demeurait point en un seul endroit : il voulait planer, dans son vol, au-dessus de tous les endroits. Et les formes des attitudes de Selvaggia furent jetées au creuset des formes, avec tous les mouvements des bêtes, et les lignes des plantes et des pierres, et les rais de la lumière, et les ondulations des vapeurs terrestres et des vagues de la mer. Et sans se souvenir de Selvaggia, Uccello paraissait demeurer éternellement penché sur le creuset des formes.
Cependant il n’y avait point à manger dans la maison d’Uccello. Selvaggia n’osait le dire à Donatello ni aux autres. Elle se tut et mourut. Uccello représenta le roidissement de son corps, et l’union de ses petites mains maigres, et la ligne de ses pauvres yeux fermés. Il ne sut pas qu’elle était morte, de même qu’il n’avait pas su si elle était vivante. Mais il jeta ces nouvelles formes parmi toutes celles qu’il avait rassemblées.
L’Oiseau devint vieux, et personne ne comprenait plus ses tableaux. On n’y voyait qu’une confusion de courbes. On ne reconnaissait plus ni la terre, ni les plantes, ni les animaux, ni les hommes. Depuis de longues années, il travaillait à son œuvre suprême, qu’il cachait à tous les yeux. Elle devait embrasser toutes ses recherches, et elle en était l’image dans sa conception. C’était saint Thomas incrédule, tentant la plaie du Christ. Uccello termina son tableau à quatre-vingts ans. Il fit venir Donatello, et le découvrit pieusement devant lui. Et Donatello s’écria : « Ô Paolo, recouvre ton tableau ! » L’Oiseau interrogea le grand sculpteur : mais il ne voulut dire autre chose. De sorte qu’Uccello connut qu’il avait accompli le miracle. Mais Donatello n’avait vu qu’un fouillis de lignes.
Et quelques années plus tard, on trouva Paolo Uccello mort d’épuisement sur son grabat. Son visage était rayonnant de rides. Ses yeux étaient fixés sur le mystère révélé. Il tenait dans sa main strictement refermée un petit rond de parchemin couvert d’entrelacements qui allaient du centre à la circonférence et qui retournaient de la circonférence au centre.
PEINTRE
Il se nommait vraiment Paolo di Dono ; mais les Florentins l’appelèrent Uccelli, ou Paul les Oiseaux, à cause du grand nombre d’oiseaux figurés et de bêtes peintes qui remplissaient sa maison : car il était trop pauvre pour nourrir des animaux ou pour se procurer ceux qu’il ne connaissait point. On dit même qu’à Padoue il exécuta une fresque des quatre éléments, et qu’il donna pour attribut à l’air l’image du caméléon. Mais il n’en avait jamais vu, de sorte qu’il représenta un chameau ventru qui a la gueule bée. (Or le caméléon, explique Vasari, est semblable à un petit lézard sec, au lieu que le chameau est une grande bête dégingandée.) Car Uccello ne se souciait point de la réalité des choses, mais de leur multiplicité et de l’infini des lignes ; de sorte qu’il fit des champs bleus, et des cités rouges, et des cavaliers vêtus d’armures noires sur des chevaux d’ébène dont la bouche est enflammée, et des lances dirigées comme des rayons de lumière vers tous les points du ciel. Et il avait coutume de dessiner des mazocchi, qui sont des cercles de bois recouvert de drap que l’on place sur la tête, de façon que les plis de l’étoffe rejetée entourent tout le visage. Uccello en figura de pointus, d’autres carrés, d’autres à facettes, disposés en pyramides et en cônes, suivant toutes les apparences de la perspective, si bien qu’il trouvait un monde de combinaisons dans les replis du mazocchio. Et le sculpteur Donatello lui disait : « Ah ! Paolo, tu laisses la substance pour l’ombre ! »
Mais l’Oiseau continuait son œuvre patiente, et il assemblait les cercles, et il divisait les angles, et il examinait toutes les créatures sous tous leurs aspects, et il allait demander l’interprétation des problèmes d’Euclide à son ami le mathématicien Giovanni Manetti ; puis il s’enfermait et couvrait ses parchemins et ses bois de points et de courbes. Il s’employa perpétuellement à l’étude de l’architecture, en quoi il se fit aider par Filippo Brunelleschi ; mais ce n’était point dans l’intention de construire. Il se bornait à remarquer les directions des lignes, depuis les fondations jusqu’aux corniches, et la convergence des droites à leurs intersections, et la manière dont les voûtes tournaient à leurs clefs, et le raccourci en éventail des poutres de plafond qui semblaient s’unir à l’extrémité des longues salles. Il représentait aussi toutes les bêtes et leurs mouvements, et les gestes des hommes, afin de les réduire en lignes simples.
Ensuite, semblable à l’alchimiste qui se penchait sur les mélanges de métaux et d’organes et qui épiait leur fusion à son fourneau pour trouver l’or, Uccello versait toutes les formes dans le creuset des formes. Il les réunissait, et les combinait, et les fondait, afin d’obtenir leur transmutation dans la forme simple, d’où dépendent toutes les autres. Voilà pourquoi Paolo Uccello vécut comme un alchimiste au fond de sa petite maison. Il crut qu’il pourrait muer toutes les lignes en un seul aspect idéal. Il voulut concevoir l’univers créé ainsi qu’il se reflétait dans l’œil de Dieu, qui voit jaillir toutes les figures hors d’un centre complexe. Autour de lui vivaient Ghiberti, della Robbia, Brunelleschi, Donatello, chacun orgueilleux et maître de son art, raillant le pauvre Uccello, et sa folie de la perspective, plaignant sa maison pleine d’araignées, vide de provisions ; mais Uccello était plus orgueilleux encore. À chaque nouvelle combinaison de lignes, il espérait avoir découvert le mode de créer. Ce n’était pas l’imitation où il mettait son but, mais la puissance de développer souverainement toutes choses, et l’étrange série de chaperons à plis lui semblait plus révélatrice que les magnifiques figures de marbre du grand Donatello.
Ainsi vivait l’Oiseau, et sa tête pensive était enveloppée dans sa cape ; et il ne s’apercevait ni de ce qu’il mangeait ni de ce qu’il buvait, mais il était entièrement pareil à un ermite. En sorte que dans une prairie, près d’un cercle de vieilles pierres enfoncées parmi l’herbe, il aperçut un jour une jeune fille qui riait, la tête ceinte d’une guirlande. Elle portait une longue robe délicate soutenue aux reins par un ruban pâle, et ses mouvements étaient souples comme les tiges qu’elle courbait. Son nom était Selvaggia, et elle sourit à Uccello. Il nota la flexion de son sourire. Et quand elle le regarda, il vit toutes les petites lignes de ses cils, et les cercles de ses prunelles, et la courbe de ses paupières, et les enlacements subtils de ses cheveux, et il fit décrire dans sa pensée à la guirlande qui ceignait son front une multitude de positions. Mais Selvaggia ne sut rien de cela, parce qu’elle avait seulement treize ans. Elle prit Uccello par la main et elle l’aima. C’était la fille d’un teinturier de Florence, et sa mère était morte. Une autre femme était venue dans la maison, et elle avait battu Selvaggia. Uccello la ramena chez lui.
Selvaggia demeurait accroupie tout le jour devant la muraille sur laquelle Uccello traçait les formes universelles. Jamais elle ne comprit pourquoi il préférait considérer des lignes droites et des lignes arquées à regarder la tendre figure qui se levait vers lui. Le soir, quand Brunelleschi ou Manetti venaient étudier avec Uccello, elle s’endormait, après minuit, au pied des droites entrecroisées, dans le cercle d’ombre qui s’étendait sous la lampe. Le matin, elle s’éveillait, avant Uccello, et se réjouissait parce qu’elle était entourée d’oiseaux peints et de bêtes de couleur. Uccello dessina ses lèvres, et ses yeux, et ses cheveux, et ses mains, et fixa toutes les attitudes de son corps ; mais il ne fit point son portrait, ainsi que faisaient les autres peintres qui aimaient une femme. Car l’Oiseau ne connaissait pas la joie de se limiter à l’individu ; il ne demeurait point en un seul endroit : il voulait planer, dans son vol, au-dessus de tous les endroits. Et les formes des attitudes de Selvaggia furent jetées au creuset des formes, avec tous les mouvements des bêtes, et les lignes des plantes et des pierres, et les rais de la lumière, et les ondulations des vapeurs terrestres et des vagues de la mer. Et sans se souvenir de Selvaggia, Uccello paraissait demeurer éternellement penché sur le creuset des formes.
Cependant il n’y avait point à manger dans la maison d’Uccello. Selvaggia n’osait le dire à Donatello ni aux autres. Elle se tut et mourut. Uccello représenta le roidissement de son corps, et l’union de ses petites mains maigres, et la ligne de ses pauvres yeux fermés. Il ne sut pas qu’elle était morte, de même qu’il n’avait pas su si elle était vivante. Mais il jeta ces nouvelles formes parmi toutes celles qu’il avait rassemblées.
L’Oiseau devint vieux, et personne ne comprenait plus ses tableaux. On n’y voyait qu’une confusion de courbes. On ne reconnaissait plus ni la terre, ni les plantes, ni les animaux, ni les hommes. Depuis de longues années, il travaillait à son œuvre suprême, qu’il cachait à tous les yeux. Elle devait embrasser toutes ses recherches, et elle en était l’image dans sa conception. C’était saint Thomas incrédule, tentant la plaie du Christ. Uccello termina son tableau à quatre-vingts ans. Il fit venir Donatello, et le découvrit pieusement devant lui. Et Donatello s’écria : « Ô Paolo, recouvre ton tableau ! » L’Oiseau interrogea le grand sculpteur : mais il ne voulut dire autre chose. De sorte qu’Uccello connut qu’il avait accompli le miracle. Mais Donatello n’avait vu qu’un fouillis de lignes.
Et quelques années plus tard, on trouva Paolo Uccello mort d’épuisement sur son grabat. Son visage était rayonnant de rides. Ses yeux étaient fixés sur le mystère révélé. Il tenait dans sa main strictement refermée un petit rond de parchemin couvert d’entrelacements qui allaient du centre à la circonférence et qui retournaient de la circonférence au centre.
Videos de Marcel Schwob (2)
Voir plusAjouter une vidéo
« Je serai poète, écrivain, dramaturge. D'une façon ou d'une autre, je serai célèbre, quitte à avoir mauvaise réputation. » Oscar Wilde (1854-1900) était un homme de parole : il fut poète, écrivain et dramaturge, il eut une mauvaise réputation et il est célèbre.
[…]
le jeune Wilde, élève brillant, entre au Trinity College de Dublin avec une bourse […] et suit des études classiques : histoire ancienne, philosophie et littérature. Il commence à voyager et découvre l'Italie et la Grèce. […] Il s'installe à Londres et fréquente les milieux élégants intellectuels. […] Il se fabrique une image d'esthète : […] ses tenues vestimentaires de dandy font fureur… Oscar Wilde est à la mode. […] il fait une tournée de conférences sur « l'esthétisme » aux États-Unis, avant de séjourner à Paris où il rencontre Hugo (1802-1885), Daudet (1840-1897), Zola (1840-1902), Edmond de Goncourt (1822-1896) (qui le décrit comme « un individu de sexe douteux »), Verlaine (1844-1896), et les peintres Pissarro (1830-1903), Degas (1834-1917) et Jacques-Émile Blanche (1861-1942). […]
[…] Un second voyage à Paris lui permet de rencontrer Mallarmé (1842-1898), Pierre Louÿs (1870-1925), Marcel Schwob (1867-1905) et André Gide (1869-1951). Juillet 1891 marque le début d'une liaison qui ne se terminera qu'à la mort De Wilde : Alfred Bruce Douglas (1870-1945), « Bosie », vient d'entrer dans sa vie. […] Accusé de sodomie, Wilde […] est arrêté et jugé, […] déclaré coupable d' « actes indécents » et condamné à la peine maximale : deux ans de travaux forcés. […]
Wilde séjourne dans plusieurs prisons […]. Au bout de quelques mois, son état de santé lui vaut d'être dispensé de travaux forcés proprement dits. Ne pouvant payer les frais de justice du procès […], il est condamné pour banqueroute et ses biens sont vendus aux enchères. […] En 1900, un abcès dentaire dégénère en méningite et Oscar Wilde meurt le 30 novembre après avoir reçu, à sa demande, l'absolution d'un prêtre catholique. le convoi funèbre est composé de quelques artistes anglais et français, dont Pierre Louÿs ; Wilde est enterré au cimetière de Bagneux. Ses restes seront transférés au Père-Lachaise en 1909. » (Dominique Jean dans Oscar Wilde, Maximes et autres textes, Éditions Gallimard, 2017)
« […] Les aphorismes traduits ici ont été publiés en 1904, quatre ans après la mort de leur auteur, par Arthur L. Humphreys, qui s'appuyait sur un recueil « analogue » qu'il avait lui-même publié en 1895 sous le titre Oscariana : Epigrams. […] le recueil de 1904 s'intitulait simplement Sebastian Melmoth, Oscar Wilde n'étant mentionné qu'entre crochets. […] Cet ensemble donne un aperçu de la pensée et de l'esprit De Wilde, et si les aphorismes sont parfois contradictoire, ils n'en sont pas moins - précisément - le reflet exact de sa personnalité. Wilde, en public, offrait un tel feu d'artifice de mots d'esprit et de paradoxes que le poète Yeats (1865-1939) a dit qu'il donnait l'impression de les avoir préparés à l'avance […]. » (Bernard Hoepffner)
0:00 - 1er aphorisme 0:17 - 2e aphorisme 0:40 - 3e aphorisme 0:54 - 4e aphorisme 1:19 - 5e aphorisme 1:28 - 6e aphorisme 1:55 - 7e aphorisme 2:20 - 8e aphorisme 2:44 - 9e aphorisme 2:55 - 10e aphorisme 3:51 - 11e aphorisme 4:12 - 12e aphorisme 4:26 - 13e aphorisme 4:40 - 14e aphorisme 5:07 - Générique
Références bibliographiques : Oscar Wilde, Aphorismes, traduits par Bernard Hoepffner, Éditions Mille et une nuits, 1995
Oscar Wilde, Pensées, mots d'esprit, paradoxes, traduits par Alain Blanc, Éditions V
« […] Les aphorismes traduits ici ont été publiés en 1904, quatre ans après la mort de leur auteur, par Arthur L. Humphreys, qui s'appuyait sur un recueil « analogue » qu'il avait lui-même publié en 1895 sous le titre Oscariana : Epigrams. […] le recueil de 1904 s'intitulait simplement Sebastian Melmoth, Oscar Wilde n'étant mentionné qu'entre crochets. […] Cet ensemble donne un aperçu de la pensée et de l'esprit De Wilde, et si les aphorismes sont parfois contradictoire, ils n'en sont pas moins - précisément - le reflet exact de sa personnalité. Wilde, en public, offrait un tel feu d'artifice de mots d'esprit et de paradoxes que le poète Yeats (1865-1939) a dit qu'il donnait l'impression de les avoir préparés à l'avance […]. » (Bernard Hoepffner)
0:00 - 1er aphorisme 0:17 - 2e aphorisme 0:40 - 3e aphorisme 0:54 - 4e aphorisme 1:19 - 5e aphorisme 1:28 - 6e aphorisme 1:55 - 7e aphorisme 2:20 - 8e aphorisme 2:44 - 9e aphorisme 2:55 - 10e aphorisme 3:51 - 11e aphorisme 4:12 - 12e aphorisme 4:26 - 13e aphorisme 4:40 - 14e aphorisme 5:07 - Générique
Références bibliographiques : Oscar Wilde, Aphorismes, traduits par Bernard Hoepffner, Éditions Mille et une nuits, 1995
Oscar Wilde, Pensées, mots d'esprit, paradoxes, traduits par Alain Blanc, Éditions V
+ Lire la suite
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Marcel Schwob (25)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1726 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1726 lecteurs ont répondu