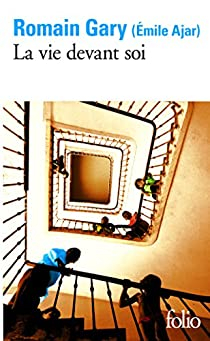>
Critique de Littecritiques
La vie devant soi est le chef d'oeuvre, lauréat du prix Goncourt en 1975 d'Émile Ajar, qui n'est autre que le nom d'emprunt de Romain Gary. Il ne révèlera son identité réelle qu'avant son suicide en 1980 lorsqu'il rédige un ouvrage à son éditeur dans lequel il y révèle toute la supercherie « Je me suis bien amusé. Au revoir et merci ». Il est ainsi le seul écrivain à avoir été récompensé deux fois par le plus grand prix littéraire français, ce qui est officiellement impossible en raison des règles de ce concours. Beau pied de nez de cet écrivain que la critique de l'époque jugeait passé de mode.
Ce roman raconte une histoire d'amour maternelle empruntée entre un petit garçon arabe, Momo, et une très vieille femme juive, Madame Rosa, ancienne prostituée reconvertie qui tient « un clandé pour enfant de putes ». Madame Rosa garde les enfants de prostituées pour ne pas qu'ils se retrouvent à « l'assistance publique ». Attachée à ses enfants, elle ne les y enverra pas, même dans la plus grande précarité, la faiblesse et la vieillesse. Momo est le plus ancien de tous, le plus différent comme le dira à plusieurs reprises son médecin. Madame Rosa refuse de le faire grandir, de lui raconter d'où il vient. Elle veut le garder près d'elle aussi longtemps que possible. Et lui, Momo, lui voue une infinie tendresse. Il n'aura de cesse de l'aider à monter ces six étages sans ascenseur, la rassurer jusqu'à lui mentir, la cacher dans son « trou juif », la garder près d'elle dans la maladie pour ne pas devenir un « légume » à l'hôpital qu'on ne voudrait pas « avorter », lui tenir compagnie jusqu'à sa mort et même au-delà.
Le narrateur n'est autre que Momo, ce petit enfant de dix ans qui a plus d'expérience que les enfants de son âge « croyez-en ma vieille expérience », qui répète ce qu'on lui dit, sans filtre. Au début du roman, il s'embrouille un peu de tous ces termes techniques d' « assistance publique », de prostitution, de « proxynète ». Il est émouvant, drôle, touchant « Pendant longtemps, je n'ai pas su que j'étais arabe parce que personne ne m'insultait. On me l'a seulement appris à l'école ». Il est un enfant de dix ans (enfin à ce qu'on lui a dit) et il dit les choses comme il les pense. Rien n'est plus pur. Puis, au fur et à mesure du roman, lorsqu'il grandit d'un coup parce que « la vie, ça ne pardonne pas », il devient plus mature, plus lucide mais reste toujours très sincère. Il nous retourne l'estomac tant il est anormalement conscient de l'univers dans lequel il vit. Ses réflexions sont pleines de stéréotypes et d'amalgames amusants qui nous plongent dans une profonde réflexion « Elle ne voulait pas entendre parler de l'hôpital où ils vous font mourir jusqu'au bout au lieu de vous faire une piqure. Elle disait qu'en France on était contre la mort douce et qu'on vous forçait à vivre tant que vous étiez encore capable d'en baver ».
Il a saisi le sens de vie « Moi, l'héroïne, je crache dessus. Les mômes qui se piquent deviennent tous habitués au bonheur et ça ne pardonne pas, vu que le bonheur est connu pour ses états de manque » et de l'amour. Il s'agit d'une véritable ode aux sentiments humains les plus nobles. C'est une véritable leçon de vie, d'entente entre les peuples, d'amour envers les siens et les autres. Les personnages tous plus hétéroclites les uns que les autres (la « travestite », le vendeur de tapis ambulant, le « proxynète », le « juif », etc.) sont aimants et aimés. Alors à la question posée au début du roman « Peut-on vivre sans amour ? », il apparaît que non, et heureusement !
Lien : https://littecritiques.wordp..
Ce roman raconte une histoire d'amour maternelle empruntée entre un petit garçon arabe, Momo, et une très vieille femme juive, Madame Rosa, ancienne prostituée reconvertie qui tient « un clandé pour enfant de putes ». Madame Rosa garde les enfants de prostituées pour ne pas qu'ils se retrouvent à « l'assistance publique ». Attachée à ses enfants, elle ne les y enverra pas, même dans la plus grande précarité, la faiblesse et la vieillesse. Momo est le plus ancien de tous, le plus différent comme le dira à plusieurs reprises son médecin. Madame Rosa refuse de le faire grandir, de lui raconter d'où il vient. Elle veut le garder près d'elle aussi longtemps que possible. Et lui, Momo, lui voue une infinie tendresse. Il n'aura de cesse de l'aider à monter ces six étages sans ascenseur, la rassurer jusqu'à lui mentir, la cacher dans son « trou juif », la garder près d'elle dans la maladie pour ne pas devenir un « légume » à l'hôpital qu'on ne voudrait pas « avorter », lui tenir compagnie jusqu'à sa mort et même au-delà.
Le narrateur n'est autre que Momo, ce petit enfant de dix ans qui a plus d'expérience que les enfants de son âge « croyez-en ma vieille expérience », qui répète ce qu'on lui dit, sans filtre. Au début du roman, il s'embrouille un peu de tous ces termes techniques d' « assistance publique », de prostitution, de « proxynète ». Il est émouvant, drôle, touchant « Pendant longtemps, je n'ai pas su que j'étais arabe parce que personne ne m'insultait. On me l'a seulement appris à l'école ». Il est un enfant de dix ans (enfin à ce qu'on lui a dit) et il dit les choses comme il les pense. Rien n'est plus pur. Puis, au fur et à mesure du roman, lorsqu'il grandit d'un coup parce que « la vie, ça ne pardonne pas », il devient plus mature, plus lucide mais reste toujours très sincère. Il nous retourne l'estomac tant il est anormalement conscient de l'univers dans lequel il vit. Ses réflexions sont pleines de stéréotypes et d'amalgames amusants qui nous plongent dans une profonde réflexion « Elle ne voulait pas entendre parler de l'hôpital où ils vous font mourir jusqu'au bout au lieu de vous faire une piqure. Elle disait qu'en France on était contre la mort douce et qu'on vous forçait à vivre tant que vous étiez encore capable d'en baver ».
Il a saisi le sens de vie « Moi, l'héroïne, je crache dessus. Les mômes qui se piquent deviennent tous habitués au bonheur et ça ne pardonne pas, vu que le bonheur est connu pour ses états de manque » et de l'amour. Il s'agit d'une véritable ode aux sentiments humains les plus nobles. C'est une véritable leçon de vie, d'entente entre les peuples, d'amour envers les siens et les autres. Les personnages tous plus hétéroclites les uns que les autres (la « travestite », le vendeur de tapis ambulant, le « proxynète », le « juif », etc.) sont aimants et aimés. Alors à la question posée au début du roman « Peut-on vivre sans amour ? », il apparaît que non, et heureusement !
Lien : https://littecritiques.wordp..