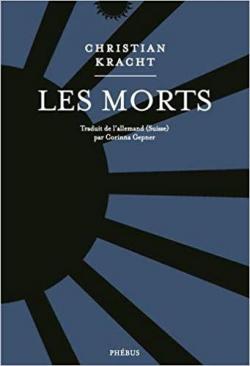>
Critique de cprevost
Christian Kracht nous invite à voyager, au tout début des années trente, en cinématographie nippone et germanique. le Japon écartelé entre économie conquérante, occidentalisation et traditionalisme, mais aussi la République de Weimar foisonnante, écorchée et fiévreuse constituent les extraordinaires arrière-plans de ce très beau livre. Les nationalistes allemands et japonais omniprésents dans le roman, avant le grand affrontement, chauffent leurs muscles et roulent des épaules. Ils sont sur tous les fronts et notamment en première ligne du cinématographe. Forts de leurs talentueux représentants, F. W. Murnau, Fritz Lang ou Y. Ozu, K. Mizoguchi, ils entendent bien damer le pion aux conquérants américains du grand écran et constituer une sorte d'axe « celluloïdique » germano-nippon.
Les amateurs de romans bien documentés, qui mêlent la grande histoire de prodigieux bouleversements et la petite de personnages insignifiants et bien campés, en seront pour leurs frais. Il ne s'agit pas avec « Les morts » de cet artisanat-là. L'auteur suisse ne fait-il pas dire à un de ses personnages : « Il faut inventer quelque chose de neuf, d'inédit, qui soit fautif, oui, c'est exactement ça ; il ne suffit plus de vouloir créer par le film [le roman] une membrane transparente qui permette peut peut-être à un spectateur [lecteur] sur mille de discerner la sombre, la merveilleuse lumière magique derrière les apparences. Il doit créer quelque chose qui soit au plus haut point artificiel tout en se rapportant à soi-même » ? Christian Kracht, en véritable écrivain et en artiste, toujours particularise les personnages, les situations et les lieux. Ils apparaissent le plus souvent pleins de son expérience personnelle et de sa sensibilité. Ainsi, dans ce foisonnant récit, dans ces longues phrases, jamais rien d'asséné. L'idéologie, les sentiments, les défauts et les qualités de chacun sont toujours discrètement suggérés, montrés et jamais déclamés.
La structure du récit semble être ici celle du théâtre nô. Un personnage du roman indique d'ailleurs […] que dans le premier acte , le jo, le rythme des évènements doit commencer avec une lenteur prometteuse, puis s'accélérer dans l'acte suivant, le ha, pour à la fin, dans le kyu, parvenir le plus vite possible à son apogée ». C'est tout à fait cela. Aussi, la première partie du roman prend tout son temps. Elle alterne le présent et le passé, l'orient et l'occident des héros, le réalisateur suisse Emil Nägeli et le haut fonctionnaire japonais Masahiko Amakasu. C'est dans ce chapitre qu'une improbable proposition de collaboration cinématographique est esquissée entre Tokyo et Berlin. La deuxième partie, mêlant personnage historiques et de fiction, prend alors de la vitesse. Emil Nägeli convainc le tout puissant et de sinistre mémoire, patron de l'UFA, Alfred Hugenberg, de financer une gigantesque production cinématographique au Japon. C'est en Allemagne qu'il croise le critique de film Siegfried Kracauer et l'historienne du cinéma Lotte H. Eisner mais c'est de retour au japon qu'il perd sa maitresse et rencontre Charlie Chaplin. La dernière partie enfin, comme il se doit classiquement au Japon, entre farce et histoire, se termine dans un grand fracas qu'il ne convient pas de raconter ici. Décidément, traduit en quinze langues, ce best-seller en Allemagne mérite bien, à notre humble avis, d'être le lauréat du Schweizer Buchpreis 2016.
Les amateurs de romans bien documentés, qui mêlent la grande histoire de prodigieux bouleversements et la petite de personnages insignifiants et bien campés, en seront pour leurs frais. Il ne s'agit pas avec « Les morts » de cet artisanat-là. L'auteur suisse ne fait-il pas dire à un de ses personnages : « Il faut inventer quelque chose de neuf, d'inédit, qui soit fautif, oui, c'est exactement ça ; il ne suffit plus de vouloir créer par le film [le roman] une membrane transparente qui permette peut peut-être à un spectateur [lecteur] sur mille de discerner la sombre, la merveilleuse lumière magique derrière les apparences. Il doit créer quelque chose qui soit au plus haut point artificiel tout en se rapportant à soi-même » ? Christian Kracht, en véritable écrivain et en artiste, toujours particularise les personnages, les situations et les lieux. Ils apparaissent le plus souvent pleins de son expérience personnelle et de sa sensibilité. Ainsi, dans ce foisonnant récit, dans ces longues phrases, jamais rien d'asséné. L'idéologie, les sentiments, les défauts et les qualités de chacun sont toujours discrètement suggérés, montrés et jamais déclamés.
La structure du récit semble être ici celle du théâtre nô. Un personnage du roman indique d'ailleurs […] que dans le premier acte , le jo, le rythme des évènements doit commencer avec une lenteur prometteuse, puis s'accélérer dans l'acte suivant, le ha, pour à la fin, dans le kyu, parvenir le plus vite possible à son apogée ». C'est tout à fait cela. Aussi, la première partie du roman prend tout son temps. Elle alterne le présent et le passé, l'orient et l'occident des héros, le réalisateur suisse Emil Nägeli et le haut fonctionnaire japonais Masahiko Amakasu. C'est dans ce chapitre qu'une improbable proposition de collaboration cinématographique est esquissée entre Tokyo et Berlin. La deuxième partie, mêlant personnage historiques et de fiction, prend alors de la vitesse. Emil Nägeli convainc le tout puissant et de sinistre mémoire, patron de l'UFA, Alfred Hugenberg, de financer une gigantesque production cinématographique au Japon. C'est en Allemagne qu'il croise le critique de film Siegfried Kracauer et l'historienne du cinéma Lotte H. Eisner mais c'est de retour au japon qu'il perd sa maitresse et rencontre Charlie Chaplin. La dernière partie enfin, comme il se doit classiquement au Japon, entre farce et histoire, se termine dans un grand fracas qu'il ne convient pas de raconter ici. Décidément, traduit en quinze langues, ce best-seller en Allemagne mérite bien, à notre humble avis, d'être le lauréat du Schweizer Buchpreis 2016.