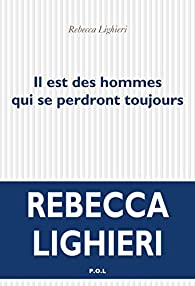>
Critique de Apolline27
le narrateur nous immerge dans une cité des quartiers nord de Marseille dans les années 80. Mais l'immersion se fait progressivement. L'histoire commence dans un café du vieux port, la brasserie du Soleil, par une scène anodine en apparence, mais qui contient en réalité, à elle seule, la totalité du roman, avec au centre, la figure dévastatrice et terrifiante du père. Un père déjà mort, puisque le 1er chapitre, style prologue, en évoque l'assassinat, mais aussi toxique mort que vivant ; une mort qui enclenche le souvenir et le récit d'une enfance massacrée, d'une adolescence saccagée et d'un âge d'homme insoutenable.
Plus on plonge dans l'histoire de cette vie dépouillée de tout ce qui pourrait la rendre supportable, plus on a – en tant que lecteur – le sentiment d'être dans un film plus que dans un roman, au point que la musique manque. On a le rythme, on a les images, on a les mots, les paroles mêmes des chansons du moment, mais il manque la musique, et ce manque est gênant. A la scène d'ouverture, dans le café du vieux port où la mère, Loubna, fonce sur le juke-box et fait grésiller la voix « nasillarde » du chanteur italien Eros Ramazzotti « una storia importante... » pour conjurer la perfidie de Karl, répond, à l'avant dernier chapitre, la voix « suave » de Terence Trent D'Arby et son injonction : « Dance little sister, don't give up today... » qui fait vibrer le narrateur et virevolter sa soeur. Entre les deux, une avalanche de souffrances, de violences, de cruautés familiales, amicales, amoureuses, sexuelles.
Si, au début de l'histoire, dans la petite enfance, l'image de la mère vient éclairer quelque peu un quotidien sordide et insupportable, cette image se dégrade très vite et devient aussi toxique que celle du père, peut-être même plus toxique parce qu'elle ne se donne pas comme telle. A noter que la figure centrale du père atteint des summums de cruauté et de lâcheté, suscitant chez ses trois enfants une haine imprescriptible. Or, autant la littérature nous a habitués à des figures de mères monstrueuses, autant elle reste beaucoup plus nuancée sur les figures de pères. Ils peuvent être froids, volages, calculateurs, autoritaires, violents même, mais rarement, à ma connaissance en tout cas, monstrueux. En cela, Rebecca Lighieri inaugure un genre avec un modèle difficile à égaler et dont le réalisme confère une authenticité qui fait frémir.
Par ailleurs, il ressort de ce récit un pessimisme susceptible de décourager le plus acharné des humanistes. Si, au début du récit, le narrateur enfant peut encore se projeter dans un avenir désirable : « ...Je me sens grand, vertueux, presque heureux – le coeur gonflé d'espoir. C'est peut-être moi le sauveur, après tout. », ces illusions ne font pas long feu. Surgit alors, au fil des pages, le principe incontestable d'une détermination à laquelle nul ne peut échapper, Karel encore moins que quiconque. L'enfance malheureuse et sordide implique nécessairement une vie malheureuse et sordide. Karel, fils de Karl, est condamné à reproduire et à s'approprier violence et cruauté, condamné à rester enfermé dans ce cercle vicieux de la misère matérielle et affective. C'est ce déterminisme qui est asséné à chaque nouvel épisode du roman jusqu'à la citation d'Antonin Artaud, tirée du texte intitulé « La Liquidation de l'opium » paru dans La Révolution surréaliste en janvier 1925 « Il y a des âmes incurables et perdues pour le reste de la société. Supprimez-leur un moyen de folie, elles en inventeront dix mille autres. ». Et cette affirmation nous ramène au titre du roman, emprunté lui aussi à ce même texte dont je redonne ici l'extrait : « L'homme est misérable, l'âme est faible, il est des hommes qui se perdront toujours. Peu importe le moyen de la perte ; ça ne regarde pas la société. » Artaud affirme un déterminisme total que soutient et met en scène le récit de Rebecca Lighieri. Est-il possible d'y échapper ? Comme chez Artaud, qui a donné son nom à la cité marseillaise, la fratrie Claeys n'y échappe que grâce aux paradis artificiels, et encore, y échappent-ils vraiment ? « Tant que ne serons parvenus à supprimer aucune des causes du désespoir humain... » (opus cité) il est probable que nul n'y échappe durablement. Ce devrait être le combat de la richesse de lutter contre la misère et d'en éradiquer les causes. Mais la richesse ne se bat que pour elle-même, et sa générosité n'est qu'un leurre ainsi que le démontre le fugitif et insipide personnage de Jérémie.
Autant de constats bien sombres et un tableau dérangeant de la détresse humaine. Ils mériteraient sans doute une adaptation cinématographique qui pourrait en préciser les contours et, avec un peu de génie, en extirper une parcelle d'espoir.
Plus on plonge dans l'histoire de cette vie dépouillée de tout ce qui pourrait la rendre supportable, plus on a – en tant que lecteur – le sentiment d'être dans un film plus que dans un roman, au point que la musique manque. On a le rythme, on a les images, on a les mots, les paroles mêmes des chansons du moment, mais il manque la musique, et ce manque est gênant. A la scène d'ouverture, dans le café du vieux port où la mère, Loubna, fonce sur le juke-box et fait grésiller la voix « nasillarde » du chanteur italien Eros Ramazzotti « una storia importante... » pour conjurer la perfidie de Karl, répond, à l'avant dernier chapitre, la voix « suave » de Terence Trent D'Arby et son injonction : « Dance little sister, don't give up today... » qui fait vibrer le narrateur et virevolter sa soeur. Entre les deux, une avalanche de souffrances, de violences, de cruautés familiales, amicales, amoureuses, sexuelles.
Si, au début de l'histoire, dans la petite enfance, l'image de la mère vient éclairer quelque peu un quotidien sordide et insupportable, cette image se dégrade très vite et devient aussi toxique que celle du père, peut-être même plus toxique parce qu'elle ne se donne pas comme telle. A noter que la figure centrale du père atteint des summums de cruauté et de lâcheté, suscitant chez ses trois enfants une haine imprescriptible. Or, autant la littérature nous a habitués à des figures de mères monstrueuses, autant elle reste beaucoup plus nuancée sur les figures de pères. Ils peuvent être froids, volages, calculateurs, autoritaires, violents même, mais rarement, à ma connaissance en tout cas, monstrueux. En cela, Rebecca Lighieri inaugure un genre avec un modèle difficile à égaler et dont le réalisme confère une authenticité qui fait frémir.
Par ailleurs, il ressort de ce récit un pessimisme susceptible de décourager le plus acharné des humanistes. Si, au début du récit, le narrateur enfant peut encore se projeter dans un avenir désirable : « ...Je me sens grand, vertueux, presque heureux – le coeur gonflé d'espoir. C'est peut-être moi le sauveur, après tout. », ces illusions ne font pas long feu. Surgit alors, au fil des pages, le principe incontestable d'une détermination à laquelle nul ne peut échapper, Karel encore moins que quiconque. L'enfance malheureuse et sordide implique nécessairement une vie malheureuse et sordide. Karel, fils de Karl, est condamné à reproduire et à s'approprier violence et cruauté, condamné à rester enfermé dans ce cercle vicieux de la misère matérielle et affective. C'est ce déterminisme qui est asséné à chaque nouvel épisode du roman jusqu'à la citation d'Antonin Artaud, tirée du texte intitulé « La Liquidation de l'opium » paru dans La Révolution surréaliste en janvier 1925 « Il y a des âmes incurables et perdues pour le reste de la société. Supprimez-leur un moyen de folie, elles en inventeront dix mille autres. ». Et cette affirmation nous ramène au titre du roman, emprunté lui aussi à ce même texte dont je redonne ici l'extrait : « L'homme est misérable, l'âme est faible, il est des hommes qui se perdront toujours. Peu importe le moyen de la perte ; ça ne regarde pas la société. » Artaud affirme un déterminisme total que soutient et met en scène le récit de Rebecca Lighieri. Est-il possible d'y échapper ? Comme chez Artaud, qui a donné son nom à la cité marseillaise, la fratrie Claeys n'y échappe que grâce aux paradis artificiels, et encore, y échappent-ils vraiment ? « Tant que ne serons parvenus à supprimer aucune des causes du désespoir humain... » (opus cité) il est probable que nul n'y échappe durablement. Ce devrait être le combat de la richesse de lutter contre la misère et d'en éradiquer les causes. Mais la richesse ne se bat que pour elle-même, et sa générosité n'est qu'un leurre ainsi que le démontre le fugitif et insipide personnage de Jérémie.
Autant de constats bien sombres et un tableau dérangeant de la détresse humaine. Ils mériteraient sans doute une adaptation cinématographique qui pourrait en préciser les contours et, avec un peu de génie, en extirper une parcelle d'espoir.