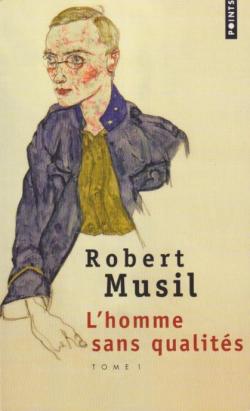>
Critique de FrancescoRimini
Dans "le zéro et l'infini" d'Arthur Koestler, le personnage de Roubachov écrit dans son journal : " L'ère industrielle est encore jeune dans l'histoire, et l'écart reste considérable entre sa structure économique extrêmement complexe et la compréhension de cette structure par les masses".
Robert Musil partage ce point de vue, mais l'élargit : ce n'est pas uniquement la structure économique du monde contemporain qui est extrêmement complexe, mais aussi la structure de la connaissance; et "les masses" ne sont pas les seules à ne pas avoir une compréhension exacte de cette structure; "les élites" elles aussi sont incapable d'en avoir une vue d'ensemble.
L'écart entre le progrès des sciences et de la technique et l'inertie des autres compartiments de la société occupe le centre de la réflexion de Musil. Il se trouve symboliser dès la première page où s'opposent la manière scientifique et la façon ordinaire de décrire une "belle après-midi d'automne".
Pour employer un langage vaguement marxiste, il existe une contradiction entre l'infrastructure (scientifique, technique, productive) et la superstructure (Institutions, Arts, Morale...) de la société.
Cette opposition se trouve représentée de manière satirique sur différents plans : rivalité entre la Prusse et l'Autriche-Hongrie, flirt risible entre Arnheim et Diotime, jalousie croissante de Walter pour Ulrich et polémique interminable sur le cas Moosbrugger, rendue insoluble par la contradiction entre une vision scientifique qui voit du continu, là où la pensée juridique veut des distinctions nettes et tranchées.
Les personnages du roman sont à la recherche d'une solution qui apaiserait cette tension fondamentale entre l'incroyable complexité du réel tel que le conçoit la pensée scientifique et les insurmontables difficultés que cette abondance de détails posent à l'esprit qui réclame quelque chose comme une compréhension globale du monde et de l'existence.
Le roman montre l'émergence progressive des tentations irrationnelles face aux insatisfactions et aux frustrations que crée la pensée scientifique, même auprès de ceux qui se réclament du "cercle de la raison": l'impossibilité d'atteindre à une vision unitaire et synthétique de la réalité ouvre la voie à toutes les solutions irrationnelles : Wagner, le nationalisme, la philosophie charlatanesque de Meingast, l'antisémitisme et la pureté raciale... L'action parallèle, tentative ridicule de réconcilier les émotions avec la raison, aboutit à la guerre.
Ulrich cherche lui aussi à reconstituer l'unité perdue de l'homme, mais il refuse de transiger avec la précision scientifique. Il est conscient d'une mutilation. Il sait que le besoin de synthèse ne peut être étouffer sous l'accumulation pléthorique des constatations de détails de la science, mais il ne veut pas sacrifier cette dernière à une illusion d'unité supérieure.
L'attirance qu'il éprouve pour Clarisse, puis pour Agathe témoigne de ce sentiment.
Robert Musil partage ce point de vue, mais l'élargit : ce n'est pas uniquement la structure économique du monde contemporain qui est extrêmement complexe, mais aussi la structure de la connaissance; et "les masses" ne sont pas les seules à ne pas avoir une compréhension exacte de cette structure; "les élites" elles aussi sont incapable d'en avoir une vue d'ensemble.
L'écart entre le progrès des sciences et de la technique et l'inertie des autres compartiments de la société occupe le centre de la réflexion de Musil. Il se trouve symboliser dès la première page où s'opposent la manière scientifique et la façon ordinaire de décrire une "belle après-midi d'automne".
Pour employer un langage vaguement marxiste, il existe une contradiction entre l'infrastructure (scientifique, technique, productive) et la superstructure (Institutions, Arts, Morale...) de la société.
Cette opposition se trouve représentée de manière satirique sur différents plans : rivalité entre la Prusse et l'Autriche-Hongrie, flirt risible entre Arnheim et Diotime, jalousie croissante de Walter pour Ulrich et polémique interminable sur le cas Moosbrugger, rendue insoluble par la contradiction entre une vision scientifique qui voit du continu, là où la pensée juridique veut des distinctions nettes et tranchées.
Les personnages du roman sont à la recherche d'une solution qui apaiserait cette tension fondamentale entre l'incroyable complexité du réel tel que le conçoit la pensée scientifique et les insurmontables difficultés que cette abondance de détails posent à l'esprit qui réclame quelque chose comme une compréhension globale du monde et de l'existence.
Le roman montre l'émergence progressive des tentations irrationnelles face aux insatisfactions et aux frustrations que crée la pensée scientifique, même auprès de ceux qui se réclament du "cercle de la raison": l'impossibilité d'atteindre à une vision unitaire et synthétique de la réalité ouvre la voie à toutes les solutions irrationnelles : Wagner, le nationalisme, la philosophie charlatanesque de Meingast, l'antisémitisme et la pureté raciale... L'action parallèle, tentative ridicule de réconcilier les émotions avec la raison, aboutit à la guerre.
Ulrich cherche lui aussi à reconstituer l'unité perdue de l'homme, mais il refuse de transiger avec la précision scientifique. Il est conscient d'une mutilation. Il sait que le besoin de synthèse ne peut être étouffer sous l'accumulation pléthorique des constatations de détails de la science, mais il ne veut pas sacrifier cette dernière à une illusion d'unité supérieure.
L'attirance qu'il éprouve pour Clarisse, puis pour Agathe témoigne de ce sentiment.