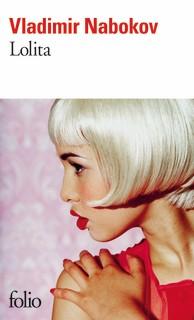>
Critique de JIEMDE
Commencer l'année par une chronique casse-gueule : c'est parti !
Et en même temps, quel exercice prétentieux ! Qu'ai-je de nouveau ou de plus intéressant à apporter à toutes les chroniques déjà faites de Lolita, écrit par Vladimir Nabokov en 1955 et lu dans la traduction de Maurice Couturier ? Car comme beaucoup, j'ai passé cette lecture avec un sentiment constant de malaise profond et de subjugation stylistique.
La raison du malaise est connue, et comme il est dit dans l'introduction du livre, le contexte actuel est paradoxalement plus sensible au contenu que celui de la parution. C'est dire. En ce qui me concerne, les passages licencieux entre Humbert et Lolita, sa « fille » de 12 ans, furent difficilement supportables, extrêmement nauséabonds, physiquement dérangeants. Et qu'on ne me fasse aucun procès en pudibonderie ou obscurantisme mal placé. Ce serait hors sujet…
Mais quand tu as toi-même eu trois filles, comment trouver le détachement nécessaire à la lecture sereine de cette innommable dépendance de Dolorès/Lolita vis-à-vis des sordides pulsions de Humbert ? Comment supporter que cet esclavagisme sexuel soit l'objet de chantages dont les contreparties sont la nourriture (Lolita n'ayant accès à son petit-déjeuner que si elle a « satisfait à son devoir du matin »), la menace d'un placement en orphelinat ou quelques pièces ou billets lâchés après l'extase ?
Comment essayer de comprendre à défaut d'excuser la psychologie de ce père auto-déclaré, qui s'enfonce encore davantage quand il se justifie : « Je ne suis pas un débauché sexuel, un dangereux criminel prenant des libertés indécentes avec une enfant …/… Je suis le thérapeute – petit distinguo subtil, mais qui a son importance. Je suis ton papounet, Lo. » ? Mais rien chez Humbert ne permet d'entrer en empathie, et encore moins en compréhension.
Et c'est probablement là qu'est la clé ! Pourquoi faudrait-il essayer de comprendre un homme dont l'auteur lui-même déclare dans sa postface qu'il est « un personnage abject et horrible, un exemple insigne de lèpre morale …/… Il est anormal. Mais son archet magique sait faire naître une musique si pleine de tendresse et de compassion pour Lolita que l'on succombe au charme du livre alors que l'on abhorre son auteur ». Voilà. Se détacher de l'esprit immonde pour mieux goûter le verbe magnifique.
Et là ce livre touche au sublime, à la quintessence du style. Des styles, serait d'ailleurs plus juste. Car Nabokov excelle dans tous : la beauté et la tendresse lorsqu'il évoque la grâce et la fraîcheur de Dolorès ; la description poétique, notamment dans cette incroyable année de voyage des étés 47 à 48, depuis le Connecticut à travers la moitié des États-Unis pour finir dans le Deep South, ce Dixieland chéri des écrivains américains dans la cour desquels Nabokov veut jouer ; l'étude sociologique fine et détaillée de la société US de cette deuxième moitié du siècle. Il joue sur tous les tableaux, et sur tous, son style fait mouche.
Voilà. Peut-on être à la fois écoeuré et subjugué par un même livre ? Assurément. C'est le paradoxe de Lolita, livre repoussant mais lu avec enthousiasme, comme le résume parfaitement Maurice Couturier : « C'est le rapport entre l'éthique et l'esthétique de l'oeuvre, qui lie irrémédiablement l'esthétique littéraire de l'oeuvre à la transgression éthique qu'elle véhicule ». Touché ! Et impossible de terminer cette chronique sans laisser la parole à Nabokov :
Il neige. le décor s'écroule, Lolita !
Lolita, qu'ai-je fait de ta vie ?
C'est fini, je me meurs, ma Lo, mon rêve !
De haine, de remords, je meurs.
Et de nouveau mon poing velu je lève,
Et de nouveau j'entends tes pleurs.
Et en même temps, quel exercice prétentieux ! Qu'ai-je de nouveau ou de plus intéressant à apporter à toutes les chroniques déjà faites de Lolita, écrit par Vladimir Nabokov en 1955 et lu dans la traduction de Maurice Couturier ? Car comme beaucoup, j'ai passé cette lecture avec un sentiment constant de malaise profond et de subjugation stylistique.
La raison du malaise est connue, et comme il est dit dans l'introduction du livre, le contexte actuel est paradoxalement plus sensible au contenu que celui de la parution. C'est dire. En ce qui me concerne, les passages licencieux entre Humbert et Lolita, sa « fille » de 12 ans, furent difficilement supportables, extrêmement nauséabonds, physiquement dérangeants. Et qu'on ne me fasse aucun procès en pudibonderie ou obscurantisme mal placé. Ce serait hors sujet…
Mais quand tu as toi-même eu trois filles, comment trouver le détachement nécessaire à la lecture sereine de cette innommable dépendance de Dolorès/Lolita vis-à-vis des sordides pulsions de Humbert ? Comment supporter que cet esclavagisme sexuel soit l'objet de chantages dont les contreparties sont la nourriture (Lolita n'ayant accès à son petit-déjeuner que si elle a « satisfait à son devoir du matin »), la menace d'un placement en orphelinat ou quelques pièces ou billets lâchés après l'extase ?
Comment essayer de comprendre à défaut d'excuser la psychologie de ce père auto-déclaré, qui s'enfonce encore davantage quand il se justifie : « Je ne suis pas un débauché sexuel, un dangereux criminel prenant des libertés indécentes avec une enfant …/… Je suis le thérapeute – petit distinguo subtil, mais qui a son importance. Je suis ton papounet, Lo. » ? Mais rien chez Humbert ne permet d'entrer en empathie, et encore moins en compréhension.
Et c'est probablement là qu'est la clé ! Pourquoi faudrait-il essayer de comprendre un homme dont l'auteur lui-même déclare dans sa postface qu'il est « un personnage abject et horrible, un exemple insigne de lèpre morale …/… Il est anormal. Mais son archet magique sait faire naître une musique si pleine de tendresse et de compassion pour Lolita que l'on succombe au charme du livre alors que l'on abhorre son auteur ». Voilà. Se détacher de l'esprit immonde pour mieux goûter le verbe magnifique.
Et là ce livre touche au sublime, à la quintessence du style. Des styles, serait d'ailleurs plus juste. Car Nabokov excelle dans tous : la beauté et la tendresse lorsqu'il évoque la grâce et la fraîcheur de Dolorès ; la description poétique, notamment dans cette incroyable année de voyage des étés 47 à 48, depuis le Connecticut à travers la moitié des États-Unis pour finir dans le Deep South, ce Dixieland chéri des écrivains américains dans la cour desquels Nabokov veut jouer ; l'étude sociologique fine et détaillée de la société US de cette deuxième moitié du siècle. Il joue sur tous les tableaux, et sur tous, son style fait mouche.
Voilà. Peut-on être à la fois écoeuré et subjugué par un même livre ? Assurément. C'est le paradoxe de Lolita, livre repoussant mais lu avec enthousiasme, comme le résume parfaitement Maurice Couturier : « C'est le rapport entre l'éthique et l'esthétique de l'oeuvre, qui lie irrémédiablement l'esthétique littéraire de l'oeuvre à la transgression éthique qu'elle véhicule ». Touché ! Et impossible de terminer cette chronique sans laisser la parole à Nabokov :
Il neige. le décor s'écroule, Lolita !
Lolita, qu'ai-je fait de ta vie ?
C'est fini, je me meurs, ma Lo, mon rêve !
De haine, de remords, je meurs.
Et de nouveau mon poing velu je lève,
Et de nouveau j'entends tes pleurs.