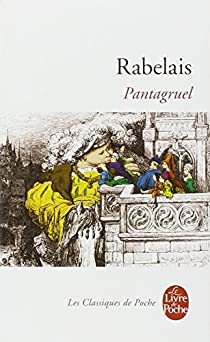>
Critique de Elthar
Il semble qu'en écrivant son premier ouvrage, Rabelais mette à l'essai une formule originale qui est issue des romans populaires, de la verve des fabliaux et de la comédie satirique" pour une part, mais qui, d'autre part, est inspirée par sa culture humaniste de type syncrétique. Pour schématiser: une culture antique, qui va d'Homère à Lucien en passant par Virgile, se double d'une culture théologique et biblique particulièrement au fait des traductions en grec ; enfin, une culture moderne de type encyclopédique, technique et pratique, vient couronner l'ensemble, en matière de droit, de médecine, de linguistique et de pédagogie.
La tension que ressent le lecteur est au fond constitutive de l'oeuvre. Hugues Sahel, dans son « Dizain liminaire» qui apparait dans l'édition de 1534, voit en Rabelais un nouveau Démocrite qui « soubz plaisant fondement » nous offre un livre où règne « l'utilité ». Mais on sait que cette formule originale, où s'allient le comique et le sérieux, mise au point dès le premier Pantagruel, a reçu un accueil partagé: si l'ouvrage a bénéficié d'un véritable succès de librairie - comme en témoignent ses nombreuses rééditions de 1532 à 1542 - il a été, semble-t-il, froidement reçu par le public cultivé. Au fond il est bien difficile de se représenter le lecteur idéal d'un tel ouvrage; sans doute faut-il voir là l'ambition d'un écrivain qui, à travers Son oeuvre, appelle un nouveau lecteur et suscite une nouvelle manière de lire. C'est au dernier chapitre de l'ouvrage qu'apparaît l'image souhaitée d'un tel lecteur : le bon pantagruéliste sachant « vivre en paix, joye, santé, faisans tousjours grande chère »; mais surtout ce lecteur va se définir par son état d'esprit: il lit non pour « nuyre à quelq'un meschantement» mais pour « passer temps joyeusement » (ibid.).
C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre le titre d'« abstracteur de quintessence » dont s'affuble l'auteur-narrateur Rabelais-Alcofribas au début et à la fin de l'oeuvre: il s'agit là de l'expression traditionnelle pour désigner l'alchimiste, dont le but véritable se rapproche singulièrement du livre plein de pantagruélisme. En s'appuyant, en effet, sur une connaissance parfaite des agents de la nature (les métaux essentiellement) et de leur transformation possible (selon diverses opérations naturelles: coction, etc.), l'alchimie ne vise rien d'autre au fond que « la guérison prompte de toutes les maladies qui affligent l'humanité». Il faudrait donc lire ces livres pantagruéliques avec la même espérance qui habite un malade buvant un remède miracle, avec le même désir qui pousse l'assoiffé à se désaltérer.
La tension que ressent le lecteur est au fond constitutive de l'oeuvre. Hugues Sahel, dans son « Dizain liminaire» qui apparait dans l'édition de 1534, voit en Rabelais un nouveau Démocrite qui « soubz plaisant fondement » nous offre un livre où règne « l'utilité ». Mais on sait que cette formule originale, où s'allient le comique et le sérieux, mise au point dès le premier Pantagruel, a reçu un accueil partagé: si l'ouvrage a bénéficié d'un véritable succès de librairie - comme en témoignent ses nombreuses rééditions de 1532 à 1542 - il a été, semble-t-il, froidement reçu par le public cultivé. Au fond il est bien difficile de se représenter le lecteur idéal d'un tel ouvrage; sans doute faut-il voir là l'ambition d'un écrivain qui, à travers Son oeuvre, appelle un nouveau lecteur et suscite une nouvelle manière de lire. C'est au dernier chapitre de l'ouvrage qu'apparaît l'image souhaitée d'un tel lecteur : le bon pantagruéliste sachant « vivre en paix, joye, santé, faisans tousjours grande chère »; mais surtout ce lecteur va se définir par son état d'esprit: il lit non pour « nuyre à quelq'un meschantement» mais pour « passer temps joyeusement » (ibid.).
C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre le titre d'« abstracteur de quintessence » dont s'affuble l'auteur-narrateur Rabelais-Alcofribas au début et à la fin de l'oeuvre: il s'agit là de l'expression traditionnelle pour désigner l'alchimiste, dont le but véritable se rapproche singulièrement du livre plein de pantagruélisme. En s'appuyant, en effet, sur une connaissance parfaite des agents de la nature (les métaux essentiellement) et de leur transformation possible (selon diverses opérations naturelles: coction, etc.), l'alchimie ne vise rien d'autre au fond que « la guérison prompte de toutes les maladies qui affligent l'humanité». Il faudrait donc lire ces livres pantagruéliques avec la même espérance qui habite un malade buvant un remède miracle, avec le même désir qui pousse l'assoiffé à se désaltérer.