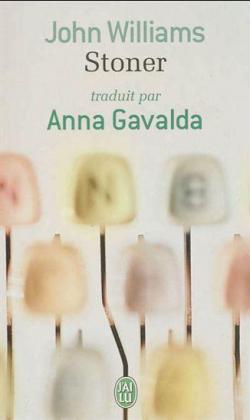>
Critique de Creisifiction
J'avoue être assez déconcerté en refermant le livre de John Williams. Comme son personnage, Stoner, j'éprouve moi aussi une réelle difficulté à trouver les mots justes pour exprimer mes sentiments et, surtout, je ne le cache pas, l'ambivalence que m'a suscité cette lecture.
Il ne s'agit aucunement pour moi de remettre en cause les qualités très appréciables de ce roman. Au contraire, je trouve que cet ouvrage est un bel objet littéraire, assez joliment façonné. Réaliste et classique sur la forme, son style, agréable et fluide, se révèle particulièrement fin, touchant, restitué de surcroît avec soin et grâce ici par l'excellente traduction d'Anna Gavalda. On y trouve des descriptions empreintes d'une grande acuité. L''écriture donne à voir, par des touches et des nuances impressionnistes, un décor ou une ambiance, un paysage ou une saison, un détail anatomique révélateur ou bien l'éclat changeant d'une carnation, joliment, avec un lyrisme naturel, sans fioritures.
Le contraste a été pour moi d'autant plus saisissant -voire, en l'occurrence, déconcertant!-, entre, je dirais d'un côté, une plume inspirée, irisée, focalisant d'un oeil toujours bienveillant et délicat les tribulations du personnage qu'elle construit au fur et à mesure, et d'un autre, le récit d'une existence d'une platitude qui m'a paru par moments exaspérante. Dont le but essentiel semblerait se résumer à pouvoir traverser la vie, à l'image d'ailleurs évoquée par le patronyme «Stoner», comme un «roc» : immuable et placide, résistant passivement aux intempéries et aux modifications intervenant dans son environnement.
Excepté quelques élans passagers, restés néanmoins sans suite, ou bien quelques rares épisodes furtifs de fougue ou de transcendance durant lesquels les «armes de la lassitude et de l'indifférence» dont son s'était emparé sa vie, seront provisoirement déposées et où Stoner pourra momentanément l'habiter véritablement , ce frugal personnage semble avoir opté pour «l'indifférence comme un mode de survie». Stoner s' exile de lui-même derrière une carrière universitaire sans ambitions, le mettant toutefois «à l'abri de la tempête», dans un mariage raté, et manifeste dans toutes situations un flegme résigné, une endurance silencieuse, aussi bien face à l'adversité qu'à tout désir personnel de changement.
La découverte de sa passion pour la littérature s'était pourtant d'emblée imposée à lui avec la force d'une véritable révélation. Cette attirance irrépressible envers la «chose littéraire», et pour l'indispensable dimension imaginaire qui la sous-tend et la nourrit, avait amené Stoner à rejeter sans trop d'hésitations les injonctions parentales, à se libérer de l'assujettissement à un destin auquel son milieu et sa condition sociale le vouaient au départ, à savoir, dans le meilleur de cas, suivre des études agricoles avant de pouvoir rejoindre ses parents et continuer à les soutenir dans leurs efforts de modernisation nécessaire à la survie de la petite exploitation familiale.
C'est ainsi, au début de ses études universitaires et grâce à l'émergence d'une passion nouvelle pour la littérature, en un mouvement dans un premier temps riche en promesses d'individuation, que le jeune Stoner découvre une nouvelle image de lui-même, ou pour être plus précis, dans le miroir se voit pour la première fois «comme de l'extérieur», éprouve le sentiment d'être, d'exister de manière autonome.
Ayant vécu l'expérience d'un état d'«atemporalité et de dédoublement» qui lui permet de s'extraire du carcan de l'indifférenciation dans lequel il avait vécu jusqu'à ce moment-là, Stoner décide de prendre son destin en main, change de cursus universitaire et, au bout de quelques années, jeune diplômé, en vient à occuper lui-même un poste d'enseignant au sein de la Faculté de Lettres où il avait suivi ses études.
Par la suite néanmoins, et tout au long de son existence, Stoner manquera cruellement de ce que le philosophe allemand Paul Tillich avait appelé «le courage d'être».
En dehors de son rôle d'enseignant et de ses missions pédagogiques auprès de ses étudiants, vécus comme une sorte de véritable sacerdoce, des solides principes que ces dernières lui inspirent et auxquels il s'astreindra avec parfois un entêtement obstiné envers et contre tous, en dehors de ce terrain connu et suffisamment «protecteur» de l'université, Stoner se révélera par ailleurs incapable de s'engager à titre personne, voire même de défendre ses intérêts propres ou de faire valoir ses désirs.
Son corps se voûtera prématurément, l'échine se courbera face à la banalité d'une vie «sans trop d'émotions», toute aspiration au bonheur étant progressivement remplacée par une attitude stoïque face à l'existence, aspirant dans le meilleur des cas aux vertus d'une vie, sinon épanouie, «du moins tranquille dans son malheur»....
Ainsi par exemple, quand la perspective d'une communion amoureuse se présentera-t-elle, qu'il réalisera enfin que l'amour ne se résume pas à un port d'attache rassurant contre les tempêtes de l'existence, que le sentiment amoureux ne consiste guère en «une fin en soi, mais un cheminement», il lui sera malgré tout impossible de franchir le pas et d'envisager un nouveau départ. Ce ne sera pourtant pas le scandale, ou les dégâts affectifs et matériels que la rupture de son mariage risquerait certainement de provoquer autour, et en lui, qui le feront reculer. Ce qui lui fera renoncer à cette occasion, unique dans sa vie, d'être aimé intensément par une femme, d'être comblé à la fois en tant qu'individu, amant et homme de lettres, ce sera avant tout le fantasme terrifiant d'une «destruction de soi-même».
Ce qui aura le dernier mot dans cette affaire ressemble donc, à défaut de toute autre explication plausible, à une peur atavique face au changement, véritable frayeur existentielle, archaïque et paralysante chez Stoner, plus forte que toute promesse de bonheur, le condamnant systématiquement à chercher refuge dans ce qui pourrait s'apparenter, de mon point de vue et à un tout autre niveau d'analyse, à une sorte de forteresse et de «faux self» dont il ne réussira jamais à se dépêtrer complètement...
Tel cet autre curieux personnage de fiction, au nom à consonance tout aussi minérale de «Stein», Stoner m'a donné aussi le sentiment d'avoir subi une sorte de ravissement de son être profond, d'en avoir été irrémédiablement clivé et d'avoir vécu à côté de lui-même et de ses rêves, le seul exutoire possible et toléré à ces derniers étant constitué par les livres, situé dans le terrain imaginaire et inexpugnable de la littérature.
Il ne lui restera donc en fin de partie, en tout et pour tout, maigre et triste consolation à mes yeux et dans mon âme inquiète de lecteur, que cet amour des livres, seule passion à laquelle «il s'était donné sans compter».
Stone essayera tout de même, l'âge venant, d'apprivoiser un sentiment d'échec qui commence malgré tout à pointer le bout de son nez!
Il se complaît alors dans une jolie trouvaille, dans un compromis lui permettant de conclure qu'il aurait au moins réussi dans sa vie «à dire à une femme ou à un poème : Regarde ! Je suis vivant».
Outre la beauté et un caractère indéniablement poétique, cette formulation serait-elle toutefois suffisante pour justifier l'effacement méthodique de ce même élan vital qu'il commémore? Stoner réussit-il à l'orée du grand voyage, ce sentiment de «quiddité», d'adéquation à soi-même, que nous recherchons tous à un moment ou un autre de nos existences, par sa tendance à s'accommoder toujours de peu?
«Qu'espérait-il d'autre de sa vie?», se demandera en définitive un Stoner au bout du compte apaisé, après avoir déroulé le film de son existence.
«Ambivalence», disais-je au début de ce billet...
Et qu'espérais-je, moi le lecteur, à la fin? Il y va de quelque chose que je refuse à entendre ou à accepter dans cette histoire? En quoi exactement m'attriste et me perturbe-t-elle? Par le sentiment de pessimisme résigné qu'à mes yeux elle distille subtilement, et m'infuse en toute douceur? Essaierais-je peut-être d'effacer un arrière-goût désagréable qu'elle m'aurait laissé en m'évoquant, pourquoi pas, la banalité de mes propres jours?
On l'entend souvent, n'est-ce pas, qu'il faut pouvoir accepter sereinement et sans regrets le fait qu'on aura fait de son mieux et qu'on aura vécu comme on a pu. Banale platitude (!), me susurrerait-il sournoisement mon coeur tourmenté ?
Malgré toute la beauté de ce que mes yeux ont parcouru sur le papier, mon coeur serait-il, lui, agité par la sensation que ce que Nietzche avait appelé «amor fati», cet amour de sa destinée, mais empli toutefois de puissance élégiaque face au chaos auquel on se sait malgré tout voué?
Stoner le confondrait-il avec une résignation passive face à la vie et aux renoncements qu'elle ne cesse de vouloir nous imposer ?
En littérature, mon coeur, finis-je par me dire, préfère une mélancolie grandiloquente, voire quichottesque, à cet arrière-goût laissé donc par un pessimisme et une tristesse que John Williams réussit en même temps, cest indéniable, à teinter de poésie et de beauté.
Je finirai ce billet «intranquille» par ces verssublimes de Fernando Pessoa qui, d'une manière ou d'une autre, font parfaitement écho à mes sentiments contradictoires vis-à-vis de cette lecture :
«Mon maître, mon coeur n'a pas appris ta sérénité,
Mon coeur n'a rien appris,
Mon coeur n'est rien,
Mon coeur est perdu.
(..)
Et puis, pourquoi m'as-tu appris la clarté de la vue,
Si tu ne pouvais pas m'apprendre à avoir l'âme avec laquelle voir clair?
Pourquoi m'as-tu appelé au sommet des montagnes,
Si moi, enfant des villages de la vallée, je ne savais pas respirer ?»
Il ne s'agit aucunement pour moi de remettre en cause les qualités très appréciables de ce roman. Au contraire, je trouve que cet ouvrage est un bel objet littéraire, assez joliment façonné. Réaliste et classique sur la forme, son style, agréable et fluide, se révèle particulièrement fin, touchant, restitué de surcroît avec soin et grâce ici par l'excellente traduction d'Anna Gavalda. On y trouve des descriptions empreintes d'une grande acuité. L''écriture donne à voir, par des touches et des nuances impressionnistes, un décor ou une ambiance, un paysage ou une saison, un détail anatomique révélateur ou bien l'éclat changeant d'une carnation, joliment, avec un lyrisme naturel, sans fioritures.
Le contraste a été pour moi d'autant plus saisissant -voire, en l'occurrence, déconcertant!-, entre, je dirais d'un côté, une plume inspirée, irisée, focalisant d'un oeil toujours bienveillant et délicat les tribulations du personnage qu'elle construit au fur et à mesure, et d'un autre, le récit d'une existence d'une platitude qui m'a paru par moments exaspérante. Dont le but essentiel semblerait se résumer à pouvoir traverser la vie, à l'image d'ailleurs évoquée par le patronyme «Stoner», comme un «roc» : immuable et placide, résistant passivement aux intempéries et aux modifications intervenant dans son environnement.
Excepté quelques élans passagers, restés néanmoins sans suite, ou bien quelques rares épisodes furtifs de fougue ou de transcendance durant lesquels les «armes de la lassitude et de l'indifférence» dont son s'était emparé sa vie, seront provisoirement déposées et où Stoner pourra momentanément l'habiter véritablement , ce frugal personnage semble avoir opté pour «l'indifférence comme un mode de survie». Stoner s' exile de lui-même derrière une carrière universitaire sans ambitions, le mettant toutefois «à l'abri de la tempête», dans un mariage raté, et manifeste dans toutes situations un flegme résigné, une endurance silencieuse, aussi bien face à l'adversité qu'à tout désir personnel de changement.
La découverte de sa passion pour la littérature s'était pourtant d'emblée imposée à lui avec la force d'une véritable révélation. Cette attirance irrépressible envers la «chose littéraire», et pour l'indispensable dimension imaginaire qui la sous-tend et la nourrit, avait amené Stoner à rejeter sans trop d'hésitations les injonctions parentales, à se libérer de l'assujettissement à un destin auquel son milieu et sa condition sociale le vouaient au départ, à savoir, dans le meilleur de cas, suivre des études agricoles avant de pouvoir rejoindre ses parents et continuer à les soutenir dans leurs efforts de modernisation nécessaire à la survie de la petite exploitation familiale.
C'est ainsi, au début de ses études universitaires et grâce à l'émergence d'une passion nouvelle pour la littérature, en un mouvement dans un premier temps riche en promesses d'individuation, que le jeune Stoner découvre une nouvelle image de lui-même, ou pour être plus précis, dans le miroir se voit pour la première fois «comme de l'extérieur», éprouve le sentiment d'être, d'exister de manière autonome.
Ayant vécu l'expérience d'un état d'«atemporalité et de dédoublement» qui lui permet de s'extraire du carcan de l'indifférenciation dans lequel il avait vécu jusqu'à ce moment-là, Stoner décide de prendre son destin en main, change de cursus universitaire et, au bout de quelques années, jeune diplômé, en vient à occuper lui-même un poste d'enseignant au sein de la Faculté de Lettres où il avait suivi ses études.
Par la suite néanmoins, et tout au long de son existence, Stoner manquera cruellement de ce que le philosophe allemand Paul Tillich avait appelé «le courage d'être».
En dehors de son rôle d'enseignant et de ses missions pédagogiques auprès de ses étudiants, vécus comme une sorte de véritable sacerdoce, des solides principes que ces dernières lui inspirent et auxquels il s'astreindra avec parfois un entêtement obstiné envers et contre tous, en dehors de ce terrain connu et suffisamment «protecteur» de l'université, Stoner se révélera par ailleurs incapable de s'engager à titre personne, voire même de défendre ses intérêts propres ou de faire valoir ses désirs.
Son corps se voûtera prématurément, l'échine se courbera face à la banalité d'une vie «sans trop d'émotions», toute aspiration au bonheur étant progressivement remplacée par une attitude stoïque face à l'existence, aspirant dans le meilleur des cas aux vertus d'une vie, sinon épanouie, «du moins tranquille dans son malheur»....
Ainsi par exemple, quand la perspective d'une communion amoureuse se présentera-t-elle, qu'il réalisera enfin que l'amour ne se résume pas à un port d'attache rassurant contre les tempêtes de l'existence, que le sentiment amoureux ne consiste guère en «une fin en soi, mais un cheminement», il lui sera malgré tout impossible de franchir le pas et d'envisager un nouveau départ. Ce ne sera pourtant pas le scandale, ou les dégâts affectifs et matériels que la rupture de son mariage risquerait certainement de provoquer autour, et en lui, qui le feront reculer. Ce qui lui fera renoncer à cette occasion, unique dans sa vie, d'être aimé intensément par une femme, d'être comblé à la fois en tant qu'individu, amant et homme de lettres, ce sera avant tout le fantasme terrifiant d'une «destruction de soi-même».
Ce qui aura le dernier mot dans cette affaire ressemble donc, à défaut de toute autre explication plausible, à une peur atavique face au changement, véritable frayeur existentielle, archaïque et paralysante chez Stoner, plus forte que toute promesse de bonheur, le condamnant systématiquement à chercher refuge dans ce qui pourrait s'apparenter, de mon point de vue et à un tout autre niveau d'analyse, à une sorte de forteresse et de «faux self» dont il ne réussira jamais à se dépêtrer complètement...
Tel cet autre curieux personnage de fiction, au nom à consonance tout aussi minérale de «Stein», Stoner m'a donné aussi le sentiment d'avoir subi une sorte de ravissement de son être profond, d'en avoir été irrémédiablement clivé et d'avoir vécu à côté de lui-même et de ses rêves, le seul exutoire possible et toléré à ces derniers étant constitué par les livres, situé dans le terrain imaginaire et inexpugnable de la littérature.
Il ne lui restera donc en fin de partie, en tout et pour tout, maigre et triste consolation à mes yeux et dans mon âme inquiète de lecteur, que cet amour des livres, seule passion à laquelle «il s'était donné sans compter».
Stone essayera tout de même, l'âge venant, d'apprivoiser un sentiment d'échec qui commence malgré tout à pointer le bout de son nez!
Il se complaît alors dans une jolie trouvaille, dans un compromis lui permettant de conclure qu'il aurait au moins réussi dans sa vie «à dire à une femme ou à un poème : Regarde ! Je suis vivant».
Outre la beauté et un caractère indéniablement poétique, cette formulation serait-elle toutefois suffisante pour justifier l'effacement méthodique de ce même élan vital qu'il commémore? Stoner réussit-il à l'orée du grand voyage, ce sentiment de «quiddité», d'adéquation à soi-même, que nous recherchons tous à un moment ou un autre de nos existences, par sa tendance à s'accommoder toujours de peu?
«Qu'espérait-il d'autre de sa vie?», se demandera en définitive un Stoner au bout du compte apaisé, après avoir déroulé le film de son existence.
«Ambivalence», disais-je au début de ce billet...
Et qu'espérais-je, moi le lecteur, à la fin? Il y va de quelque chose que je refuse à entendre ou à accepter dans cette histoire? En quoi exactement m'attriste et me perturbe-t-elle? Par le sentiment de pessimisme résigné qu'à mes yeux elle distille subtilement, et m'infuse en toute douceur? Essaierais-je peut-être d'effacer un arrière-goût désagréable qu'elle m'aurait laissé en m'évoquant, pourquoi pas, la banalité de mes propres jours?
On l'entend souvent, n'est-ce pas, qu'il faut pouvoir accepter sereinement et sans regrets le fait qu'on aura fait de son mieux et qu'on aura vécu comme on a pu. Banale platitude (!), me susurrerait-il sournoisement mon coeur tourmenté ?
Malgré toute la beauté de ce que mes yeux ont parcouru sur le papier, mon coeur serait-il, lui, agité par la sensation que ce que Nietzche avait appelé «amor fati», cet amour de sa destinée, mais empli toutefois de puissance élégiaque face au chaos auquel on se sait malgré tout voué?
Stoner le confondrait-il avec une résignation passive face à la vie et aux renoncements qu'elle ne cesse de vouloir nous imposer ?
En littérature, mon coeur, finis-je par me dire, préfère une mélancolie grandiloquente, voire quichottesque, à cet arrière-goût laissé donc par un pessimisme et une tristesse que John Williams réussit en même temps, cest indéniable, à teinter de poésie et de beauté.
Je finirai ce billet «intranquille» par ces verssublimes de Fernando Pessoa qui, d'une manière ou d'une autre, font parfaitement écho à mes sentiments contradictoires vis-à-vis de cette lecture :
«Mon maître, mon coeur n'a pas appris ta sérénité,
Mon coeur n'a rien appris,
Mon coeur n'est rien,
Mon coeur est perdu.
(..)
Et puis, pourquoi m'as-tu appris la clarté de la vue,
Si tu ne pouvais pas m'apprendre à avoir l'âme avec laquelle voir clair?
Pourquoi m'as-tu appelé au sommet des montagnes,
Si moi, enfant des villages de la vallée, je ne savais pas respirer ?»