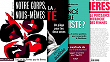Citations de Rejane Senac (59)
Aborder l’égalité femmes-hommes en terme de valeur c’est une manière de la dépolitiser en la mettant au même niveau que d’autres valeurs concurrentes. Ceci alors que l’égalité est un principe fondamental sans condition. De la droite identitaire à la gauche républicaine, une confusion est portée entre la communauté nationale et la communauté dite majoritaire. Les travaux de Cécile Laborde portent un républicanisme critique en éclairant cette tentation de ne pas voir que l’universalisme républicain dit neutre est pétri d’héritage « catho-laïque ».
Nous sommes dans une mise en scène de l’exemplarité à la française non critique. C’est un récit qui se réapproprie la rhétorique identitaire et dit les frontières binaires entre le « nous » et le « eux », les « conformes » et les « non-conformes », les « authentiques » et « ceux qui ne le sont pas ». Il charrie avec lui une conception des fameuses « valeurs » de la République. Comme l’analyse Jean-Marc Ferry, c’est la différence entre valeur, norme et principe qui est ici passée à la trappe.
C’est un paradoxe historique entre naïveté et cynisme absolu que de faire de l’égalité femmes-hommes un fondement de la République française.
Il est significatif que notre devise nationale soit censée dire le lien, la communauté politique par un terme exclusif tel que fraternité. Proposer de changer ce terme par celui d’adelphité, provenant d’un mot grec désignant les enfants nés de la même mère quelque soit leur sexe, ou solidarité, si l’on veut sortir de l’analogie familiale, est encore perçu comme iconoclaste. Je fais cette proposition à la fois dans mon livre "Les non-frères au pays de l’égalité" et dans l’avis pour une réforme constitutionnelle garante de l’égalité femmes-hommes du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes dont je suis rapporteure.
À mon sens, tant que nous n’aurons pas fait un travail qui consiste à dire que, oui, notre héritage est hétérosexiste, hétéronormatif et racialisé, nous ne pourrons pas lutter contre les inégalités et les discriminations que l’on diagnostique aujourd’hui en agissant sur leurs racines. Entre l’idéalisation du « surmoi » égalitaire et le déni d’un « ça » inégalitaire, le « moi » républicain est schizophrène. Il ne pourra ni se guérir ni être cohérent tant qu’il n’assumera pas son héritage ambivalent dans une perspective critique. Cela demande de faire une psychanalyse politique, par définition dérangeante et inconfortable.
En France, notre difficulté réside dans le fait de percevoir notre histoire et nos principes comme des totems. Notre « hétérosexisme racialisé constituant » est notre « ça » républicain que nous n’assumons pas, mais qui nous agit. Le « surmoi » étant à la fois le politiquement correct de l’égalité et un récit idéalisé de notre héritage malgré les preuves, à la manière de l’égalité absolue avec parenthèse de Piketty. Autant de circonvolutions pour ne rien reconnaître.
Pour moi, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd’hui et pourquoi des intellectuels de gauche comme Thomas Piketty ne voient aucun problème à décrire une « égalité absolue » suivie d’une parenthèse disant l’exclusion, que comme une réimpression de ce qui constitue notre logiciel républicain. De même, il me semble absurde que personne ne relève le problème de la devise française en passant le terme « fraternité » sous la bannière présumée d’un universalisme républicain. Si on remplaçait « fraternité » par « sororité », tout le monde verrait le problème.
Sylvain Maréchal, considéré comme l’un des précurseurs du mouvement libertaire et de l’anarchisme, offre lui aussi de beaux morceaux pour l’analyse. Il publie "Le Manifeste des égaux" en 1796 – celui-là même qui demande l’« abolition des révoltantes distinctions » – et cinq ans après, en 1801, dépose un projet de loi pour interdire l’apprentissage de la lecture aux filles avec, pour justification, le fait que sa démarche est faite au nom de l’égalité même, de son application stricto sensu, et non en vertu d’une exception à ce principe. Si Piketty qualifie l’égalité d’« absolue », Sylvain Maréchal, lui, précise que « les deux sexes sont parfaitement égaux ; c’est-à-dire, aussi parfaits l’un que l’autre, dans ce qui les constitue ». Pour atteindre cette « parfaite égalité » et le « bonheur commun », il faut logiquement que les femmes soient exclues de l’apprentissage de la lecture. Rousseau ne dit rien de différent quand il affirme qu’éduquer les filles comme les garçons revient à leur faire perdre « la moitié de leur prix », puisque cela revient à ce qu’« elles restent au-dessous de leur portée sans se mettre à la nôtre ». Il présume que les lecteurs sont des « hommes », bien entendu.
Le terme de "fraternité" incarne les dilemmes au cœur des principes républicains. Mon livre "Les non-frères au pays de l’égalité" est un polar politique sur le meurtre en série de l’égalité pour les « non-frères » dans la République française. Le meurtre inaugural, lors du moment révolutionnaire, naturalise l’exclusion des « non-frères » au nom de leur incapacité prétendument « naturelle » à être des sujets autonomes. Rousseau théorise l’exclusion des femmes du politique, en affirmant dans "L’Émile ou De l’éducation", publié de manière significative en 1762 la même année que "Le Contrat social", qu’elle n’est pas l’ouvrage du préjugé mais de la raison. La femme étant « femelle toute sa vie, ou du moins toute sa jeunesse », elle doit selon lui être élevée – ou plutôt rabaissée – comme un être dépendant de ses instincts, ses missions naturelles ainsi que de l’autorité tout aussi naturelle et légitime des hommes…
Malgré les preuves, la France continue à se mettre en scène comme exemplaire au regard du principe d’égalité.
Déchiffrer l’égalité à la française comme mythologie exige un double niveau de lecture. Le premier niveau de lecture consiste à constater que Thomas Piketty contribue à démystifier l’égalité à la française dans la mesure où il précise que les femmes ont été historiquement exclues de l’application de ce principe. Cette précision est lacunaire et non rigoureuse, sur le sens et la portée du principe de l’égalité puisqu’il n’y a pas que les femmes qui étaient cantonnées à une citoyenneté passive limitant leurs droits civils et civiques : sont aussi concernés dans cette catégorie de « non-frères » l’indigène colonisé, par exemple, qui bénéficiait d’un régime de sous-citoyenneté voire de non-citoyenneté. Le deuxième niveau de lecture est qu’en postulant une double exemplarité française – à la fois en termes d’analyse de l’évolution des inégalités et de mise en œuvre d’un ordre politique et juridique égalitaire –, Thomas Piketty participe de la perpétuation contemporaine du mythe de l’égalité à la française. Ainsi, ce propos est un métalangage qui est là pour signifier autre chose : malgré les preuves, la France continue à se mettre en scène comme exemplaire au regard du principe d’égalité.
Mais là où ça devient vraiment intéressant, c’est lorsqu’il [Thomas Piketty] affirme que « le code civil garantit l’égalité ABSOLUE face au droit de propriété et à celui de contracter librement (tout au moins pour les hommes) ». Le mythe de l’égalité surgit dans la parenthèse qui est une « vaccine » au sens de Barthes. En effet, de dire l’exclusive immunise l’imaginaire collectif d’une remise en cause du principe d’égalité : « par une petite inoculation de mal reconnu ; on le défend ainsi contre le risque d’une subversion généralisée. » C’est-à-dire que cette parenthèse autorise à continuer de qualifier l’égalité d’ « absolue », alors même que l’exclusion historique de la moitié non masculine de la population de l’application de ce principe est connue et publicisée.
Notre héritage républicain repose sur un récit ambivalent dans lequel, dans le même mouvement, l’égalité est proclamée comme un principe politique sacré et des groupes d’individus – les femmes et les personnes racisées –sont exclus de son application car dépolitisés. Le mythe de l’égalité « à la française » est entre totem et tabou, du moment révolutionnaire à aujourd’hui, il continue à perdurer et à faire écran à une réflexion sur les conditions d’impossibilité de l’égalité.
La devise française est très symbolique de cela. Le troisième terme, la « fraternité » renvoie au « qui », à la communauté politique à qui s’applique les principes, entre libéralisme politique et républicanisme, de liberté et d’égalité. L’angle mort des « non-frères » est extrêmement révélateur. C’est ce que j’appelle le « mythe de l’égalité » à la manière de Roland Barthes, c’est-à-dire au sens d’une parole dépolitisée.
La devise française est très symbolique de cela. Le troisième terme, la « fraternité » renvoie au « qui », à la communauté politique à qui s’applique les principes, entre libéralisme politique et républicanisme, de liberté et d’égalité. L’angle mort des « non-frères » est extrêmement révélateur. C’est ce que j’appelle le « mythe de l’égalité » à la manière de Roland Barthes, c’est-à-dire au sens d’une parole dépolitisée.
Pourquoi parler de « non-frères » ? Cette expression permet d’expliciter que c’est sur le registre de la négation, du manque que certain•e•s groupes d’individu•e•s ont été défini•e•s comme incapables d’être autonomes, et donc d’être des acteurs politiques légitimes. Elle dit leur assignation à un rapport asymptotique à une norme, celle des frères, qui ne pourra jamais être atteinte.
Ceux qui sont en position d’être classificateurs, c’est-à-dire les hommes blancs, ont le pouvoir de déterminer à la fois les règles et le cadre du jeu politique. Cela pose la question des frontières du politique, à la fois du « qui » et de « ce qui » est légitime. D’autre part, cela adresse également la question du « pour quoi » et du « quoi », c’est-à-dire de la destination et de la finalité du politique. Cela a des implications en terme de « comment » : en 1790, Condorcet dans son essai "Sur l’admission des femmes au droit de cité" défend ainsi le droit de vote et d’éligibilité des femmes en affirmant que « celui qui vote contre le droit d’un autre, quels que soient sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens. » Cette affirmation est essentielle car elle pose la question du « qui est politique » au sens de « qui est à la hauteur de ce qu’est être humain ». Il se réapproprie le pouvoir fondamental de décider de « qui est politique ».
Le féminisme est éminemment politique au sens où le politique est l’intervalle de discussion et d’action entre ce qui est et ce qui devrait être, ce que l’on juge légitime. Ce qu’il y a d’intéressant dans la question « qu’est-ce que le féminisme ? » c’est qu’elle pose celle de « qui et de ce qui est politique ? », car les inégalités de genre reposent sur la sortie des femmes du politique, au motif qu’elles sont renvoyées à une impuissance, une incapacité d’être dans la mise à distance par la raison. Il en va de même pour les personnes racisées.
L’inégalité de genre est la mise en récit d’un ordre éminemment social et politique.
Prenons la manière dont est né le terme « féministe » en France. Il est associé au néologisme, reprenant un terme désignant l’intersexuation et associée à une pathologique, utilisé en 1872 par Dumas fils pour discréditer l’écrivain et diplomate Henri d’Ideville dans sa défense des femmes comme les égales des hommes devant avoir la même éducation et les mêmes droits. Cette dénonciation des différences de traitement entre les sexes comme illégitimes, et donc comme des inégalités à combattre, est discréditée au nom du respect d’une prétendue complémentarité naturelle ayant donnée la force à l’homme. L’historienne Christine Bard le montre très bien : ce renvoi des féministes à l’absurde, au ridicule, au non-sens, renvoie l’égalité femmes-hommes à une contre-vérité et rend l’échange, le débat impossible. Qualifier Henri d’Ideville de « féministe », c’est le désigner comme traître à son corps, aux hommes. Dumas fils s’oppose ainsi à la mise à distance critique d’un ordre établi justifié au nom d’un récit essentialiste. Dans cette généalogie, être féministe, c’est dénoncer l’illégitimité du traitement systémique inégalitaire entre les sexes au nom d’un ordre prétendument naturel.
Interroger ce qu’est être féministe, c’est se poser la question du lien entre critique et politique au sens où le/la politique dit et fait advenir les ordres légitimes dans leurs interactions et leurs tensions : ordre naturel, ordre social, ordre politique, ordre légal, ordre religieux, etc.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Rejane Senac
Lecteurs de Rejane Senac (38)Voir plus
Quiz
Voir plus
La faune de Malronce
Comment les longs marcheurs appellent ces vers de toutes tailles, petits comme des limaces ou long comme des cocombres suspendus aux câbles des pylones électriques à l'entrée des villes ?
Les vers communautaires
Les vers solidaires
Les cuculombricées
Les vers limaces
Les cuculimacées
11 questions
104 lecteurs ont répondu
Thème : Autre-Monde, tome 2 : Malronce de
Maxime ChattamCréer un quiz sur cet auteur104 lecteurs ont répondu