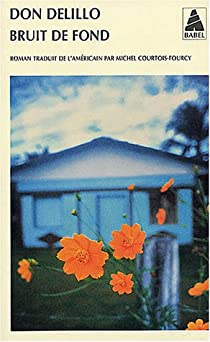>
Critique de AnnaCan
Je me suis souvenue que je n'avais encore lu aucun livre de Don DeLillo après avoir découvert la très inspirante critique de L'homme qui tombe par Creisifiction. Et j'ai choisi de commencer par Bruit de fond sur les conseils entrecroisés du susdit, de Bobfutur et de HordeDuContrevent. Qu'ils en soient tous trois remerciés.
Bruit de fond (« White noise » ) est l'histoire d'un professeur d'université, Jack Gladney, et de sa famille nombreuse et recomposée dont la petite ville du Midwest, Blacksmith, est évacuée après un accident industriel. Ce résumé, pourtant factuellement exact, en dit à peu près autant sur ce livre que la boutade de Woody Allen vantant les mérites de la lecture rapide appliquée à Guerre et paix : « Ça parle de la Russie ».
Quoique « Ça parle de l'Amérique » serait déjà un premier pas dans la compréhension d'un livre écrit dans les années quatre-vingts et pourtant toujours très actuel, bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Une Amérique où personne n'est responsable, où personne n'a le contrôle sur rien, où les individus sont, non pas les acteurs de leur propre vie, mais les réceptacles plus ou moins consentants de stimuli auditifs et sensoriels variés, pitoyables objets d'événements fortuits parfois désastreux, enfin consommateurs insatiables se rendant rituellement dans ce haut temple de la consommation de masse qu'est le supermarché local.
En dépit de la présence discrète et écrasante d'Hitler, dont Jack Gladney est devenu l'expert national et incontesté, en dépit d'une ambiance aux relents apocalyptiques, le livre met en scène des événements finalement très ordinaires : des individus aux prises avec l'angoisse et le mystère qui irriguent leur vie quotidienne.
J'ai beaucoup pensé à Philip K.Dick durant ma lecture, un auteur également très doué pour mettre en récit l'étrangeté de la vie ordinaire. du reste, il ne serait guère surprenant que DeLillo qui a, pour son quatrième opus, L'étoile de Ratner, choisi le genre de la science-fiction, connût bien l'oeuvre de Philip K.Dick. Dans celle-ci, en particulier dans son chef-d'oeuvre, Ubik, où la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts est devenue si poreuse que l'on ne sait plus qui est en vie ou qui est mort, on trouve également une critique acerbe de la société de consommation et de son avatar incontournable, le marketing. Dans Bruit de fond, qui excelle à retranscrire la bande-son de la société américaine, la télévision et la radio éructent à toute heure du jour et de la nuit leurs messages vides de sens en total décalage avec ce que vivent les individus empêtrés dans les rets d'une angoisse mortifère, créant au passage un effet comique indéniable.
Ainsi, tandis qu'un Jack Gladney effrayé, avec toute sa famille entassée dans la voiture, tente de fuir le nuage toxique flottant au-dessus de leur petite ville, une voix à la radio ânonne : “C'est l'hologramme arc-en-ciel qui donne à cette carte de crédit une force étonnante de pénétration.” »
Ou encore, lorsque, rejoignant Denise, la fille de sa femme Babette, dans sa chambre pour lui annoncer la découverte stupéfiante qu'il vient de faire au sujet de sa mère, le narrateur entend « la voix au bout du lit qui susurre : “En attendant, voici une garniture vite faite et charmante, à base de citron, qui convient parfaitement pour n'importe quel fruit de mer.”
Don DeLillo est incontestablement un analyste hors pair des peurs et des symptômes de notre temps, mais c'est aussi une oreille, une oreille qui sait capter mieux que quiconque la musicalité langagière de notre époque. Tous les dialogues en particulier sonnent de façon surprenante. Bien que réalistes, ils dégagent un curieux parfum d'étrangeté. Un exemple parmi des dizaines d'autres :
« Ce pauvre Cotsakis, emporté par une vague, dis-je. Cet homme énorme.
— C'est bien lui.
— Je ne sais vraiment que dire.
— Il était gros, ça, c'est sûr.
— Fabuleusement gros, dis-je. (…)
— Partir ainsi sans laisser de trace. Etre emporté, balayé.
— Je me souviens de lui si parfaitement.
— D'une certaine manière, je trouve ça curieux, dit-il, que nous puissions nous souvenir des morts. »
Ce qui se cache derrière l'angoisse et le mystère de la vie, c'est, bien sûr, la peur de la mort. Véritable sujet du livre, la crainte de la mort, traitée ici avec un humour qui n'est pas sans rappeler … Woody Allen, en particulier le personnage hypocondriaque obsédé par sa mort prochaine qu'il incarne dans « Hannah et ses soeurs », irrigue tout le récit, qu'elle prenne la forme inhabituelle d'un gros nuage noir et toxique, ou qu'elle se niche dans les moindres replis du quotidien : routine, déchets, vieilleries accumulées, reportages TV…
Cette peur prend rapidement un tour obsessionnel chez le narrateur, Jack Gladney, qui, la nuit, se « réveille dans les sueurs de l'agonie. Impuissant en face d'une terreur incontrôlable. »
Sa peur subit un approfondissement assez net et un début d'incarnation quand la base de données de l'ordinateur siégeant dans le camp où les habitants de Blacksmith ont été évacués, lui révèle que son organisme comporte des traces de nyodène D, le pesticide exhalé par le nuage toxique :
« Tout le problème est de savoir si je vais ou non survivre à ce produit. Il a en effet une durée de vie qui lui est propre. Trente ans. Même s'il ne me tue pas directement, il survivra probablement à mon corps. Si je meurs par exemple dans un accident d'avion, le nyodène d'restera florissant dans ma tombe. »
Sa peur se creuse encore davantage quand, abasourdi, il apprend que sa femme Babette, qu'il croyait résolument du côté de la vie et immunisée contre l'angoisse, la subit en réalité depuis fort longtemps, à tel point qu'elle se prête en grand secret à l'insu de sa famille à une expérimentation médicamenteuse hasardeuse initiée par un laboratoire de recherche à l'éthique douteuse qui prétend avoir isolé et pouvoir inhiber les neurones responsables de la crainte de la mort.
Enfin, la peur de Jack Gladney se mue en panique quand les analyses révèlent la présence de « grosseurs confuses » dans son organisme. Nous sommes tous des condamnés à mort en sursis. Disons que dans ce cas précis, le sursis vient d'être brutalement levé.
« Je sais seulement que je ne continue de vivre que grâce à une vitesse acquise, à la force d'inertie. En fait, je suis déjà mort. »
Que faire contre cette peur et contre l'approche imminente de la mort ? Rien, semble répondre Jack le fataliste… faire l'autruche, ce qui revient au même. Une seule chose à faire, suggère son étrange ami Ramsey : tuer un homme, n'importe lequel, pour ne pas mourir :
« Tuer un homme, c'est augmenter la durée de votre propre vie. Plus vous tuez de gens, plus vous augmentez votre survie. (…) Les moribonds succombent avec passivité. Les tueurs vivent. Quelle merveilleuse équation ! »
J'éprouve généralement une intense jubilation à la lecture des (grands) livres qui parlent de la mort, et Bruit de fond n'a pas dérogé à la règle, même si j'ai trouvé parfois qu'il manquait de rythme et qu'il ne tenait pas toutes ses promesses. J'attendais en particulier davantage qu'un saupoudrage de la part d'un livre qui fait de l'enseignement de Hitler la spécialité de son narrateur. Ce sont là de bien petites réserves au regard de la joie ressentie à cette lecture. La mort, donc, chez les autres et quand elle est tenue en respect par l'humour et par l'écriture, me fait jubiler. Elle me fait me sentir moins seule. Lorsque j'ai compris, je veux dire vraiment compris, intégré, que j'étais destinée à mourir comme tout un chacun, mon regard sur la vie a changé du tout au tout. Je me souviens que cette prise de conscience a coïncidé avec la lecture d'un livre : « Tous les hommes sont mortels » de Simone de Beauvoir. Et pour moi, cette prise de conscience s'est immédiatement accompagnée d'une autre : j'ai compris que je n'étais pas cet astre autour duquel gravitaient des satellites plus ou moins proches, mais un dérisoire grain de poussière parmi des millards d'autres. Autrement dit, j'ai compris que la foule des gens qui m'environnait (j'étais dans le métro lors de ma douloureuse prise de conscience) avait la même légitimité que moi à se considérer comme le centre de tout, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose : personne, y compris moi, n'était le centre de rien.
« C'est le moment de l'année, le moment du jour où une petite tristesse insistante passe dans la texture même des choses. Crépuscule, silence, froid glacial. La solitude s'infiltre même dans les os. »
Bruit de fond (« White noise » ) est l'histoire d'un professeur d'université, Jack Gladney, et de sa famille nombreuse et recomposée dont la petite ville du Midwest, Blacksmith, est évacuée après un accident industriel. Ce résumé, pourtant factuellement exact, en dit à peu près autant sur ce livre que la boutade de Woody Allen vantant les mérites de la lecture rapide appliquée à Guerre et paix : « Ça parle de la Russie ».
Quoique « Ça parle de l'Amérique » serait déjà un premier pas dans la compréhension d'un livre écrit dans les années quatre-vingts et pourtant toujours très actuel, bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Une Amérique où personne n'est responsable, où personne n'a le contrôle sur rien, où les individus sont, non pas les acteurs de leur propre vie, mais les réceptacles plus ou moins consentants de stimuli auditifs et sensoriels variés, pitoyables objets d'événements fortuits parfois désastreux, enfin consommateurs insatiables se rendant rituellement dans ce haut temple de la consommation de masse qu'est le supermarché local.
En dépit de la présence discrète et écrasante d'Hitler, dont Jack Gladney est devenu l'expert national et incontesté, en dépit d'une ambiance aux relents apocalyptiques, le livre met en scène des événements finalement très ordinaires : des individus aux prises avec l'angoisse et le mystère qui irriguent leur vie quotidienne.
J'ai beaucoup pensé à Philip K.Dick durant ma lecture, un auteur également très doué pour mettre en récit l'étrangeté de la vie ordinaire. du reste, il ne serait guère surprenant que DeLillo qui a, pour son quatrième opus, L'étoile de Ratner, choisi le genre de la science-fiction, connût bien l'oeuvre de Philip K.Dick. Dans celle-ci, en particulier dans son chef-d'oeuvre, Ubik, où la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts est devenue si poreuse que l'on ne sait plus qui est en vie ou qui est mort, on trouve également une critique acerbe de la société de consommation et de son avatar incontournable, le marketing. Dans Bruit de fond, qui excelle à retranscrire la bande-son de la société américaine, la télévision et la radio éructent à toute heure du jour et de la nuit leurs messages vides de sens en total décalage avec ce que vivent les individus empêtrés dans les rets d'une angoisse mortifère, créant au passage un effet comique indéniable.
Ainsi, tandis qu'un Jack Gladney effrayé, avec toute sa famille entassée dans la voiture, tente de fuir le nuage toxique flottant au-dessus de leur petite ville, une voix à la radio ânonne : “C'est l'hologramme arc-en-ciel qui donne à cette carte de crédit une force étonnante de pénétration.” »
Ou encore, lorsque, rejoignant Denise, la fille de sa femme Babette, dans sa chambre pour lui annoncer la découverte stupéfiante qu'il vient de faire au sujet de sa mère, le narrateur entend « la voix au bout du lit qui susurre : “En attendant, voici une garniture vite faite et charmante, à base de citron, qui convient parfaitement pour n'importe quel fruit de mer.”
Don DeLillo est incontestablement un analyste hors pair des peurs et des symptômes de notre temps, mais c'est aussi une oreille, une oreille qui sait capter mieux que quiconque la musicalité langagière de notre époque. Tous les dialogues en particulier sonnent de façon surprenante. Bien que réalistes, ils dégagent un curieux parfum d'étrangeté. Un exemple parmi des dizaines d'autres :
« Ce pauvre Cotsakis, emporté par une vague, dis-je. Cet homme énorme.
— C'est bien lui.
— Je ne sais vraiment que dire.
— Il était gros, ça, c'est sûr.
— Fabuleusement gros, dis-je. (…)
— Partir ainsi sans laisser de trace. Etre emporté, balayé.
— Je me souviens de lui si parfaitement.
— D'une certaine manière, je trouve ça curieux, dit-il, que nous puissions nous souvenir des morts. »
Ce qui se cache derrière l'angoisse et le mystère de la vie, c'est, bien sûr, la peur de la mort. Véritable sujet du livre, la crainte de la mort, traitée ici avec un humour qui n'est pas sans rappeler … Woody Allen, en particulier le personnage hypocondriaque obsédé par sa mort prochaine qu'il incarne dans « Hannah et ses soeurs », irrigue tout le récit, qu'elle prenne la forme inhabituelle d'un gros nuage noir et toxique, ou qu'elle se niche dans les moindres replis du quotidien : routine, déchets, vieilleries accumulées, reportages TV…
Cette peur prend rapidement un tour obsessionnel chez le narrateur, Jack Gladney, qui, la nuit, se « réveille dans les sueurs de l'agonie. Impuissant en face d'une terreur incontrôlable. »
Sa peur subit un approfondissement assez net et un début d'incarnation quand la base de données de l'ordinateur siégeant dans le camp où les habitants de Blacksmith ont été évacués, lui révèle que son organisme comporte des traces de nyodène D, le pesticide exhalé par le nuage toxique :
« Tout le problème est de savoir si je vais ou non survivre à ce produit. Il a en effet une durée de vie qui lui est propre. Trente ans. Même s'il ne me tue pas directement, il survivra probablement à mon corps. Si je meurs par exemple dans un accident d'avion, le nyodène d'restera florissant dans ma tombe. »
Sa peur se creuse encore davantage quand, abasourdi, il apprend que sa femme Babette, qu'il croyait résolument du côté de la vie et immunisée contre l'angoisse, la subit en réalité depuis fort longtemps, à tel point qu'elle se prête en grand secret à l'insu de sa famille à une expérimentation médicamenteuse hasardeuse initiée par un laboratoire de recherche à l'éthique douteuse qui prétend avoir isolé et pouvoir inhiber les neurones responsables de la crainte de la mort.
Enfin, la peur de Jack Gladney se mue en panique quand les analyses révèlent la présence de « grosseurs confuses » dans son organisme. Nous sommes tous des condamnés à mort en sursis. Disons que dans ce cas précis, le sursis vient d'être brutalement levé.
« Je sais seulement que je ne continue de vivre que grâce à une vitesse acquise, à la force d'inertie. En fait, je suis déjà mort. »
Que faire contre cette peur et contre l'approche imminente de la mort ? Rien, semble répondre Jack le fataliste… faire l'autruche, ce qui revient au même. Une seule chose à faire, suggère son étrange ami Ramsey : tuer un homme, n'importe lequel, pour ne pas mourir :
« Tuer un homme, c'est augmenter la durée de votre propre vie. Plus vous tuez de gens, plus vous augmentez votre survie. (…) Les moribonds succombent avec passivité. Les tueurs vivent. Quelle merveilleuse équation ! »
J'éprouve généralement une intense jubilation à la lecture des (grands) livres qui parlent de la mort, et Bruit de fond n'a pas dérogé à la règle, même si j'ai trouvé parfois qu'il manquait de rythme et qu'il ne tenait pas toutes ses promesses. J'attendais en particulier davantage qu'un saupoudrage de la part d'un livre qui fait de l'enseignement de Hitler la spécialité de son narrateur. Ce sont là de bien petites réserves au regard de la joie ressentie à cette lecture. La mort, donc, chez les autres et quand elle est tenue en respect par l'humour et par l'écriture, me fait jubiler. Elle me fait me sentir moins seule. Lorsque j'ai compris, je veux dire vraiment compris, intégré, que j'étais destinée à mourir comme tout un chacun, mon regard sur la vie a changé du tout au tout. Je me souviens que cette prise de conscience a coïncidé avec la lecture d'un livre : « Tous les hommes sont mortels » de Simone de Beauvoir. Et pour moi, cette prise de conscience s'est immédiatement accompagnée d'une autre : j'ai compris que je n'étais pas cet astre autour duquel gravitaient des satellites plus ou moins proches, mais un dérisoire grain de poussière parmi des millards d'autres. Autrement dit, j'ai compris que la foule des gens qui m'environnait (j'étais dans le métro lors de ma douloureuse prise de conscience) avait la même légitimité que moi à se considérer comme le centre de tout, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose : personne, y compris moi, n'était le centre de rien.
« C'est le moment de l'année, le moment du jour où une petite tristesse insistante passe dans la texture même des choses. Crépuscule, silence, froid glacial. La solitude s'infiltre même dans les os. »