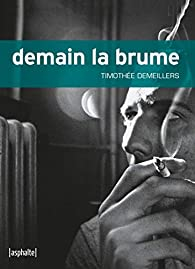Citations sur Demain la brume (28)
C’était la première fois que l’on me parlait si ouvertement de mon ethnicité. Moi, le fils du rêve yougoslave. Né d’un père serbe et d’une mère croate. Qui n’avais jamais eu à me poser la question de mes origines. Qui n’avais jamais eu à demander à mes parents qui j’étais. Qui n’avais qu’à cocher la case yougoslave. Mais cette case n’existait plus. Il fallait choisir un camp. Il fallait affirmer haut et fort une nationalité ou l’autre. Il était devenu impossible de maintenir une neutralité. Pire, être neutre signifiait choisir le camp de l’autre. Être l’ennemi de tous.
INCIPIT
Katia Koné
Je sortais tout juste de l’enfance, j’étais à un âge où l’on se dit que la vie ne vaut pas grand-chose, où l’on claironne que l’on voudrait se foutre en l’air et où l’on feint la mélancolie à la moindre contrariété parce que la dépression est encore quelque chose de séduisant, d’énigmatique et de romantique. Pour survivre, je courais après le fantastique, le ténébreux, je m’enveloppais dans des habits trop grands pour moi, j’imitais les attitudes et les poses en noir et blanc des Clash, dont je tapissais ma chambre de posters, leur aura sulfureuse sur papier glacé. Je n’étais qu’une jeune lycéenne élevée dans le calme propret des bords de Loire, mais je me persuadais d’évoluer dans la crasse londonienne, je m’imaginais des odeurs de fog et de bière éventée entre les briques cramoisies des mansions anglaises, sous le bas ciel britannique, tandis que les hymnes incendiaires échappés de mon walkman me cognaient les tympans. J’arborais une crête de cheveux pourpres pour ressembler à mes idoles et j’écrivais des poèmes virulents dans un calepin que je rangeais dans la poche intérieure de ma veste en jean perforée de pin’s et d’épingles à nourrice. Je fumais. Je buvais. Et chaque verre bu, chaque cigarette fumée l’était en essayant d’imiter mes héros, les Clash et leurs quatre gueules d’ange, anguleuses et blanchâtres, drapés dans leurs perfectos brillants. Je voulais leur ressembler. Je voulais devenir comme eux. Je rêvais que ma vie soit la leur.
J’étais entre deux âges.
J’avais dix-huit ans.
C’est là que tout a commencé.
J’habitais Nevers. Nevers et son insupportable quiétude. Nevers et sa Loire pas encore magistrale, encore rivière anodine, glissant mollement telle une inéluctable marée noire le long de ses rives écussonnées de crépis sales et de toits en ardoises qui se confondaient avec la couleur du ciel. Nevers qui vivotait dans des habits trop grands pour elle, des manoirs à tourelles et des jardins à la française, témoins de son histoire royale, aujourd’hui occupés par des institutions préfectorales médiocres et des chambres de commerce. Nevers qui ressassait le nom de son maire dans tous les foyers, à tous les comptoirs de bar, parce qu’il semblait que, pour une fois, quelqu’un avait réussi à s’extirper de cette soupe fade. Grâce à lui, on pouvait désormais entendre prononcer le nom de notre ville à la télévision nationale, ce qui revenait pour la plupart des habitants à une bénédiction, comme si à travers ce « Nevers » ou ce « Pierre Bérégovoy » articulés par le présentateur du JT, c’était un peu de nous qu’on causait, nous qui étions habituellement si éloignés de tout ça, comme si nous en tirions une gloire toute personnelle.
Mais malgré notre maire, ministre des Finances de la France entière, malgré la télévision, Nevers restait Nevers, l’ennui gonflait à mesure de mes rêves d’émancipation, de mes envies de liberté, à mesure que je prenais conscience que mes poèmes ne sortiraient jamais des quatre murs de ma chambre et que je n’insufflerais jamais le vent de la révolution punk sur la scène poétique française.
Je haïssais cette ville. Je la haïssais fabuleusement.
Après minuit, les rues assoupies s’exposaient sous la lueur jaunâtre des lampadaires dont les halos soporifiques grésillaient devant les volets clos et ne s’éteignaient qu’avec le lever du jour. Et dans ce terrain de jeu bien trop petit, notre bande lycéenne rejouait ce que nous pensions être la folie insomniaque des plus grandes capitales. Les nuits où nos parents nous laissaient sortir, nous roulions d’épais joints de mauvais haschisch, buvions au goulot de vieilles bouteilles de calvados oubliées au fond des buffets à alcool familiaux, nous promenions notre ennui ivres dans les rues en nous cachant dans des bosquets taillés en fleurs de lys lorsque les patrouilles de police approchaient. Parfois, l’un d’entre nous apportait une bombe de peinture et nous taguions, comme c’était la mode dans les banlieues françaises, notre lassitude dans des phrases révolutionnaires, pensant peut-être que cela permettrait une prise de conscience collective de l’ennui qui plombait la jeunesse d’ici, mais c’était peine perdue. Nous ne récoltions que de sèches brèves dans l’édition du Journal du Centre: ils font désormais partie du paysage urbain, les tags, une pollution visuelle qui s’amplifie, le centre de Nevers a été à nouveau vandalisé, « c’est une honte de faire ça vraiment quel est l’intérêt », commente écœurée la gérante de l’agence du Crédit mutuel de l’avenue du Général-de-Gaulle…
Et les articles se concluaient avec d’autres propos du même acabit, des commérages de commerçants mécontents, sans jamais parler de l’aspect poétique et du sens profond des inscriptions. Tout cela ne faisait que confirmer la médiocrité qui m’entourait : je vivais dans un monde de cons à une époque tout aussi naze.
De ces virées artistiques, je rentrais au milieu de la nuit, dans le pavillon de mes parents un peu en retrait du centre. Je garais ma mobylette Peugeot orange dans le jardin. Je montais les escaliers qui menaient à ma chambre sur la pointe des pieds en évitant les marches qui grinçaient particulièrement. Je me glissais dans mon lit. Je me saisissais de mon carnet pour écrire des textes que j’avais la prétention d’appeler des poèmes, je filais les mots au rythme du stylo Bic, qui débordait parfois des petits carrés blancs de la page, et je me persuadais qu’un jour ces carnets seraient retrouvés, et qu’ils seraient exhumés et publiés et que, comme Kafka, mon œuvre serait érigée au rang des chefs-d’œuvre posthumes de la littérature française alors que je n’osais même pas les soumettre au journal de mon lycée et puis, tandis que j’écrivais au rythme de mon ébriété, j’entendais les petits pas de souris de ma mère qui se relevait pour aller aux toilettes, ma mère qui ne pouvait fermer l’œil avant mon retour et que j’imaginais si fluette, se retournant dans son lit toute la nuit, aux côtés des cent kilos inamovibles et ronflants de mon père, ma mère, attendant nerveusement le cliquetis de la serrure de la porte d’entrée qui viendrait la délivrer, ma fille n’a pas été renversée, ni violée, ni assassinée ce soir ! Et moi, alors, j’éteignais la lumière pour lui faire croire qu’en effet je dormais et j’interrompais de la sorte ma carrière de plus grande poétesse punk de ce tout début des années 1990. Et avant de m’endormir, la réalité de ma vie me sautait à la gueule.
Katia Koné
Je sortais tout juste de l’enfance, j’étais à un âge où l’on se dit que la vie ne vaut pas grand-chose, où l’on claironne que l’on voudrait se foutre en l’air et où l’on feint la mélancolie à la moindre contrariété parce que la dépression est encore quelque chose de séduisant, d’énigmatique et de romantique. Pour survivre, je courais après le fantastique, le ténébreux, je m’enveloppais dans des habits trop grands pour moi, j’imitais les attitudes et les poses en noir et blanc des Clash, dont je tapissais ma chambre de posters, leur aura sulfureuse sur papier glacé. Je n’étais qu’une jeune lycéenne élevée dans le calme propret des bords de Loire, mais je me persuadais d’évoluer dans la crasse londonienne, je m’imaginais des odeurs de fog et de bière éventée entre les briques cramoisies des mansions anglaises, sous le bas ciel britannique, tandis que les hymnes incendiaires échappés de mon walkman me cognaient les tympans. J’arborais une crête de cheveux pourpres pour ressembler à mes idoles et j’écrivais des poèmes virulents dans un calepin que je rangeais dans la poche intérieure de ma veste en jean perforée de pin’s et d’épingles à nourrice. Je fumais. Je buvais. Et chaque verre bu, chaque cigarette fumée l’était en essayant d’imiter mes héros, les Clash et leurs quatre gueules d’ange, anguleuses et blanchâtres, drapés dans leurs perfectos brillants. Je voulais leur ressembler. Je voulais devenir comme eux. Je rêvais que ma vie soit la leur.
J’étais entre deux âges.
J’avais dix-huit ans.
C’est là que tout a commencé.
J’habitais Nevers. Nevers et son insupportable quiétude. Nevers et sa Loire pas encore magistrale, encore rivière anodine, glissant mollement telle une inéluctable marée noire le long de ses rives écussonnées de crépis sales et de toits en ardoises qui se confondaient avec la couleur du ciel. Nevers qui vivotait dans des habits trop grands pour elle, des manoirs à tourelles et des jardins à la française, témoins de son histoire royale, aujourd’hui occupés par des institutions préfectorales médiocres et des chambres de commerce. Nevers qui ressassait le nom de son maire dans tous les foyers, à tous les comptoirs de bar, parce qu’il semblait que, pour une fois, quelqu’un avait réussi à s’extirper de cette soupe fade. Grâce à lui, on pouvait désormais entendre prononcer le nom de notre ville à la télévision nationale, ce qui revenait pour la plupart des habitants à une bénédiction, comme si à travers ce « Nevers » ou ce « Pierre Bérégovoy » articulés par le présentateur du JT, c’était un peu de nous qu’on causait, nous qui étions habituellement si éloignés de tout ça, comme si nous en tirions une gloire toute personnelle.
Mais malgré notre maire, ministre des Finances de la France entière, malgré la télévision, Nevers restait Nevers, l’ennui gonflait à mesure de mes rêves d’émancipation, de mes envies de liberté, à mesure que je prenais conscience que mes poèmes ne sortiraient jamais des quatre murs de ma chambre et que je n’insufflerais jamais le vent de la révolution punk sur la scène poétique française.
Je haïssais cette ville. Je la haïssais fabuleusement.
Après minuit, les rues assoupies s’exposaient sous la lueur jaunâtre des lampadaires dont les halos soporifiques grésillaient devant les volets clos et ne s’éteignaient qu’avec le lever du jour. Et dans ce terrain de jeu bien trop petit, notre bande lycéenne rejouait ce que nous pensions être la folie insomniaque des plus grandes capitales. Les nuits où nos parents nous laissaient sortir, nous roulions d’épais joints de mauvais haschisch, buvions au goulot de vieilles bouteilles de calvados oubliées au fond des buffets à alcool familiaux, nous promenions notre ennui ivres dans les rues en nous cachant dans des bosquets taillés en fleurs de lys lorsque les patrouilles de police approchaient. Parfois, l’un d’entre nous apportait une bombe de peinture et nous taguions, comme c’était la mode dans les banlieues françaises, notre lassitude dans des phrases révolutionnaires, pensant peut-être que cela permettrait une prise de conscience collective de l’ennui qui plombait la jeunesse d’ici, mais c’était peine perdue. Nous ne récoltions que de sèches brèves dans l’édition du Journal du Centre: ils font désormais partie du paysage urbain, les tags, une pollution visuelle qui s’amplifie, le centre de Nevers a été à nouveau vandalisé, « c’est une honte de faire ça vraiment quel est l’intérêt », commente écœurée la gérante de l’agence du Crédit mutuel de l’avenue du Général-de-Gaulle…
Et les articles se concluaient avec d’autres propos du même acabit, des commérages de commerçants mécontents, sans jamais parler de l’aspect poétique et du sens profond des inscriptions. Tout cela ne faisait que confirmer la médiocrité qui m’entourait : je vivais dans un monde de cons à une époque tout aussi naze.
De ces virées artistiques, je rentrais au milieu de la nuit, dans le pavillon de mes parents un peu en retrait du centre. Je garais ma mobylette Peugeot orange dans le jardin. Je montais les escaliers qui menaient à ma chambre sur la pointe des pieds en évitant les marches qui grinçaient particulièrement. Je me glissais dans mon lit. Je me saisissais de mon carnet pour écrire des textes que j’avais la prétention d’appeler des poèmes, je filais les mots au rythme du stylo Bic, qui débordait parfois des petits carrés blancs de la page, et je me persuadais qu’un jour ces carnets seraient retrouvés, et qu’ils seraient exhumés et publiés et que, comme Kafka, mon œuvre serait érigée au rang des chefs-d’œuvre posthumes de la littérature française alors que je n’osais même pas les soumettre au journal de mon lycée et puis, tandis que j’écrivais au rythme de mon ébriété, j’entendais les petits pas de souris de ma mère qui se relevait pour aller aux toilettes, ma mère qui ne pouvait fermer l’œil avant mon retour et que j’imaginais si fluette, se retournant dans son lit toute la nuit, aux côtés des cent kilos inamovibles et ronflants de mon père, ma mère, attendant nerveusement le cliquetis de la serrure de la porte d’entrée qui viendrait la délivrer, ma fille n’a pas été renversée, ni violée, ni assassinée ce soir ! Et moi, alors, j’éteignais la lumière pour lui faire croire qu’en effet je dormais et j’interrompais de la sorte ma carrière de plus grande poétesse punk de ce tout début des années 1990. Et avant de m’endormir, la réalité de ma vie me sautait à la gueule.
Nous ne nous étions toujours pas embrassé, je pensais à ses lèvres, au goût qu’elles auraient et je me sentais envahie par sa chaleur, nous étions dans ce moment juste avant, submergés de sensualité, et nous avons fini dans un quartier chinois, dans un petit bouiboui enfumé, tapi sous de grandes tours bétonnées, à déguster une soupe épicée trop chaude sur des tabourets trop bas, alors que le désir montait, et Pierre-Yves a réglé les deux plats, quelques francs laissés en pourboire, un dernier verre d’alcool de riz cul-sec, offert par le patron, que j’ai bu, que Pierre-Yves a laissé sur la table, en riant en aparté avec un Chinois mal fagoté qu’il semblait connaître tellement ils étaient familiers, puis de nouveau dehors il a enfin posé ses lèvres sur les miennes, un baiser long et confus sur le trottoir qui a annihilé le reste, un baiser rassurant comme une respiration, puis notre déambulation finale vers un hôtel miteux, un établissement deux-étoiles planté au bord d’un boulevard bruyant, à l’ombre des structures métalliques du métro aérien agité de secousses au passage des rames bleues et blanches, grimper les trois étages sur sur les marches feutrées de la pension, les marches couvertes d’une moquette grenat élimée, et refermer la porte sur nous deux, sur notre histoire, enfin seuls, vraimentseuls, dans la chambre désuète de ce vieux bâtiment, avec le moignon en laiton massif gravé du numéro de notre piaule, la 312, qui oscillait dans le vide, pendu à la serrure, cognant comme un métronome la porte en bois, et mes ongles de s’accrocher aux aspérités de sa chair, arrachant les couches de vêtements, et ma langue avait débuté l’exploration de son corps, ce désir irréfrénable, ce désir surréel avec le sommeil en toile de fond, et lui m’a repoussée, gentiment refoulée, « ma Katia non ma Katia je préfère pas, pas déjà », et moi de poursuivre bien sûr, de redoubler d’ardeur, alors qu’il secouait gentiment la tête, comme un adulte amusé de tant d’enfantillages, et tentait de se défaire de mon emprise, souriant :
« Non, Katia… »
« Non, Katia… »
Je sortais tout juste de l’enfance, j’étais à un âge où l’on se dit que la vie ne vaut pas grand-chose, où l’on claironne que l’on voudrait se foutre en l’air et où l’on feint la mélancolie à la moindre contrariété parce que la dépression est encore quelque chose de séduisant, d’énigmatique et de romantique. Pour survivre, je courais après le fantastique, le ténébreux, je m’enveloppais dans des habits trop grands pour moi, j’imitais les attitudes et les poses en noir et blanc des Clash, dont je tapissais ma chambre de posters, leur aura sulfureuse sur papier glacé.
Comment en sommes-nous arrivés là ? Quand est-ce que tout a commencé ? À quel moment de ma vie ai-je senti que les choses allaient changer ? Que les eaux saumâtres de la dissension allaient s’immiscer entre nous, comme un lac sombre et profond. Un lac sournois dans lequel nous nous sommes noyés. Comment nous, ceux qu’on nommait les Yougoslaves, ce peuple uni, fraternel a laissé notre pays se déchirer, au point où je ne le reconnais plus aujourd’hui, au point où plus rien ne ressemble à ce qui avait cours avant, avant cela, lorsqu’il y avait encore la musique, les films de partisans et Vukovar, la ville où j’ai grandi, là-bas sur le Danube. Il y avait Jimmy. Il y avait les vacances d’été et les lettres envoyées à Tito. Avant, il y avait aussi Nada, ma cousine.
Il y avait tout ça.
Et même si tout existe encore aujourd’hui, même si tout est d’une certaine manière encore là, même si ma ville natale figure encore sur les cartes, même si les films de ma jeunesse se louent toujours dans les vidéoclubs ouverts 24 heures sur 24, derrière les néons publicitaires qui clignotent dans les rues pleines de vitrines débordantes de produits colorés, même si nos cassettes reposent toujours sur les étagères de fans de la première heure et si notre tube est encore joué parfois sur quelques stations de radio nostalgiques, même si les îles de notre enfance attirent de nouveau les touristes du monde entier, à l’intérieur de nous, tout a été réduit en miettes, en brasier fumant. Tout. Absolument tout. Et je dois vivre avec ces souvenirs heureux de l’avant, qui me laissent aujourd’hui un sale goût en bouche, un goût rance et avarié, parce que je sais maintenant pour sûr que ce bonheur de l’époque, que ces souvenirs enfantins n’étaient pas la réalité, que la réalité c’est ce qui s’est produit ensuite, c’est ce à quoi tous ces souvenirs ont mené, et il n’y a plus qu’une seule vérité aujourd’hui, c’est ce cataclysme qui nous écrasés. Mon histoire est l’histoire d’une lente mais inéluctable descente aux enfers.
Il y avait tout ça.
Et même si tout existe encore aujourd’hui, même si tout est d’une certaine manière encore là, même si ma ville natale figure encore sur les cartes, même si les films de ma jeunesse se louent toujours dans les vidéoclubs ouverts 24 heures sur 24, derrière les néons publicitaires qui clignotent dans les rues pleines de vitrines débordantes de produits colorés, même si nos cassettes reposent toujours sur les étagères de fans de la première heure et si notre tube est encore joué parfois sur quelques stations de radio nostalgiques, même si les îles de notre enfance attirent de nouveau les touristes du monde entier, à l’intérieur de nous, tout a été réduit en miettes, en brasier fumant. Tout. Absolument tout. Et je dois vivre avec ces souvenirs heureux de l’avant, qui me laissent aujourd’hui un sale goût en bouche, un goût rance et avarié, parce que je sais maintenant pour sûr que ce bonheur de l’époque, que ces souvenirs enfantins n’étaient pas la réalité, que la réalité c’est ce qui s’est produit ensuite, c’est ce à quoi tous ces souvenirs ont mené, et il n’y a plus qu’une seule vérité aujourd’hui, c’est ce cataclysme qui nous écrasés. Mon histoire est l’histoire d’une lente mais inéluctable descente aux enfers.
C’est un titre qui a de la gueule, c’est sulfureux, décapant. On se fera remarquer, avec ça, parce qu’aucun artiste oserait dire “Fuck you Yu”, et nous, on va le hurler, fuck you Yugoslavia, fuck you la Yougoslavie, comme les Sex Pistols, et non seulement notre chanson est géniale, mais en plus on va briser un tabou…
Tous nos étés se ressemblaient. Nous dormions. Nous nagions. Nous jouions de la musique. Et c’était à peu près tout. Des vacances paradisiaques dans un coin tout aussi idyllique, loin du tumulte pollué de Zagreb pour Jimmy et moi. Loin des plaines céréalières de Vukovar pour Nada.
La plage se vidait en cette fin d’après-midi. Il ne restait que les indécrottables, une poignée de retraités greffés à leurs transats en plastique blanc, qui dormaient là comme oubliés par le temps, comme échoués sur le rivage, le corps tanné par le soleil, leur peau huilée prenant la teinte du caramel, leur ventre rond celui de l’ambre brillant, et nous trois, nous trois, les inséparables, qui observions ces formes figées, momifiées par le soleil et l’air marin.
Nada portait un maillot deux-pièces mauve, encore détrempé par sa récente baignade. La mer Adriatique avait laissé une pincée de sel dans le duvet blond au-dessus de ses lèvres, comme des graines de pissenlit, fragiles et figées, comme une morsure légère. Elle avait noué ses cheveux mouillés et s’était assise en tailleur sur les galets de la crique, face à moi et ma guitare, face à Jimmy, torse nu
La plage se vidait en cette fin d’après-midi. Il ne restait que les indécrottables, une poignée de retraités greffés à leurs transats en plastique blanc, qui dormaient là comme oubliés par le temps, comme échoués sur le rivage, le corps tanné par le soleil, leur peau huilée prenant la teinte du caramel, leur ventre rond celui de l’ambre brillant, et nous trois, nous trois, les inséparables, qui observions ces formes figées, momifiées par le soleil et l’air marin.
Nada portait un maillot deux-pièces mauve, encore détrempé par sa récente baignade. La mer Adriatique avait laissé une pincée de sel dans le duvet blond au-dessus de ses lèvres, comme des graines de pissenlit, fragiles et figées, comme une morsure légère. Elle avait noué ses cheveux mouillés et s’était assise en tailleur sur les galets de la crique, face à moi et ma guitare, face à Jimmy, torse nu
Et je dois vivre avec ces souvenirs heureux de l’avant, qui me laissent aujourd’hui un sale goût en bouche, un goût rance et avarié, parce que je sais maintenant pour sûr que ce bonheur de l’époque, que ces souvenirs enfantins n’étaient pas la réalité, que la réalité c’est ce qui s’est produit ensuite, c’est ce à quoi tous ces souvenirs ont mené, et il n’y a plus qu’une seule vérité aujourd’hui, c’est ce cataclysme qui nous a écrasés. Mon histoire est l’histoire d’une lente mais inéluctable descente aux enfers.
Ses yeux se sont plongés dans les miens. Ses grands yeux verts. Un océan émouvant. Au fond duquel irradiait un éclat jaune. Une veilleuse fascinante. J’ai frissonné. Il m’a prise dans ses bras pour une longue accolade. « Ça te dit d’aller faire un tour ailleurs ? » il a susurré. Comme une évidence. Je l’ai suivi. Aimantée. M’éloignant amusée d’Aymeric qui a levé les deux bras en l’air dans un geste théâtral, depuis l’autre bout de la pièce, qui voulait dire : « Tu pars déjà ? Mais reste, bordel ! »
J’ai repensé à Pierre-Yves. À son regard. Je nous imaginais ensemble. Notre première étreinte, cette tension qui montait, ses mains qui cherchaient sur mon corps, ses caresses qui se rapprochaient. Nos corps emmêlés. Nos fluides échangés. Lui qui m’embrassait. Moi qui l’enlaçais de mes jambes. Nos intimités livrées. Les rêveries ardentes m’ont noué l’estomac, m’ont fait fourmiller le bas-ventre à mesure que je me jouais notre première étreinte.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Timothée Demeillers (4)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Littérature jeunesse
Comment s'appelle le héros créé par Neil Gailman ?
Somebody Owens
Dead Owens
Nobody Owens
Baby Owens
10 questions
1538 lecteurs ont répondu
Thèmes :
jeunesse
, littérature jeunesse
, enfantsCréer un quiz sur ce livre1538 lecteurs ont répondu