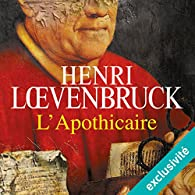>
Critique de encoredunoir
Andreas Saint-Loup, un des plus talentueux apothicaires de Paris, homme de peu de foi, découvre un beau matin de janvier 1313, dans sa maison, une pièce dont il avait complètement oublié l'existence. Peu après, c'est en regardant un portrait de lui qu'il s'aperçoit qu'un personnage présent à ses côtés a disparu sans qu'il puisse se souvenir de qui il s'agit. Bien vite, Saint-Loup se trouve aussi pris en chasse par de mystérieux cavaliers et par l'Inquisition sans savoir pourquoi. Commence pour lui une longue course jusqu'à Compostelle à la recherche d'un passé qui fuit sa mémoire.
En projetant le lecteur dans l'Occident médiéval, Henri Loevenbruck s'intègre on ne peut mieux à la Ligue de l'Imaginaire et à notre défi tant cette période tient une place importante dans notre imaginaire collectif. Temps obscurs, mystérieux, dominés par une religion inquisitrice qui peine à juguler hérésies et croyances populaires, les âges médiévaux sont un terreau fertile pour les auteurs qui, comme Loevenbruck ici, se piquent d'ésotérisme. Et, de fait, on trouvera là tous les ingrédients nécessaires : templiers, passages souterrains, codes secrets, sectes puissantes, mystère remontant aux origines de la Bible…
En soi, pour peu que l'on éprouve un attrait pour ce genre d'histoire ou que l'on accepte de s'y laisser entrainer, l'intrigue se tient relativement bien, même si elle use beaucoup des ficelles habituelles du genre – à commencer par les heureuses coïncidences et les apparitions de personnages aux moments cruciaux, permettant aux héros de sortir in extremis de la panade – et qu'elle apparaît souvent cousue de fil blanc. Notons d'ailleurs que ceci n'est pas un reproche ; souvent, le fait de se plonger dans ce genre de roman est un moyen pour le lecteur de retrouver une structure à laquelle il est habitué et qu'il apprécie. Il en va de même des contes. Ce n'est pas tant l'arrivée qui compte, que le voyage.
On retrouve donc les figures habituelles : un héros sévère mais juste dissimulant bien mal une profonde blessure, un apprenti qui joue les faire-valoir, une jeune fille innocente qui a commis un acte irréparable et se cherche elle-même, des putains au grand coeur et, bien entendu, des méchants vraiment très méchants. Car si Henri Loevenbruck cherche à donner un peu d'épaisseur et d'ambigüité aux personnages d'Andreas Saint-Loup et de la jeune Aalis – addiction à la drogue pour le premier, parenticide pour la seconde, carrément – il n'en demeure pas moins que le simple fait qu'ils sachent eux-mêmes combien leurs actes sont graves ou qu'ils soient consscients de leurs faiblesses fait d'eux des personnages éminemment gentils inspirant même la compassion. Ils sont bons, mais pas comme des super-héros. Ils sont humains. Comme nous. Au contraire des méchants, dont rien, jamais, ne donne à penser qu'ils puissent abriter en eux une once de gentillesse.
Là où, à notre sens, le roman pèche vraiment, c'est bien sur la forme. Et la forme commence par la langue utilisée. Henri Loevenbruck choisit ici d'écrire « à la manière de » ; d'un auteur médiéval en l'occurrence. le problème, bien entendu, est que la langue contemporaine se trouve bien éloignée de celle du Moyen age et serait proprement incompréhensible au commun des lecteurs. Loevenbruck décide donc de ponctuer son texte d'expressions ou de tournures de phrases inspirées de la langue médiévale (« Il était de ces figures assurées, qui oncques n'exhibent la moindre faiblesse, qui ont réponse à toute chose et ne quittent en aucun cas le masque leur sapience reconnue », p.24) qui tranchent parfois avec d'autres que l'on n'imaginait pas dater de cette époque – mais cela demande vérification – comme un magnifique « Et mon cul c'est du poulet ? », p.64. En fin de compte, cela donne à peu près la même impression que lorsque l'on écoute le colonel Klink, dans Papa Schultz , parler en français avec un abominable accent allemand enntrecoupé de quelques idiomatismes germaniques. L'effet comique est assuré, mais il n'est pas certain que ce soit celui que l'auteur recherchait.
Sans doute est-ce encore pire en ce qui concerne le parcours de la jeune Aalis lors duquel Loevenbruck se plait à ponctuer toutes les conversations d'expressions occitanes . Clairement, l'auteur s'éloigne là de la réalité sociolinguistique. Jeune bitteroise du XIVème siècle, Aalis ne peut parler qu'occitan et, lorsqu'elle est en présence de paysans languedociens, n'utiliser que cette langue. Dès lors, l'auteur à le choix : traduire le tout en français, ou l'écrire en occitan. On comprend bien que la deuxième solution ne soit pas des plus aisées et le roman ne perd rien à être écrit en français. Mais le choix de cette insertion d'expressions occitanes (même si on doit reconnaître à Henri Loevenbruck d'avoir fait un réel effort de recherche sur la langue et sa graphie) donne à ces parties du roman un air de pagnolade qui confine parfois au ridicule. Et l'on peut s'étonner que, une fois sortie du Languedoc, Aalis cesse de parler occitan, en particulier lorsqu'elle arrive en Béarn où l'occitan dans sa variante gasconne est alors langue d'État.
Il en va de même lorsqu'Aalis, toujours elle, entre dans le quartier juif de Bayonne et se trouve confrontée à une vieille dame qui cherche à la marier à tout prix. On a alors droit à un long dialogue où l'on croit entendre, au choix, Marthe Villalonga ou une publicité pour le couscous Garbit : « Et moi je te dis que je ne le connais pas ! Si je ne le connais pas, il y a peu de chances qu'il habite ici, tu sais, parce, parole de chadkhanit, je connais presque tout le monde, des lieues à la ronde ! Je peux même te trouver un mari à Bordeaux ou à Narbonne, si tu veux ! Un guêvêr ! Ma parole, je peux même t'en trouver un en Navarre s'il le faut ! ».
Si ces choix linguistiques peuvent s'avérer agaçant à la longue, un autre aspect de L'Apothicaire tend à devenir lassant. On l'a déjà vu avec d'autres romans lus lors de ce défi, il s'agit de cette tendance de certains auteurs à vouloir à tout prix s'appuyer sur la réalité (réalité historique, recherche scientifique, écrits philosophiques) à partir de laquelle ils vont pouvoir faire dévier leur histoire du côté de l'imaginaire. le procédé, en soi, n'est pas un problème. Il est à la base de romans comme ceux de Jules Verne ou d'Alexandre Dumas (qu'Henri Loevenbruck cite d'ailleurs en exergue : « Il est permis de violer l'histoire, à condition de lui faire un enfant ») pour ne citer qu'eux. Ce qui est problématique, c'est que la volonté de l'auteur de montrer au lecteur sa culture ou sa capacité à réunir des informations sur son sujet l'amène – comme Werber ou Giacometti et Ravenne, par exemple – à accumuler les longs développements parfois bien fastidieux servant à décrire telle ou telle ville, expliquer le fonctionnement de telle institution ou encore à expliquer tel fait culturel (les trobairitz par exemple).
Ce faisant, l'auteur laisse finalement peu l'occasion au lecteur de laisser filer sa propre imagination tend il le prend constamment par la main ; phénomène accentué ici par l'utilisation régulière d'adresses au lecteur lui indiquant qu'il lui faut bien faire attention à ce qui se passe à ce moment précis, qu'il ne doit pas s'inquiéter car on reviendra plus loin sur telle action…
Bref, comme souvent au long de ce défi, on se trouve confronté à un imaginaire très encadré. Sans doute, comme nous l'avons remarqué plus haut, parce que cela s'avère plus confortable pour un lecteur attendant un roman très balisé et où, en fin de compte, la surprise n'en est pas vraiment une. Mais pour qui se voudra un peu plus exigeant en matière de transport vers un autre monde, vers quelque chose qui excitera vraiment son propre imaginaire, tout cela paraîtra sans doute bien fade.
Henri Loevenbruck, L'Apothicaire, Flammarion, 2011.
Lien : http://www.encoredunoir.com/..
En projetant le lecteur dans l'Occident médiéval, Henri Loevenbruck s'intègre on ne peut mieux à la Ligue de l'Imaginaire et à notre défi tant cette période tient une place importante dans notre imaginaire collectif. Temps obscurs, mystérieux, dominés par une religion inquisitrice qui peine à juguler hérésies et croyances populaires, les âges médiévaux sont un terreau fertile pour les auteurs qui, comme Loevenbruck ici, se piquent d'ésotérisme. Et, de fait, on trouvera là tous les ingrédients nécessaires : templiers, passages souterrains, codes secrets, sectes puissantes, mystère remontant aux origines de la Bible…
En soi, pour peu que l'on éprouve un attrait pour ce genre d'histoire ou que l'on accepte de s'y laisser entrainer, l'intrigue se tient relativement bien, même si elle use beaucoup des ficelles habituelles du genre – à commencer par les heureuses coïncidences et les apparitions de personnages aux moments cruciaux, permettant aux héros de sortir in extremis de la panade – et qu'elle apparaît souvent cousue de fil blanc. Notons d'ailleurs que ceci n'est pas un reproche ; souvent, le fait de se plonger dans ce genre de roman est un moyen pour le lecteur de retrouver une structure à laquelle il est habitué et qu'il apprécie. Il en va de même des contes. Ce n'est pas tant l'arrivée qui compte, que le voyage.
On retrouve donc les figures habituelles : un héros sévère mais juste dissimulant bien mal une profonde blessure, un apprenti qui joue les faire-valoir, une jeune fille innocente qui a commis un acte irréparable et se cherche elle-même, des putains au grand coeur et, bien entendu, des méchants vraiment très méchants. Car si Henri Loevenbruck cherche à donner un peu d'épaisseur et d'ambigüité aux personnages d'Andreas Saint-Loup et de la jeune Aalis – addiction à la drogue pour le premier, parenticide pour la seconde, carrément – il n'en demeure pas moins que le simple fait qu'ils sachent eux-mêmes combien leurs actes sont graves ou qu'ils soient consscients de leurs faiblesses fait d'eux des personnages éminemment gentils inspirant même la compassion. Ils sont bons, mais pas comme des super-héros. Ils sont humains. Comme nous. Au contraire des méchants, dont rien, jamais, ne donne à penser qu'ils puissent abriter en eux une once de gentillesse.
Là où, à notre sens, le roman pèche vraiment, c'est bien sur la forme. Et la forme commence par la langue utilisée. Henri Loevenbruck choisit ici d'écrire « à la manière de » ; d'un auteur médiéval en l'occurrence. le problème, bien entendu, est que la langue contemporaine se trouve bien éloignée de celle du Moyen age et serait proprement incompréhensible au commun des lecteurs. Loevenbruck décide donc de ponctuer son texte d'expressions ou de tournures de phrases inspirées de la langue médiévale (« Il était de ces figures assurées, qui oncques n'exhibent la moindre faiblesse, qui ont réponse à toute chose et ne quittent en aucun cas le masque leur sapience reconnue », p.24) qui tranchent parfois avec d'autres que l'on n'imaginait pas dater de cette époque – mais cela demande vérification – comme un magnifique « Et mon cul c'est du poulet ? », p.64. En fin de compte, cela donne à peu près la même impression que lorsque l'on écoute le colonel Klink, dans Papa Schultz , parler en français avec un abominable accent allemand enntrecoupé de quelques idiomatismes germaniques. L'effet comique est assuré, mais il n'est pas certain que ce soit celui que l'auteur recherchait.
Sans doute est-ce encore pire en ce qui concerne le parcours de la jeune Aalis lors duquel Loevenbruck se plait à ponctuer toutes les conversations d'expressions occitanes . Clairement, l'auteur s'éloigne là de la réalité sociolinguistique. Jeune bitteroise du XIVème siècle, Aalis ne peut parler qu'occitan et, lorsqu'elle est en présence de paysans languedociens, n'utiliser que cette langue. Dès lors, l'auteur à le choix : traduire le tout en français, ou l'écrire en occitan. On comprend bien que la deuxième solution ne soit pas des plus aisées et le roman ne perd rien à être écrit en français. Mais le choix de cette insertion d'expressions occitanes (même si on doit reconnaître à Henri Loevenbruck d'avoir fait un réel effort de recherche sur la langue et sa graphie) donne à ces parties du roman un air de pagnolade qui confine parfois au ridicule. Et l'on peut s'étonner que, une fois sortie du Languedoc, Aalis cesse de parler occitan, en particulier lorsqu'elle arrive en Béarn où l'occitan dans sa variante gasconne est alors langue d'État.
Il en va de même lorsqu'Aalis, toujours elle, entre dans le quartier juif de Bayonne et se trouve confrontée à une vieille dame qui cherche à la marier à tout prix. On a alors droit à un long dialogue où l'on croit entendre, au choix, Marthe Villalonga ou une publicité pour le couscous Garbit : « Et moi je te dis que je ne le connais pas ! Si je ne le connais pas, il y a peu de chances qu'il habite ici, tu sais, parce, parole de chadkhanit, je connais presque tout le monde, des lieues à la ronde ! Je peux même te trouver un mari à Bordeaux ou à Narbonne, si tu veux ! Un guêvêr ! Ma parole, je peux même t'en trouver un en Navarre s'il le faut ! ».
Si ces choix linguistiques peuvent s'avérer agaçant à la longue, un autre aspect de L'Apothicaire tend à devenir lassant. On l'a déjà vu avec d'autres romans lus lors de ce défi, il s'agit de cette tendance de certains auteurs à vouloir à tout prix s'appuyer sur la réalité (réalité historique, recherche scientifique, écrits philosophiques) à partir de laquelle ils vont pouvoir faire dévier leur histoire du côté de l'imaginaire. le procédé, en soi, n'est pas un problème. Il est à la base de romans comme ceux de Jules Verne ou d'Alexandre Dumas (qu'Henri Loevenbruck cite d'ailleurs en exergue : « Il est permis de violer l'histoire, à condition de lui faire un enfant ») pour ne citer qu'eux. Ce qui est problématique, c'est que la volonté de l'auteur de montrer au lecteur sa culture ou sa capacité à réunir des informations sur son sujet l'amène – comme Werber ou Giacometti et Ravenne, par exemple – à accumuler les longs développements parfois bien fastidieux servant à décrire telle ou telle ville, expliquer le fonctionnement de telle institution ou encore à expliquer tel fait culturel (les trobairitz par exemple).
Ce faisant, l'auteur laisse finalement peu l'occasion au lecteur de laisser filer sa propre imagination tend il le prend constamment par la main ; phénomène accentué ici par l'utilisation régulière d'adresses au lecteur lui indiquant qu'il lui faut bien faire attention à ce qui se passe à ce moment précis, qu'il ne doit pas s'inquiéter car on reviendra plus loin sur telle action…
Bref, comme souvent au long de ce défi, on se trouve confronté à un imaginaire très encadré. Sans doute, comme nous l'avons remarqué plus haut, parce que cela s'avère plus confortable pour un lecteur attendant un roman très balisé et où, en fin de compte, la surprise n'en est pas vraiment une. Mais pour qui se voudra un peu plus exigeant en matière de transport vers un autre monde, vers quelque chose qui excitera vraiment son propre imaginaire, tout cela paraîtra sans doute bien fade.
Henri Loevenbruck, L'Apothicaire, Flammarion, 2011.
Lien : http://www.encoredunoir.com/..