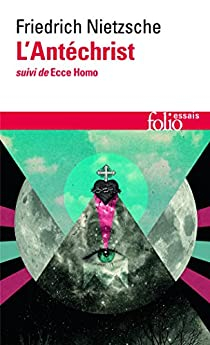>
Critique de HenryWar
L'extrême proximité, cette accointance de l'esprit et du coeur, cette sympathie si étroite qui m'unit à Nietzsche en tant qu'il fut l'un des derniers !... Un des derniers quoi ? demandera-t-on. Un des derniers hommes dignes, élevés, un des derniers explorateurs de la pensée, cela va sans dire ! un des derniers individus proprement et en cela l'un des derniers penseurs à pouvoir nous apprendre encore quelque chose sur le monde tel qu'il est resté à peu près inchangé depuis lui puisque justement il n'y a guère eu d'autres facteurs d'évolution notables intellectuellement. Sa façon de bravoure impolie et insistante ; sa courtoisie du méthodique sonneur de cloches au marteau, du donneur d'épée même dans l'eau ; sa menace tranquille faite à tout ce qui paralyse et dévie, à tout ce qui est faible et corrompu, inhumain, trop humain, en-deçà de la mesure de l'homme ; son superbe et terrible blasement provoqué par la vie tout comme l'intolérable et fatidique ignorance jalouse dont il fut l'objet et que lui valut notoirement sa priorité morale accordée à la recherche de la pureté au détriment des mignardises scolaires et bienséantes et de toutes formes de dédicaces ; sa certitude devenue farouche, intégrée, résignée, de sa solitude devenue compagne en lui au même titre qu'un alien qui arpenterait une terre étrangère ; enfin sa conscience presque désespérée qu'il n'y avait plus d'auditeur pour la vérité, que la vérité était déjà au-delà de la préoccupation générale, au-delà du confort bourgeois de l'avenir, jusqu'à atteindre au désintéressement redoutable d'écrire pour ne pas être lu et comme par nécessité inutile ! Tout aliène Nietzsche que son siècle rejette avec persistance malgré ses tentatives pour le rejoindre : il n'est pas maudit pourtant, nul n'a à subir ce raccourci de la malédiction qui n'est qu'un reliquat bête de vision romantique de la destinée ; c'est que le siècle n'en veut pas, ce que démontre l'obstination du siècle, après tant de publications, à ne pas le considérer jusqu'à ce qu'il puisse devenir à toute force un animal superficiellement et mensongèrement politique – avant cela, il ne sera pas du siècle, promesse du siècle ! étant senti d'emblée trop iconoclaste et ambitieux, humiliant et inactuel, difficile et douloureux comme Bloy ! le siècle à présent a mieux à faire que s'appesantir au génie difficultueux ! C'est ainsi qu'il devient prophète d'une contemporanéité qui dorénavant trouve mieux à faire que réfléchir, mieux à valoriser que l'art : pas assez ludique ou mondain, tout cela, ce sont de vieilles lubies élitistes et sérieuses, vestiges d'une autre ère empesée de dignité, comme les blasons du monarchisme, comme ses nobiliaires fiertés dont tout le monde se fiche à présent. Nietzsche, intempestif avec évidence à une époque où déjà l'Europe connaît le déclin littéraire – et son apogée tout ensemble, c'est logique –, car elle annonce et pervertit tout bien humain en marchandise pour foules, en prêt-à-porter ou en prêt-à-apprécier, en dérisoire-des-valeurs. Ce qui a de la valeur, c'est dorénavant ce qui se vend, et dans l'aimable folie du divertissement où l'on plonge, il n'y a que ce qui est distrayant qui fait recette.
Au fait, cet « avant-propos » ! j'en suis si intime, si familier, que je crois bien que j'en ai écrit bien des similitudes, que je l'assume comme mien, et qu'on dira même certainement que je l'ai ici ou là recopié ! Il constitue en soi la définition de ce qu'est un « hyperboréen », un esprit probe et libre et disponible, une faculté ouverte à lire Nietzsche : je veux m'approprier cette définition pour l'appliquer à mes propres lecteurs ou, devrais-je dire, à mon lecteur. Tout le génie de Nietzsche – et son style – est synthétisé dedans ; aussi, à défaut de lire L'Antéchrist, puisqu'il faut à tous des digests pour gagner le temps des vacances : lire son avant-propos : un vent d'altitude court sur ces lignes ; on n'a rien écrit de plus direct, de plus juste, de plus exact : c'est la boussole de l'esprit.
L'Antéchrist est la toute dernière charge de Nietzsche contre le christianisme – et je ne prétends pas expliciter en détails en quoi elle consiste, cela est trop connu et je me refuse aux explicitations pour étudiants type Folio Plus. Toujours seulement, c'est la religion des faibles – comme le philosophe tâche d'en établir la généalogie (nul autre, je crois, n'a tâché d'établir avec autant de « psychologie de l'homme » la généalogie d'une pensée) –, celle de la pitié, celle qui, en incitant à la destruction de tout ce qui est fort et audacieux, prétend faire le monde à la mesure effrayée des humbles qui peuvent ainsi continuer à nourrir la bonne conscience de leurs minables vertus : le christianisme est en cela une doctrine du malheur et du renversement des valeurs naturelles où triomphe celui qui n'a pas d'élan ni de volonté propre ; c'est l'apologie de la mauvaise santé physique et spirituelle. Celui que le christianisme vante et élit, c'est celui qui, sans cette structure pour le conforter et le soutenir, ne survivrait pas : le christianisme est le mépris de la hiérarchie vraisemblable des êtres. Sans parler de ses mensonges délibérés, de ses déformations éhontées, de sa démence vindicative, de ses harcèlements incommensurables, de ses travestissements de la vérité jusque dans ses textes, et en particulier de sa négation de cette réalité que le christianisme consiste exactement en un discours de l'absence de réalité, que la réalité est toujours pour lui un embarras, qu'il lui faut absolument le recours de l'imaginaire, raison pour quoi il a besoin de recourir systématiquement aux allégories et aux affects : le christianisme comme antiphilosophie à laquelle le monde s'est tristement habitué – et comment entendre ses niaiseries du point de vue de la réalité comme : « Ne juge point et tu ne seras point jugé » : beau précepte pour un jury de cour pénale ! d'autant que Nietzsche rappelle justement : « Mais ils expédient en enfer tout ce qui se met en travers de leur chemin » (page 98). Au grand surplus, le christianisme comme religion antichristique, le Christ n'ayant fait que l'exemple d'une attitude d'abandon de toute volonté de puissance – lire la preuve éclatante que Nietzsche, a compris mieux que personne, mieux même qu'un Chrétien, l'essence du Christ et sa « doctrine en actes » à travers l'aphorisme 35 –, tandis que le christianisme effectif est tout au contraire l'organisation d'une institution du rapport de force où le prêtre veut s'arroger tout pouvoir sur la société et les personnes qui la composent : le règne organisé et inféodé du royaume de Dieu sur Terre est en cela antithétique de la parole et de la geste du Christ. St Paul notamment est un grand infidèle par la violence même de sa ferveur, par le principe même de son prosélytisme : Jésus jamais n'imposait ni ne résistait.
Le christianisme, au lieu d'un dévouement, est une déviation. Rien n'y est droit, il ne s'y trouve aucune rectitude intellectuelle mais la béatitude des illusions – pléonasme : la vérité est toujours une difficulté. le christianisme a eu raison en un sens de faire grand cas du monde intérieur, du monde spirituel et de l'après-monde : ce lui était un opportunisme nécessaire, une occasion indispensable, car il est incapable de voir le monde réel tel qu'il est : il n'a pas d'autre choix stratégique que de détourner l'esprit du croyant sur ce qui n'est pas, allégorie, hypothèses, affects sans cause, artificialités oratoires de toutes sortes. Et même philologiquement c'est-à-dire quand il s'efforce de comprendre scrupuleusement ses propres évangiles, le christianisme est toujours une mauvaise foi : n'importe quel prêtre interprète à sa façon les textes « sacrés », pour autant que ce soit valorisant personne ne trouve à redire de ce qu'on leur fasse exprimer des contradictions : le Chrétien n'en a cure, il est au-dessus de cela, c'est-à-dire – de la vérité, c'est-à-dire de cette honnêteté du fait, pourvu que sa croyance soit consolidée et qu'il soit lui-même justifié. Ils sont encore nombreux, après tout et même parmi les « fervents », à croire que l'Immaculée Conception s'applique à la naissance de Jésus : cette déformation ne fait pour eux aucune différence, comme les autres.
Ce combat contre le christianisme n'est pas, comme Michel Onfray le prétendait encore récemment depuis qu'il s'est résolu, par politique, à ménager les communautés les plus vastes, un combat d'arrière-garde, une façon d'acculer des malheureux à la dernière extrémité de leurs forces en extinction : c'est qu'on n'a pas compris que la morale contemporaine est foncièrement chrétienne, se défiant de scientificité et de dialogisme, s'appuyant socialistement sur la défense du misérable, réfutant l'argument au profit de la conviction qui n'est que la foi sous un autre nom, incapable de débattre et d'accéder à des lumières qui lui soient initialement extérieures. Comme le Chrétien, le Contemporain refuse d'apprendre quelque chose qu'il ne sait pas déjà : il faut que toute vérité soit une révélation venue de l'intérieur. L'absence de caractère personnel d'un fait – l'effacement de l'individu au profit exclusif d'une solidarité de foule suffisant à accréditer –, est un motif profondément chrétien, tout comme la déformation éhontée de la vérité (ce que les Chrétiens validèrent sous l'appellation latine de « pia fraus » ou « mensonge pieux », artifice argumentatif non seulement qu'on permet mais qu'on incite à défaut de pouvoir rétorquer au « Mal »), l'auto-justification (ou bonne conscience pour l'estime de soi, le Chrétien ayant avant tout besoin d'avoir raison pour le seul profit de se sentir bien), et la position du porte-parole ou détournement de la responsabilité (l'autorité est ailleurs, c'est à elle qu'il faut demander des comptes, on n'a pas à argumenter soi-même, on ne fait que respecter la parole d'un grand) ; au même titre, le Chrétien est celui qui prie, c'est-à-dire qui ne fait rien, au mieux il manifeste en façon d'évangélisation : la société où nous sommes souffre exactement de tous ces vices, incluant cette absence d'engagement à l'action. Au même titre encore : l'obéissance et la crainte relativement à la morale qu'il n'est plus jamais question de réinterroger et de rétablir : une peur superstitieuse du « législateur » comme substitut du prêtre, et une défiance presque systématique de la parole du scientifique.
Notre époque pâtit, d'une certaine façon, d'une recrudescence du christianisme sous une forme ontologique. La raison contemporaine ne s'est pas remise de ce choc ancien dont elle a tant conservé l'atavisme erroné qu'elle ne s'aperçoit même plus qu'il l'infeste encore. Elle nie l'esprit rationnel, toute recherche structurée et autonome de vérité, toute possibilité même d'avoir raison à part et contre une majorité. Elle se contente d'appliquer des sentiments passés pour affirmer des réalités qui ne dépendent nullement du sentiment. Elle est tout d'affect et d'affectation comme le christianisme, et inapte à démontrer, sans méthode pour cela : elle n'a pas de « bon sens commun », contrairement à l'affirmation péremptoire de Descartes. Elle veut persuader, mais elle ignore convaincre. Elle n'a que le goût de ne pas perdre la face, et elle s'y empresse avec une fébrilité et une fureur tout chrétiennes qui servent plutôt de preuve à son manque de fondement, à son instabilité, à son peu de fiabilité. Elle voudrait bien mieux, si elle le pouvait encore, faire périr par l'opprobre et par l'ignominie, plutôt, tous ceux qui ne sont pas de son avis, façon décidément « d'expédier en enfer » : c'est plus simple, cela contrebalance et supplante l'agacement d'être utilement contredit.
Comme le christianisme, notre époque exige l'uniformité des opinions fondées sur la loi.
Il n'y aura pas d'avancée déterminante des civilisations – et j'affirme qu'il n'y en a pas eu depuis Nietzsche – tant que la question du christianisme et de son insidieuse persistance ne sera pas définitivement et consciemment traitée par ces civilisations.
Nous sommes gréco-romains, à ce qu'il paraît, et Nietzsche prétend que ce qui a servi principalement de sape à cette magnifique structure sociale de l'Antiquité est le christianisme avec sa morale de l'esclave – en quoi nous serions post-gréco-romains : une civilisation même chrétienne plutôt que judéo-chrétienne. Eh bien ! si nous aspirons à être encore au-delà de cela, il faut nous débarrasser du ferment de christianisme qui nous paralyse et nous encombre. Où il reste des vestiges du christianisme non dépassés, nous végétons, nous stagnons. Il y aurait, sans cela, de quoi redresser l'humanité et la dignifier pour longtemps ! Notre société est devenue peut-être pire encore, dégradée, déchue, car elle maintient son christianisme sans y croire ; elle est bâtarde et hypocrite ; elle conserve son socle par intéressement, pour asseoir toutes ses fois, mais elle ne croit plus : elle se sert des procédés rhétoriques de la foi chrétienne pour discuter et disputer – notamment toutes les formes dites « argumentées » du socialisme où des valeurs jamais réinterrogées et absolument tabou tiennent lieu de fonds – mais elle n'a plus la foi chrétienne. Nous avons gardé la mièvrerie, la compassion, la tolérance, l'amour poisseux, la passion des compromis et de l'universalité, l'impersonnalité des motifs, l'absence de probité et maintes traditions afférentes, mais nous n'avons plus le détachement de passivité, l'absence de lutte ni le courage de subir patiemment la gifle des forts que personnifiait le Christ résigné… en qui nous ne croyons d'aucune façon bien ferme. Après nous être construits de faussetés et d'illusions, nous sommes aujourd'hui bâtis de la ruine de ces faussetés et illusions, ce qui est encore moindre. Pire : à présent, nous le savons ; ainsi, toute notre posture est fabriquée d'une incohérence volontaire.
Nous sommes un pays d'athées avec un système argumentatif chrétien. On croit toujours avoir raison pour la raison qu'on le sent – les arguments viennent après le sentiment qu'à présent on nomme conviction : et l'on prétendrait faire de la parole contemporaine une force ? Même, tout ce que le peuple déplore dans sa politique vient de là : on sait une chose a priori (qu'on a bien agi, qu'on a raison, que le fait est tel qu'on se le représente…), par conséquent on doit y trouver des arguments non seulement pour répandre cette idée mais pour l'instituer – c'est dans ce sens vicié que se réalise aujourd'hui encore toute réflexion y compris politique. Tout citoyen qui s'inquiète de l'irrationnalité hypocrite de ses élus doit en tout premier lieu s'interroger sur l'origine curieuse de ce travers : or, ne sont-ils pas, ne se sentent-il pas précisément, des Élus ? Il y a là un mode de pensée très chrétien si l'on y songe : celui qui gouverne les hommes leur est supérieur non par la Raison, mais par ses raisons, c'est à peine s'il a à se justifier ; il y aurait en soi de quoi définir l'origine et la forme mêmes de ce qu'on appelle « l'ambition » dans notre civilisation. le règne, le « roi », est toujours fondamentalement, foncièrement, inconsciemment le Christ en notre société et, s'il a tort, c'est que Dieu a tort : rien ne peut vraiment changer d'un régime avec cette conception-là dont nous sommes les héritiers et qui demeure sinon en nos gènes, du moins en un patrimoine que nous n'avons toujours pas véritablement renié, dont nous nous flattons même bien souvent tantôt comme d'une fatalité, tantôt comme d'un avantage, et tantôt comme d'une fierté.
Nous sommes héritiers de chrétiens, sans nul doute, et il importe pour notre grandeur ou ne serait-ce que pour notre saine croissance que cet héritage ne soit pas de nouveau transmis ; or, tant il persiste et contamine effectivement, il l'est même faute d'y réfléchir : c'est comme un palimpseste dont le premier écrit revient toujours faute d'être raturé et gratté jusqu'à la trame du parchemin. En quoi le dernier débat, l'ultime controverse, la dispute finale de la philosophie et de la pensée humaine est bien, à défaut d'avoir innervé le monde, le sujet de Nietzsche en 1896 : rien après, que des émanations chrétiennes pas encore évacuées, pas encore digérées et « déféquées », toujours des reprises, des repousses, des bourgeonnements ultérieurs, fondés sur ce mode, tardifs, obsolètes et sans cesse réactualisés, tant que la sève coule. On regreffe et c'est tout : le mal repart. Il n'y a pas de nouvelles pensées depuis lors, car le poison y coule toujours.
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Au fait, cet « avant-propos » ! j'en suis si intime, si familier, que je crois bien que j'en ai écrit bien des similitudes, que je l'assume comme mien, et qu'on dira même certainement que je l'ai ici ou là recopié ! Il constitue en soi la définition de ce qu'est un « hyperboréen », un esprit probe et libre et disponible, une faculté ouverte à lire Nietzsche : je veux m'approprier cette définition pour l'appliquer à mes propres lecteurs ou, devrais-je dire, à mon lecteur. Tout le génie de Nietzsche – et son style – est synthétisé dedans ; aussi, à défaut de lire L'Antéchrist, puisqu'il faut à tous des digests pour gagner le temps des vacances : lire son avant-propos : un vent d'altitude court sur ces lignes ; on n'a rien écrit de plus direct, de plus juste, de plus exact : c'est la boussole de l'esprit.
L'Antéchrist est la toute dernière charge de Nietzsche contre le christianisme – et je ne prétends pas expliciter en détails en quoi elle consiste, cela est trop connu et je me refuse aux explicitations pour étudiants type Folio Plus. Toujours seulement, c'est la religion des faibles – comme le philosophe tâche d'en établir la généalogie (nul autre, je crois, n'a tâché d'établir avec autant de « psychologie de l'homme » la généalogie d'une pensée) –, celle de la pitié, celle qui, en incitant à la destruction de tout ce qui est fort et audacieux, prétend faire le monde à la mesure effrayée des humbles qui peuvent ainsi continuer à nourrir la bonne conscience de leurs minables vertus : le christianisme est en cela une doctrine du malheur et du renversement des valeurs naturelles où triomphe celui qui n'a pas d'élan ni de volonté propre ; c'est l'apologie de la mauvaise santé physique et spirituelle. Celui que le christianisme vante et élit, c'est celui qui, sans cette structure pour le conforter et le soutenir, ne survivrait pas : le christianisme est le mépris de la hiérarchie vraisemblable des êtres. Sans parler de ses mensonges délibérés, de ses déformations éhontées, de sa démence vindicative, de ses harcèlements incommensurables, de ses travestissements de la vérité jusque dans ses textes, et en particulier de sa négation de cette réalité que le christianisme consiste exactement en un discours de l'absence de réalité, que la réalité est toujours pour lui un embarras, qu'il lui faut absolument le recours de l'imaginaire, raison pour quoi il a besoin de recourir systématiquement aux allégories et aux affects : le christianisme comme antiphilosophie à laquelle le monde s'est tristement habitué – et comment entendre ses niaiseries du point de vue de la réalité comme : « Ne juge point et tu ne seras point jugé » : beau précepte pour un jury de cour pénale ! d'autant que Nietzsche rappelle justement : « Mais ils expédient en enfer tout ce qui se met en travers de leur chemin » (page 98). Au grand surplus, le christianisme comme religion antichristique, le Christ n'ayant fait que l'exemple d'une attitude d'abandon de toute volonté de puissance – lire la preuve éclatante que Nietzsche, a compris mieux que personne, mieux même qu'un Chrétien, l'essence du Christ et sa « doctrine en actes » à travers l'aphorisme 35 –, tandis que le christianisme effectif est tout au contraire l'organisation d'une institution du rapport de force où le prêtre veut s'arroger tout pouvoir sur la société et les personnes qui la composent : le règne organisé et inféodé du royaume de Dieu sur Terre est en cela antithétique de la parole et de la geste du Christ. St Paul notamment est un grand infidèle par la violence même de sa ferveur, par le principe même de son prosélytisme : Jésus jamais n'imposait ni ne résistait.
Le christianisme, au lieu d'un dévouement, est une déviation. Rien n'y est droit, il ne s'y trouve aucune rectitude intellectuelle mais la béatitude des illusions – pléonasme : la vérité est toujours une difficulté. le christianisme a eu raison en un sens de faire grand cas du monde intérieur, du monde spirituel et de l'après-monde : ce lui était un opportunisme nécessaire, une occasion indispensable, car il est incapable de voir le monde réel tel qu'il est : il n'a pas d'autre choix stratégique que de détourner l'esprit du croyant sur ce qui n'est pas, allégorie, hypothèses, affects sans cause, artificialités oratoires de toutes sortes. Et même philologiquement c'est-à-dire quand il s'efforce de comprendre scrupuleusement ses propres évangiles, le christianisme est toujours une mauvaise foi : n'importe quel prêtre interprète à sa façon les textes « sacrés », pour autant que ce soit valorisant personne ne trouve à redire de ce qu'on leur fasse exprimer des contradictions : le Chrétien n'en a cure, il est au-dessus de cela, c'est-à-dire – de la vérité, c'est-à-dire de cette honnêteté du fait, pourvu que sa croyance soit consolidée et qu'il soit lui-même justifié. Ils sont encore nombreux, après tout et même parmi les « fervents », à croire que l'Immaculée Conception s'applique à la naissance de Jésus : cette déformation ne fait pour eux aucune différence, comme les autres.
Ce combat contre le christianisme n'est pas, comme Michel Onfray le prétendait encore récemment depuis qu'il s'est résolu, par politique, à ménager les communautés les plus vastes, un combat d'arrière-garde, une façon d'acculer des malheureux à la dernière extrémité de leurs forces en extinction : c'est qu'on n'a pas compris que la morale contemporaine est foncièrement chrétienne, se défiant de scientificité et de dialogisme, s'appuyant socialistement sur la défense du misérable, réfutant l'argument au profit de la conviction qui n'est que la foi sous un autre nom, incapable de débattre et d'accéder à des lumières qui lui soient initialement extérieures. Comme le Chrétien, le Contemporain refuse d'apprendre quelque chose qu'il ne sait pas déjà : il faut que toute vérité soit une révélation venue de l'intérieur. L'absence de caractère personnel d'un fait – l'effacement de l'individu au profit exclusif d'une solidarité de foule suffisant à accréditer –, est un motif profondément chrétien, tout comme la déformation éhontée de la vérité (ce que les Chrétiens validèrent sous l'appellation latine de « pia fraus » ou « mensonge pieux », artifice argumentatif non seulement qu'on permet mais qu'on incite à défaut de pouvoir rétorquer au « Mal »), l'auto-justification (ou bonne conscience pour l'estime de soi, le Chrétien ayant avant tout besoin d'avoir raison pour le seul profit de se sentir bien), et la position du porte-parole ou détournement de la responsabilité (l'autorité est ailleurs, c'est à elle qu'il faut demander des comptes, on n'a pas à argumenter soi-même, on ne fait que respecter la parole d'un grand) ; au même titre, le Chrétien est celui qui prie, c'est-à-dire qui ne fait rien, au mieux il manifeste en façon d'évangélisation : la société où nous sommes souffre exactement de tous ces vices, incluant cette absence d'engagement à l'action. Au même titre encore : l'obéissance et la crainte relativement à la morale qu'il n'est plus jamais question de réinterroger et de rétablir : une peur superstitieuse du « législateur » comme substitut du prêtre, et une défiance presque systématique de la parole du scientifique.
Notre époque pâtit, d'une certaine façon, d'une recrudescence du christianisme sous une forme ontologique. La raison contemporaine ne s'est pas remise de ce choc ancien dont elle a tant conservé l'atavisme erroné qu'elle ne s'aperçoit même plus qu'il l'infeste encore. Elle nie l'esprit rationnel, toute recherche structurée et autonome de vérité, toute possibilité même d'avoir raison à part et contre une majorité. Elle se contente d'appliquer des sentiments passés pour affirmer des réalités qui ne dépendent nullement du sentiment. Elle est tout d'affect et d'affectation comme le christianisme, et inapte à démontrer, sans méthode pour cela : elle n'a pas de « bon sens commun », contrairement à l'affirmation péremptoire de Descartes. Elle veut persuader, mais elle ignore convaincre. Elle n'a que le goût de ne pas perdre la face, et elle s'y empresse avec une fébrilité et une fureur tout chrétiennes qui servent plutôt de preuve à son manque de fondement, à son instabilité, à son peu de fiabilité. Elle voudrait bien mieux, si elle le pouvait encore, faire périr par l'opprobre et par l'ignominie, plutôt, tous ceux qui ne sont pas de son avis, façon décidément « d'expédier en enfer » : c'est plus simple, cela contrebalance et supplante l'agacement d'être utilement contredit.
Comme le christianisme, notre époque exige l'uniformité des opinions fondées sur la loi.
Il n'y aura pas d'avancée déterminante des civilisations – et j'affirme qu'il n'y en a pas eu depuis Nietzsche – tant que la question du christianisme et de son insidieuse persistance ne sera pas définitivement et consciemment traitée par ces civilisations.
Nous sommes gréco-romains, à ce qu'il paraît, et Nietzsche prétend que ce qui a servi principalement de sape à cette magnifique structure sociale de l'Antiquité est le christianisme avec sa morale de l'esclave – en quoi nous serions post-gréco-romains : une civilisation même chrétienne plutôt que judéo-chrétienne. Eh bien ! si nous aspirons à être encore au-delà de cela, il faut nous débarrasser du ferment de christianisme qui nous paralyse et nous encombre. Où il reste des vestiges du christianisme non dépassés, nous végétons, nous stagnons. Il y aurait, sans cela, de quoi redresser l'humanité et la dignifier pour longtemps ! Notre société est devenue peut-être pire encore, dégradée, déchue, car elle maintient son christianisme sans y croire ; elle est bâtarde et hypocrite ; elle conserve son socle par intéressement, pour asseoir toutes ses fois, mais elle ne croit plus : elle se sert des procédés rhétoriques de la foi chrétienne pour discuter et disputer – notamment toutes les formes dites « argumentées » du socialisme où des valeurs jamais réinterrogées et absolument tabou tiennent lieu de fonds – mais elle n'a plus la foi chrétienne. Nous avons gardé la mièvrerie, la compassion, la tolérance, l'amour poisseux, la passion des compromis et de l'universalité, l'impersonnalité des motifs, l'absence de probité et maintes traditions afférentes, mais nous n'avons plus le détachement de passivité, l'absence de lutte ni le courage de subir patiemment la gifle des forts que personnifiait le Christ résigné… en qui nous ne croyons d'aucune façon bien ferme. Après nous être construits de faussetés et d'illusions, nous sommes aujourd'hui bâtis de la ruine de ces faussetés et illusions, ce qui est encore moindre. Pire : à présent, nous le savons ; ainsi, toute notre posture est fabriquée d'une incohérence volontaire.
Nous sommes un pays d'athées avec un système argumentatif chrétien. On croit toujours avoir raison pour la raison qu'on le sent – les arguments viennent après le sentiment qu'à présent on nomme conviction : et l'on prétendrait faire de la parole contemporaine une force ? Même, tout ce que le peuple déplore dans sa politique vient de là : on sait une chose a priori (qu'on a bien agi, qu'on a raison, que le fait est tel qu'on se le représente…), par conséquent on doit y trouver des arguments non seulement pour répandre cette idée mais pour l'instituer – c'est dans ce sens vicié que se réalise aujourd'hui encore toute réflexion y compris politique. Tout citoyen qui s'inquiète de l'irrationnalité hypocrite de ses élus doit en tout premier lieu s'interroger sur l'origine curieuse de ce travers : or, ne sont-ils pas, ne se sentent-il pas précisément, des Élus ? Il y a là un mode de pensée très chrétien si l'on y songe : celui qui gouverne les hommes leur est supérieur non par la Raison, mais par ses raisons, c'est à peine s'il a à se justifier ; il y aurait en soi de quoi définir l'origine et la forme mêmes de ce qu'on appelle « l'ambition » dans notre civilisation. le règne, le « roi », est toujours fondamentalement, foncièrement, inconsciemment le Christ en notre société et, s'il a tort, c'est que Dieu a tort : rien ne peut vraiment changer d'un régime avec cette conception-là dont nous sommes les héritiers et qui demeure sinon en nos gènes, du moins en un patrimoine que nous n'avons toujours pas véritablement renié, dont nous nous flattons même bien souvent tantôt comme d'une fatalité, tantôt comme d'un avantage, et tantôt comme d'une fierté.
Nous sommes héritiers de chrétiens, sans nul doute, et il importe pour notre grandeur ou ne serait-ce que pour notre saine croissance que cet héritage ne soit pas de nouveau transmis ; or, tant il persiste et contamine effectivement, il l'est même faute d'y réfléchir : c'est comme un palimpseste dont le premier écrit revient toujours faute d'être raturé et gratté jusqu'à la trame du parchemin. En quoi le dernier débat, l'ultime controverse, la dispute finale de la philosophie et de la pensée humaine est bien, à défaut d'avoir innervé le monde, le sujet de Nietzsche en 1896 : rien après, que des émanations chrétiennes pas encore évacuées, pas encore digérées et « déféquées », toujours des reprises, des repousses, des bourgeonnements ultérieurs, fondés sur ce mode, tardifs, obsolètes et sans cesse réactualisés, tant que la sève coule. On regreffe et c'est tout : le mal repart. Il n'y a pas de nouvelles pensées depuis lors, car le poison y coule toujours.
Lien : http://henrywar.canalblog.com