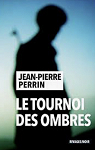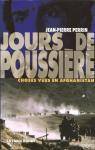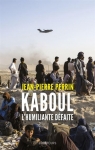Citations sur Le djihad contre le rêve d'Alexandre en Afghanistan, de.. (3)
'Derrière l'exotisme et derrière les paysages sublimes se cache une réalité sociale très laide. Certes, le melmastia et le nanawatai, les devoirs de protection qui s'appliquent aux membres les plus faibles des tribus pour les protéger et même aux ennemis, sont de belles déclinaisons du patchounwali, mais ce code d'honneur appliqué aux femmes est terrible. Dans ce Waziristan, il est pire encore.
Les femmes sont le bétail de ces vallées. Elles ne servent qu'à travailler du matin au soir et à faire des gosses - malheur à celles qui ne font que des filles. On ne les aperçoit que pliées en deux dans les champs ou portant sur la tête d'imposants fagots de bois ou des seaux de linge et, occasionnellement, au bazar, revêtues de la burqa à la place du voile. Même si certains anthropologues assurent qu'elles sont reines du foyer, on les exploite, on les marie à des veillards, on les brutalise, on les frappe, on les vend; il arrive qu'on les brûle et qu'on les tue. Parfois, pour mettre fin à un badal, on les livre dès l'adolescence à la famille ennemie, ce qui les condamne à un esclavage domestique qui durera jusqu'à leur mort'.
Les femmes sont le bétail de ces vallées. Elles ne servent qu'à travailler du matin au soir et à faire des gosses - malheur à celles qui ne font que des filles. On ne les aperçoit que pliées en deux dans les champs ou portant sur la tête d'imposants fagots de bois ou des seaux de linge et, occasionnellement, au bazar, revêtues de la burqa à la place du voile. Même si certains anthropologues assurent qu'elles sont reines du foyer, on les exploite, on les marie à des veillards, on les brutalise, on les frappe, on les vend; il arrive qu'on les brûle et qu'on les tue. Parfois, pour mettre fin à un badal, on les livre dès l'adolescence à la famille ennemie, ce qui les condamne à un esclavage domestique qui durera jusqu'à leur mort'.
L’honneur, c’est la vertu capitale des Afghans. Ahmad Shah Abdali, le fondateur de l’Afghanistan sur lequel il régna pendant vingt-six ans (il est mort en 1773) et qui fut aussi un grand poète en pachtou et en perse, l’évoque souvent dans les quelque trois mille vers qu’il écrivit :
La mort sur le chemin de l’honneur n’est pas la mort.
La vie d’un homme sans courage est vraiment un fardeau.
Je ne dévierai jamais du chemin de l’honneur puisque la valeur de ce monde est l’honneur.
Cet honneur, il existe plusieurs termes pour le désigner. Le plus fréquent est le ghayrat ou nang. D’emblée, il fait référence à la tribu, aux valeurs féodales, à l’acabiya, l’appartenance communautaire au sens le plus fort qui donne une cohésion sociale au groupe, un concept forgé par Ibn Khaldun, les sociétés urbaines et modernes ne reposant pas sur le sens de l’honneur. Aux yeux du montagnard afghan ou pakistanais, le citadin ou l’agriculteur du Pendjab en sont dépourvus, de même que l’employé, quel que soit son rang, du gouvernement ou de l’État. La notion dépasse l’individu pour englober sa famille, proche et élargie, en particulier les femmes qui ne doivent en aucun cas faillir au ghayrat des mâles de la maison, et même du clan, parfois de la tribu. C’est au nom du ghayrat qu’on surveille de près les épouses, les sœurs et les filles, que l’on contrôle le moindre de leurs déplacements, qu’on leur proscrit l’accès à certaines professions ou même d’aller chez le médecin. Le ghayrat leur évite de glisser sur la pente, si infime soit-elle, dangereuse pour l’honneur familial ou clanique, et permet de corriger sans cesse leur attitude. On utilise le même mot dans le vocabulaire des chameliers : pour que la charge portée par un dromadaire reste équilibrée de part et d’autre de sa bosse et immobile malgré le balancement de l’animal en marche ; charge qu’il est sans cesse nécessaire de réajuster.
(...)
Mais le ghayrat implique également la défense des parents et proches, des amis, des propriétés familiales, des plus faibles, la lutte contre ce qui est inique, l’oppression, le colonisateur évidemment. Ne pas se révolter, c’est attenter à son propre honneur. Ce qui fait le prestige des moudjahidine et, aujourd’hui, des talibans, c’est qu’ils sont par excellence les hommes du ghayrat : ils s’opposent à l’envahisseur qui, lui, n’est pas forcément bi-ghayrat : il l’est s’il emploie des drones ou des bombardements aériens ; il y échappe s’il se bat loyalement, sur le terrain. Le ghayrat conduit donc naturellement à la guerre. Il est comme un toboggan au profit des pulsions de mort, subtilement libérées, projetées en avant, entraînant tout l’être vers l’anéantissement de l’autre – ou de lui-même à travers le martyre. (pp. 116-118)
La mort sur le chemin de l’honneur n’est pas la mort.
La vie d’un homme sans courage est vraiment un fardeau.
Je ne dévierai jamais du chemin de l’honneur puisque la valeur de ce monde est l’honneur.
Cet honneur, il existe plusieurs termes pour le désigner. Le plus fréquent est le ghayrat ou nang. D’emblée, il fait référence à la tribu, aux valeurs féodales, à l’acabiya, l’appartenance communautaire au sens le plus fort qui donne une cohésion sociale au groupe, un concept forgé par Ibn Khaldun, les sociétés urbaines et modernes ne reposant pas sur le sens de l’honneur. Aux yeux du montagnard afghan ou pakistanais, le citadin ou l’agriculteur du Pendjab en sont dépourvus, de même que l’employé, quel que soit son rang, du gouvernement ou de l’État. La notion dépasse l’individu pour englober sa famille, proche et élargie, en particulier les femmes qui ne doivent en aucun cas faillir au ghayrat des mâles de la maison, et même du clan, parfois de la tribu. C’est au nom du ghayrat qu’on surveille de près les épouses, les sœurs et les filles, que l’on contrôle le moindre de leurs déplacements, qu’on leur proscrit l’accès à certaines professions ou même d’aller chez le médecin. Le ghayrat leur évite de glisser sur la pente, si infime soit-elle, dangereuse pour l’honneur familial ou clanique, et permet de corriger sans cesse leur attitude. On utilise le même mot dans le vocabulaire des chameliers : pour que la charge portée par un dromadaire reste équilibrée de part et d’autre de sa bosse et immobile malgré le balancement de l’animal en marche ; charge qu’il est sans cesse nécessaire de réajuster.
(...)
Mais le ghayrat implique également la défense des parents et proches, des amis, des propriétés familiales, des plus faibles, la lutte contre ce qui est inique, l’oppression, le colonisateur évidemment. Ne pas se révolter, c’est attenter à son propre honneur. Ce qui fait le prestige des moudjahidine et, aujourd’hui, des talibans, c’est qu’ils sont par excellence les hommes du ghayrat : ils s’opposent à l’envahisseur qui, lui, n’est pas forcément bi-ghayrat : il l’est s’il emploie des drones ou des bombardements aériens ; il y échappe s’il se bat loyalement, sur le terrain. Le ghayrat conduit donc naturellement à la guerre. Il est comme un toboggan au profit des pulsions de mort, subtilement libérées, projetées en avant, entraînant tout l’être vers l’anéantissement de l’autre – ou de lui-même à travers le martyre. (pp. 116-118)
A cette époque, il est bien difficile de saisir ce qui sépare les barbus de Gulbuddin Hekmatyar des poilus du mollah Mohammad Omar. Les deux chefs sont des Pachtouns, le premier du nord de l’Afghanistan, le second du sud. Tous deux ont combattu l’armée soviétique – le mollah Omar y a perdu son œil. Ils sont l’un et l’autre liés aux services secrets de l’armée pakistanaise, dont ils dépendent totalement pour leur armement et leur logistique. Ils veulent enfin faire de l’Afghanistan un État strictement islamiste fondé sur la charî’a.
Au-delà des questions de personne, c’est sur la conception de cet État qu’ils divergent. Hekmatyar veut une République islamique dirigée par un parti unique, le Hezb-e-Islami, où les commissaires politiques l’emporteront sur les religieux. A sa façon, c’est un moderniste. Plus traditionaliste, le mollah Omar, qui va bientôt se proclamer Amir Mouminin (commandeur des croyants), entend établir un émirat sans aucun parti, résurgence de celui qui était censé exister du temps de Mahomet. C’est, selon eux, une bonne raison de se faire la guerre. De plus, aux yeux du mollah Omar, Hekmatyar et ses hommes sont liés aux seigneurs de guerre et aux trafiquants dont il a promis de débarrasser l’Afghanistan. (p. 65)
Au-delà des questions de personne, c’est sur la conception de cet État qu’ils divergent. Hekmatyar veut une République islamique dirigée par un parti unique, le Hezb-e-Islami, où les commissaires politiques l’emporteront sur les religieux. A sa façon, c’est un moderniste. Plus traditionaliste, le mollah Omar, qui va bientôt se proclamer Amir Mouminin (commandeur des croyants), entend établir un émirat sans aucun parti, résurgence de celui qui était censé exister du temps de Mahomet. C’est, selon eux, une bonne raison de se faire la guerre. De plus, aux yeux du mollah Omar, Hekmatyar et ses hommes sont liés aux seigneurs de guerre et aux trafiquants dont il a promis de débarrasser l’Afghanistan. (p. 65)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jean-Pierre Perrin (13)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1742 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1742 lecteurs ont répondu