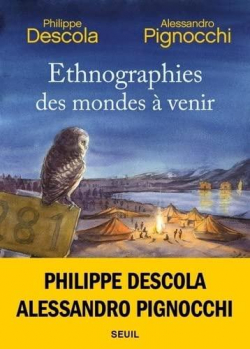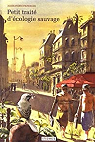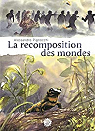Un bel ouvrage qui regorge de pépites intellectuelles et de nouvelles perspectives comme une bouffée d'air frais... mais qui aurait pu délivrer ses messages de manière plus concise et plus fluide.
Il me semble que Philippe Descola avait dit un jour que l'anthropologie permettait de penser les impensés de la société, et Ethnographies des mondes à venir se situe totalement dans cette perspective : décortiquer la notion toute occidentale/capitaliste de nature pour nous amener à imaginer d'autres rapports, libérés des contraintes économiques, avec les non humains. le tout en prenant comme guides principaux les Achuars (pour les personnes qui connaissent le travail de Descola, cette partie sonnera comme une répétition un peu longue) et les ZAD, mais sans jamais vanter un modèle d'organisation sociétale en particulier.
Le propos est dense, parfois inutilement complexe d'ailleurs : pas le genre de lecture à entamer entre deux gares. Mon erreur était en effet de croire que le parti pris de l'ouvrage sous forme de dialogue fluidifierait le propos : en vérité, ce sont plus des blocs de textes successifs qu'une réelle conversation, dans un aller-retour un peu artificiel entre les deux auteurs. Même si, heureusement, les traits d'aquarelle et d'humour d'Alessandro Pignocchi permettent des respirations nécessaires.
Il me semble que Philippe Descola avait dit un jour que l'anthropologie permettait de penser les impensés de la société, et Ethnographies des mondes à venir se situe totalement dans cette perspective : décortiquer la notion toute occidentale/capitaliste de nature pour nous amener à imaginer d'autres rapports, libérés des contraintes économiques, avec les non humains. le tout en prenant comme guides principaux les Achuars (pour les personnes qui connaissent le travail de Descola, cette partie sonnera comme une répétition un peu longue) et les ZAD, mais sans jamais vanter un modèle d'organisation sociétale en particulier.
Le propos est dense, parfois inutilement complexe d'ailleurs : pas le genre de lecture à entamer entre deux gares. Mon erreur était en effet de croire que le parti pris de l'ouvrage sous forme de dialogue fluidifierait le propos : en vérité, ce sont plus des blocs de textes successifs qu'une réelle conversation, dans un aller-retour un peu artificiel entre les deux auteurs. Même si, heureusement, les traits d'aquarelle et d'humour d'Alessandro Pignocchi permettent des respirations nécessaires.
C'est avec une certaine déception, ou plutôt une déception certaine que je repose ce livre, un peu agacée qu'on attribue à Descola la paternité de ce qu'on a dit bien avant lui concernant la nature, la culture, l'Occident industriel (ce que Heidegger appelle le "Gestell") et l'exploitation des ressources. Un peu agacée aussi par les inexactitudes, les anachronismes, toutes ces choses approximatives qui finissent nécessairement par dérailler. le grand anthropologue et sociologue Louis Dumont, décédé en 1998, a bien mieux décrit en quoi consistait l'origine chrétienne de l'individualisme moderne, et c'est presque devenu un lieu commun de montrer après tant d'autres ce que les monstruosités en matière d'écologie doivent à la sécularisation par le capitalisme de la théodicée chrétienne, ce plan d'ensemble censé conduire l'humanité.
Au moins cinquante ans que les partisans de la deep ecology et le philosophe norvégien Arne Naess, au moins cinquante ans qu'Alain Hervé et Edwin Matthews, fondateurs d'Amis de la Terre et créateurs de la première collection écologiste chez Fayard auront dit la même chose avec infiniment plus de justesse et de talent.
J'ai bien peur, hélas! que le fond du discours soit bien moins écologiste qu'un prétexte à une auto-flagellation convenue de donneurs de leçons universels (d'où le titre "Ethnographie"). Car enfin, des Européens qui accusent l'eurocentrisme d'être la cause de tout le mal dans le monde (seuls les Européens... les autres peuples ne font pas ci, ni ça), qu'est-ce d'autre qu'une illustration de cette propension européenne à distribuer des bons points au reste du monde et à creuser des différences artificielles entre les peuples? Nous savons tous de quoi il retourne réellement. La modernité est la forme sécularisée du christianisme eschatologique. Elle place l'individu hors du monde, donc hors de la nature (forme sécularisée de la "sainteté") et ce faisant l'autorise à exploiter dramatiquement le monde.
Est-ce ''la faute aux Européens"? Non, premièrement il ne s'agit pas d'Europe, mais d'Occident, deux concepts radicalement différents, voire contradictoires. Ensuite, il n'y a aucune composante ethnique: tout le monde - des Chinois aux Tunisiens et même aux Tibétains - veut en être, et c'est bien ça le drame. Ensuite, ce livre propose-t-il des solutions? Il indique, dès le titre, que non: "Ethnographie des mondes à venir". A venir, vraiment? Mais c'est bien dans cet A-venir dont on prêche depuis l'avènement de la modernité la toute-puissante autorité (progrès industriel, lendemains qui chantent, fin de l'histoire, etc.) que tient TOUT le problème écologique, dans cet "avenir" qui a fait basculer le monde dans l'exploitation, la pollution, la ruine des écosystèmes. "Ethnographie", "mondes" (la pensée au singulier qui s'écrit au pluriel: c'est la mode), "avenir". Trois mots qui révèlent l'envers du discours. Un discours, par-dessus le marché, infantilisant: on regrette le temps où Louis Dumont, Arne Naess et Alain Hervé parlaient sans recourir à la bande dessinée.
Au moins cinquante ans que les partisans de la deep ecology et le philosophe norvégien Arne Naess, au moins cinquante ans qu'Alain Hervé et Edwin Matthews, fondateurs d'Amis de la Terre et créateurs de la première collection écologiste chez Fayard auront dit la même chose avec infiniment plus de justesse et de talent.
J'ai bien peur, hélas! que le fond du discours soit bien moins écologiste qu'un prétexte à une auto-flagellation convenue de donneurs de leçons universels (d'où le titre "Ethnographie"). Car enfin, des Européens qui accusent l'eurocentrisme d'être la cause de tout le mal dans le monde (seuls les Européens... les autres peuples ne font pas ci, ni ça), qu'est-ce d'autre qu'une illustration de cette propension européenne à distribuer des bons points au reste du monde et à creuser des différences artificielles entre les peuples? Nous savons tous de quoi il retourne réellement. La modernité est la forme sécularisée du christianisme eschatologique. Elle place l'individu hors du monde, donc hors de la nature (forme sécularisée de la "sainteté") et ce faisant l'autorise à exploiter dramatiquement le monde.
Est-ce ''la faute aux Européens"? Non, premièrement il ne s'agit pas d'Europe, mais d'Occident, deux concepts radicalement différents, voire contradictoires. Ensuite, il n'y a aucune composante ethnique: tout le monde - des Chinois aux Tunisiens et même aux Tibétains - veut en être, et c'est bien ça le drame. Ensuite, ce livre propose-t-il des solutions? Il indique, dès le titre, que non: "Ethnographie des mondes à venir". A venir, vraiment? Mais c'est bien dans cet A-venir dont on prêche depuis l'avènement de la modernité la toute-puissante autorité (progrès industriel, lendemains qui chantent, fin de l'histoire, etc.) que tient TOUT le problème écologique, dans cet "avenir" qui a fait basculer le monde dans l'exploitation, la pollution, la ruine des écosystèmes. "Ethnographie", "mondes" (la pensée au singulier qui s'écrit au pluriel: c'est la mode), "avenir". Trois mots qui révèlent l'envers du discours. Un discours, par-dessus le marché, infantilisant: on regrette le temps où Louis Dumont, Arne Naess et Alain Hervé parlaient sans recourir à la bande dessinée.
Une lecture passionnante pour appréhender notre culture judéo-chrétienne et humaniste issue du siècle des Lumières , désormais à reconsidérer pour user sans en abuser de la vie qui nous est offerte…
Les perspectives méritent d'être plus ouvertes. Les exemples sont multiples depuis les années 70. Une réflexion plus approfondie et moins engagée peut ouvrir des portes à bon nombre de gens ordinaires qui souffrent de notre société capitale-industrielle !
Les perspectives méritent d'être plus ouvertes. Les exemples sont multiples depuis les années 70. Une réflexion plus approfondie et moins engagée peut ouvrir des portes à bon nombre de gens ordinaires qui souffrent de notre société capitale-industrielle !
Dans un dialogue mêlant anthropologie, philosophie et politique, les deux penseurs nous invitent à politiser le tournant ontologique qu'appelle la révolte des vivants contre les tractopelles aveugles du marché mondialisé. Ils y exposent leurs idées de façon très claire même pour les profanes à leurs disciplines, illustrant leur propos par leurs expériences et des références pertinentes, le texte bien structuré est aéré par les petites bandes dessinées satyrico-philosophique d'Alessandro, mettant en scène le gouvernement Macron I dans une quête spirituelle transcendantale en rase campagne. Qu'on ne s'y trompe pas, c'est un appel argumenté à rejoindre les ZAD et lieux où l'ont lutte contre la fatalité autodestructrice du capitalisme tout en se reconnectant à ce qui a un avenir dans nos coeur de mammifère libre car capable d'autodétermination et rêveur car capable d'ouverture cosmologique. Preuves s'il en fallait que la barbarie et la bêtise n'ont jamais était du cotés des zadistes.
« L'anthropologie et l'histoire nous apportent la preuve que d'autres voies sont possibles pour nous assembler et régler nos vies que celles qui nous sont familières en Occident, puisque certaines d'entre elles, aussi improbables qu'elles puissent paraître, ont été explorées et mises en pratique ailleurs. Elles montrent que l'avenir n'est pas un prolongement automatique de l'actuel, reconductible à intervalles réguliers, mais qu'il est ouvert à tous les possibles pour peu que nous sachions les imaginer. »
Ethnographies des mondes à venir, Philippe Descola et Alessandro Pignocchi @editionsduseuil
Voici un court essai anthropologique qui se présente comme une conversation entre les deux auteurs discutant du monde à créer pour demain, des possibilités qui sont à notre portée, des mentalités et concepts à modifier, des exemples dont on peut s'inspirer…
Avant toute chose, ce qui est primordial, c'est de modifier le regard que l'on porte sur les non-humains.
« Changer de régime implique de ne plus « socialiser les non-humains » de cette manière, c'est-à-dire comme des produits dérivés de l'existence sociale des humains, mais d'admettre au contraire leur autonomie, leur radicale indépendance, leur altérité, en les créditant de capacités de représentation politique. C'est déjà ce que font les zadistes lorsqu'ils disent « nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». L'appropriation change de sens: les humains n'accaparent plus les non-humains dans leurs réseaux, ils en sont une émanation. »
Les zad sont présentées dans cet essai comme une piste de réflexion pour le futur…
« Mais tout d'abord, les zad ont une évidente dimension offensive. Elles entravent des grands projets étatiques, bien sûr, mais elles servent de base arrière pour lancer des actions contre l'écosystème capitaliste. Elles permettent d'alimenter, au sens propre comme au figuré, des luttes existantes et de penser de nouvelles formes de luttes et de nouveaux modes d'action. »
Mais qu'est-ce qu'une zad? C'est une zone à défendre, une manière de s'opposer à un projet d'aménagement… Cela rejoint la lutte de certains peuples autochtones, comme en Amazonie par exemple!
« En nous inspirant des luttes autochtones et des luttes territoriales, nous avons esquissé une perspective hybride, dans laquelle cette écologie prendrait d'abord forme sur des territoires, idéalement de plus en plus nombreux et fédérés en réseaux, qui exploreraient différentes formes d'autonomie et différents modes de relations avec les structures étatiques encore en place. L'existence de terres communalistes ne laisserait par les États avec lesquels elles cohabitent inchangés, loin de là. Elles pourraient par exemple contribuer à faire reconnaître une personnalité juridique aux milieux de vie, inversant ainsi de façon globale la perception que l'on a des relations entre humains et non-humains. »
Plus qu'un manifeste, ce livre est en quelque sorte un guide pour repenser notre société et créer le monde de demain…
« L'anthropologie devient un réservoir « d'outils de dérangement intellectuel » qui nous aident a nous penser nous-mêmes et à imaginer l'avenir comme un foisonnement de possibilités, et non plus comme un trajet unique et tout tracé vers le désastre. »
Un regard intéressant, une étude anthropologique de notre société!
Ethnographies des mondes à venir, Philippe Descola et Alessandro Pignocchi @editionsduseuil
Voici un court essai anthropologique qui se présente comme une conversation entre les deux auteurs discutant du monde à créer pour demain, des possibilités qui sont à notre portée, des mentalités et concepts à modifier, des exemples dont on peut s'inspirer…
Avant toute chose, ce qui est primordial, c'est de modifier le regard que l'on porte sur les non-humains.
« Changer de régime implique de ne plus « socialiser les non-humains » de cette manière, c'est-à-dire comme des produits dérivés de l'existence sociale des humains, mais d'admettre au contraire leur autonomie, leur radicale indépendance, leur altérité, en les créditant de capacités de représentation politique. C'est déjà ce que font les zadistes lorsqu'ils disent « nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». L'appropriation change de sens: les humains n'accaparent plus les non-humains dans leurs réseaux, ils en sont une émanation. »
Les zad sont présentées dans cet essai comme une piste de réflexion pour le futur…
« Mais tout d'abord, les zad ont une évidente dimension offensive. Elles entravent des grands projets étatiques, bien sûr, mais elles servent de base arrière pour lancer des actions contre l'écosystème capitaliste. Elles permettent d'alimenter, au sens propre comme au figuré, des luttes existantes et de penser de nouvelles formes de luttes et de nouveaux modes d'action. »
Mais qu'est-ce qu'une zad? C'est une zone à défendre, une manière de s'opposer à un projet d'aménagement… Cela rejoint la lutte de certains peuples autochtones, comme en Amazonie par exemple!
« En nous inspirant des luttes autochtones et des luttes territoriales, nous avons esquissé une perspective hybride, dans laquelle cette écologie prendrait d'abord forme sur des territoires, idéalement de plus en plus nombreux et fédérés en réseaux, qui exploreraient différentes formes d'autonomie et différents modes de relations avec les structures étatiques encore en place. L'existence de terres communalistes ne laisserait par les États avec lesquels elles cohabitent inchangés, loin de là. Elles pourraient par exemple contribuer à faire reconnaître une personnalité juridique aux milieux de vie, inversant ainsi de façon globale la perception que l'on a des relations entre humains et non-humains. »
Plus qu'un manifeste, ce livre est en quelque sorte un guide pour repenser notre société et créer le monde de demain…
« L'anthropologie devient un réservoir « d'outils de dérangement intellectuel » qui nous aident a nous penser nous-mêmes et à imaginer l'avenir comme un foisonnement de possibilités, et non plus comme un trajet unique et tout tracé vers le désastre. »
Un regard intéressant, une étude anthropologique de notre société!
Philippe Descola, anthropologue de haut vol et Alessandro Pignocchi ex-chercheur en sciences cognitives et philosophie, auteur de BD ( Petit traité d'écologie sauvage ) dialoguent et partagent leurs expériences d'immersion auprès de peuples animistes, les bouleversements que cela a apporté dans leur vision du monde occidental et de ses valeurs et certitudes, et rêvent d'une solution mondiale à la crise écologique.
C'est très réducteur de résumer les choses ainsi, car c'est un passionnant échange de haut niveau qui ouvre de nombreuses pistes de réflexion. Les petites BD de Pignocchi apportent une teinte d'humour assez jouissif et permettent une pause entre chaque chapitre.
En voici un résumé très simplifié et forcément très réducteur.
Descola appelle naturalisme cette attitude typiquement occidentale qui consiste à considérer l'homme d'une part et la nature d'autre part – même si elle se donne un aspect vertueux en souhaitant protéger la nature. L 'humain en fait est un élément du vivant. C'est ce qu'on compris un certain nombre de peuples dits primitifs, ainsi que les occupants des zad.
Se débarrasser de cette attitude est indissociable du fait de se débarrasser le capitalisme, puisqu'il ne repose sur l'exploitation du vivant.
De nombreuses sociétés, chacune ayant sa singularité, existent et ont existé, qui reconnaissent une intériorité à tous les constituants du vivant, ne se l'approprient pas, et s'autogouvernent selon des choix consensuels et non décidés par quelques un.es. Ces sociétés ne sont pas pour autant moins évoluées ou primitives : contrairement à ce que suggère l'évolutionnisme, l'État et son organisation occidentale hiérarchisée ne sont pas une fin en soi ni un aboutissement obligé, mais une solution parmi d'autres ; le progrès ne mène pas forcément au capitalisme. Celui-ci n'est pas une évolution inéluctable mais le résultat de choix.
Comprendre ces sociétés portées par des valeurs différentes des nôtres, comme le fait un anthropologue en étude de terrain, c'est adopter le concept de symétrisation : le choix d'adopter leur point de vue et non nos modalités d'analyse « rationnelles » (soit pour comprendre leur fonctionnement de l'intérieur, soit pour percevoir en quoi notre propre fonctionnement n'est pas le seul et unique).
Descola et Pignocchi envisagent (et ont l'air d'y croire…) une société composite où l'État, devenu sobre, n'est plus là que pour fédérer une multitude de territoires autonomes développant des formes de vie alternative. A travers la participation personnelle des citoyens à l'action publique, loin du capitalisme marchand, on ne distinguera plus entre l'humanité et la nature, on reconnaîtra la place des non-humains et des milieux de vie. A terme, après bien des luttes, ces interstices communaux feront tache d'huile, l'usage égalitaire des communs deviendra la norme.
Ces solutions cosmopolitiques tranchent avec le conception traditionnelle centralisatrice de l'action révolutionnaire, car elles sortent de l'idée que l'émancipation des opprimés ne peut être menée que par une avant garde qui agirait et penserait pour les autres dans le but d'obtenir la désagrégation de l'État.
Les auteurs justifient cet utopie non seulement par la nécessité de la crise écologique, mais aussi en elle-même : « réenchanter le monde ».
C'est très réducteur de résumer les choses ainsi, car c'est un passionnant échange de haut niveau qui ouvre de nombreuses pistes de réflexion. Les petites BD de Pignocchi apportent une teinte d'humour assez jouissif et permettent une pause entre chaque chapitre.
En voici un résumé très simplifié et forcément très réducteur.
Descola appelle naturalisme cette attitude typiquement occidentale qui consiste à considérer l'homme d'une part et la nature d'autre part – même si elle se donne un aspect vertueux en souhaitant protéger la nature. L 'humain en fait est un élément du vivant. C'est ce qu'on compris un certain nombre de peuples dits primitifs, ainsi que les occupants des zad.
Se débarrasser de cette attitude est indissociable du fait de se débarrasser le capitalisme, puisqu'il ne repose sur l'exploitation du vivant.
De nombreuses sociétés, chacune ayant sa singularité, existent et ont existé, qui reconnaissent une intériorité à tous les constituants du vivant, ne se l'approprient pas, et s'autogouvernent selon des choix consensuels et non décidés par quelques un.es. Ces sociétés ne sont pas pour autant moins évoluées ou primitives : contrairement à ce que suggère l'évolutionnisme, l'État et son organisation occidentale hiérarchisée ne sont pas une fin en soi ni un aboutissement obligé, mais une solution parmi d'autres ; le progrès ne mène pas forcément au capitalisme. Celui-ci n'est pas une évolution inéluctable mais le résultat de choix.
Comprendre ces sociétés portées par des valeurs différentes des nôtres, comme le fait un anthropologue en étude de terrain, c'est adopter le concept de symétrisation : le choix d'adopter leur point de vue et non nos modalités d'analyse « rationnelles » (soit pour comprendre leur fonctionnement de l'intérieur, soit pour percevoir en quoi notre propre fonctionnement n'est pas le seul et unique).
Descola et Pignocchi envisagent (et ont l'air d'y croire…) une société composite où l'État, devenu sobre, n'est plus là que pour fédérer une multitude de territoires autonomes développant des formes de vie alternative. A travers la participation personnelle des citoyens à l'action publique, loin du capitalisme marchand, on ne distinguera plus entre l'humanité et la nature, on reconnaîtra la place des non-humains et des milieux de vie. A terme, après bien des luttes, ces interstices communaux feront tache d'huile, l'usage égalitaire des communs deviendra la norme.
Ces solutions cosmopolitiques tranchent avec le conception traditionnelle centralisatrice de l'action révolutionnaire, car elles sortent de l'idée que l'émancipation des opprimés ne peut être menée que par une avant garde qui agirait et penserait pour les autres dans le but d'obtenir la désagrégation de l'État.
Les auteurs justifient cet utopie non seulement par la nécessité de la crise écologique, mais aussi en elle-même : « réenchanter le monde ».
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Alessandro Pignocchi (13)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )
Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "
amoureux
positiviste
philosophique
20 questions
860 lecteurs ont répondu
Thèmes :
essai
, essai de société
, essai philosophique
, essai documentCréer un quiz sur ce livre860 lecteurs ont répondu