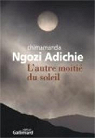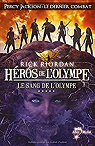Critiques de Mona de Pracontal (188)
Le drapeau de l’éphémère état du Biafra donne son titre à ce roman. Ce demi soleil sur le drapeau emplira d'espoir tout nos protagonistes, Ugwu, qui débute le roman en tant que boy d'un professeur d'université, Odenigbo, son patron, universitaire engagé, ou encore les jumelles, Olanna et Kainene, probablement les deux personnages les plus intéressants. La suite est connue: la guerre, le Nigeria bombardant et affamant les populations civiles de la région séparatiste, la famine, et quelque chose comme un million de morts, un chiffre dont personne ne sera même jamais sûr.
C'est un roman très marquant, et évidemment dur, mais cela n'empêche pas les moments d'humour ou d'espoir. L'histoire vue par des personnages lambda se révèle parfois plus marquante que tracée dans les essais en chiffres et en titres ronflants de généraux: ici, on panique quand Ugwu est enrôlé d'office, on s'inquiète quand Baby affiche les premiers signes du kwashiorkor, cette terrible horreur qui a emporté tant d'enfants, on vibre avec eux pour le Biafra et on se désole à chaque défaite.
La construction du livre, des ellipses éclaircies plus tard, n'apporte finalement pas grand chose car les personnages et le roman se débrouillent très bien tous seuls pour former une magnifique oeuvre.
C'est un roman très marquant, et évidemment dur, mais cela n'empêche pas les moments d'humour ou d'espoir. L'histoire vue par des personnages lambda se révèle parfois plus marquante que tracée dans les essais en chiffres et en titres ronflants de généraux: ici, on panique quand Ugwu est enrôlé d'office, on s'inquiète quand Baby affiche les premiers signes du kwashiorkor, cette terrible horreur qui a emporté tant d'enfants, on vibre avec eux pour le Biafra et on se désole à chaque défaite.
La construction du livre, des ellipses éclaircies plus tard, n'apporte finalement pas grand chose car les personnages et le roman se débrouillent très bien tous seuls pour former une magnifique oeuvre.
Un roman qui raconte le vie d’un petit groupe de personnes lettrées confrontées à la guerre civile du Nigeria entre les populations Yoruba (musulmans chrétiens et animistes) , haoussa (musulmans) et igbo (chrétiens et animiste). Un tiers de l’ouvrage est consacré aux personnages, au contexte africain, politique et à la présentation de la vie nigériane, coutumes, superstitions et cuisine (cuisine exotique à souhait. Ah les pépé-soupe, les chin-chin, riz jollof et autres moi-moi) puis Adichie entre dans la partie plus délicate avec toutes les horreurs de cette guerre civile, génocide d’igbo, famine de la population, sur fond de pétrole et d’intérêts internationaux.
Les personnages sont intéressants: les couples et leurs amis font partie de l’élite nigériane avec les inévitables enseignants/universitaires qui glosent bêtement et ont un avis sur tout le soir lorsqu’ils refont le monde. Leur mode de vie est occidental car ils ont fait leurs études en occident, cuisinent et boivent comme en Angleterre et fréquentent les anglais du cru. A coté d’eux leurs familles, peu éduquées restent profondément africaines et elles ne comprennent pas leur mode de vie et l’acceptent mal. Ensuite, et c’est un aspect séduisant du livre, les intermédiaires africains, les domestiques qui s’amalgament tant bien que mal au mode de vie occidental et apportent une vision mixte à la narration. Coincé entre tradition notamment croyances aux esprits et culture occidentale, ils sont les liens indispensables et involontaires du livre.
Toutefois la présentation de ce personnel est curieuse car on l’impression d’être dans «la case de l’oncle Tom»: grande maison avec boy stylé en uniforme à l’africaine et propriétaires appelés «patrons» mais tous noirs et même s’ils sont bien traités, ils sont quand même moqués gentiment et traités avec condescendance, celle des dominants.
Pour les personnages Deux sœurs jumelles très dissemblables
Kainene rappelle un peu la Khadiga de Naguib Mahfouz dans «La Trilogie du Caire», jeune femme pas très jolie mais au caractère bien trempé un personnage solide ancré dans l’Afrique , intéressant contrairement à Olanna sa sœur jumelle et jeune femme occidentalisée, bien africaine physiquement qui plaît aux hommes à qui la vie sourie plus facilement, personnage féministe et humaniste qui s’interroge avec sincérité.
Odenigbo est l’anticolonialisme de service et promoteur idéaliste pan africaniste de la société nigériane, plus à l’aise avec l’idéologie qu’avec le réalité quotidienne de la guerre
Richard le seul blanc est présenté comme une denrée secondaire, sympathique mais peu
conséquent, écrivain raté, dilettante de l’époque ancienne. Il fait l’objet d’un racisme anti-blanc aussi bien de la part des hommes que des femmes, racisme parce qu’il est blanc, anglais et ex colon.
Les domestiques ont une réelle épaisseur surtout Ugwu : ils ne sont pas que des faire-valoir Ils nous en apprennent beaucoup sur la mentalité et le mode de vie nigérian. Il est étonnant de voir ces «boys», et leurs patrons, se comporter comme au temps du colonialisme avec les blancs. Une sorte de racisme interafricain bon teint et sans émotion qui semble dans l’ordre des choses. Ugwu, dans sa simplicité, est une sorte de regard sur ses patrons et son environnement il voit tout, comprend tout et compatit: une conscience. D’autres personnages secondaires interviennent et donnent une vision plus africaine et populaire: les parents des jumelles, la Mama, Amala, Julius, les relations d’Odenigbo
Le Style d’ Adichie est très léger et surtout très élégant contrairement à son homologue nigérian Wole Soyinka. Ce n’est pas une écriture proprement africaine mais occidentalisée on sent l’école d’écriture anglaise dans le sujet, politique et féminisme, et le style. Elle parvient avec beaucoup de brio a faire coïncider les amours d’un couple avec une guerre civile, les traditions africaines et la modernité occidentale, les rapports entre africains et occidentaux ainsi que les africains entre eux et ce sans jamais ennuyer le lecteur.
Une autrice de talent. Les horreurs de la guerre ne sont pas cachées et Adichie n’y recours pas non plus pour faire du misérabilisme. Il y a un équilibre très juste de la vie quotidienne telle qu’elle est: les descriptions restent très dignes et respectable, c’est louable.
On peut saluer le travail exemplaire de traduction de Mona de Pracontal, traduction qu’elle nous explique sommairement en annexes en fin d’ouvrage. Entre l’anglais parler, le français bâtard et les principaux idiomes nigérians, langue officielle, dialectes et langue d’usage elle a du s’amuser (un peu comme Quadruppani avec le sicilien de Camilleri). Des traducteurs bien souvent ostracisés mais qui sont indispensables pour que la littérature et donc les idées passent, au mieux, d’une culture à l’autre.
Les personnages sont intéressants: les couples et leurs amis font partie de l’élite nigériane avec les inévitables enseignants/universitaires qui glosent bêtement et ont un avis sur tout le soir lorsqu’ils refont le monde. Leur mode de vie est occidental car ils ont fait leurs études en occident, cuisinent et boivent comme en Angleterre et fréquentent les anglais du cru. A coté d’eux leurs familles, peu éduquées restent profondément africaines et elles ne comprennent pas leur mode de vie et l’acceptent mal. Ensuite, et c’est un aspect séduisant du livre, les intermédiaires africains, les domestiques qui s’amalgament tant bien que mal au mode de vie occidental et apportent une vision mixte à la narration. Coincé entre tradition notamment croyances aux esprits et culture occidentale, ils sont les liens indispensables et involontaires du livre.
Toutefois la présentation de ce personnel est curieuse car on l’impression d’être dans «la case de l’oncle Tom»: grande maison avec boy stylé en uniforme à l’africaine et propriétaires appelés «patrons» mais tous noirs et même s’ils sont bien traités, ils sont quand même moqués gentiment et traités avec condescendance, celle des dominants.
Pour les personnages Deux sœurs jumelles très dissemblables
Kainene rappelle un peu la Khadiga de Naguib Mahfouz dans «La Trilogie du Caire», jeune femme pas très jolie mais au caractère bien trempé un personnage solide ancré dans l’Afrique , intéressant contrairement à Olanna sa sœur jumelle et jeune femme occidentalisée, bien africaine physiquement qui plaît aux hommes à qui la vie sourie plus facilement, personnage féministe et humaniste qui s’interroge avec sincérité.
Odenigbo est l’anticolonialisme de service et promoteur idéaliste pan africaniste de la société nigériane, plus à l’aise avec l’idéologie qu’avec le réalité quotidienne de la guerre
Richard le seul blanc est présenté comme une denrée secondaire, sympathique mais peu
conséquent, écrivain raté, dilettante de l’époque ancienne. Il fait l’objet d’un racisme anti-blanc aussi bien de la part des hommes que des femmes, racisme parce qu’il est blanc, anglais et ex colon.
Les domestiques ont une réelle épaisseur surtout Ugwu : ils ne sont pas que des faire-valoir Ils nous en apprennent beaucoup sur la mentalité et le mode de vie nigérian. Il est étonnant de voir ces «boys», et leurs patrons, se comporter comme au temps du colonialisme avec les blancs. Une sorte de racisme interafricain bon teint et sans émotion qui semble dans l’ordre des choses. Ugwu, dans sa simplicité, est une sorte de regard sur ses patrons et son environnement il voit tout, comprend tout et compatit: une conscience. D’autres personnages secondaires interviennent et donnent une vision plus africaine et populaire: les parents des jumelles, la Mama, Amala, Julius, les relations d’Odenigbo
Le Style d’ Adichie est très léger et surtout très élégant contrairement à son homologue nigérian Wole Soyinka. Ce n’est pas une écriture proprement africaine mais occidentalisée on sent l’école d’écriture anglaise dans le sujet, politique et féminisme, et le style. Elle parvient avec beaucoup de brio a faire coïncider les amours d’un couple avec une guerre civile, les traditions africaines et la modernité occidentale, les rapports entre africains et occidentaux ainsi que les africains entre eux et ce sans jamais ennuyer le lecteur.
Une autrice de talent. Les horreurs de la guerre ne sont pas cachées et Adichie n’y recours pas non plus pour faire du misérabilisme. Il y a un équilibre très juste de la vie quotidienne telle qu’elle est: les descriptions restent très dignes et respectable, c’est louable.
On peut saluer le travail exemplaire de traduction de Mona de Pracontal, traduction qu’elle nous explique sommairement en annexes en fin d’ouvrage. Entre l’anglais parler, le français bâtard et les principaux idiomes nigérians, langue officielle, dialectes et langue d’usage elle a du s’amuser (un peu comme Quadruppani avec le sicilien de Camilleri). Des traducteurs bien souvent ostracisés mais qui sont indispensables pour que la littérature et donc les idées passent, au mieux, d’une culture à l’autre.
Chimamanda Ngozi Adichie est connue pour ses engagements contre toutes les injustices et inégalités de la société. Dans ce roman historique très personnel, elle éclaire une page mal connue de l’histoire de son pays, le Nigéria.
Le roman est divisé en quatre parties et se déroule alternativement dans la première moitié des années 60, entre l’indépendance (octobre 1960) et le coup d’état de janvier 1966 ; puis à la fin des années 60, à partir de ce coup d’état et jusqu’à la fin de la guerre du Biafra, début 1970.
On suit la trajectoire de cinq personnages principaux, qui entrent en scène successivement : Ugwu, qui devient à treize ans le boy d’Odenigbo ; ce dernier, qui se met en couple avec Olanna ; laquelle a une sœur jumelle, Kainene, qui rencontre elle-même Richard, un Anglais expatrié fasciné par le Nigéria.
Ces personnages, très bien caractérisés, sont inoubliables et terriblement attachants. Et la puissance émotionnelle de cette chronique tient certainement en partie à la sensibilité particulière de l’autrice envers son sujet ; le roman est en effet dédié à ses quatre grands-parents et ses grands-pères n’ont pas survécu à la guerre du Biafra, comme en témoignent la dédicace et la note finale.
Le Nigéria, colonisé par la Grande-Bretagne au tout début du XXème siècle, comprenait 250 ethnies, dont trois principales, les Haoussas, les Yorubas et les Igbos. Ces derniers ayant été favorisés par les Britaniques dans l’accession aux postes administratifs, de manière à diviser la population pour mieux régner, et ayant été largement christianisés (les autres ethnies comprenant plus de Musulmans), des tensions importantes vont naître dès l’indépendance. Et ce d’autant plus que ce sont les territoires Igbos, au sud-est du pays, qui détiennent l’essentiel des ressources minières et des réserves de pétrole du pays. Ces conflits interethniques, accompagnés de discours de haine de plus en plus virulents, aboutissent, en 1966, à un massacre des Igbos dans les territoires du nord du pays, à un exode massif des survivants vers leurs territoires ancestraux du sud-est, puis à la sécession de cette région, qui prend le nom de République du Biafra, en 1967. Dès juillet, l’armée fédérale franchit la frontière du Biafra : c’est la guerre, qui durera deux ans et demi et finira par la capitulation et la réintégration du Biafra, après un blocus alimentaire qui provoque une famine effroyable et fait près de deux millions de victimes.
C’est l’histoire mouvementée de cette décennie qui nous racontée ici, du point de vue Igbo, groupe ethnique auquel appartiennent les cinq personnages principaux. D'abord les idéaux et l’utopie politique et sociale, lors de l’indépendance, puis de la proclamation de la République, trois ans plus tard ; et la réalité quotidienne de la guerre civile, malgré les espoirs toujours fervents de l’emporter contre l’armée nigériane ; enfin la famine quand le blocus prend place et la violente dislocation des idéaux et des corps.
Mais ce roman aborde bien d'autres sujets plus généraux, dans un pays particulièrement marqué par les injustices et les inégalités : la colonisation et la supériorité des Blancs sur les Noirs qui perdure même après l’indépendance, dans le regard des Britanniques restés en place, la supériorité masculine, l’aide des Britanniques aux fédéraux, pour conserver l’approvisionnement en pétrole de BP et de Shell, etc.
C’est aussi une vision des relations humaines en général, familiales, amicales, de voisinage, et des relations de couple en particulier, à travers les couples formés par les deux sœurs. Nos héros vont être transformés par la guerre et devront redéfinir leurs relations.
On nous offre encore une représentation des points de vue disparates de différents types d'habitants du Nigéria, car le récit adopte trois points de vue . La voix d’Ugwu, introduit dans une maison bourgeoise, est celle des populations de la brousse, avec ses traditions et ses superstitions ; Olanna porte celle de la bourgeoisie nigériane cultivée et progressiste ; enfin, nous entendons de Richard, représentant atypique des anciens colonisateurs, tombé amoureux de l’art traditionnel Igbo et de Kainene.
C’est enfin un roman d’apprentissage, celui d’Ugwu, jeune garçon naïf tout juste sorti d’un village de brousse, qui devient un homme capable de prendre la parole au nom de son peuple et d’écrire le récit de cette guerre ; la naissance même de cette capacité à l’écrire fait partie du roman et des bribes de celui-ci sont disséminées en fins de chapitres. Ce roman que Richard rêvait d’écrire, mais ne trouvait pas légitime de sa part. Ce roman enchâssé dans un autre.
Une œuvre magistrale, illuminée par ce demi-soleil représenté sur le drapeau éphémère de la République du Biafra.
Le roman est divisé en quatre parties et se déroule alternativement dans la première moitié des années 60, entre l’indépendance (octobre 1960) et le coup d’état de janvier 1966 ; puis à la fin des années 60, à partir de ce coup d’état et jusqu’à la fin de la guerre du Biafra, début 1970.
On suit la trajectoire de cinq personnages principaux, qui entrent en scène successivement : Ugwu, qui devient à treize ans le boy d’Odenigbo ; ce dernier, qui se met en couple avec Olanna ; laquelle a une sœur jumelle, Kainene, qui rencontre elle-même Richard, un Anglais expatrié fasciné par le Nigéria.
Ces personnages, très bien caractérisés, sont inoubliables et terriblement attachants. Et la puissance émotionnelle de cette chronique tient certainement en partie à la sensibilité particulière de l’autrice envers son sujet ; le roman est en effet dédié à ses quatre grands-parents et ses grands-pères n’ont pas survécu à la guerre du Biafra, comme en témoignent la dédicace et la note finale.
Le Nigéria, colonisé par la Grande-Bretagne au tout début du XXème siècle, comprenait 250 ethnies, dont trois principales, les Haoussas, les Yorubas et les Igbos. Ces derniers ayant été favorisés par les Britaniques dans l’accession aux postes administratifs, de manière à diviser la population pour mieux régner, et ayant été largement christianisés (les autres ethnies comprenant plus de Musulmans), des tensions importantes vont naître dès l’indépendance. Et ce d’autant plus que ce sont les territoires Igbos, au sud-est du pays, qui détiennent l’essentiel des ressources minières et des réserves de pétrole du pays. Ces conflits interethniques, accompagnés de discours de haine de plus en plus virulents, aboutissent, en 1966, à un massacre des Igbos dans les territoires du nord du pays, à un exode massif des survivants vers leurs territoires ancestraux du sud-est, puis à la sécession de cette région, qui prend le nom de République du Biafra, en 1967. Dès juillet, l’armée fédérale franchit la frontière du Biafra : c’est la guerre, qui durera deux ans et demi et finira par la capitulation et la réintégration du Biafra, après un blocus alimentaire qui provoque une famine effroyable et fait près de deux millions de victimes.
C’est l’histoire mouvementée de cette décennie qui nous racontée ici, du point de vue Igbo, groupe ethnique auquel appartiennent les cinq personnages principaux. D'abord les idéaux et l’utopie politique et sociale, lors de l’indépendance, puis de la proclamation de la République, trois ans plus tard ; et la réalité quotidienne de la guerre civile, malgré les espoirs toujours fervents de l’emporter contre l’armée nigériane ; enfin la famine quand le blocus prend place et la violente dislocation des idéaux et des corps.
Mais ce roman aborde bien d'autres sujets plus généraux, dans un pays particulièrement marqué par les injustices et les inégalités : la colonisation et la supériorité des Blancs sur les Noirs qui perdure même après l’indépendance, dans le regard des Britanniques restés en place, la supériorité masculine, l’aide des Britanniques aux fédéraux, pour conserver l’approvisionnement en pétrole de BP et de Shell, etc.
C’est aussi une vision des relations humaines en général, familiales, amicales, de voisinage, et des relations de couple en particulier, à travers les couples formés par les deux sœurs. Nos héros vont être transformés par la guerre et devront redéfinir leurs relations.
On nous offre encore une représentation des points de vue disparates de différents types d'habitants du Nigéria, car le récit adopte trois points de vue . La voix d’Ugwu, introduit dans une maison bourgeoise, est celle des populations de la brousse, avec ses traditions et ses superstitions ; Olanna porte celle de la bourgeoisie nigériane cultivée et progressiste ; enfin, nous entendons de Richard, représentant atypique des anciens colonisateurs, tombé amoureux de l’art traditionnel Igbo et de Kainene.
C’est enfin un roman d’apprentissage, celui d’Ugwu, jeune garçon naïf tout juste sorti d’un village de brousse, qui devient un homme capable de prendre la parole au nom de son peuple et d’écrire le récit de cette guerre ; la naissance même de cette capacité à l’écrire fait partie du roman et des bribes de celui-ci sont disséminées en fins de chapitres. Ce roman que Richard rêvait d’écrire, mais ne trouvait pas légitime de sa part. Ce roman enchâssé dans un autre.
Une œuvre magistrale, illuminée par ce demi-soleil représenté sur le drapeau éphémère de la République du Biafra.
Un livre à mettre en toutes les mains. Il décrit un génocide et une guerre aujourd'hui presque oubliés dans les années 60. Le choix des personnages est également intéressant : des universitaires de la classe supérieurs qui eux aussi ont connu la famine et les horreurs de la guerre. Lesbpersonnage sont assez complexe pour être réaliste et la descente au enfer est très bien amené dans le récit. Superbe travail de recherche de la part de l auteur.
Rick Riordan est constant. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire la fin des aventures de Percy Jackson et des autres demi-dieux. J'ai trouvé ce dernier tome très légèrement en-dessous du précédent, mais les derniers chapitres consacrés à la bataille contre Gaïa et les géants ont tout de même failli m'arracher quelques larmes. Les dernières pages étaient très mignonnes, mais m'ont un peu laissée sur ma faim. J'ai désormais hâte de rencontrer Apollon. Rendez-vous à la fin du premier tome de ses aventures.
Ce roman est le livre le plus éprouvant que j'ai jamais lu et pourtant, le finir m'a laissé un grand vide. Les personnages, absolument pas parfaits, sont touchants, humains et très attachants. Nous commençons le récit par l'arrivée d'Ugwu, un jeune homme d'un petit village isolé, qui se met au service d'Odenigbo, un professeur qui commence sa carrière à l'université. Nous sommes au Nigéria dans les années soixante. Ugwu veut bien faire mais ignore les usages, il se bat pour rester au service de son Master. Quand Olanna vient s'installer, une fois encore il craint de ne pas être à la hauteur de sa tâche, elle arrive de Londres, avec son parfum, ses tenues et ses perruques. Olanna est aussi professeur, ils vivent leur passion amoureuse. Puis nous faisons un saut dans le temps. Il y a une petite fille, baby. La sœur jumelle d'Olanna, Kainene, fait des affaires, tout comme leur père, homme puissant du Nigéria. Un retour en arrière nous explique certains changements de situation. Et enfin la dernière partie est une descente aux enfers. Les Igbo sont massacrés par les Haoussas, ils déclarent unilatéralement un nouveau pays : le Biafra. La guerre est déclarée. Les personnages sont Igbo, ils découvrent les exactions dans leurs familles, ils fuient pour y échapper. Ils perdent progressivement tout, y compris leurs illusions. Ils se retrouvent aussi, l'amour reste et revient. On croit avoir tout lu, qu'il ne se passera plus rien d'épouvantable et puis ça continue. La précarité devient insécurité. C'est terrifiant. On pense à tous ceux en guerre. Tous ses aspects sont décrits avec une justesse incroyable, ce qui rend cette lecture extrêmement douloureuse. Il en reste un amour immense pour les personnages, on aimerait les retrouver, les revoir, savoir ce qu'ils sont devenus. C'est très étonnant et rare.
Lien : http://objectif-livre.over-b..
Lien : http://objectif-livre.over-b..
MAIS PERCY JACKSON C'ÉTAIT DE LA GNOGNOTTE A COTE DE CA !!!!!!!!!!!!!! Wouaw quelle saga ! Sérieux comment on est sensé faire notre île déserte avec tous ces livres incroyables !! Je suis vraiment sensée départager Héros de l'Olympe, Harry Potter et Gardiens des cités perdus, mais c'est IMPOSSIBLE !!! Bref, concentrons nous sur Héros de l'Olympe, ben... je crois que vous avez compris que j'ai adoré la saga ! Les personnages sont attachants, l'histoire est entrainante et j'avoue que parfois j'ai crié après mon livre tellement j'étais excitée !
Mention spéciale au 2ème tome, car c'était très intéressant de redécouvrir Percy sans que lui ne sache plus qui il est. Mais les défauts fatales ont encore une fois été laissé de coté se que je trouve bête car déjà dans Percy Jackson il n'était pas exploités mais là ! On dit dans le livre que Percy aura un choix à faire en rapport avec son défaut fatales mais... Si quelqu'un sait quel était ce choix mettez u!n commentaire !!
Spoiler ne dévoilé pas la suite si vous n'avez pas FINI la saga!
Je suis tout de même un peu triste que Léo ne retourne pas à la Colonie au moins pour donner un signe de vie après son départ avec Calypso, mais on ne peut pas tout avoir! Cela m'a aussi fait chaud au coeur pour Nico (un personnage que j'ai beaucoup aimé) qu'il ait réussi à se faire accepté, à se trouver des amis.
Et voilà une merveilleuse saga s'achève si vous ne connaissez pas la mythologie grecque (et même si vous connaissez) lisaient cette saga fantastique. Un grand merci à l'auteur.
Mention spéciale au 2ème tome, car c'était très intéressant de redécouvrir Percy sans que lui ne sache plus qui il est. Mais les défauts fatales ont encore une fois été laissé de coté se que je trouve bête car déjà dans Percy Jackson il n'était pas exploités mais là ! On dit dans le livre que Percy aura un choix à faire en rapport avec son défaut fatales mais... Si quelqu'un sait quel était ce choix mettez u!n commentaire !!
Spoiler ne dévoilé pas la suite si vous n'avez pas FINI la saga!
Je suis tout de même un peu triste que Léo ne retourne pas à la Colonie au moins pour donner un signe de vie après son départ avec Calypso, mais on ne peut pas tout avoir! Cela m'a aussi fait chaud au coeur pour Nico (un personnage que j'ai beaucoup aimé) qu'il ait réussi à se faire accepté, à se trouver des amis.
Et voilà une merveilleuse saga s'achève si vous ne connaissez pas la mythologie grecque (et même si vous connaissez) lisaient cette saga fantastique. Un grand merci à l'auteur.
Une famille avec ses désordres et ses aspérités au coeur d'une guerre ethnique. Une femme riche, belle, cultivée, aimée qui vit la famine, la peur, la misère. Tour a tour roman de la désillusion, de la résilience, de l'espoir mais aussi et surtout du chagrin. Un hymne à la famille et à ceux qui comptent.
Dans les années 60, au Nigeria, deux soeurs jumelles très différentes, satisfaites de leur vie, ont choisi une trajectoire bien différente.
Olanna, professeur, belle jeune fille ouverte et aimable, contrairement aux voeux de ses parents qui souhaitent la voir épouser un homme susceptible à terme d'être un soutien pour leur entreprise, fait le choix de s'installer à Nsukka avec son fiancé Obdenigbo, un intellectuel engagé et idéaliste qui travaille au sein de l'université.
Kainene, plus discrète pour ne pas dire secrète mais au caractère bien trempé, soucieuse de plaire à ses parents, a fait le choix de travailler dans leur entreprise à Lagos. Elle entretient une relation avec Richard, un journaliste britannique un peu naïf et passionné de l'art local et notamment des ports cordés.
Ce bonheur va prend fin quand une conflit entre la Haoussas, majoritairement au nord du pays et les Ibos, plus au sud éclate. Les Haoussas reprochant aux Ibos, avec l'appui des britanniques, de détenir tous les postes clés du pays. Dès lors, les Ibos seront pourchassés et massacrés.
Olanna et Obdenigbo n'ont d'autres choix que de fuir, Kaneine et Richard ne les rejoindront qu'une fois Lagos aux mains des Haoussas. La communauté des Ibos fera donc sécession avec le Nigeria et créera le Biafra. Cet Etat ne sera par reconnu par la communauté internationale, sauf tardivement par la Tanzanie. Le Nigeria, avec l'aide des britanniques, fera blocus et empêchera les ponts aériens alimentaires de la Croix Rouge. Plus d'un million d'Ibos mourront dans l'indifférence générale des pays occidentaux. Parmi ces morts, un grand nombre d'enfants présentant un syndrome de malnutrition protéino-calorique sévère, dénommé le kwashiorkor.
Les relations entre les différents protagonistes sont très fortes et chargées d'émotions. Ils sont tous dotés d'un caractère leur donnant la force de croire en un avenir meilleur et nous démontre que même si on trébuche, si on tombe, il faut se relever et continuer à avancer.
Ce livre est aussi une belle leçon d'amour, de solidarité, d'entraide. Ce roman me réconcilie avec la nature humaine et me redonne de l'espoir car en ce moment on en a vraiment besoin. Il est aussi une leçon d'histoire car cela explique le rôle qu'ont eu les pays occidentaux et notamment le Royaume Uni dans ce conflit et comment l'Occident, par intérêts, a joué d'indifférence face à un peuple à l'agonie.
Je sors de cette lecture en colère mais j'ai aussi honte d'être occidentale au vu du comportement qui fut le notre et que l'on continue à ce jour à se comporter en censeur, en supérieur vis à vis de l'Afrique. Je sors aussi grandie car j'ai appris beaucoup de choses et je vais faire des recherches pour avoir une meilleure compréhension de ce conflit. Et je tire mon chapeau à l'auteur qui a réussi à ne pas en faire un pamphlet contre le monde occidental mais à raconter une histoire ayant pour base un conflit entre ethnies d'une même pays
Olanna, professeur, belle jeune fille ouverte et aimable, contrairement aux voeux de ses parents qui souhaitent la voir épouser un homme susceptible à terme d'être un soutien pour leur entreprise, fait le choix de s'installer à Nsukka avec son fiancé Obdenigbo, un intellectuel engagé et idéaliste qui travaille au sein de l'université.
Kainene, plus discrète pour ne pas dire secrète mais au caractère bien trempé, soucieuse de plaire à ses parents, a fait le choix de travailler dans leur entreprise à Lagos. Elle entretient une relation avec Richard, un journaliste britannique un peu naïf et passionné de l'art local et notamment des ports cordés.
Ce bonheur va prend fin quand une conflit entre la Haoussas, majoritairement au nord du pays et les Ibos, plus au sud éclate. Les Haoussas reprochant aux Ibos, avec l'appui des britanniques, de détenir tous les postes clés du pays. Dès lors, les Ibos seront pourchassés et massacrés.
Olanna et Obdenigbo n'ont d'autres choix que de fuir, Kaneine et Richard ne les rejoindront qu'une fois Lagos aux mains des Haoussas. La communauté des Ibos fera donc sécession avec le Nigeria et créera le Biafra. Cet Etat ne sera par reconnu par la communauté internationale, sauf tardivement par la Tanzanie. Le Nigeria, avec l'aide des britanniques, fera blocus et empêchera les ponts aériens alimentaires de la Croix Rouge. Plus d'un million d'Ibos mourront dans l'indifférence générale des pays occidentaux. Parmi ces morts, un grand nombre d'enfants présentant un syndrome de malnutrition protéino-calorique sévère, dénommé le kwashiorkor.
Les relations entre les différents protagonistes sont très fortes et chargées d'émotions. Ils sont tous dotés d'un caractère leur donnant la force de croire en un avenir meilleur et nous démontre que même si on trébuche, si on tombe, il faut se relever et continuer à avancer.
Ce livre est aussi une belle leçon d'amour, de solidarité, d'entraide. Ce roman me réconcilie avec la nature humaine et me redonne de l'espoir car en ce moment on en a vraiment besoin. Il est aussi une leçon d'histoire car cela explique le rôle qu'ont eu les pays occidentaux et notamment le Royaume Uni dans ce conflit et comment l'Occident, par intérêts, a joué d'indifférence face à un peuple à l'agonie.
Je sors de cette lecture en colère mais j'ai aussi honte d'être occidentale au vu du comportement qui fut le notre et que l'on continue à ce jour à se comporter en censeur, en supérieur vis à vis de l'Afrique. Je sors aussi grandie car j'ai appris beaucoup de choses et je vais faire des recherches pour avoir une meilleure compréhension de ce conflit. Et je tire mon chapeau à l'auteur qui a réussi à ne pas en faire un pamphlet contre le monde occidental mais à raconter une histoire ayant pour base un conflit entre ethnies d'une même pays
Ce roman conte l'histoire d'une famille plutôt privilégiée de Chrétiens Ibo pendant la guerre du Biafra dans les années 60 pendant sa sécession d'avec le Nigeria .Cette sécession ne dura que peu de temps mais provoqua une terrible guerre civile . Elle fit les Unes des journaux de l'époque, avec leurs photos d'enfants sous alimentés .Ce fut à ce moment , je crois, que fut créé Médecins sans frontières .
L'action se situe côté Biafrais ,et n'explique pas vraiment quelles furent les raisons qui déclenchèrent les hostilités .Les personnages sont bien campés ,l'écriture efficace , je suis cependant d'accord avec 5arabella pour y voir l'influence des ateliers d'écriture américains .Le roman permet de connaitre l'histoire, un peu oubliée de nos jours, de cette région du Nigéria ,elle ressemble toutefois à toutes ces guerres civiles qui existent encore dans maintes régions d'Afrique
L'action se situe côté Biafrais ,et n'explique pas vraiment quelles furent les raisons qui déclenchèrent les hostilités .Les personnages sont bien campés ,l'écriture efficace , je suis cependant d'accord avec 5arabella pour y voir l'influence des ateliers d'écriture américains .Le roman permet de connaitre l'histoire, un peu oubliée de nos jours, de cette région du Nigéria ,elle ressemble toutefois à toutes ces guerres civiles qui existent encore dans maintes régions d'Afrique
Une guerre civile au prisme de l’intime et de ses tensions sociales sous-jacentes. Avec un beau basculement de l’avant au pendant, du début des années 60 à leur fin, Chimamanda Ngozi Adichie décrit, avec un dépouillement concerté, la guerre au Biafra et en rend sensible chacune des insurmontables conséquences. Puissions-nous ne jamais oublier.
Voilà c'est fini, comme dirait l'autre.
Je suis une GRANDE fan de Percy Jackson dont j'ai lu je ne sais pas combien de fois la première série. Ce personnage est hyper attachant et drôle. J'ai été contente de le retrouver dans les héros de l'olympe mais j'ai eu du mal à lui voir jouer un petit rôle. Au niveau de la narration, j'aimais bien quand il racontait ses aventures mais là le changement continuel de narrateurs a été non pas dur à suivre (quoi que) mais m'a empêché d'accrocher avec certains personnages. J'ai adoré Nico et bien aimé Rayna et Piper (annabeth mais c'était acquis d'avant). J'aurais aimé retrouvé davantage de personnages de la série 1 (grover, Clarisse que j'adore...) Au niveau de la bataille, un peu déçue car le tome 5 de la première série était vraiment au top.
J'ai apprécié de retrouver autant de références à la mythologie grecque. J'ai lu ce tome longtemps après le 4, j'ai peut être un peu décroché. La première série demeure mon gros coup de cœur.
Je suis une GRANDE fan de Percy Jackson dont j'ai lu je ne sais pas combien de fois la première série. Ce personnage est hyper attachant et drôle. J'ai été contente de le retrouver dans les héros de l'olympe mais j'ai eu du mal à lui voir jouer un petit rôle. Au niveau de la narration, j'aimais bien quand il racontait ses aventures mais là le changement continuel de narrateurs a été non pas dur à suivre (quoi que) mais m'a empêché d'accrocher avec certains personnages. J'ai adoré Nico et bien aimé Rayna et Piper (annabeth mais c'était acquis d'avant). J'aurais aimé retrouvé davantage de personnages de la série 1 (grover, Clarisse que j'adore...) Au niveau de la bataille, un peu déçue car le tome 5 de la première série était vraiment au top.
J'ai apprécié de retrouver autant de références à la mythologie grecque. J'ai lu ce tome longtemps après le 4, j'ai peut être un peu décroché. La première série demeure mon gros coup de cœur.
Je suis beaucoup trop triste d'avoir terminé cette saga. Vraiment Percy est un des meilleurs personnages que j'ai jamais croisé, c'était beaucoup trop bien ! Il reste drôle, un peu paumé mais tellement badass quand il le faut. J'ai adoré tous les personnages qui gravitent autour de lui, ils sont tous tellement attachants. Bref, je super saga
L’autre moitié du soleil / Chimamanda Ngozi Adichie
Cette belle histoire commence au début des années 60 quand le jeune Ugwu âgé de treize ans est emmené à Nsukka dans la région sud-est du Nigeria, indépendant depuis 1960, par sa tante auprès d’un certain Master afin d’apprendre un métier, celui de boy en l’occurrence.
Master, de son vrai nom Odenigbo, un homme aisé, maître de conférence à l’université de Nsukka, veut inscrire Ugwu dès la rentrée dans une école primaire vu les aptitudes du jeune garçon. Rapidement, Ugwu réalise qu’il n’est pas un boy ordinaire : il va aller à l’école et il a sa propre chambre, ce qui n’est pas commun, dans la belle demeure de Master. Peu à peu, Ugwu se met au diapason du genre de vie de son « patron », avec réceptions sur réceptions et chacun est satisfait de l’autre. Ugwu est intelligent et observateur et il découvre un monde nouveau, lui qui vient de la brousse.
Quatre mois ont vite passé pour Ugwu au service de Master, lorsqu’une femme vient troubler la quiétude et la routine des lieux. Elle s’appelle Olanna, de l’ethnie yoruba, a étudié la sociologie en Angleterre, arrive à Nsukka pour un bref séjour chez Odenigbo, son amant, où elle a le projet d’emménager bientôt. Pour Ugwu, qui a tout compris, la vie risque de changer. Il se sent triste et en même temps excité par cette nouvelle présence, la pensée de ne pas la revoir quand elle repartirait lui étant soudain insupportable.
Olanna repart à Lagos auprès de sa famille pour régler ses affaires avant de revenir au plus vite, impatiente de retrouver la maison de Odenigbo à Nsukka où elle a obtenu un poste administratif important. Il lui tarde de repartir auprès de Odenigbo afin de ne pas tomber dans un piège tendu par son père, homme d’affaires, qui veut la mettre dans les bras d’un homme haut placé pour obtenir des marchés.
Richard Churchill, journaliste et écrivain et Susan Greenville-Pitts, du British Council, son aînée et maîtresse, sont des expatriés résidant à Lagos. Susan est une femme charmante et pleine de vie, mais sujette à des crises de jalousie. Elle connaît bien le pays et veut le faire découvrir à Richard qui habite
chez elle. Au cours d’une réception chez des amis, Richard et Susan sont présentés au chef Ozobia, un homme richissime, le père d’Olanna et de sa sœur jumelle Kainene qui vient d’obtenir un master à Londres. Richard est visiblement séduit par la grâce de Kainene qui lui explique ce qu’est la nouvelle élite nigériane, à savoir un ramassis d’analphabètes qui ne lisent jamais et dont le seul sujet de conversation tourne autour de leur dernière nouvelle voiture. Une relation s’en suit avec des hauts et des bas…Kainene part alors à Port Harcourt travailler avec son père tandis que Richard s’installe à Nsukka afin d’écrire son livre. Il fréquente Odenigbo et Olanna et visiblement il est séduit par cette dernière.
La visite à Nsukka de la mère d’Odenigbo laisse augurer des moments difficiles pour Olanna qui dès le premier jour est contrainte de se réfugier dans ses appartements personnels quand elle entend cette femme lui demander de laisser son fils tranquille !
Le temps a passé et nous sommes à la fin des années 60 : les événements se sont précipités avec coups d’état à répétition dans ce Nigeria post-colonial qui cherche sa voie sur fond de conflits interethniques entre Ibos du sud et haoussas musulmans du nord et des tueries associées. Entre temps, Olanna et Odenigbo sont devenus « parents » d’une petite fille qui a à présent quatre ans, Baby et les deux sœurs Kainene et Olanna sont en froid et ne se parlent plus. On saura plus tard pourquoi…
Par la suite, sur fond de sécession et guerre du Biafra, des massacres et des atrocités sont commis et les familles sont contraintes de fuir là où elles peuvent.
Dans une troisième partie subtilement introduite par l’auteure, on est revenu en arrière pour expliquer la deuxième qui a vu la relation entre Olanna et Odenigbo se tendre en même temps que celle entre Richard et Kainene, et enfin celle de Olanna avec sa sœur jumelle. Infidélités et vengeance se succèdent dans une ambiance très particulière tout au long de cette période.
Dans la quatrième partie on revient au temps de la guerre du Biafra en 1967, avec l’extension d’une famine sans remède liée à une guerre civile attisée par l’ancienne puissance coloniale. Des millions de réfugiés ne savent où s’installer et les écoles sont réquisitionnées pour en abriter quelques-uns. La haine entre les différentes ethnies avec la sécession du Biafra est à son paroxysme. Et la fin de ce magnifique roman vous tient en haleine jusqu’au dernier mot.
Pour l’Histoire, il faut se rappeler que la guerre du Biafra se déroula de 1967 à 1970 et fit plus d’un million de morts. Et cette guerre aura totalement bouleversé la vie des beaux personnages de ce roman, happés par la tourmente dévastatrice.
J’ai beaucoup aimé ce roman de Chimamanda Ngosi Adichie, bien écrit, habilement construit, relatant la vie au Nigeria avant la guerre et pendant la guerre avec des personnages intéressants.
Cette belle histoire commence au début des années 60 quand le jeune Ugwu âgé de treize ans est emmené à Nsukka dans la région sud-est du Nigeria, indépendant depuis 1960, par sa tante auprès d’un certain Master afin d’apprendre un métier, celui de boy en l’occurrence.
Master, de son vrai nom Odenigbo, un homme aisé, maître de conférence à l’université de Nsukka, veut inscrire Ugwu dès la rentrée dans une école primaire vu les aptitudes du jeune garçon. Rapidement, Ugwu réalise qu’il n’est pas un boy ordinaire : il va aller à l’école et il a sa propre chambre, ce qui n’est pas commun, dans la belle demeure de Master. Peu à peu, Ugwu se met au diapason du genre de vie de son « patron », avec réceptions sur réceptions et chacun est satisfait de l’autre. Ugwu est intelligent et observateur et il découvre un monde nouveau, lui qui vient de la brousse.
Quatre mois ont vite passé pour Ugwu au service de Master, lorsqu’une femme vient troubler la quiétude et la routine des lieux. Elle s’appelle Olanna, de l’ethnie yoruba, a étudié la sociologie en Angleterre, arrive à Nsukka pour un bref séjour chez Odenigbo, son amant, où elle a le projet d’emménager bientôt. Pour Ugwu, qui a tout compris, la vie risque de changer. Il se sent triste et en même temps excité par cette nouvelle présence, la pensée de ne pas la revoir quand elle repartirait lui étant soudain insupportable.
Olanna repart à Lagos auprès de sa famille pour régler ses affaires avant de revenir au plus vite, impatiente de retrouver la maison de Odenigbo à Nsukka où elle a obtenu un poste administratif important. Il lui tarde de repartir auprès de Odenigbo afin de ne pas tomber dans un piège tendu par son père, homme d’affaires, qui veut la mettre dans les bras d’un homme haut placé pour obtenir des marchés.
Richard Churchill, journaliste et écrivain et Susan Greenville-Pitts, du British Council, son aînée et maîtresse, sont des expatriés résidant à Lagos. Susan est une femme charmante et pleine de vie, mais sujette à des crises de jalousie. Elle connaît bien le pays et veut le faire découvrir à Richard qui habite
chez elle. Au cours d’une réception chez des amis, Richard et Susan sont présentés au chef Ozobia, un homme richissime, le père d’Olanna et de sa sœur jumelle Kainene qui vient d’obtenir un master à Londres. Richard est visiblement séduit par la grâce de Kainene qui lui explique ce qu’est la nouvelle élite nigériane, à savoir un ramassis d’analphabètes qui ne lisent jamais et dont le seul sujet de conversation tourne autour de leur dernière nouvelle voiture. Une relation s’en suit avec des hauts et des bas…Kainene part alors à Port Harcourt travailler avec son père tandis que Richard s’installe à Nsukka afin d’écrire son livre. Il fréquente Odenigbo et Olanna et visiblement il est séduit par cette dernière.
La visite à Nsukka de la mère d’Odenigbo laisse augurer des moments difficiles pour Olanna qui dès le premier jour est contrainte de se réfugier dans ses appartements personnels quand elle entend cette femme lui demander de laisser son fils tranquille !
Le temps a passé et nous sommes à la fin des années 60 : les événements se sont précipités avec coups d’état à répétition dans ce Nigeria post-colonial qui cherche sa voie sur fond de conflits interethniques entre Ibos du sud et haoussas musulmans du nord et des tueries associées. Entre temps, Olanna et Odenigbo sont devenus « parents » d’une petite fille qui a à présent quatre ans, Baby et les deux sœurs Kainene et Olanna sont en froid et ne se parlent plus. On saura plus tard pourquoi…
Par la suite, sur fond de sécession et guerre du Biafra, des massacres et des atrocités sont commis et les familles sont contraintes de fuir là où elles peuvent.
Dans une troisième partie subtilement introduite par l’auteure, on est revenu en arrière pour expliquer la deuxième qui a vu la relation entre Olanna et Odenigbo se tendre en même temps que celle entre Richard et Kainene, et enfin celle de Olanna avec sa sœur jumelle. Infidélités et vengeance se succèdent dans une ambiance très particulière tout au long de cette période.
Dans la quatrième partie on revient au temps de la guerre du Biafra en 1967, avec l’extension d’une famine sans remède liée à une guerre civile attisée par l’ancienne puissance coloniale. Des millions de réfugiés ne savent où s’installer et les écoles sont réquisitionnées pour en abriter quelques-uns. La haine entre les différentes ethnies avec la sécession du Biafra est à son paroxysme. Et la fin de ce magnifique roman vous tient en haleine jusqu’au dernier mot.
Pour l’Histoire, il faut se rappeler que la guerre du Biafra se déroula de 1967 à 1970 et fit plus d’un million de morts. Et cette guerre aura totalement bouleversé la vie des beaux personnages de ce roman, happés par la tourmente dévastatrice.
J’ai beaucoup aimé ce roman de Chimamanda Ngosi Adichie, bien écrit, habilement construit, relatant la vie au Nigeria avant la guerre et pendant la guerre avec des personnages intéressants.
Je ne sais plus où, quand et pourquoi j’ai acheté ce livre, et ce n’est que plus de dix ans après l’avoir laissé dormir sur mes étagères que je me décide enfin à le lire, poussée par le défi de lecture de romans africains auquel je participe cette année. En l’ouvrant, je ne savais pas à quoi m’attendre et après quelques dizaines de pages, il m’a fallu lire la quatrième de couverture pour essayer de me repérer.
La guerre du Biafra, donc, c’est de cela qu’il s’agit... J’en connais peu de chose et surtout, plutôt que le pourquoi et le comment, la guerre du Biafra, c’est avant tout pour moi la naissance de Médecins sans Frontières et de l’humanitaire à la française. Ce livre vient donc combler une lacune importante en me faisant voir ce que cette guerre a été « pour de vrai ».
L’autrice fait partie de ces rares auteurs africains contemporains qui ont une renommée véritablement internationale et solidement établie. Je crois que j’avais donc d’assez hautes attentes lorsque j’ai ouvert ce livre. Et je crois que ces hautes attentes n’ont pas été totalement comblées. J’ai beaucoup aimé les personnages créés par Chimamanda Ngozi Adichie : Odenigbo l’intellectuel, Olanna la privilégiée, Kainene la pragmatique et tous ceux qui gravitent autour d’eux, sans oublier Ugwu, le jeune garçon à tout faire qui s’ouvre à la littérature et à la pensée politique ou Richard Churchill (non rien à voir avec le premier ministre comme il doit le préciser à chaque fois) le journaliste et aspirant écrivain plus étranger dans sa propre société qu’ici. Toute la reconstitution de la vie de ces milieux intellectuels au début de l’indépendance, le mélange d’espoir et d’illusions, tout cela m’a captivée.
Lorsque, par contre la guerre éclate, le livre pour moi perd de sa force littéraire. Ainsi, j’ai l’impression que le lecteur autant que l’autrice restent extérieurs lorsqu’on évoque la guerre et ses conséquences. Je n’ai pas non plus bien compris cette famine qui justement est la seule image que j’avais de cette guerre, et il y a, me semble-t-il, quelques petites incohérences par moment dans la description des cas de kwashiorkor. Tout cela est un peu dommage et ne m’a pas permis d’immerger totalement dans cette histoire.
Mais je dis bien que c’est en « force littéraire » que perd ce livre, pas en force tout seul. Car si, comme je crois l’avoir lu, il s’agit du premier roman traitant ainsi de la guerre au Biafra, et si l’on considère que c’est une des descendantes d’ex-Biafrais qui écrit, on peut comprendre qu’elle ait voulu tout mettre dans ce livre, ne sachant peut-être pas si elle aurait la volonté ou la possibilité de revenir sur le sujet. Peut-être ne s’est-il pas encore passé assez de temps pour que la mémoire de ces événements historiques puissent faire l’objet d’un récit romanesque avec la distance qu’un lecteur extérieur à l’histoire peut en attendre.
Je suis bien consciente que ma réserve vis-à-vis de ce livre est bien mince et qu’en plus elle est probablement très personnelle et peut-être pas tout à fait justifiée, fruit de mes attentes et de représentations préalables plutôt que conséquences de ma lecture. Et malgré cette réserve, je serais prête à recommander ce livre les yeux fermés tant il aborde un sujet nécessaire et trop longtemps tu. Il est important que ces points de vue émergent, et si la littérature peut en être le lieu, je ne peux que m’en réjouir.
Pour conclure, c’est un livre que je suis contente d’avoir lu pour ce qu’il dit de la construction d’une mémoire et d’un devoir de mémoire, pour le témoignage qu’il donne, tant d’événements graves que surtout de la façon dont ces événements résonnent au niveau individuel encore aujourd’hui. Un livre essentiel, non pour ses qualités littéraires mais pour ce qu’il dit de cette moitié de soleil qui s’est abîmée dans un bain de sang et de désespoir et qui reste encore comme un tison dans le cœur de beaucoup dans les campagnes d’Enugu, à Nsukka, ou encore en exil.
La guerre du Biafra, donc, c’est de cela qu’il s’agit... J’en connais peu de chose et surtout, plutôt que le pourquoi et le comment, la guerre du Biafra, c’est avant tout pour moi la naissance de Médecins sans Frontières et de l’humanitaire à la française. Ce livre vient donc combler une lacune importante en me faisant voir ce que cette guerre a été « pour de vrai ».
L’autrice fait partie de ces rares auteurs africains contemporains qui ont une renommée véritablement internationale et solidement établie. Je crois que j’avais donc d’assez hautes attentes lorsque j’ai ouvert ce livre. Et je crois que ces hautes attentes n’ont pas été totalement comblées. J’ai beaucoup aimé les personnages créés par Chimamanda Ngozi Adichie : Odenigbo l’intellectuel, Olanna la privilégiée, Kainene la pragmatique et tous ceux qui gravitent autour d’eux, sans oublier Ugwu, le jeune garçon à tout faire qui s’ouvre à la littérature et à la pensée politique ou Richard Churchill (non rien à voir avec le premier ministre comme il doit le préciser à chaque fois) le journaliste et aspirant écrivain plus étranger dans sa propre société qu’ici. Toute la reconstitution de la vie de ces milieux intellectuels au début de l’indépendance, le mélange d’espoir et d’illusions, tout cela m’a captivée.
Lorsque, par contre la guerre éclate, le livre pour moi perd de sa force littéraire. Ainsi, j’ai l’impression que le lecteur autant que l’autrice restent extérieurs lorsqu’on évoque la guerre et ses conséquences. Je n’ai pas non plus bien compris cette famine qui justement est la seule image que j’avais de cette guerre, et il y a, me semble-t-il, quelques petites incohérences par moment dans la description des cas de kwashiorkor. Tout cela est un peu dommage et ne m’a pas permis d’immerger totalement dans cette histoire.
Mais je dis bien que c’est en « force littéraire » que perd ce livre, pas en force tout seul. Car si, comme je crois l’avoir lu, il s’agit du premier roman traitant ainsi de la guerre au Biafra, et si l’on considère que c’est une des descendantes d’ex-Biafrais qui écrit, on peut comprendre qu’elle ait voulu tout mettre dans ce livre, ne sachant peut-être pas si elle aurait la volonté ou la possibilité de revenir sur le sujet. Peut-être ne s’est-il pas encore passé assez de temps pour que la mémoire de ces événements historiques puissent faire l’objet d’un récit romanesque avec la distance qu’un lecteur extérieur à l’histoire peut en attendre.
Je suis bien consciente que ma réserve vis-à-vis de ce livre est bien mince et qu’en plus elle est probablement très personnelle et peut-être pas tout à fait justifiée, fruit de mes attentes et de représentations préalables plutôt que conséquences de ma lecture. Et malgré cette réserve, je serais prête à recommander ce livre les yeux fermés tant il aborde un sujet nécessaire et trop longtemps tu. Il est important que ces points de vue émergent, et si la littérature peut en être le lieu, je ne peux que m’en réjouir.
Pour conclure, c’est un livre que je suis contente d’avoir lu pour ce qu’il dit de la construction d’une mémoire et d’un devoir de mémoire, pour le témoignage qu’il donne, tant d’événements graves que surtout de la façon dont ces événements résonnent au niveau individuel encore aujourd’hui. Un livre essentiel, non pour ses qualités littéraires mais pour ce qu’il dit de cette moitié de soleil qui s’est abîmée dans un bain de sang et de désespoir et qui reste encore comme un tison dans le cœur de beaucoup dans les campagnes d’Enugu, à Nsukka, ou encore en exil.
La guerre fait rage au Biafra mais Olanna et Kainene ne la vivent pas de la même façon. Olanna est amoureuse et idéaliste alors que Kainene est plus terre-à-terre, en les suivant on appréhende la vie quotidienne au Biafra sous deux angles différents.
Un roman qui prend aux tripes !
Un roman qui prend aux tripes !
A travers L'autre moitié du soleil, Chimamanda Ngozi Adichie nous offre un roman exceptionnel sur la sécession du Nigeria et l'indépendance du Biafra, dans les années 60.
Nous suivons le parcours de Ugwu, garçon de 13 ans récemment devenu boy auprès d'Odenigbo, un intellectuel... Ainsi ce roman nous plonge dans la vie quotidienne et amoureuse des couples formés par Odenigbo et Olanna, et sa soeur jumelle Kainene et l'anglais Richard.
On apprend à les connaître, et l'on comprend déjà comment les différences que ce soit de classe sociale, de couleur de peau ou encore d'ethnie peuvent être prétextes à fragmenter les familles au Nigeria. Cette fragmentation prend de l'ampleur et une tout autre réalité lorsque des massacres ont lieu envers les Igbos, dont font partis Olanna et Kainene, et que la guerre est déclarée.
Ainsi, au fur et à mesure des pages, le cadre paisible du roman avec ses scènes de la vie quotidienne est bouleversé par les bombardements, la violence, l'exil, la famine. Tant de chose qui vont marquer à vie les personnages, enfants et adultes.
Dans ce roman, Chimamanda Ngozi Adichie jongle avec habilité entre les personnages, donnant une dynamique au récit ! De même elle joue avec la temporalité, avec des retours en arrière et des ellipses, ce qui rend prenante l'histoire ! Elle a un véritable talent pour nous toucher par ses mots, et ses personnages auxquels elle donne la parole.
De plus son écriture renforce la portée de son témoignage sur le conflit Biafrain qui est encore aujourd'hui méconnu. Pour toutes ces raisons je recommande vivement ce roman !
Nous suivons le parcours de Ugwu, garçon de 13 ans récemment devenu boy auprès d'Odenigbo, un intellectuel... Ainsi ce roman nous plonge dans la vie quotidienne et amoureuse des couples formés par Odenigbo et Olanna, et sa soeur jumelle Kainene et l'anglais Richard.
On apprend à les connaître, et l'on comprend déjà comment les différences que ce soit de classe sociale, de couleur de peau ou encore d'ethnie peuvent être prétextes à fragmenter les familles au Nigeria. Cette fragmentation prend de l'ampleur et une tout autre réalité lorsque des massacres ont lieu envers les Igbos, dont font partis Olanna et Kainene, et que la guerre est déclarée.
Ainsi, au fur et à mesure des pages, le cadre paisible du roman avec ses scènes de la vie quotidienne est bouleversé par les bombardements, la violence, l'exil, la famine. Tant de chose qui vont marquer à vie les personnages, enfants et adultes.
Dans ce roman, Chimamanda Ngozi Adichie jongle avec habilité entre les personnages, donnant une dynamique au récit ! De même elle joue avec la temporalité, avec des retours en arrière et des ellipses, ce qui rend prenante l'histoire ! Elle a un véritable talent pour nous toucher par ses mots, et ses personnages auxquels elle donne la parole.
De plus son écriture renforce la portée de son témoignage sur le conflit Biafrain qui est encore aujourd'hui méconnu. Pour toutes ces raisons je recommande vivement ce roman !
Merci à Chimamanda Ngozi Adichie pour ce récit à la fois beau et dur. J'avoue que j'étais totalement ignorante concernant le Biafra et la guerre Biafra / Nigéria. L'auteur nous fait découvrir cette guerre à travers l'histoire d'une famille Igbo, une ethnie du Nigéria contrainte de se replier dans une partie du territoire qui deviendra le Biafra pendant 3 années, 3 années de massacres et de famine. J'ai l'impression de connaître les personnages d'Ugwu, Olanna, Odegnibo et Kainene comme s'ils faisaient partie de ma famille et c'est à regret que j'ai refermé ce beau roman.
Un roman d'une grande finesse psychologique qui en dit aussi beaucoup sur le plan politique sans tomber dans le didactisme. Beaucoup de nuances, de subtilité dans l'évocation du Nigéria postcolonial dont l'histoire douloureuse est peu connue du grand public. On comprend en lisant ce livre comment le 'diviser pour mieux régner' des puissances colonisatrices a attisé les conflits potentiels au sein de sociétés africaines multi-ethniques, sans jamais que l'auteure tombe dans le manichéisme. Tout est posé par petites touches, pas de pathos, aucune emphase et une intelligence immense de l'humain qui rend universel un récit pourtant ancré dans un univers particulier et éloigné. Une histoire émouvante et une narration du type 'roman choral' très réussie, dont on sort plus intelligent, que demander de plus ?
J’ai trouvé très bien fait cette série de livres.
L’auteur arrive à soutenir la cadence des quêtes de nos héros.
La mythologie Grecque et romaine rythme notre histoire avec des informations faciles à mémoriser pour le lecteur.
Très pratique pour capturer un public divers.
Les aventures des héros mythologiques ne s’arrêtent pas là !La prochaine saga « Magnus Chase et les dieux d’Asgard » promet d’être palpitante.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Quiz
Voir plus
Le manga en quelques mots (facile)
Quel est le pays d'origine du manga ?
La Chine
Le Laos
Le Vietnam
Le Japon
5 questions
1495 lecteurs ont répondu
Thèmes :
manga
, mangakaCréer un quiz sur cet auteur1495 lecteurs ont répondu