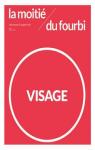Citations de Revue La Moitié du Fourbi (38)
Et puis il y a tous les autres, donc, les perdus, les effacés, les envolés qui ont flambé dans les joies ou les peines d’un soir, les papillons sous nos chaussures, celles et ceux qui se sont glissés entre les mailles du filet au point qu’on ne se souvient même plus de les avoir croisés une seule fois. Mais dont la toile de nos gestes est pourtant tissée et qui ont à coup sûr laissé une trace dans le grain de nos voix, la couleur de nos mots. Qui auront fait de nous, en pointillé, des vivants singuliers parmi les vivants singuliers. (Frédéric Fiolof)
On peut se perdre des heures dans la lecture des entretiens, sans jamais, semble-t-il, épuiser la richesse de cette étonnante galerie de portraits. Reste que, dans l’abondance de ces pages, le véritable cœur du sujet poursuivi par les créateurs de la revue et qui donne son titre à la série, l’art de la fiction, semble rester hors de portée, comme s’il devait conserver son mystère, au point que même ses praticiens les plus éminents ne peuvent le formuler ni le désigner pleinement, restant toujours à la marge, stupéfaits, muets, en dépit de tout, comme en présence d’un secret impossible à percer. Ce que ces entretiens nous offrent, ce n’est donc pas tant un accès direct au bureau de l’écrivain, qui nous permettrait de percer à jour ses méthodes de travail et ses secrets d’atelier, mais plutôt le spectacle de la création de figures de l’écrivain, par les écrivains eux-mêmes. Face à l’interviewer, ceux-ci puisent à la source de leur compétence la plus singulière, l’art de la fiction, pour se raconter et se réinventer, démontrant ainsi leur maîtrise technique mais trahissant aussi leurs mythes, leurs repères, leurs conceptions de ce qu’est la littérature. Dès lors, ils disent moins en quoi consiste le métier d’écrivain qu’ils ne le pratiquent brillamment sous nos yeux, avec la complicité des rédacteurs. Et c’est peut-être paradoxalement là que nous pouvons le mieux saisir l’essence de l’art de la fiction.
(Julia Kerninon, « La légende »)
(Julia Kerninon, « La légende »)
J’ai un souvenir des années 1990.
Athlète adolescent, je me trouve en Andorre pour participer à une course de demi-fond. Dans mon sac de sport, mes chaussures à pointes et un vieil exemplaire des Cronopes et Fameux. Je me détends avant la course en lisant quelques passages. Il fait beau. Je suis au soleil, allongé sur un mur, les jambes pendantes. En lisant les « Instructions pour monter un escalier », mes yeux s’emplissent de larmes. « Quel salaud », me dis-je. Et décide, tout d’un coup, de remplacer l’athlétisme par la littérature.
(Pablo Martin Sánchez, « Je me souviens de Julio Cortázar »)
Athlète adolescent, je me trouve en Andorre pour participer à une course de demi-fond. Dans mon sac de sport, mes chaussures à pointes et un vieil exemplaire des Cronopes et Fameux. Je me détends avant la course en lisant quelques passages. Il fait beau. Je suis au soleil, allongé sur un mur, les jambes pendantes. En lisant les « Instructions pour monter un escalier », mes yeux s’emplissent de larmes. « Quel salaud », me dis-je. Et décide, tout d’un coup, de remplacer l’athlétisme par la littérature.
(Pablo Martin Sánchez, « Je me souviens de Julio Cortázar »)
Jean Genet, l’orphelin, l’absent au rendez-vous des tout premiers regards, le sait depuis toujours : il n’y a pas de visage. Au mieux une plaie, un vide, une blessure – ou ce néant atone qui flotte derrière nos yeux et passe d’un homme à l’autre. Il n’y a pas de visage, sauf à l’écrire ou le chanter. La littérature, puissante et mélancolique, est là pour ça. (Frédéric Fiolof, « Dernier visage »)
Trahison. Europe de grande bouche et aux yeux de douce génisse, tu as trahi. Jamais tu ne te tais ni ne fais comme Énée, traître épique et joyeux. Jamais tu n’empruntes la langue des vaincus. Jamais on ne t’entend débattre, jamais tu ne veux négocier, jamais, comme Ramin, tu ne te faufiles, découvrant les passages : tu préfères le mur. (Marie Cosnay)
Ces mythes imprègnent le programmeur. Dans son monde, la prolixité est bannie au profit d’une esthétique exigeante de la concision, visant à contenir l’entropie naturelle du code. Cette orientation s’impose dans la syntaxe des langages informatiques récents. Le langage Python, par exemple, se revendique de ces aphorismes :
Mieux vaut beau que laid.
Mieux vaut explicite qu’implicite.
Mieux vaut simple que complexe.
Mieux vaut complexe que compliqué.
Mieux vaut plat qu’imbriqué.
Mieux vaut concis que dense.
La lisibilité compte.
L’esthétique logicielle souscrit à un principe général d’efficience : elle cherche l’emploi le plus rentable des ressources offertes par le langage ou l’unité de calcul. Au plan formel, elle restreint l’espace de l’expression et le sature d’information. Le modèle symbolique du code idéal, c’est le plateau-repas qu’on vous sert dans l’avion, qui concentre 1 800 calories dans une surface de 42 x 24 cm. Les programmeurs sont les seuls passagers au monde à se passionner pour l’agencement de leur plateau-repas.
Il faut noter que ces considérations d’économie, nées aux âges obscurs de l’informatique, n’ont souvent plus lieu d’être au regard des performances actuelles en calcul et en stockage. Mais elles sont culturellement héritées : elles font partie de l’inconscient du codeur. Il en découle un idéal de concision distribué en diverses figures, que mobilisent les incessantes réécritures du code. Nous tâcherons d’en signaler quelques-unes. (Hugues Leroy)
Mieux vaut beau que laid.
Mieux vaut explicite qu’implicite.
Mieux vaut simple que complexe.
Mieux vaut complexe que compliqué.
Mieux vaut plat qu’imbriqué.
Mieux vaut concis que dense.
La lisibilité compte.
L’esthétique logicielle souscrit à un principe général d’efficience : elle cherche l’emploi le plus rentable des ressources offertes par le langage ou l’unité de calcul. Au plan formel, elle restreint l’espace de l’expression et le sature d’information. Le modèle symbolique du code idéal, c’est le plateau-repas qu’on vous sert dans l’avion, qui concentre 1 800 calories dans une surface de 42 x 24 cm. Les programmeurs sont les seuls passagers au monde à se passionner pour l’agencement de leur plateau-repas.
Il faut noter que ces considérations d’économie, nées aux âges obscurs de l’informatique, n’ont souvent plus lieu d’être au regard des performances actuelles en calcul et en stockage. Mais elles sont culturellement héritées : elles font partie de l’inconscient du codeur. Il en découle un idéal de concision distribué en diverses figures, que mobilisent les incessantes réécritures du code. Nous tâcherons d’en signaler quelques-unes. (Hugues Leroy)
Écrire petit. Ordonner. Tailler. Restreindre. Retrancher. Réduire. Couper. Vider. Faire taire. Soumettre. Quadriller les territoires d’une écriture fine et précise. Mailler les espaces. Étouffer les imaginaires avec des respirations sèches, avec peu de respiration, avec une majorité absolue de points finaux. Étouffer et assécher les imaginaires en réduisant les possibles et les significations. Quadriller le réel par les mots. Le rendre étanche. Opaque. Lourd. Immobile. Sans échappée ni imprévu. Effacer. Écrire petit-minus-miniature-incisif. Pour la postérité toujours. Viser l’avenir. Anticiper sur les autres écritures qui pourraient dire autrement, qui pourraient dire ailleurs, qui pourraient proposer d’autres grammaires, d’autres rythmes, périodes ou respirations, d’autres latences. Travailler à prévoir. Écrire en prévoyant. Rédiger l’avenir et laisser aux jeunes générations de ce début du XXIe siècle cette écriture minuscule aussi fine et précise qu’un barbelé. Invisible et illisible pour la plupart au point qu’on oublie qu’il y eut là un travail d’écriture avec ratures corrections points et reprises. Écrire pour faire accepter l’ordre des mots, l’ordre des discours, l’ordre des choses, la régularité des jours, du travail, de la fatigue et de l’oubli. Commencer à rédiger la nouvelle Constitution chilienne une douzaine de jours après le coup d’État militaire du 11 septembre 1973 qui mit un point final à la révolution pacifique et démocratique de l’Unité populaire représentée par Salvador Allende. Alors qu’au dehors les militaires écrivent gros avec de grosses bombes et de grosses mitrailleuses et de gros avions qui déchirent le ciel. Alors qu’ils vident les têtes à coups de crosse d’électricité et de disparitions, plient et soumettent les corps, désespèrent la parole avec toute la vulgarité ténébreuse du fascisme, à l’écart dans les salons constitutionnels de Santiago, Jaime Guzmán, idéologue d’extrême droite, écrit avec son équipe, tranquillement, sûr de l’avenir qui leur appartient pour dix-sept ans, un projet-pays fin serré douloureux et coupant. (Samuel Gallet)
À partir de là, les pistes s’étoilent. Les policiers en charge de l’affaire, des professeurs, des étudiants de l’université d’Adelaïde s’usent les yeux sans succès sur ces lettres sans sens. On trouve à la gare de Henley Beach une valise contenant des vêtements dont toutes les étiquettes ont été arrachées ainsi qu’un pinceau à pochoir, une cuiller, un couteau, trois stylos. Un nom, « T. Keane », inscrit sur un sac de linge sale, et le même nom sans le « e » final sur l’étiquette sans doute oubliée d’un maillot de corps. Le réceptionniste de l’hôtel Strathmore, en face de la gare, se rappelle un homme étrange qui aurait occupé la chambre 21 et laissé derrière lui une seringue et une trousse de médecin. Quelques mois plus tard, un enfant de 2 ans dont le père avait tenté d’identifier le mort succombe mystérieusement après un empoisonnement. Trois ans avant, à Sydney, on a retrouvé en Australie le corps d’un ressortissant de Singapour, le recueil de poèmes posé sur sa poitrine.
L’étoile s’élargit, dans le passé, le futur, sur les côtes australiennes et au cœur des lettres persanes, une étoile dont le centre reste muet, opaque, ce corps mort sur cette plage et ces mots dans sa poche, sans lesquels il aurait rejoint les milliers de victimes sans nom et sans histoire.
Dans la brèche ouverte par les mots qui manquent et circonscrite par ceux qui restent – Tamán Shud, cette sonorité orientale, et ces combinaisons de lettres sans queue ni tête – s’engouffrent les friands d’affaires non résolues, cold cases, pistes et retournements, amateurs de polars, de tout ce qui fait accroc dans la toile déjà irrégulière du monde. (Hélène Gaudy)
L’étoile s’élargit, dans le passé, le futur, sur les côtes australiennes et au cœur des lettres persanes, une étoile dont le centre reste muet, opaque, ce corps mort sur cette plage et ces mots dans sa poche, sans lesquels il aurait rejoint les milliers de victimes sans nom et sans histoire.
Dans la brèche ouverte par les mots qui manquent et circonscrite par ceux qui restent – Tamán Shud, cette sonorité orientale, et ces combinaisons de lettres sans queue ni tête – s’engouffrent les friands d’affaires non résolues, cold cases, pistes et retournements, amateurs de polars, de tout ce qui fait accroc dans la toile déjà irrégulière du monde. (Hélène Gaudy)
Mais ce qui importe vraiment, c’est écrire. La découverte des microgrammes de Walser a créé la légende d’un écrivain compulsif, acharné. Je ne peux prétendre livrer la vérité, mais il semble qu’en déposant ces traces sur tous les supports à sa portée, Robert Walser s’approprie un territoire minuscule, qu’il élargit de ses promenades – le mot « voyage » apparaît rarement dans ses oeuvres. Ces morceaux épars d’écriture pourraient bien être placés bout à bout. Constitueraient-ils un monde ? Sans doute : celui qui s’offre à chacun, composé de bribes, d’éclats, de débris parfois… Le monde ne se mesure pas ; pourtant, les mots inscrits au crayon circonscrivent le lieu de la pensée, du souvenir, de l’imagination. Les empreintes de ses pas dans la neige dessinent une calligraphie que l’on pourrait voir du ciel ; elle est cependant destinée à disparaître lors du dégel, rendant à la nature sa pureté originelle. Ainsi, pour laisser une trace, il faut écrire. La feuille, le ticket, le billet sont des mondes où l’écrivain dépose la marque de sa foulée – elle n’est pas éternelle, les lettres sont vouées à s’effacer elles aussi, mais plus lentement. Plus qu’une conquête du monde, l’écriture est une tentative de maîtrise du temps… (Anne-Françoise Kavauvea)
Emil Cioran, glissant ami, croit le cerner lorsqu’il décrit Michaux comme un scientifique « swiftien ». Il n’est pourtant pas des auteurs que de fumeux protocoles séduisent, ce n’est pas un être de chiffres (ou de modèles). Plutôt un observateur curieux, et que le réel (ou ce qu’on appelle tel) émerveille.
C’est d’ailleurs toute la part du mystique, trouver le geste liant éparpillement et unification. Aussi bien en l’œuvre qu’en l’homme – de ce point de vue-là, ce nouveau gradin sur la voie de la poussière, qui se répand partout et embrasse uniformément les choses, ce n’est plus la biographie tranchée de la bibliographie qui compte, ces concepts n’opèrent plus ; les scalpels sont de mousse et le médecin est un esprit frappeur. (Benoît Vincent)
C’est d’ailleurs toute la part du mystique, trouver le geste liant éparpillement et unification. Aussi bien en l’œuvre qu’en l’homme – de ce point de vue-là, ce nouveau gradin sur la voie de la poussière, qui se répand partout et embrasse uniformément les choses, ce n’est plus la biographie tranchée de la bibliographie qui compte, ces concepts n’opèrent plus ; les scalpels sont de mousse et le médecin est un esprit frappeur. (Benoît Vincent)
La nuit porte conseil, nous dit la sagesse populaire. Une bonne nuit, c’est connu, ancre en nous tout ce qui a été appris la veille. Aussi n’est-il jamais inutile pour les puissants de répéter, dans ce moment suspendu juste avant le sommeil, que chacun doit rester à sa place, et les vaches seront bien gardées. (Hélène Gaudy)
« Emma Bovary ne serait-elle pas aujourd’hui fervente lectrice de romances ? » me demandais-je l’autre jour. « Et, si « Emma, c’est lui », cela fait-il de moi un Flaubert ? » J’étais en train de corriger le énième récit du genre que l’on confie à mes bons soins pour donner à leur langue quelque tour mieux propre à faire rêver les jeunes filles en fleur du Vieux Continent. Il faut dire que certaines traductions de départ rendent surtout songeur : je vous laisse imaginer quelles « excitations passionnelles » pourrait bien éveiller un « étroit conduit lubrifié » chez qui n’est pas plombier de son état – et, pour ma part, je m’en tiendrai pudiquement à Mario dans l’évocation d’un tel personnage. (Noëlle Rollet)
J’atteignis enfin le littoral et trouvais le repos et de l’eau fraîche sur le rivage désert d’Ogiura, baigné de lumière dorée. Seul un couple appareillait gaiement un joli prao rouge avant de s’en aller voguer sur les flots translucides. Assise contre un vieux bois flotté, échoué sur le sable blanc, je guettais le minibus qui devait me ramener à Okumura auprès des mes hôtes. Je peur ferais bientôt mes adieux. L’Ogasawara Maru, qui me ramènerait à Tokyo, venait d’accoster. Je quitterais Chichijima, comblée et résolue à ne plus y retourner. Ce voyage se devait d’être unique. Déjà, l’ultime nuit s’étoilait. Alanguie sur mon futan blanc, j’écoutais le chant du printemps souffler sur le Pacifique. (Zoé Balthus)
Chaque soir je tisse devant vous l' »Il était une fois » dont je vais m’augmenter. Devant vous et avec vous, car, sous la forme obscure d’un auditoire attentif, vous êtes saisis dans ma trame. Il vous a semblé ne faire qu’écouter une histoire, mais sachez bien que l’histoire vous a entendus – et vous a façonnés au passage. Homme au chapeau, fille au filet, femme au couffin, vous avez contribué ce soir à la version 283 494 231 de la Diseuse de Toutes les Aventures. Encore un millier de ces soirées et j’en aurai fini avec mon avenir. L’once de mon histoire sera complète. Peut-être que ma dernière variante rejoindra la première et que mon Conte des contes partira en fumée. Je dis peut-être, je n’en sais rien : mon histoire est la seule dont j’ignore les variantes, je les découvre en les disant et ne peux les anticiper. Si vous souhaitez savoir ce qu’il adviendra de moi et du recueil complet de nos rencontres, il n’y a pas d’autre choix pour vous que de revenir à chaque représentation, jusqu’à la dernière. Et si vous décidez de revenir, soyez sans crainte, je vous reconnaîtrai. Qu’importent votre costume et vos accessoires, sous une forme ou une autre, je vous reconnais toujours. (Ursula W. Child)
J’entends ce qui va venir après quand je partirai, que je prendrai un train puis un autre. Depuis que j’ai commencé à détecter les points de bifurcation, je perçois tous les passés possibles, futurs potentiels. Cela devient perturbant ensuite d’être dans ce présent si simple qui ne se détourne pas, coule comme une rivière sans bras. Parfois je permets à la vie de faire ce qu’elle veut et moi je reviens dans les endroits où j’ai été heureuse. Peux-tu imaginer le train qui va en même temps dans deux directions opposées, comme si je m’éloignais et me rapprochais avec la même vitesse ? Une fois je l’ai essayé et depuis on ne fait que bifurquer. (Aliona Gloukhova)
L’écuyer et le chevalier : deux manifestations extrêmes de l’existence, qui se dissolvent par le trop plein et le trop peu… Deux points limites et antithétiques entre lesquels se déploie la selva oscura de toutes les autres vies. Les nôtres, disons, pour aller vite.
(Frédéric Fiolof, « Débordements »)
(Frédéric Fiolof, « Débordements »)
Cette modestie de la chute dérisoire est le signe d’une vigilance particulière à l’égard de tous. C’est aussi un aveu émouvant de la vie où tout est difficile à nommer – notamment de ce qui ne se possède pas, comme l’air dans lequel on ne fait que passer. Bas Jan Ader offre une expérience à chacun, à tous, de l’invisible de l’intervalle, de la gravité caressée. S’il ose cette transgression sociale et morale folle de tomber, il refuse de prendre une place disproportionnée par une chute trop spectaculaire que personne ne pourrait raisonnablement envisager. Si c’est donc lui qui est filmé, et une partie de sa vie qu’il nous donne à voir, ce pourrait être aussi quelqu’un d’autre ; tout le monde peut se mettre à sa place, l’empathie est immense.
(Thomas Giraud, « À la recherche de Bas Jan Ader »)
(Thomas Giraud, « À la recherche de Bas Jan Ader »)
Deux destinées – deux Kères – ont été proposées à Achille : mourir vieux, dans sa patrie, oublié de tous ; ou bien mourir jeune, devant les murs de Troie, pour une gloire immortelle. Les résumés de l’Iliade affirment que le guerrier choisit la seconde ; il est permis de contester cette lecture. Pour autant que, chez les Grecs, on puisse choisir quelque chose, c’est bien à la première Kère, celle de l’oubli, que nous voyons Achille se vouer. Il l’embrasse délibérément, sous l’effet d’une colère dont ses alliés, non ses ennemis, sont les victimes : elle consiste à déposer ses armes, à ne plus s’inquiéter des pertes grecques, et à vouloir rentrer chez lui.
(Hugues Leroy, « J’y vais pas »)
(Hugues Leroy, « J’y vais pas »)
Peu importe la disposition des livres dans l’espace de la bibliothèque, leur rangement, leur ordre, leur classement concret. Lorsque je considère chacun d’entre les miens, je suis capable de le replacer dans une portion assez précise de temps, de l’associer à d’autres qui ont, non à l’aune de l’histoire culturelle mais à la mesure de ma propre vie, le même âge. Chaque livre est ainsi un instant de vie.
Dans les inventaires après décès, les livres tiennent une place particulière. Ce ne sont pas des objets comme les autres – à bien des égards, mais d’abord parce que les autres objets, fabriqués, taillés, fondus, assemblés, tissés, ne sont pas écrits. Les livres, eux, le sont. Nos livres sont la vie écrite, la vie à l’état écrit. La bibliothèque est une (auto)biographie.
(Éloïse Lièvre, « La vie écrite »)
Dans les inventaires après décès, les livres tiennent une place particulière. Ce ne sont pas des objets comme les autres – à bien des égards, mais d’abord parce que les autres objets, fabriqués, taillés, fondus, assemblés, tissés, ne sont pas écrits. Les livres, eux, le sont. Nos livres sont la vie écrite, la vie à l’état écrit. La bibliothèque est une (auto)biographie.
(Éloïse Lièvre, « La vie écrite »)
Ainsi rien n’est acquis, tout reste un doute, et demande que je m’arrête sur mon chemin pour retourner dans tous les sens, décoder, examiner. Surtout parce que, n’ayant pas de langue maternelle, je n’ai accès à aucune mémoire collective : ce qui est évident pour vous ne l’est jamais pour moi, ce qui ne nécessite aucune explication pour vous en nécessite pour moi ; mon cerveau ne connaît jamais de répit dans sa recherche de clarté. J’aime citer l’exemple de la brique qui tombe sur le pied : quel est le cri de douleur que vous pousseriez ? Le mien serait inaudible, une panique silencieuse, des yeux qui rouleraient dans leurs orbites, un cri orphelin au fond d’une grotte tout au bout du monde. Après tout, le fin du fin du mot sur le plongeoir de la langue, n’est-ce pas quand toute une langue s’y tient ? Une langue qui fut maternelle pour un instant, perdue, retrouvée (réapprise), reperdue (oubliée), tapissant les parois de la grotte, devenues illisibles. (Sabine Huynh, « Une grotte sombre au bout du monde »)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Lecteurs de Revue La Moitié du Fourbi (4)Voir plus
Quiz
Voir plus
Mario
Comment s'appelle l'héros du jeu vidéo?
Luigi
Mario
Peach
Bowser
6 questions
20 lecteurs ont répondu
Thèmes :
jeux vidéoCréer un quiz sur cet auteur20 lecteurs ont répondu