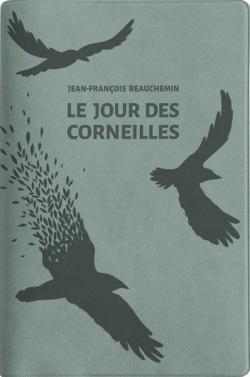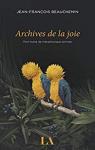Critiques filtrées sur 5 étoiles
Le jour des corneilles est une petite pépite littéraire !
Tant sur le fond (l'histoire) que sur la forme (la langue), ce roman est marquant. Il est de ceux qui vous bouleversent. Alors certes l'ambiance n'est pas aux réjouissances dans ce récit. La dureté de la vie de notre personnage principal et des scènes peintes par la plume de Jean-François Beauchemin nous frappe de plein fouet. C'est plus percutant qu'un uppercut mais on en redemande !
Tant sur le fond (l'histoire) que sur la forme (la langue), ce roman est marquant. Il est de ceux qui vous bouleversent. Alors certes l'ambiance n'est pas aux réjouissances dans ce récit. La dureté de la vie de notre personnage principal et des scènes peintes par la plume de Jean-François Beauchemin nous frappe de plein fouet. C'est plus percutant qu'un uppercut mais on en redemande !
Vive la francophonie et la logo-diversité ! Seul un écrivain québécois, en effet, pouvait écrire Le Jour des corneilles, dans cette langue inventive, prolifique et truculente, qu’on a souvent comparée à celle de Rabelais, mais qui s’apparente plutôt à l’exubérance des créoles, dont elle a toutes la verdeur et les saveurs… Comme si, en littérature comme en botanique, pour compenser et enrayer le progressif affadissement des cultivars, il fallait en revenir toujours à la vigueur et à la rusticité des variétés sauvages : racines ou formes archaïques, souches paysannes et terroirs provinciaux. Et le miracle, c’est que, non seulement la greffe prend parfaitement, mais qu’elle produit de plus un idiome d’une richesse incroyable, à la fois populaire et savant, désuet et novateur, dans lequel on s’étonne de nager d’emblée comme poisson dans l’eau.
Nul doute donc que l’intérêt de ce petit livre tient d’abord à sa langue et, en regard, le contenu, naïf et horrifiant (« glauque » et « gore », dit Nastasia-B), peut laisser perplexe ou déçu. Car de quoi s’agit-il ? Le père Courge et son fils (narrateur rétrospectif parce qu’il fut in extremis « instruit de vocabulaire ») sont en effet de drôles d’indigènes, vivant en prédateurs dans une cabane en pleine forêt, bêtes parmi les bêtes, ramenés par la misanthropie du vieux à une primitivité farouche. C’est que, depuis la mort de la mère en couches, l’esprit du paternel se met à battre la campagne (au gré des voix et des « gens » qui le visitent intérieurement), aussi furieusement que ses poings le malheureux rejeton tenu par lui pour responsable. Dans l’étroit commerce de la vie et de la mort (et même des « vifs » et des « trépassés ») qui règle ici les jours et les fonctions, on assiste alors à l’étrange couplage du bourreau et de sa victime, du copieur et de son modèle, du partenaire et de l’adversaire, du désir et de la frustration. Un véritable enfer au quotidien… On est, si l’on veut, dans une sorte d’« état de nature » — degré zéro (ou peu s’en faut) d’humanité, à partir duquel, justement, on peut voir progressivement émerger chez le fils les rudiments de cette humanité —, mais aux antipodes du paradis rousseauiste, plutôt dans un cauchemar à la Hobbes où, comme on sait, « l’homme est un loup pour l’homme ». S’il y a d’emblée, dans cette biosphère élémentaire, une connivence et une intelligence naturelles, liées aux impératifs de survie, et donc froides et pragmatiques, la dimension affective et le sentiment ne s’y introduisent (chez le fils) que par effraction : la rencontre inopinée avec Manon. Et tout est alors bouleversé, la traque d’amour se substituant et se mélangeant dès lors à celle des gibiers… jusqu’à l’hallali pour enfin « sonder reins et cœur » dans les moindres recoins (comme dit la métaphore langagière, quand on a appris à se transporter dans les mots. Mais si l’on n’a pas les mots… gare !).
Viandard et violent, le père Courge (le véritable héros de l’histoire) tient plus de l’ogre que de l’ermite, et cette histoire naïve et cruelle sur les rapports familiaux n’est pas sans évoquer les contes populaires. Comme eux, elle tourne autour de quelques questions et vérités premières de l’existence : la vie et la mort qui en balisent l’espace, le temps qui y met du changement, l’amour qui mêle et démêle tous les fils, et le langage qui nous promène au milieu de tout cela… Il n’est pas étonnant qu’on ait pensé à en tirer un dessin animé (Jean-Christophe Dessaint, en 2012), puisqu’on a pris l’habitude chez nous de destiner les contes à un public enfantin. Et, pour tout dire, si j’ai entrepris de relire récemment Le Jour des corneilles-livre, c’est dans l’intention de regarder Le Jour des corneilles-film avec mes petits-enfants… Mais quelle drôle d’idée, dira-t-on ! Quelle lubie a pris l’auteur d’une telle adaptation ? Passe encore, à la rigueur, pour le contenu, même s’il n’est certes pas à mettre entre toutes les oreilles ou sous tous les yeux… Car, moyennant quelques retouches, une bonne dose d’édulcorant et, bien sûr, une happy end pour tout remettre en place, on peut toujours lui faire subir le même sort qu’à tous les contes populaires traditionnels… qu’on pense au Petit Poucet ou à Barbe Bleue par exemple. Mais comment, diable, le réalisateur pourrait-il bien relever le défi du langage ? Car la magie et la fascination du livre tiennent incontestablement à sa forme ; les personnages et l’histoire en sont eux-mêmes comme transfigurés. Or comment traduire ou transposer visuellement cet enchantement verbal né du mélange d’archaïsmes et de néologismes… comme dans une fabrique de mots à l’ancienne qui sortirait des nouveautés à tire-larigot ? Comment rendre la patine du temps sur les mots, la palette de leurs teintes terreuses et végétales, la rocaille des accents paysan, trappeur ou bûcheron (qui se fondent et résonnent jusque dans les phrases écrites) ? Oui, comment restituer aussi le parfum acidulé de fleurs fanées, et malgré tout cette vivifiante fraîcheur de ton ? Eh bien, les créateurs de ce très beau film d’animation s’en sont plutôt bien tirés. En retrouvant d’une part, du riche filon d’origine, quelques pépites linguistiques qui ont fort heureusement réchappé du passage du récit au direct (exemple : « Père, il se met tout blafard, et il me corrige maximalement »). En jouant surtout d’une sorte de dédoublement ou de désynchronisation de l’image, le trait incisif et mobile des personnages venant en surimpression des fondus et des très beaux pastels un peu figés des paysages (forêt des quatre saisons ou coquet petit village évoquant la Bavière ou le Tyrol). Comme s’ils évoluaient dans les décors romantiques d’un vieux théâtre, prenant ainsi une dimension représentative, universelle et intemporelle.
Nul doute donc que l’intérêt de ce petit livre tient d’abord à sa langue et, en regard, le contenu, naïf et horrifiant (« glauque » et « gore », dit Nastasia-B), peut laisser perplexe ou déçu. Car de quoi s’agit-il ? Le père Courge et son fils (narrateur rétrospectif parce qu’il fut in extremis « instruit de vocabulaire ») sont en effet de drôles d’indigènes, vivant en prédateurs dans une cabane en pleine forêt, bêtes parmi les bêtes, ramenés par la misanthropie du vieux à une primitivité farouche. C’est que, depuis la mort de la mère en couches, l’esprit du paternel se met à battre la campagne (au gré des voix et des « gens » qui le visitent intérieurement), aussi furieusement que ses poings le malheureux rejeton tenu par lui pour responsable. Dans l’étroit commerce de la vie et de la mort (et même des « vifs » et des « trépassés ») qui règle ici les jours et les fonctions, on assiste alors à l’étrange couplage du bourreau et de sa victime, du copieur et de son modèle, du partenaire et de l’adversaire, du désir et de la frustration. Un véritable enfer au quotidien… On est, si l’on veut, dans une sorte d’« état de nature » — degré zéro (ou peu s’en faut) d’humanité, à partir duquel, justement, on peut voir progressivement émerger chez le fils les rudiments de cette humanité —, mais aux antipodes du paradis rousseauiste, plutôt dans un cauchemar à la Hobbes où, comme on sait, « l’homme est un loup pour l’homme ». S’il y a d’emblée, dans cette biosphère élémentaire, une connivence et une intelligence naturelles, liées aux impératifs de survie, et donc froides et pragmatiques, la dimension affective et le sentiment ne s’y introduisent (chez le fils) que par effraction : la rencontre inopinée avec Manon. Et tout est alors bouleversé, la traque d’amour se substituant et se mélangeant dès lors à celle des gibiers… jusqu’à l’hallali pour enfin « sonder reins et cœur » dans les moindres recoins (comme dit la métaphore langagière, quand on a appris à se transporter dans les mots. Mais si l’on n’a pas les mots… gare !).
Viandard et violent, le père Courge (le véritable héros de l’histoire) tient plus de l’ogre que de l’ermite, et cette histoire naïve et cruelle sur les rapports familiaux n’est pas sans évoquer les contes populaires. Comme eux, elle tourne autour de quelques questions et vérités premières de l’existence : la vie et la mort qui en balisent l’espace, le temps qui y met du changement, l’amour qui mêle et démêle tous les fils, et le langage qui nous promène au milieu de tout cela… Il n’est pas étonnant qu’on ait pensé à en tirer un dessin animé (Jean-Christophe Dessaint, en 2012), puisqu’on a pris l’habitude chez nous de destiner les contes à un public enfantin. Et, pour tout dire, si j’ai entrepris de relire récemment Le Jour des corneilles-livre, c’est dans l’intention de regarder Le Jour des corneilles-film avec mes petits-enfants… Mais quelle drôle d’idée, dira-t-on ! Quelle lubie a pris l’auteur d’une telle adaptation ? Passe encore, à la rigueur, pour le contenu, même s’il n’est certes pas à mettre entre toutes les oreilles ou sous tous les yeux… Car, moyennant quelques retouches, une bonne dose d’édulcorant et, bien sûr, une happy end pour tout remettre en place, on peut toujours lui faire subir le même sort qu’à tous les contes populaires traditionnels… qu’on pense au Petit Poucet ou à Barbe Bleue par exemple. Mais comment, diable, le réalisateur pourrait-il bien relever le défi du langage ? Car la magie et la fascination du livre tiennent incontestablement à sa forme ; les personnages et l’histoire en sont eux-mêmes comme transfigurés. Or comment traduire ou transposer visuellement cet enchantement verbal né du mélange d’archaïsmes et de néologismes… comme dans une fabrique de mots à l’ancienne qui sortirait des nouveautés à tire-larigot ? Comment rendre la patine du temps sur les mots, la palette de leurs teintes terreuses et végétales, la rocaille des accents paysan, trappeur ou bûcheron (qui se fondent et résonnent jusque dans les phrases écrites) ? Oui, comment restituer aussi le parfum acidulé de fleurs fanées, et malgré tout cette vivifiante fraîcheur de ton ? Eh bien, les créateurs de ce très beau film d’animation s’en sont plutôt bien tirés. En retrouvant d’une part, du riche filon d’origine, quelques pépites linguistiques qui ont fort heureusement réchappé du passage du récit au direct (exemple : « Père, il se met tout blafard, et il me corrige maximalement »). En jouant surtout d’une sorte de dédoublement ou de désynchronisation de l’image, le trait incisif et mobile des personnages venant en surimpression des fondus et des très beaux pastels un peu figés des paysages (forêt des quatre saisons ou coquet petit village évoquant la Bavière ou le Tyrol). Comme s’ils évoluaient dans les décors romantiques d’un vieux théâtre, prenant ainsi une dimension représentative, universelle et intemporelle.
Pour moi, il y a un "Avant" et un "Après" la lecture de ce livre !
Un livre puissant à lire d'une traite pour ne pas perdre la magie des mots et de l'écriture chantante. Une vie en osmose avec la nature, les animaux et les fantômes, uniquement consacrée à satisfaire les besoins primaires et où l'amour s'exprime férocement.
« le jour des corneilles » est un roman très court, qui m'a été recommandé par mon libraire.
J'en ai tout aimé : l'étrange histoire d'amour filial, la langue touffue et imagée, la construction sous forme de plaidoirie…
J'ai été vraiment touchée par l'histoire de ce fils Courge, rendu sauvage par la décision paternelle, vivant dans les bois, en quête désespérée de l'amour de son père.
Et émue de son ultime découverte : les mots, nos seuls véhicules pour exprimer les sentiments qui nous habitent et comprendre ce que ressentent nos semblables.
J'en ai tout aimé : l'étrange histoire d'amour filial, la langue touffue et imagée, la construction sous forme de plaidoirie…
J'ai été vraiment touchée par l'histoire de ce fils Courge, rendu sauvage par la décision paternelle, vivant dans les bois, en quête désespérée de l'amour de son père.
Et émue de son ultime découverte : les mots, nos seuls véhicules pour exprimer les sentiments qui nous habitent et comprendre ce que ressentent nos semblables.
Ce roman paraît aux premiers abords, comme un texte agréable à lire mais on ne se doute pas de la richesse alors de ce livre. le narrateur qui est aussi l'un des personnage principal de livre, s'exprime dans un ancien français mais très compréhensible et d'une façon, qui rend le texte mélodieux presque poétique. J'ai pris un grand plaisir à le lire.
Mais ce livre, comme mentionné plus haut, traite de sujets très profonds avec simplicité et on pourrait dire avec authenticité. Au fur et mesure des pages, on se laisse emporter dans le monde du narrateur (dont on ne connaît jamais le prénom) et on a envie de le comprendre, de l'aider, d'agir et de le secouer mais c'est finalement lui, qui nous secoue.
La mort, la vie, l'amour, la folie, la violence, sont les thèmes centraux de ce roman. Tous ces thèmes s'articulent autour de la relation, un peu indéfinissable, d'un père et de son fils qui vivent isolés de l'humanité.
Mais ce livre, comme mentionné plus haut, traite de sujets très profonds avec simplicité et on pourrait dire avec authenticité. Au fur et mesure des pages, on se laisse emporter dans le monde du narrateur (dont on ne connaît jamais le prénom) et on a envie de le comprendre, de l'aider, d'agir et de le secouer mais c'est finalement lui, qui nous secoue.
La mort, la vie, l'amour, la folie, la violence, sont les thèmes centraux de ce roman. Tous ces thèmes s'articulent autour de la relation, un peu indéfinissable, d'un père et de son fils qui vivent isolés de l'humanité.
le livre le plus savoureux de ma bibliothèque !
Les Dernières Actualités
Voir plus
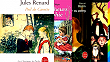
Les enfants souffre-douleur
Femi
17 livres

La forêt
GabySensei
38 livres
Autres livres de Jean-François Beauchemin (27)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Famille je vous [h]aime
Complétez le titre du roman de Roy Lewis : Pourquoi j'ai mangé mon _ _ _
chien
père
papy
bébé
10 questions
1437 lecteurs ont répondu
Thèmes :
enfants
, familles
, familleCréer un quiz sur ce livre1437 lecteurs ont répondu