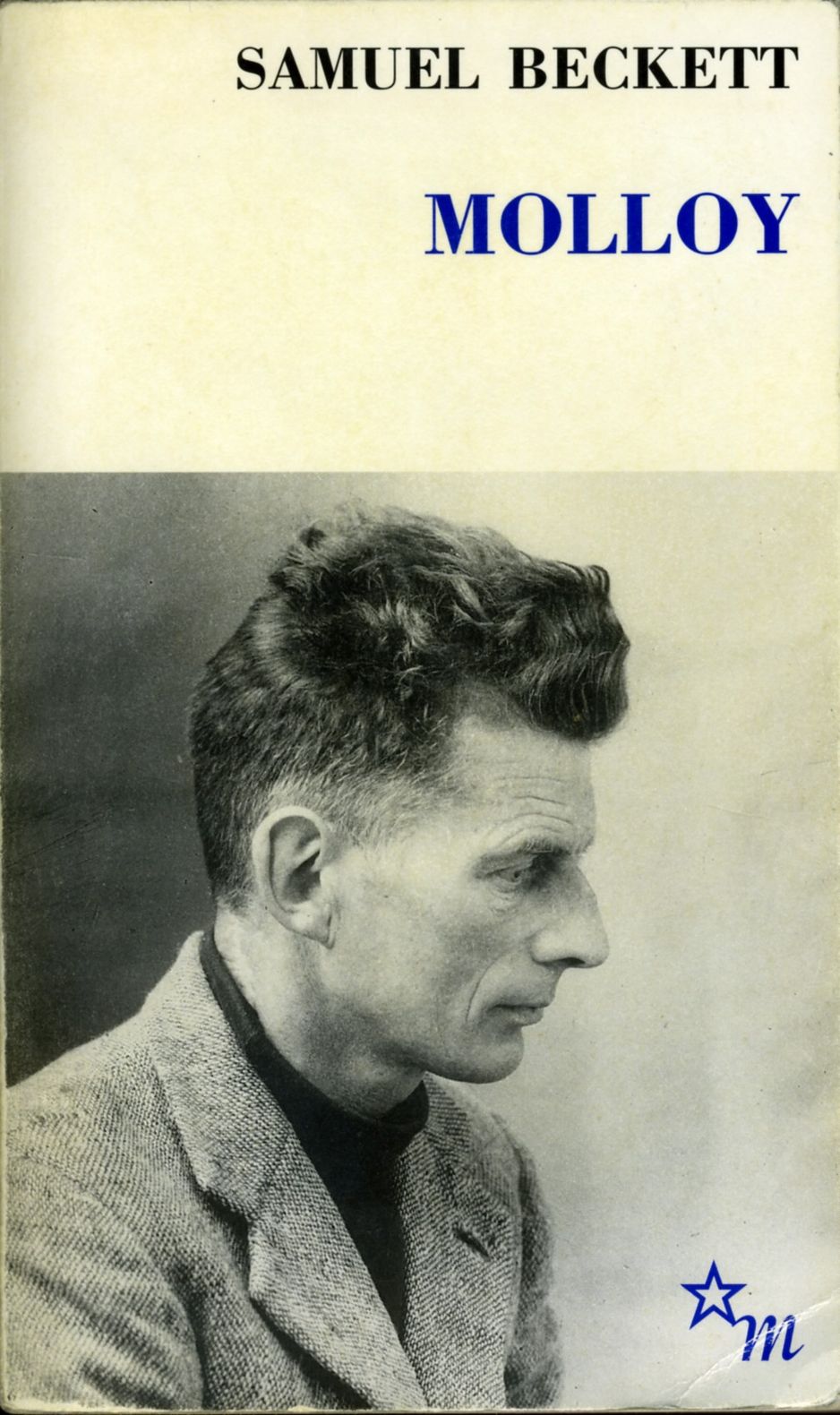>
Critique de Creisifiction
Si pour une raison improbable, dans un futur tout aussi incertain, il ne faudrait en tout et pour tout retenir qu'une poignée d'auteurs parmi tous les écrivains terriens du XXe siècle, Samuel Beckett devrait à juste titre, et en ferait à moins avis certainement partie! Car en matière de, en termes pour ainsi dire…de Beckett, il n'y a que…Beckett! Inutile de vouloir écrire comme lui, ou de chercher à imiter son génie. Roses are red. Violets are blue. And Beckett is Beckett!
Personne à mon sens n'aura réussi - ni réussira jamais - à déshabiller comme lui l'écriture, à mettre à nu la langue aussi radicalement, avec autant d'impudeur et innocence, de clarté et rigueur («serio et candide», dira Molloy..). Non pas afin de la soumettre et de la resculpter, ainsi que le feraient un Joyce ou un Nabokov, par exemple, mais pour la contempler simplement s'en aller, toute dévêtue et désossée, libre et sans artifices, belle et sans soubresauts.
Beckett s'est forgé en tant qu'écrivain à partir de ce constat essentiel que tout langage provient d'une fissure «incolmatable», consubstantielle à son émergence. Faille que le discours, toujours dans un équilibre précaire, ne cessera de vouloir transposer, combler, déplacer, commuer. «Tout langage n'est qu'écart de langage», s'exclame Morlan (ou serait-ce Molloy? ou Molloy rapporté par Morlan? peut-être Beckett au-travers de Morlan? Beckett, cité par Molloy, via Morlan?).
Évanescents et interchangeables, figures fantomatiques d'un discours erratique que paradoxalement, en artisan surdoué, Beckett reconstitue avec une grande simplicité et avec la précision millimétrique d'un horloger, ses personnages s'emploient en vain à raconter une histoire dont ils sont systématiquement dépossédés en tant que sujet. N'ayant dès lors plus aucune preuve solide du bien-fondé, ni aucune certitude de la consistance de leur récit, voire de leur propre consistance en tant que narrateurs, ils s'accrocheront néanmoins inlassablement aux promesses coulantes du verbe, comme l'âne à la carotte, afin d'essayer d'en rendre compte et de garder tant soit peu la tête hors de l'eau.
«Enarro ergo sum» ? Mais quand je me raconte, je n'y suis plus tout à fait! Y serai-je par contre, lorsque «oublié d'être» j'arrêterais tout simplement de vouloir me raconter?
«Et quand je dis je me disais, etc., je veux dire que je savais confusément qu'il en était ainsi, sans savoir exactement de quoi il retournait. Et chaque fois que je dis, Je me disais telle ou telle chose, ou que je parle d'une voix interne me disant, Molloy, et puis une belle phrase plus ou moins claire et simple, ou que je me trouve dans l'obligation de prêter aux tiers des paroles intelligibles, ou qu'à l'intention d'autrui il sort de ma propre bouche des sons articulés à peu près convenablement, je ne fais que me plier aux exigences d'une convention qui veut qu'on mente ou qu'on se taise.»
L'absurde et les paradoxes du discours qui, à défaut de mentir ou de se taire, ne peut en fin compte que se mordre la queue, ne seront cependant pas source de folie ou de désespoir chez Beckett. L'écrivain n'a visiblement rien d'un existentialiste dans l'âme – d'autres pensent le contraire, qu'importe, les contradictions dans les différentes lectures de son oeuvre sont omniprésentes et toujours bienvenues! L'on peut malgré tout lire dans MOLLOY : «Mais même à Sisyphe je ne pense pas qu'il soit imposé de se gratter, ou de gémir, ou d'exulter, à en croire une doctrine en vogue, toujours aux mêmes endroits exactement».
L'écrivain irlandais le plus français de tous temps (l'essentiel de son oeuvre, après 1947, sera écrit en français) y prônerait une forme plutôt d'"inexistentialisme", me semble-t-il en tout cas, dans lequel la quête de sens ou d'un maître-mot (ou d'un mot-maître) rédempteur («Godot», soit dit au passage, sera ici incarné par «Youdi», le «patron» jamais rencontré et commanditaire de l'enquête que fera Morlan à propos de Molloy), ou bien l'attente toujours différée de quelque chose, d'un évenement n'arrivant en fin de compte jamais, pourraient dans le meilleur des cas se voir remplacer par une sorte donc d' «oubli d'être» ou par un sentiment d'aise à se voir «récidiver sans fin».
Mais ne serait-on pas, subrepticement, en train de glisser vers la notion aussi antique que chimérique de «grâce» ? Vers ces domaines de l'expérience subjective qui, dépassant les règles du logos et les limites de l'expression verbale, sont susceptibles de rendre le sujet indifférent au fait même de «se posséder» en tant que tel, pour se fondre dans un Tout? Beckett, visionnaire et mystique ??!!
Pas si simple que ça, il me semble…! À ce propos d'ailleurs, l'on raconte que l'auteur aurait suggéré la lecture d'un philosophe flamand du XVIIe siècle, assez méconnu, Arnold Geulincx, à un critique littéraire qui lui avait demandé comment approcher sa conception «beckettienne» de l'homme et le sens global de son oeuvre. Geulincx fut apparemment le chantre de l'«occasionnalisme», doctrine philosophique qui, à l'opposé du matérialisme, affirmait que les causes naturelles n'étaient qu'«occasionnelles», qu'il n'existait aucune relation de cause-à-effet véritable, mais seulement une relation de «succession» : pas de relation de causalité effective entre les phénomènes, aucune "harmonie préétablie" dans la Nature. Ou, pour dire les choses autrement, et plus simplement, Dieu serait en train de revoir et de renouveler à chaque instant la totalité de la Création!! (Les notes de lecture de Beckett sur les oeuvres d'Arnold Geulincx ont fait l'objet d'une publication en français – « NOTES DE BECKETT SUR GEULINCX » - Préface de Nicolas Doutey - collection « Expériences Philosophiques », Les Solitaires Intempestifs.)
Ainsi Molloy, dont les mésaventures sur le chemin censé le ramener au giron maternel l'avaient réduit à la portion congrue de l'être, physiquement et moralement, dira à propos du tarabiscoté philosophe au moment où il réalise être dans l'incapacité d'y parvenir par ses propres moyens : «Moi j'avais aimé l'image de ce vieux Geulincx, mort jeune, qui m'accordait la liberté, sur le noir navire d'Ulysse, de me couler vers le levant, sur le pont. C'est une grande liberté pour qui n'a pas l'âme des pionniers. Et sur la poupe, penché sur le flot, esclave tristement hilare, je regarde l'orgueilleux et inutile sillon. Qui, ne m'éloignant d'aucune patrie, ne m'emporte vers nul naufrage».
En revanche, si le roman de MOLLOY ne s'ouvre pas sur un «Aujourd'hui, maman est morte… », il nous y ramène implicitement, à rebours, lorsqu'on lit son incipit: «Je suis dans la chambre de ma mère. C'est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé», puis, surtout lorsque s'y rajouteront quelques lignes après : «Je ne sais pas grand 'chose, franchement. La mort de ma mère par exemple. Était-elle déjà morte à mon arrivée ? Ou n'est-elle morte que plus tard ? Je veux dire morte à enterrer. Je ne sais pas. Peut-être ne l'a-t-on pas enterrée encore.»
Dix ans après la publication de L'Étranger, l'anti-matière littéraire de Beckett s'introduirait à son tour discrètement dans l'espace français, en attendant que Godot vienne quelques années après l'inscrire définitivement dans le patrimoine mondial de la littérature du XXe siècle. Éloigné comme Camus, de la «mère-patrie», et en ce qui le concerne, lui, de sa «langue maternelle» aussi, Beckett n'inviterait pourtant le lecteur, ni au désert, ni à l'enfer, mais à un hors-piste littéraire en haute-montagne, d'où l'on peut contempler sereinement le Vide au fond de toute existence et dessiner un paysage sur fond de finitude et d'incomplétude avec humour et poésie.
Personne à mon sens n'aura réussi - ni réussira jamais - à déshabiller comme lui l'écriture, à mettre à nu la langue aussi radicalement, avec autant d'impudeur et innocence, de clarté et rigueur («serio et candide», dira Molloy..). Non pas afin de la soumettre et de la resculpter, ainsi que le feraient un Joyce ou un Nabokov, par exemple, mais pour la contempler simplement s'en aller, toute dévêtue et désossée, libre et sans artifices, belle et sans soubresauts.
Beckett s'est forgé en tant qu'écrivain à partir de ce constat essentiel que tout langage provient d'une fissure «incolmatable», consubstantielle à son émergence. Faille que le discours, toujours dans un équilibre précaire, ne cessera de vouloir transposer, combler, déplacer, commuer. «Tout langage n'est qu'écart de langage», s'exclame Morlan (ou serait-ce Molloy? ou Molloy rapporté par Morlan? peut-être Beckett au-travers de Morlan? Beckett, cité par Molloy, via Morlan?).
Évanescents et interchangeables, figures fantomatiques d'un discours erratique que paradoxalement, en artisan surdoué, Beckett reconstitue avec une grande simplicité et avec la précision millimétrique d'un horloger, ses personnages s'emploient en vain à raconter une histoire dont ils sont systématiquement dépossédés en tant que sujet. N'ayant dès lors plus aucune preuve solide du bien-fondé, ni aucune certitude de la consistance de leur récit, voire de leur propre consistance en tant que narrateurs, ils s'accrocheront néanmoins inlassablement aux promesses coulantes du verbe, comme l'âne à la carotte, afin d'essayer d'en rendre compte et de garder tant soit peu la tête hors de l'eau.
«Enarro ergo sum» ? Mais quand je me raconte, je n'y suis plus tout à fait! Y serai-je par contre, lorsque «oublié d'être» j'arrêterais tout simplement de vouloir me raconter?
«Et quand je dis je me disais, etc., je veux dire que je savais confusément qu'il en était ainsi, sans savoir exactement de quoi il retournait. Et chaque fois que je dis, Je me disais telle ou telle chose, ou que je parle d'une voix interne me disant, Molloy, et puis une belle phrase plus ou moins claire et simple, ou que je me trouve dans l'obligation de prêter aux tiers des paroles intelligibles, ou qu'à l'intention d'autrui il sort de ma propre bouche des sons articulés à peu près convenablement, je ne fais que me plier aux exigences d'une convention qui veut qu'on mente ou qu'on se taise.»
L'absurde et les paradoxes du discours qui, à défaut de mentir ou de se taire, ne peut en fin compte que se mordre la queue, ne seront cependant pas source de folie ou de désespoir chez Beckett. L'écrivain n'a visiblement rien d'un existentialiste dans l'âme – d'autres pensent le contraire, qu'importe, les contradictions dans les différentes lectures de son oeuvre sont omniprésentes et toujours bienvenues! L'on peut malgré tout lire dans MOLLOY : «Mais même à Sisyphe je ne pense pas qu'il soit imposé de se gratter, ou de gémir, ou d'exulter, à en croire une doctrine en vogue, toujours aux mêmes endroits exactement».
L'écrivain irlandais le plus français de tous temps (l'essentiel de son oeuvre, après 1947, sera écrit en français) y prônerait une forme plutôt d'"inexistentialisme", me semble-t-il en tout cas, dans lequel la quête de sens ou d'un maître-mot (ou d'un mot-maître) rédempteur («Godot», soit dit au passage, sera ici incarné par «Youdi», le «patron» jamais rencontré et commanditaire de l'enquête que fera Morlan à propos de Molloy), ou bien l'attente toujours différée de quelque chose, d'un évenement n'arrivant en fin de compte jamais, pourraient dans le meilleur des cas se voir remplacer par une sorte donc d' «oubli d'être» ou par un sentiment d'aise à se voir «récidiver sans fin».
Mais ne serait-on pas, subrepticement, en train de glisser vers la notion aussi antique que chimérique de «grâce» ? Vers ces domaines de l'expérience subjective qui, dépassant les règles du logos et les limites de l'expression verbale, sont susceptibles de rendre le sujet indifférent au fait même de «se posséder» en tant que tel, pour se fondre dans un Tout? Beckett, visionnaire et mystique ??!!
Pas si simple que ça, il me semble…! À ce propos d'ailleurs, l'on raconte que l'auteur aurait suggéré la lecture d'un philosophe flamand du XVIIe siècle, assez méconnu, Arnold Geulincx, à un critique littéraire qui lui avait demandé comment approcher sa conception «beckettienne» de l'homme et le sens global de son oeuvre. Geulincx fut apparemment le chantre de l'«occasionnalisme», doctrine philosophique qui, à l'opposé du matérialisme, affirmait que les causes naturelles n'étaient qu'«occasionnelles», qu'il n'existait aucune relation de cause-à-effet véritable, mais seulement une relation de «succession» : pas de relation de causalité effective entre les phénomènes, aucune "harmonie préétablie" dans la Nature. Ou, pour dire les choses autrement, et plus simplement, Dieu serait en train de revoir et de renouveler à chaque instant la totalité de la Création!! (Les notes de lecture de Beckett sur les oeuvres d'Arnold Geulincx ont fait l'objet d'une publication en français – « NOTES DE BECKETT SUR GEULINCX » - Préface de Nicolas Doutey - collection « Expériences Philosophiques », Les Solitaires Intempestifs.)
Ainsi Molloy, dont les mésaventures sur le chemin censé le ramener au giron maternel l'avaient réduit à la portion congrue de l'être, physiquement et moralement, dira à propos du tarabiscoté philosophe au moment où il réalise être dans l'incapacité d'y parvenir par ses propres moyens : «Moi j'avais aimé l'image de ce vieux Geulincx, mort jeune, qui m'accordait la liberté, sur le noir navire d'Ulysse, de me couler vers le levant, sur le pont. C'est une grande liberté pour qui n'a pas l'âme des pionniers. Et sur la poupe, penché sur le flot, esclave tristement hilare, je regarde l'orgueilleux et inutile sillon. Qui, ne m'éloignant d'aucune patrie, ne m'emporte vers nul naufrage».
En revanche, si le roman de MOLLOY ne s'ouvre pas sur un «Aujourd'hui, maman est morte… », il nous y ramène implicitement, à rebours, lorsqu'on lit son incipit: «Je suis dans la chambre de ma mère. C'est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé», puis, surtout lorsque s'y rajouteront quelques lignes après : «Je ne sais pas grand 'chose, franchement. La mort de ma mère par exemple. Était-elle déjà morte à mon arrivée ? Ou n'est-elle morte que plus tard ? Je veux dire morte à enterrer. Je ne sais pas. Peut-être ne l'a-t-on pas enterrée encore.»
Dix ans après la publication de L'Étranger, l'anti-matière littéraire de Beckett s'introduirait à son tour discrètement dans l'espace français, en attendant que Godot vienne quelques années après l'inscrire définitivement dans le patrimoine mondial de la littérature du XXe siècle. Éloigné comme Camus, de la «mère-patrie», et en ce qui le concerne, lui, de sa «langue maternelle» aussi, Beckett n'inviterait pourtant le lecteur, ni au désert, ni à l'enfer, mais à un hors-piste littéraire en haute-montagne, d'où l'on peut contempler sereinement le Vide au fond de toute existence et dessiner un paysage sur fond de finitude et d'incomplétude avec humour et poésie.