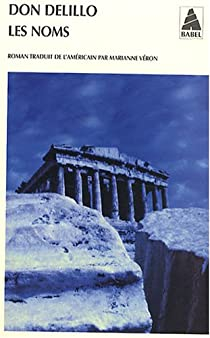>
Critique de Creisifiction
On pourrait dire, en paraphrasant «Papa» Ernest, que l'atmosphère dépeinte par Don DeLillo au sein de ce groupe d'expatriés américains installés à Athènes, à l'aube de années 1980, n'a rien à proprement parler d'une «fête»… «Les Américains avaient l'habitude de venir dans des endroits comme celui-ci pour écrire, peindre et étudier, pour trouver des textures plus profondes. Maintenant, nous faisons des affaires.»
Cadres de filiales de multinationales de l'assurance ou de la finance pour le Proche-Orient et l'Inde, basés à Athènes, travaillant à la sauvegarde des intérêts économiques et géopolitiques américains, et notamment à l'évaluation des risques et à la sécurisation matérielle des citoyens et des sites industriels américains dans les zones les plus sensibles de la planète, ce groupe d'expatriés, selon James Axton, personnage central et narrateur du roman, était emblématique d'«une sous-culture d'hommes d'affaires en transit, vieillissant dans les avions et les aéroports», se retrouvant sporadiquement à Athènes, autour d'une table au restaurant, entre deux missions en Afghanistan ou en Inde, ou bien chez les uns ou chez les autres, lors de soirées bien arrosées durant lesquelles «nous nous disions où il fallait signer un document pour boire un verre, où l'on ne pouvait pas manger de viande le mercredi ou le jeudi, où il fallait esquiver un homme accompagné d'un cobra en sortant de l'hôtel, où s'appliquait la loi martiale, où se pratiquait la fouille corporelle, la torture systématique, le tir groupé en l'air, à la mitraillette à l'occasion des mariages, l'enlèvement contre rançon des représentants des sociétés industrielles». James Axton en devient ainsi un témoin privilégié, à la fois sujet et chroniqueur du caractère compartimenté et des codes particuliers régissant le fonctionnement en vase clos de ces «étrangers en terre étrangère», programmés «pour jouer au squash et travailler les week-ends», purs produits de la nouvelle vision du monde version 80's ; Axton incarnant en même temps l'écho de cette voix subjective qui s'interroge, face à l'image en miroir renvoyée par son environnement et son époque, sur le sens et l'orientation qu'on voudrait donner à sa vie («Ma vie passe et je n'arrive pas à la maîtriser»).
Avant de se retrouver analyste des risques pour une multinationale des assurances à Athènes, notre homme menait pourtant une vie paisible avec sa femme et son enfant «dans une vielle maison à pignons entre les Montagnes Vertes et les Adirondacks», une existence simple, «se satisfaisant de peu». Rédacteur free-lance, touche-à-tout («brochures, livrets, tracts, cochonneries de toutes sortes pour des industries ou le gouvernement»), il lui arrivait aussi, à l'occasion, de faire le nègre. Un écrivain donc, écrivant cependant pour les autres. Suite à la séparation du couple, sa femme, Kathryn, part s'installer en Grèce, à l'île de Kouros, où elle avait réussi à décrocher un job sur un site archéologique, et emmène avec elle leur enfant, «Tap» (autre écrivain, en herbe cette fois-ci, âgé de 9 ans et nourrissant déjà le projet d'écrire «un roman»…). Grâce au hasard d'une rencontre dans le cadre de ses activités de rédacteur free-lance, Axton s'était vu quelque temps auparavant proposer un poste à Athènes, qu'il finirait donc par accepter pour pouvoir par la suite se rapprocher de sa famille.
A partir de cette trame initiale, assez «lisible», Don DeLillo construit une narration virtuose, à plusieurs étages, ne cessant de se ramifier dans d'autres histoires, récits d'événements parallèles s'ouvrant à leur tour à d'autres niveaux plus complexes de lecture (et par moment assez exigeants aussi vis-à-vis de ses lecteurs), mettant en scène des personnages énigmatiques, habités par d'étranges desseins : des membres d'une mystérieuse secte commettant des meurtres rituels à travers le monde, dictés par des rapprochements entre les noms des victimes et la toponymie des sites où ils sont perpétrés ; Owen Brademas, archéologue passionnée d'épigraphie, parcourant le Proche-Orient , cherchant dans les inscriptions en langues anciennes, gravées sur les pierres provenant de sites et de ruines antiques, à «déchiffrer, découvrir des secrets et relever la géographie du langage, en quelque sorte», ou encore Frank Volterra, cinéaste renommé, amitié de jeunesse d'Axton et de son ex-femme, qui abandonnera un tournage en cours pour suivre les traces de la secte mystérieuse dans les régions montagneuses du Péloponnèse, afin d'en faire un documentaire…
Roman radicalement métonymique et elliptique, où le sens ne cesse de glisser sans jamais se laisser totalement apprivoiser, par certains aspects prémonitoire (sur l'ampleur, par exemple, que les campagnes d'attaque organisées et systématiques contre «l'Empire du Mal» devaient prendre dans les années à venir), dans LES NOMS, Don DeLillo semble avoir en quelque sorte voulu mettre en parallèle les pistes balisées par la mythologie d'une nouvelle puissance américaine globalisée, véhiculée notamment par la doctrine reaganienne, avec cette autre, incarnée ici par les paysages arides de la Grèce et les contrées désertiques du Proche-Orient, cette puissance archétypique et indomptable, indéchiffrable qui continue, malgré tout le soin mis par le nouvel ordre néo-libéral à tenter de la circonscrire et, dans certains cas, de la chiffrer, à y survivre, prête à refaire surface à tout moment, se refusant à toute emprise purement rationnelle, à toute reconnaissance «soumise au [seul] scrutin conscient». L'auteur ne ménagera pas les effets de sidération et de folie qui résulteront d'une telle confrontation chez certains de ses personnages, et son lecteur non plus: DeLillo, lui, n'écrit pas pour les autres, il ne s'adresse pas en tout cas à notre besoin viscéral de certitudes, à cette part hargneuse en nous qui réclame son dû aux conteurs à qui elle prête oreille: des noms, des révélations, des conclusions! Il s'adresse avant tout à notre soif de contemplation subjective du monde et de ses mystères, à notre intelligence intime la plus précieuse et la plus fragile, celle qui s'applique à réfléchir à une forme possible d'habiter la réalité de manière unique et individuée (sans devenir pour autant purement individualiste comme semble nous y inviter notre époque) ; à cette part d'imaginaire, enfin, qui nous évitera, dans le meilleur des cas, de nous conformer, au-delà du strictement nécessaire, aux faux-semblants et aux critères tendus par l'urgence du présent. L'écrivain, nous dit Don DeLillo par la bouche de l'un de ses personnages, «en ce siècle, entretient une conversation avec la folie», le conduisant à procéder à «une distillation finale du soi, à une mise au point définitive» et à «l'extinction des voix fausses». LES NOMS semble justement constituer une métaphore de cette dissolution du sens qui marque notre modernité -ou faudrait-il plutôt dire, notre postmodernité?
«Postmodernité» : voilà une notion répandue dans différents domaines (politique, sociétal, économique, artistique, philosophique, architectural, dans la mode, etc..) et s'appliquant à caractériser notre époque. Elle semble également avoir été intégrée dans le langage courant -plutôt branché («oh-là-là, j'adooore ton look postmoderne !»), si bien qu'on peut légitimement se demander si elle ne se serait pas quelque peu galvaudée, à être utilisée ainsi à tous bouts de champs, de manière aussi vague et aléatoire… A l'origine, pourtant, cette expression avait été créée pour qualifier des phénomènes précis, à savoir la désagrégation progressive des modes de régulation sociale et économique, ou encore la déconstruction de certains courants de pensées et systèmes de valeurs emblématiques de la modernité forgée par le XXème siècle. Ainsi, en devenant postmodernes, ne serions-nous pas, pour autant, devenus encore-plus-modernes-que-les-modernes , ni plus novateurs que ne le fut le XXème siècle (ce dernier terme à ne pas confondre, bien sûr, avec le grand nombre d'innovations technologiques proposées à la pelle de nos jours). Les critères de la «modernité» n'étant plus opérants pour appréhender et/ou transformer le monde contemporain, la condition de postmodernité semblerait dès lors correspondre davantage à quelque chose de subi, qu'à une véritable révolution, celle-ci fleurerait, pour ainsi dire, davantage la décomposition que la fraicheur d'un nouveau parfum, marquerait moins l'avènement de nouvelles certitudes ou la promesse d'un bonheur inouï, qu'une perte de repères progressive et, d'ailleurs, à mesure que les années avancent, soit dit au passage, de plus en plus anxiogène. La postmodernité déconstruirait davantage qu'elle ne construit; plutôt que de créer du nouveau, elle fragmenterait, empilerait, superposerait et remixerait; le rétro-futurisme, l'afro-celtique, le cyber-gothique ou le trash-musette, par exemple, en seraient, parmi de tonnes d'autres courants et modes dits «postmodernes», de coquettes illustrations de ce manque cruel de véritables et solides perspectives nouvelles… !
La critique de la postmodernité, en tout cas depuis cet angle de vision, semble occuper une place centrale dans l'oeuvre de Don DeLillo. Echec des utopies collectives, fragmentation des identités, instrumentalisation des savoirs, repli sur soi et individualisme prononcé, ravages divers, individuels et collectifs, provoqués par le néo-libéralisme économique, en sont quelques-uns de ses ingrédients principaux, présents dès son coup de génie inaugural, «Americana», premier roman explosif de l'auteur, publié en 1972. DeLillo s'est depuis inscrit en digne héritier de cette célèbre lignée d'écrivains américains ayant aspiré à faire une radioscopie panoramique de la culture américaine, de ses grands fantasmes et ses pires démons, afin de réaliser ce qu'on a pris l'habitude de nommer le «grand roman américain» d'une époque.
LES NOMS ne semble pas, néanmoins, une lecture qui pourrait plaire facilement ou de manière consensuelle une majorité de lecteurs. du fait du développement non-linéaire et fragmenté de son intrigue, en raison du choix volontaire de l'auteur de ne pas donner des réponses fermes et unilatérales aux questions qu'elle soulève, ou de l'enfermer dans un dénouement à sens unique, ou enfin de ses différentes strates et niveaux de lecture, susceptibles d'égarer par moments les lecteurs les plus aguerris, il devient quasiment impossible d'embrasser d'un seul coup, d'un seul et unique regard toute la richesse d'évocation de ce roman et toutes les subtilités de sa construction (de surcroît, une traduction, certes pas simple à la base, mais qui en l'occurrence ne semble pas tout le temps à la hauteur, n'est pas là pour faciliter la tâche au lecteur…). Une oeuvre malgré tout fascinante. Un grand roman de mon point de vue, sans l'ombre d'un doute, qu'on savourera et appréciera peut-être mieux et davantage après lecture, quand l'on aura refermé et dépassé une certaine frustration de ne pas avoir eu toutes les réponses aux énigmes surprenantes qu'il nous avait assénées au départ; un peu d'ailleurs comme son personnage central, James Axton, quand, le temps ayant passé et la parenthèse grecque étant définitivement close, ce dernier, évoquant le souvenir des compatriotes qu'il avait côtoyés à Athènes, déclarera : «Ils font partie des gens que j'ai essayé de connaître deux fois, la seconde fois par la mémoire et le langage. Et à travers eux, moi-même. Ils sont ce que je suis devenu, par des chemins que je ne comprends pas mais qui, à mon avis, aboutiront à une vérité circulaire, une seconde vie pour moi aussi bien que pour eux».
Cadres de filiales de multinationales de l'assurance ou de la finance pour le Proche-Orient et l'Inde, basés à Athènes, travaillant à la sauvegarde des intérêts économiques et géopolitiques américains, et notamment à l'évaluation des risques et à la sécurisation matérielle des citoyens et des sites industriels américains dans les zones les plus sensibles de la planète, ce groupe d'expatriés, selon James Axton, personnage central et narrateur du roman, était emblématique d'«une sous-culture d'hommes d'affaires en transit, vieillissant dans les avions et les aéroports», se retrouvant sporadiquement à Athènes, autour d'une table au restaurant, entre deux missions en Afghanistan ou en Inde, ou bien chez les uns ou chez les autres, lors de soirées bien arrosées durant lesquelles «nous nous disions où il fallait signer un document pour boire un verre, où l'on ne pouvait pas manger de viande le mercredi ou le jeudi, où il fallait esquiver un homme accompagné d'un cobra en sortant de l'hôtel, où s'appliquait la loi martiale, où se pratiquait la fouille corporelle, la torture systématique, le tir groupé en l'air, à la mitraillette à l'occasion des mariages, l'enlèvement contre rançon des représentants des sociétés industrielles». James Axton en devient ainsi un témoin privilégié, à la fois sujet et chroniqueur du caractère compartimenté et des codes particuliers régissant le fonctionnement en vase clos de ces «étrangers en terre étrangère», programmés «pour jouer au squash et travailler les week-ends», purs produits de la nouvelle vision du monde version 80's ; Axton incarnant en même temps l'écho de cette voix subjective qui s'interroge, face à l'image en miroir renvoyée par son environnement et son époque, sur le sens et l'orientation qu'on voudrait donner à sa vie («Ma vie passe et je n'arrive pas à la maîtriser»).
Avant de se retrouver analyste des risques pour une multinationale des assurances à Athènes, notre homme menait pourtant une vie paisible avec sa femme et son enfant «dans une vielle maison à pignons entre les Montagnes Vertes et les Adirondacks», une existence simple, «se satisfaisant de peu». Rédacteur free-lance, touche-à-tout («brochures, livrets, tracts, cochonneries de toutes sortes pour des industries ou le gouvernement»), il lui arrivait aussi, à l'occasion, de faire le nègre. Un écrivain donc, écrivant cependant pour les autres. Suite à la séparation du couple, sa femme, Kathryn, part s'installer en Grèce, à l'île de Kouros, où elle avait réussi à décrocher un job sur un site archéologique, et emmène avec elle leur enfant, «Tap» (autre écrivain, en herbe cette fois-ci, âgé de 9 ans et nourrissant déjà le projet d'écrire «un roman»…). Grâce au hasard d'une rencontre dans le cadre de ses activités de rédacteur free-lance, Axton s'était vu quelque temps auparavant proposer un poste à Athènes, qu'il finirait donc par accepter pour pouvoir par la suite se rapprocher de sa famille.
A partir de cette trame initiale, assez «lisible», Don DeLillo construit une narration virtuose, à plusieurs étages, ne cessant de se ramifier dans d'autres histoires, récits d'événements parallèles s'ouvrant à leur tour à d'autres niveaux plus complexes de lecture (et par moment assez exigeants aussi vis-à-vis de ses lecteurs), mettant en scène des personnages énigmatiques, habités par d'étranges desseins : des membres d'une mystérieuse secte commettant des meurtres rituels à travers le monde, dictés par des rapprochements entre les noms des victimes et la toponymie des sites où ils sont perpétrés ; Owen Brademas, archéologue passionnée d'épigraphie, parcourant le Proche-Orient , cherchant dans les inscriptions en langues anciennes, gravées sur les pierres provenant de sites et de ruines antiques, à «déchiffrer, découvrir des secrets et relever la géographie du langage, en quelque sorte», ou encore Frank Volterra, cinéaste renommé, amitié de jeunesse d'Axton et de son ex-femme, qui abandonnera un tournage en cours pour suivre les traces de la secte mystérieuse dans les régions montagneuses du Péloponnèse, afin d'en faire un documentaire…
Roman radicalement métonymique et elliptique, où le sens ne cesse de glisser sans jamais se laisser totalement apprivoiser, par certains aspects prémonitoire (sur l'ampleur, par exemple, que les campagnes d'attaque organisées et systématiques contre «l'Empire du Mal» devaient prendre dans les années à venir), dans LES NOMS, Don DeLillo semble avoir en quelque sorte voulu mettre en parallèle les pistes balisées par la mythologie d'une nouvelle puissance américaine globalisée, véhiculée notamment par la doctrine reaganienne, avec cette autre, incarnée ici par les paysages arides de la Grèce et les contrées désertiques du Proche-Orient, cette puissance archétypique et indomptable, indéchiffrable qui continue, malgré tout le soin mis par le nouvel ordre néo-libéral à tenter de la circonscrire et, dans certains cas, de la chiffrer, à y survivre, prête à refaire surface à tout moment, se refusant à toute emprise purement rationnelle, à toute reconnaissance «soumise au [seul] scrutin conscient». L'auteur ne ménagera pas les effets de sidération et de folie qui résulteront d'une telle confrontation chez certains de ses personnages, et son lecteur non plus: DeLillo, lui, n'écrit pas pour les autres, il ne s'adresse pas en tout cas à notre besoin viscéral de certitudes, à cette part hargneuse en nous qui réclame son dû aux conteurs à qui elle prête oreille: des noms, des révélations, des conclusions! Il s'adresse avant tout à notre soif de contemplation subjective du monde et de ses mystères, à notre intelligence intime la plus précieuse et la plus fragile, celle qui s'applique à réfléchir à une forme possible d'habiter la réalité de manière unique et individuée (sans devenir pour autant purement individualiste comme semble nous y inviter notre époque) ; à cette part d'imaginaire, enfin, qui nous évitera, dans le meilleur des cas, de nous conformer, au-delà du strictement nécessaire, aux faux-semblants et aux critères tendus par l'urgence du présent. L'écrivain, nous dit Don DeLillo par la bouche de l'un de ses personnages, «en ce siècle, entretient une conversation avec la folie», le conduisant à procéder à «une distillation finale du soi, à une mise au point définitive» et à «l'extinction des voix fausses». LES NOMS semble justement constituer une métaphore de cette dissolution du sens qui marque notre modernité -ou faudrait-il plutôt dire, notre postmodernité?
«Postmodernité» : voilà une notion répandue dans différents domaines (politique, sociétal, économique, artistique, philosophique, architectural, dans la mode, etc..) et s'appliquant à caractériser notre époque. Elle semble également avoir été intégrée dans le langage courant -plutôt branché («oh-là-là, j'adooore ton look postmoderne !»), si bien qu'on peut légitimement se demander si elle ne se serait pas quelque peu galvaudée, à être utilisée ainsi à tous bouts de champs, de manière aussi vague et aléatoire… A l'origine, pourtant, cette expression avait été créée pour qualifier des phénomènes précis, à savoir la désagrégation progressive des modes de régulation sociale et économique, ou encore la déconstruction de certains courants de pensées et systèmes de valeurs emblématiques de la modernité forgée par le XXème siècle. Ainsi, en devenant postmodernes, ne serions-nous pas, pour autant, devenus encore-plus-modernes-que-les-modernes , ni plus novateurs que ne le fut le XXème siècle (ce dernier terme à ne pas confondre, bien sûr, avec le grand nombre d'innovations technologiques proposées à la pelle de nos jours). Les critères de la «modernité» n'étant plus opérants pour appréhender et/ou transformer le monde contemporain, la condition de postmodernité semblerait dès lors correspondre davantage à quelque chose de subi, qu'à une véritable révolution, celle-ci fleurerait, pour ainsi dire, davantage la décomposition que la fraicheur d'un nouveau parfum, marquerait moins l'avènement de nouvelles certitudes ou la promesse d'un bonheur inouï, qu'une perte de repères progressive et, d'ailleurs, à mesure que les années avancent, soit dit au passage, de plus en plus anxiogène. La postmodernité déconstruirait davantage qu'elle ne construit; plutôt que de créer du nouveau, elle fragmenterait, empilerait, superposerait et remixerait; le rétro-futurisme, l'afro-celtique, le cyber-gothique ou le trash-musette, par exemple, en seraient, parmi de tonnes d'autres courants et modes dits «postmodernes», de coquettes illustrations de ce manque cruel de véritables et solides perspectives nouvelles… !
La critique de la postmodernité, en tout cas depuis cet angle de vision, semble occuper une place centrale dans l'oeuvre de Don DeLillo. Echec des utopies collectives, fragmentation des identités, instrumentalisation des savoirs, repli sur soi et individualisme prononcé, ravages divers, individuels et collectifs, provoqués par le néo-libéralisme économique, en sont quelques-uns de ses ingrédients principaux, présents dès son coup de génie inaugural, «Americana», premier roman explosif de l'auteur, publié en 1972. DeLillo s'est depuis inscrit en digne héritier de cette célèbre lignée d'écrivains américains ayant aspiré à faire une radioscopie panoramique de la culture américaine, de ses grands fantasmes et ses pires démons, afin de réaliser ce qu'on a pris l'habitude de nommer le «grand roman américain» d'une époque.
LES NOMS ne semble pas, néanmoins, une lecture qui pourrait plaire facilement ou de manière consensuelle une majorité de lecteurs. du fait du développement non-linéaire et fragmenté de son intrigue, en raison du choix volontaire de l'auteur de ne pas donner des réponses fermes et unilatérales aux questions qu'elle soulève, ou de l'enfermer dans un dénouement à sens unique, ou enfin de ses différentes strates et niveaux de lecture, susceptibles d'égarer par moments les lecteurs les plus aguerris, il devient quasiment impossible d'embrasser d'un seul coup, d'un seul et unique regard toute la richesse d'évocation de ce roman et toutes les subtilités de sa construction (de surcroît, une traduction, certes pas simple à la base, mais qui en l'occurrence ne semble pas tout le temps à la hauteur, n'est pas là pour faciliter la tâche au lecteur…). Une oeuvre malgré tout fascinante. Un grand roman de mon point de vue, sans l'ombre d'un doute, qu'on savourera et appréciera peut-être mieux et davantage après lecture, quand l'on aura refermé et dépassé une certaine frustration de ne pas avoir eu toutes les réponses aux énigmes surprenantes qu'il nous avait assénées au départ; un peu d'ailleurs comme son personnage central, James Axton, quand, le temps ayant passé et la parenthèse grecque étant définitivement close, ce dernier, évoquant le souvenir des compatriotes qu'il avait côtoyés à Athènes, déclarera : «Ils font partie des gens que j'ai essayé de connaître deux fois, la seconde fois par la mémoire et le langage. Et à travers eux, moi-même. Ils sont ce que je suis devenu, par des chemins que je ne comprends pas mais qui, à mon avis, aboutiront à une vérité circulaire, une seconde vie pour moi aussi bien que pour eux».