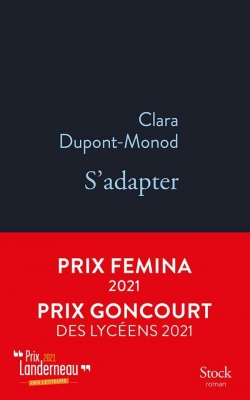>
Si les murs ont des oreilles, « les pierres rousses de la cour » de cette maison cévenole, quant à elles, prennent la parole pour raconter la vie d'une famille dont elles sont témoins. Mais par gratitude, elles s'intéressent aux enfants, « les seuls à les prendre pour jouets », une fratrie de trois.
Clara Dupont-Monod entre dans le vif du sujet dès la première phrase. « Un jour est né un bébé inadapté ». Après une description de l'environnement, elle détaille comment la mère a décelé les premiers signes, seulement après trois mois. le diagnostic provoque un tsunami chez les parents. Les interrogations témoignent de leur détresse : « Pourquoi nous ? ».
Le père convoque ses deux enfants pour les en informer.
Il y a des traditions à Noël, les pierres servent de support aux guirlandes qui accueillent les invités. Dans la montagne, on dépose des bougies pour faciliter l'atterrissage du Père Noël. Des cousines protestantes encouragent à faire preuve de « loyauté, d'endurance et de pudeur ».
On découvre les gestes protecteurs de l'aîné pour cet enfant fragile, différent, puis le rituel qu'il adopte chaque matin, presque un rôle maternel. Cette relation fusionnelle est exemplaire. L'aîné a compris le pouvoir de la nature. Quelle scène bouleversante et lénifiante lors de cette osmose : une fois « le corps déposé avec délicatesse à l'ombre d'un sapin, l'aîné frotte les aiguilles qui libèrent un parfum de citronnelle et les lui passe sous le nez ». « Le monde vient à eux », comme « les libellules turquoise ». Pour l'aîné, « la montagne est accueillante, comme le sont les animaux », elle permet le recul, un pas en arrière du monde ».
On comprend que dans ces lieux montagnards, l'aîné trouve un refuge, qu'il ne sera pas confronté aux regards des autres, ce qui lui épargnera aussi les réflexions cruelles, déplacées, blessantes de personnes qui manquent d'empathie, au point de lui dire : « Pourquoi garder de petits singes ? »
Il est étonnant de plonger dans ses pensées au retour du collège, soucieux du bien-être de « l'amateur du transat », des questions concernant davantage les parents. Ces mêmes inquiétudes l'habitent quand l'enfant est placé dans un établissement tenu par des soeurs, d'autant qu'il lui manque. Devant changer sa routine pour combler le vide de l'absence, il s'investit encore davantage au lycée.
Il se montre aussi protecteur envers sa cadette. Moins consciente de la réalité, cette soeur prend l'enfant pour une poupée, voire une marionnette, elle ne lui manifeste aucune tendresse. Au contraire, elle est souvent en colère , jalouse de cet enfant qui l'isole, l'empêche d'inviter ses amies et la prive d'une relation exclusive avec son aîné avec qui elle aimait « monter vers les drailles ». Une fois elle est même surprise à donner un coup de pied dans les coussins où est étendue « la réplique ratée » de son frère aîné. La honte l'habite. Les narratrices soulignent cette attitude « propre aux humains et aux animaux : la fragilité engendre la brutalité ». Pour la cadette, « l'enfant a pris la joie de ses parents, transformé son enfance, confisqué son frère aîné ». Sa présence encombrante la dégoûte, il est devenu le grain de sable qui a perturbé la cellule familiale.
La cadette, pour qui « la nature est d'une cruelle indifférence », trouve, enfant, du réconfort auprès de sa grand-mère. Elle admire ses dons à reconnaître les « piaillements d'une bergeronnette », à faire la différence entre un néflier et un prunier. Une grand-mère dévouée, qui « lui offre une normalité », lui fait découvrir des paysages grandioses », lui apprend les caractéristiques des arbres et lui raconte sa propre enfance dans les magnaneries, son voyage de noces au Portugal. Ensemble, elles ont confectionné des gaufres à l'orange et nous font saliver comme Florence Herrlemann avec les madeleines de son épistolière Hectorine. En lui offrant un yo-yo, elle lui transmet une leçon de vie : « Car dans la vie, il y a des bas mais ça remonte toujours ».
Le bébé étant aveugle, les odeurs prennent une place primordiale, et l'aîné, pourtant seulement âgé de dix ans, a perçu leurs pouvoirs (ainsi il le caresse avec de la menthe), tout comme il accorde de l'attention aux bruits et au toucher. Ainsi il s'efforce de sensibiliser l'enfant à la pluie.
Il le familiarise avec le contact de la feutrine, des petites branches de chênes, des noisettes ou « la forme cabossée des reinettes »...
La famille fait entrer les sons de la montagne (« La maison résonne du bruit des cascades, des cloches des moutons, des bêlements, d'aboiements de chiens, de cris d'oiseaux, de tonnerre, de cigales » ). de même, on allume la radio.
Très vite est soulevée la pénurie d'établissements capables d'accepter de tels enfants quand ils grandissent, ce qui cause le désarroi des parents. Les pierres narratrices , « gardiennes de la cour », voient les parents partir des journées entières pour « des marathons administratifs ».
En filigrane, l'aîné rend compte du parcours de combattant des parents en général face à ce « no man's land des marges »,pointant la solitude de ces familles, au point de nourrir « une haine inextinguible envers l'administration », toute cette bureaucratie.
Si la cadette, installée à Lisbonne, a mis au monde trois enfants, l'aîné trentenaire, se lie très peu et restera sans enfant. Il aurait été en permanence dévoré par l'angoisse, lui l'intranquille, qui « ne peut aimer que dans l'inquiétude » quand ses neveux et nièces sont là.
C'est seulement aux vacances que la fratrie se retrouve chez les parents.
Après la disparition de l'enfant ,on peut se demander comment le couple va résister à cette douloureuse épreuve. La famille va-t-elle rebondir ou se disloquer ?
Vont-ils envisager de prendre le risque de donner naissance à un autre enfant, comme une « consolation »? Si un petit dernier arrive, comment va-t-il être accepté par ses aînés, d'autant que l'ombre du disparu hante les esprits et le coeur ? Laissons le lecteur découvrir le dernier volet.
La scène de la photo finale, immortalisée par la mère, redonne le sourire et espoir aux parents.
L'empreinte du lieu infuse le récit : « Habiter là, cela voulait dire tolérer le chaos ».
L'aîné se rallie à un proverbe des Cévennes : « il ne fallait pas se révolter ».
La plume de Clara, telle une caméra, scrute les moindres détails des visages, des corps. La force du récit tient à ce que ce soient des pierres,supposées insensibles, qui réussissent à émouvoir autant le lecteur. de plus elles apportent une touche de poésie. Un récit tout en délicatesse, qui engendre l'empathie, ponctué par le verbe « s'adapter », ce que chacun des personnages doit réussir à accomplir. On ne peut qu'être touché par ce que vit, a vécu cette famille anonyme, surtout quand on sait que l'auteure a été elle-même, éprouvée aussi par un tel drame.
L'écrivaine signe un conte intemporel, original du côté des narratrices, qui prend aux tripes.
Il atteint une portée universelle, en s'abstenant de donner des prénoms à ses personnages. Elle met en exergue un amour fraternel intense, hors norme qui connaît des fluctuations et rappelle combien le handicap n'est pas pris en compte de la même manière selon les pays. Ainsi la France accuse du retard. Clara Dupont-Monod explore aussi l'amour au sein d'une fratrie, « cet amour fin,volatil, mystérieux ,reposant sur l'instinct aiguisé d'animal » qui permet d'échanger sans mots ni gestes.
Critique de ninachevalier
Si les murs ont des oreilles, « les pierres rousses de la cour » de cette maison cévenole, quant à elles, prennent la parole pour raconter la vie d'une famille dont elles sont témoins. Mais par gratitude, elles s'intéressent aux enfants, « les seuls à les prendre pour jouets », une fratrie de trois.
Clara Dupont-Monod entre dans le vif du sujet dès la première phrase. « Un jour est né un bébé inadapté ». Après une description de l'environnement, elle détaille comment la mère a décelé les premiers signes, seulement après trois mois. le diagnostic provoque un tsunami chez les parents. Les interrogations témoignent de leur détresse : « Pourquoi nous ? ».
Le père convoque ses deux enfants pour les en informer.
Il y a des traditions à Noël, les pierres servent de support aux guirlandes qui accueillent les invités. Dans la montagne, on dépose des bougies pour faciliter l'atterrissage du Père Noël. Des cousines protestantes encouragent à faire preuve de « loyauté, d'endurance et de pudeur ».
On découvre les gestes protecteurs de l'aîné pour cet enfant fragile, différent, puis le rituel qu'il adopte chaque matin, presque un rôle maternel. Cette relation fusionnelle est exemplaire. L'aîné a compris le pouvoir de la nature. Quelle scène bouleversante et lénifiante lors de cette osmose : une fois « le corps déposé avec délicatesse à l'ombre d'un sapin, l'aîné frotte les aiguilles qui libèrent un parfum de citronnelle et les lui passe sous le nez ». « Le monde vient à eux », comme « les libellules turquoise ». Pour l'aîné, « la montagne est accueillante, comme le sont les animaux », elle permet le recul, un pas en arrière du monde ».
On comprend que dans ces lieux montagnards, l'aîné trouve un refuge, qu'il ne sera pas confronté aux regards des autres, ce qui lui épargnera aussi les réflexions cruelles, déplacées, blessantes de personnes qui manquent d'empathie, au point de lui dire : « Pourquoi garder de petits singes ? »
Il est étonnant de plonger dans ses pensées au retour du collège, soucieux du bien-être de « l'amateur du transat », des questions concernant davantage les parents. Ces mêmes inquiétudes l'habitent quand l'enfant est placé dans un établissement tenu par des soeurs, d'autant qu'il lui manque. Devant changer sa routine pour combler le vide de l'absence, il s'investit encore davantage au lycée.
Il se montre aussi protecteur envers sa cadette. Moins consciente de la réalité, cette soeur prend l'enfant pour une poupée, voire une marionnette, elle ne lui manifeste aucune tendresse. Au contraire, elle est souvent en colère , jalouse de cet enfant qui l'isole, l'empêche d'inviter ses amies et la prive d'une relation exclusive avec son aîné avec qui elle aimait « monter vers les drailles ». Une fois elle est même surprise à donner un coup de pied dans les coussins où est étendue « la réplique ratée » de son frère aîné. La honte l'habite. Les narratrices soulignent cette attitude « propre aux humains et aux animaux : la fragilité engendre la brutalité ». Pour la cadette, « l'enfant a pris la joie de ses parents, transformé son enfance, confisqué son frère aîné ». Sa présence encombrante la dégoûte, il est devenu le grain de sable qui a perturbé la cellule familiale.
La cadette, pour qui « la nature est d'une cruelle indifférence », trouve, enfant, du réconfort auprès de sa grand-mère. Elle admire ses dons à reconnaître les « piaillements d'une bergeronnette », à faire la différence entre un néflier et un prunier. Une grand-mère dévouée, qui « lui offre une normalité », lui fait découvrir des paysages grandioses », lui apprend les caractéristiques des arbres et lui raconte sa propre enfance dans les magnaneries, son voyage de noces au Portugal. Ensemble, elles ont confectionné des gaufres à l'orange et nous font saliver comme Florence Herrlemann avec les madeleines de son épistolière Hectorine. En lui offrant un yo-yo, elle lui transmet une leçon de vie : « Car dans la vie, il y a des bas mais ça remonte toujours ».
Le bébé étant aveugle, les odeurs prennent une place primordiale, et l'aîné, pourtant seulement âgé de dix ans, a perçu leurs pouvoirs (ainsi il le caresse avec de la menthe), tout comme il accorde de l'attention aux bruits et au toucher. Ainsi il s'efforce de sensibiliser l'enfant à la pluie.
Il le familiarise avec le contact de la feutrine, des petites branches de chênes, des noisettes ou « la forme cabossée des reinettes »...
La famille fait entrer les sons de la montagne (« La maison résonne du bruit des cascades, des cloches des moutons, des bêlements, d'aboiements de chiens, de cris d'oiseaux, de tonnerre, de cigales » ). de même, on allume la radio.
Très vite est soulevée la pénurie d'établissements capables d'accepter de tels enfants quand ils grandissent, ce qui cause le désarroi des parents. Les pierres narratrices , « gardiennes de la cour », voient les parents partir des journées entières pour « des marathons administratifs ».
En filigrane, l'aîné rend compte du parcours de combattant des parents en général face à ce « no man's land des marges »,pointant la solitude de ces familles, au point de nourrir « une haine inextinguible envers l'administration », toute cette bureaucratie.
Si la cadette, installée à Lisbonne, a mis au monde trois enfants, l'aîné trentenaire, se lie très peu et restera sans enfant. Il aurait été en permanence dévoré par l'angoisse, lui l'intranquille, qui « ne peut aimer que dans l'inquiétude » quand ses neveux et nièces sont là.
C'est seulement aux vacances que la fratrie se retrouve chez les parents.
Après la disparition de l'enfant ,on peut se demander comment le couple va résister à cette douloureuse épreuve. La famille va-t-elle rebondir ou se disloquer ?
Vont-ils envisager de prendre le risque de donner naissance à un autre enfant, comme une « consolation »? Si un petit dernier arrive, comment va-t-il être accepté par ses aînés, d'autant que l'ombre du disparu hante les esprits et le coeur ? Laissons le lecteur découvrir le dernier volet.
La scène de la photo finale, immortalisée par la mère, redonne le sourire et espoir aux parents.
L'empreinte du lieu infuse le récit : « Habiter là, cela voulait dire tolérer le chaos ».
L'aîné se rallie à un proverbe des Cévennes : « il ne fallait pas se révolter ».
La plume de Clara, telle une caméra, scrute les moindres détails des visages, des corps. La force du récit tient à ce que ce soient des pierres,supposées insensibles, qui réussissent à émouvoir autant le lecteur. de plus elles apportent une touche de poésie. Un récit tout en délicatesse, qui engendre l'empathie, ponctué par le verbe « s'adapter », ce que chacun des personnages doit réussir à accomplir. On ne peut qu'être touché par ce que vit, a vécu cette famille anonyme, surtout quand on sait que l'auteure a été elle-même, éprouvée aussi par un tel drame.
L'écrivaine signe un conte intemporel, original du côté des narratrices, qui prend aux tripes.
Il atteint une portée universelle, en s'abstenant de donner des prénoms à ses personnages. Elle met en exergue un amour fraternel intense, hors norme qui connaît des fluctuations et rappelle combien le handicap n'est pas pris en compte de la même manière selon les pays. Ainsi la France accuse du retard. Clara Dupont-Monod explore aussi l'amour au sein d'une fratrie, « cet amour fin,volatil, mystérieux ,reposant sur l'instinct aiguisé d'animal » qui permet d'échanger sans mots ni gestes.